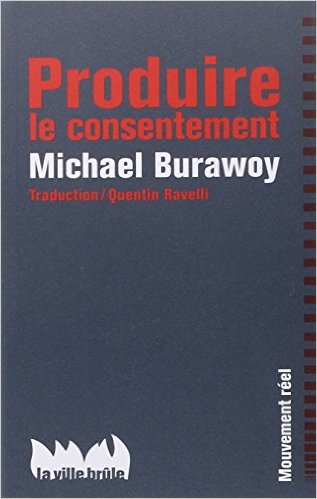
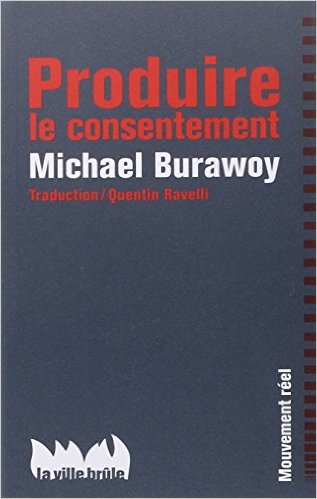
M. Burawoy, Produire le consentement, traduction et préface de Quentin Ravelli, Montreuil, Éditions La Ville Brûle, 2015, 304 p., 25€.
Nous reproduisons ici, avec l’aimable autorisation des éditions La Ville Brûle, un extrait de la 1ère partie du livre de Michael Burawoy.
Les enjeux politiques de la sociologie sont liés à une certaine philosophie de l’histoire, dans laquelle le futur est le fruit du présent et le présent n’est rien d’autre que l’aboutissement du passé. Tout le reste en découle. En se contentant de se saisir des expériences particulières de la société capitaliste pour leur donner un caractère universel, l’imagination sociologique est rivée au présent. En considérant que ce qui existe est naturel, inévitable et fatal, la sociologie n’est pas capable de concevoir un type de société fondamentalement différent dans l’avenir.
Pour concevoir et anticiper quelque chose de « neuf », il faut changer de point de départ, admettre que l’histoire est un processus discontinu et que les sociétés capitalistes ont, avec les sociétés précapitaliste et postcapitaliste, des différences fondamentales que l’on ne peut saisir qu’en les confrontant. Un point de comparaison est donc nécessaire – un ensemble de concepts généraux, applicables universellement. Mais cette applicabilité des concepts doit rester adossée à leur « particularisation » : il n’y a pas de théories générales, mais seulement des concepts généraux et des théories particulières. L’histoire ne s’imprime ni comme une succession de « faits » ni comme l’émergence téléologique du présent ; elle est en fait formée d’une succession discontinue de sociétés particulières. Une distinction est établie entre l’histoire entendue comme ensemble de dynamiques d’une société donnée, ce qui n’est rien de moins qu’une théorie de cette société, et l’histoire comme transition d’une société à l’autre. Seule cette double conception de l’histoire peut permettre de cerner un futur qui contraste avec le présent sans pour autant être utopique1.
Je vais présenter ici quelques concepts généraux – mode de production, relations de production, procès de travail, relations de production, reproduction, politique, idéologie, intérêts – dont j’indiquerai comment ils peuvent être particularisés pour nous permettre de comprendre chaque type de société. J’esquisserai également, quoi que de façon rudimentaire, une théorie du féodalisme et une théorie du capitalisme, afin de cerner la spécificité du procès de travail capitaliste.
Prémisses et concepts
Commençons par le commencement…
La condition première de toute existence humaine, et donc de toute Histoire, suppose que les hommes doivent avoir de quoi vivre pour « faire l’Histoire ». Mais pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s’habiller, etc. Le premier fait historique est donc la production des moyens permettant de satisfaire ses besoins : la production de la vie matérielle elle-même2.
Pour faire l’histoire, les hommes et les femmes doivent survivre, et pour survivre, ils doivent transformer la nature en des choses utiles. C’est la définition de ce que nous appelons des activités économiques. Une société vient à exister à partir du moment où les hommes et les femmes instaurent entre eux des relations sociales à mesure qu’ils transforment la nature. Les relations particulières ainsi produites, et reproduites, définissent le caractère des activités économiques, c’est-à-dire la manière de produire ou mode de production. L’histoire est façonnée par différents modes de production, c’est-à-dire par les différentes configurations de relations sociales dans lesquelles s’insèrent les hommes et les femmes au fil de leur transformation de la nature. En d’autres termes, ce qui donne à l’histoire ses périodes, c’est une succession de modes de production dominants.
L’ensemble des relations sociales qui caractérisent une société de classe, c’est la distinction entre ceux qui produisent ce qui est nécessaire à la vie, et ceux qui vivent de ce que les autres produisent ; entre ceux qui produisent le surplus et ceux qui se l’approprient ; entre ceux qui sont exploités et ceux qui exploitent ; entre le paysan et le seigneur ; entre l’ouvrier et le capitaliste. Les sociétés de classes peuvent être distinguées les unes des autres par la manière d’arracher le surtravail des mains des producteurs directs ou immédiats, c’est-à-dire par les rapports de production.
Un mode de production n’est pas réductible à un ensemble de relations définissant une manière particulière de distribuer et de s’approprier le temps de travail et son produit. C’est aussi une manière particulière de s’approprier la nature – de produire des choses utiles3. Aussi les rapports de production sont-ils toujours combinés à un ensemble de relations sociales correspondantes, dans lesquelles s’insèrent les hommes et les femmes dès lors qu’ils transforment des matières premières en des objets de leur imagination. C’est là le procès de travail, qui a deux composantes analytiquement distinctes mais concrètement inséparables – un aspect relationnel et un aspect pratique4. Je ferai référence à l’aspect relationnel du procès de travail comme aux relations dans la production ou aux relations de production. Il s’agit, par exemple, de relations propres aux lieux de travail, qui s’instaurent aussi bien entre travailleurs qu’entre les travailleurs et leur encadrement. Dans son aspect pratique, le procès de travail est l’ensemble des activités par lesquelles la matière brute est transformée en des objets utiles – ou en des fractions d’objets utiles – à l’aide des instruments de production. Cette transformation nécessite du travail, de l’effort, la transposition de la capacité de travail en travail effectif, et celle de la force de travail en travail. C’est par cette activité pratique que l’espèce humaine exprime son potentiel créatif, tandis que l’aspect relationnel contient en germe une communauté éthique de producteurs librement associés. Les relations de production façonnent la forme et le développement du procès de travail, qui trace quant à lui des limites à la transformation du mode de production.
Le mode d’appropriation spécifique du surtravail définit un ensemble de conditions qui doivent être remplies pour que le mode de production persiste, pour que ces relations sociales caractéristiques soient reproduites. En d’autres termes, les conditions d’existence d’un mode de production donné sont un ensemble de mécanismes qui garantit la reproduction des relations de production. Par définition, ces mécanismes sont des structures politiques. Les activités politiques concernent la reproduction (ou la transformation) des relations sociales5, et chaque mode de production particulier définit obligatoirement des structures politiques correspondantes :
La forme économique spécifique, dans laquelle le surtravail est extrait des producteurs directs, détermine le rapport entre les dominants et les dominés, en se nourrissant directement de la production elle-même et en agissant sur elle en retour d’une façon déterminante. C’est sur cette base que repose l’ensemble du système économique qui provient des relations de production elles-mêmes, et donc aussi sa forme politique spécifique. C’est toujours le rapport entre les propriétaires des moyens de production et les producteurs directs – une relation qui correspond toujours naturellement à un stade de développement particulier des méthodes de travail et de productivité – qui révèle le secret le mieux gardé, le fondement invisible de l’ensemble du corps social, et avec lui la forme politique du rapport de souveraineté et de dépendance, c’est-à-dire une forme d’État correspondante6.
C’est en ce sens que l’on peut dire que « l’économique est déterminant en dernière instance » et que l’on peut considérer que la structure sociale comme totalité doit être perçue en termes de conditions d’existence de l’économie et de reproduction des relations de production. Quand nous nous intéresserons plus loin aux modes de production particuliers, nous verrons concrètement ce qu’il en est.
Mais produire des choses, ce n’est pas seulement produire et reproduire simultanément des relations sociales, c’est aussi produire une expérience de ces relations sociales. Quand hommes et femmes s’insèrent dans les rapports de production, ils génèrent un monde d’apparences, « non pas une relation elle-même, mais la façon qu’ils ont de vivre cette relation entre eux et leurs conditions d’existence, ce qui suppose à la fois l’existence d’une relation réelle et celle d’une relation imaginaire, ou ressentie »7. Dans sa discussion sur le fétichisme des marchandises, Marx écrit : « C’est une relation sociale bien définie, entre êtres humains, qui prend à leurs yeux la forme fantastique d’une relation entre des choses »8. Dans une société productrice de marchandises, la nature sociale de la production s’exprime seulement dans le cadre du marché, où des producteurs – « isolés » ou formant des groupes de producteurs – échangent leurs biens et découvrent que la valeur de ces biens est déterminée par du travail cristallisé. Ce qu’ils peuvent échanger contre leurs propres marchandises est déterminé par le travail cristallisé dans les marchandises des autres, qu’ils ne peuvent contrôler. Les relations entre producteurs se présentent donc comme des relations entre choses. La nature sociale du travail imprime ainsi son sceau sur les choses, qui se retournent contre leurs producteurs comme une force extérieure. En tant qu’expérience vécue, la « marchandisation » des relations sociales – et, revers de la médaille, la personnification des choses – s’émancipe des relations de production, acquiert une autonomie propre et semble in fine naturelle et inévitable.
Aucune somme de savoir, qu’elle soit théorique ou scientifique, au sujet de l’indissociable lien entre la structure des relations de production et l’expérience vécue de ces relations ne peut affecter cette expérience, de même qu’aucune science, qu’elle qu’en soit le poids, ne peut changer le fait que le soleil semble tourner autour de la Terre ou qu’un bâton paraît brisé lorsqu’il est plongé dans l’eau. « Le fait d’avoir récemment découvert que les produits du travail, dans la mesure où ils sont des valeurs, ne sont rien d’autre que l’expression du travail humain cristallisé dans la production (…) ne dissipe en rien le brouillard qui permet au caractère social du travail d’apparaître comme une caractéristique objective des produits eux-mêmes »9. L’expérience vécue manifeste ce qui est socialement produit comme « naturel » et hors de portée du contrôle humain. Ni le savoir, ni la conscience individuelle ne l’altèrent. Et que celui qui occupe telle ou telle place dans les rapports sociaux de production soit Karl Marx, John Rockefeller ou Joe Hill ne change rien à l’affaire : le fétichisme de la marchandise s’impose à tous avec le même degré de réalité.
Quel est le rapport entre ce monde des apparences et l’idéologie ? Au sein de la littérature marxiste existe une tension entre l’autonomie de l’idéologie et l’expérience vécue, tension que l’on retrouve dans les écrits de Marx lui-même10. Même si cette relation est déterminée historiquement, j’aurai ici tendance à souligner les contraintes que l’expérience impose à l’idéologie. Cette dernière n’est pas manipulée suivant les seuls intérêts de la classe dominante par les instances de socialisation que sont les écoles, la famille ou l’Église, qui, en revanche, élaborent et systématisent l’expérience vécue : c’est pour elles la seule manière de disséminer efficacement leur idéologie11. Ajoutons à cela que les classes dominantes sont façonnées par l’idéologie plus qu’elles ne la façonnent, et quand elles entreprennent d’actives campagnes de manipulation, c’est de la propagande qu’elles diffusent, et pas de l’idéologie. Approximativement, en première analyse, on voit donc que c’est bien l’expérience vécue qui produit l’idéologie et non l’inverse. L’idéologie plonge ses racines dans les activités qui lui donnent naissance et qu’elle se charge d’exprimer. Comme l’écrit Althusser, citant Pascal : « Mettez-vous à genoux, remuez les lèvres de la prière, et vous croirez »12.
Les individus ne sont pas des vecteurs d’idéologie, même si leurs consciences véhiculent des théories, du savoir, des attitudes, qui deviendront une idéologie, « une force matérielle une fois qu’elle aura atteint les masses »13. L’idéologie n’est ni une « froide utopie » ni une « théorisation érudite » mais la « réalisation d’un fantasme concret qui organise la volonté collective d’un peuple brisé et dispersé »14. L’idéologie est le ciment des relations sociales ; elle lie les individus les uns aux autres ; elle connecte entre elles les expériences immédiates, au passé et au futur. De ce point de vue, le marxisme en tant que théorie expliquant comment fonctionne le capitalisme peut devenir une idéologie – une force politique – plus ou moins forte selon les périodes et les domaines d’existence de la classe ouvrière. Par exemple, il est peut-être aujourd’hui plus facile de convaincre des gens de s’engager dans des activités politiques en dehors du lieu de travail qu’en son sein, où il a pourtant longtemps paru plus logique de le faire. En période de crise, ou de lutte, quand est ébranlée la « naturalité » de l’expérience vécue, le nombre de théories capables de devenir une force politique s’élargit et la compétition entre idéologies peut s’aiguiser. Mais il est clair que le fait d’enseigner des théories à l’école n’est pas la même chose que de produire une idéologie. Faire du marxisme la « pensée » officielle d’un pays ne modifiera pas nécessairement le comportement au travail.
Quelle est la portée de l’idéologie ? Peut-on la considérer comme une force matérielle ? Dans la mesure où l’idéologie exprime la manière dont on fait l’expérience des relations sociales, c’est par elle que les « hommes prennent conscience du conflit et décident de partir au combat »15. Eugene Genovese montre comment les luttes entre les esclaves et les propriétaires d’esclaves furent façonnées par le paternalisme – une idéologie qui exprime l’« humanité » des esclaves dans le contexte d’un mode de production qui ne les a jamais considérés autrement que comme des objets16. Quand les esclaves rejetèrent l’esclavagisme, ils se débarrassèrent ou au contraire se tournèrent vers le paternalisme, selon leur type d’idéologie religieuse, car, d’après Genovese, la religion a été un facteur déterminant dans l’adaptation des esclaves au paternalisme – dans le Sud des États-Unis – et dans la façon dont ils se sont révoltés – partout ailleurs. Quand une lutte se déroule sur le terrain idéologique, ses conséquences doivent être appréhendées par un examen des véritables relations qui se cachent derrière l’idéologie. Prenons l’exemple de l’Afrique du Sud : les luttes de classes s’y livrent sur le terrain du racisme, mais leurs conséquences ne peuvent être saisies que par l’analyse de la reproduction de relations sociales qui, simultanément, forgent le racisme et sont masquées par lui.
Mais quelle est la nature de ces luttes si elles ne cherchent pas explicitement à faire triompher des intérêts ? Et d’où proviennent les intérêts ? Selon ce qui a été dit jusqu’ici, ils prennent clairement leur source dans l’idéologie, bien que cette façon de voir soit loin d’être la plus répandue. Comme nous l’avons vu, les intérêts sont une donnée de départ pour de nombreux sociologues. Et c’est là que se pose de façon cruciale le problème qui surgit de l’écart qui se creuse entre comportements réels et supposés : ce problème, c’est celui de la rationalité et de l’irrationalité, des comportements logiques et illogiques, des intérêts vrais et faux, mais aussi immédiats et fondamentaux, de court et moyen terme. Là où ces intérêts sont une donnée de base, l’idéologie devient une ressource que l’on manipule pour mettre en avant ses propres intérêts, ou bien une matière qui cimente le conflit ou diminue la pression de la contrainte17. Mais d’un autre côté, si les intérêts ne sont pas postulés, ils sont découverts empiriquement ou reconstruits après coup, d’une façon tautologique : tel groupe particulier a voté ainsi parce que tels sont ses intérêts. Pourquoi tels intérêts et pas tels autres ? Parce qu’ils ont voté ainsi. Mais pourquoi, par exemple, les travailleurs se battent-ils parfois pour leurs intérêts ethniques et parfois pour leurs intérêts de classe ? L’enjeu n’est pas de décrire empiriquement des intérêts, mais d’être capable de les comprendre dans n’importe quelle situation donnée. Plutôt que de postuler des intérêts métaphysiques ou empiriques, nous devons développer une théorie des intérêts, ou plus exactement une théorie de leur manière de se construire à partir de l’idéologie.
Il apparaît clairement que les intérêts ne peuvent être compris en dehors de la conscience spontanée et particulière de relations sociales données, c’est-à-dire en dehors d’une théorie de ces mêmes relations sociales. En ce sens, les intérêts en termes de gain matériel, de quantité plutôt que de qualité, d’avantage compétitif au sein d’une société marchande, relèvent du « fétichisme de la marchandise » que Marx voit comme une conséquence d’une forme particulière de production. C’est le même problème que celui de la rationalité :
La rationalité du comportement économique des individus apparaît comme un aspect d’une rationalité plus large, sociale, basée sur le rapport interne des structures économiques et non économiques dans divers types de sociétés. (…) On comprend donc qu’à défaut d’une connaissance scientifique du rapport interne des structures sociales, l’économiste ne puisse atteindre qu’une connaissance statistique des préférences qui lui apparaissent nécessairement comme une question de goût, qu’on juge souvent non rationnelle18.
Mais si les intérêts sont intégralement constitués par la société où ils sont nés, comment est-il possible de parler des luttes qui conduisent à son dépassement ? Comment concevoir une société douée d’une « rationalité » alternative, une société dans laquelle l’histoire est faite consciemment et collectivement, une société dans laquelle il n’y a pas d’écart entre les illusions et la réalité, entre l’expérience et l’apparence – en bref, une société dénuée d’idéologie et donc « d’intérêts » ? En effet, comme Agnes Heller le démontre de manière convaincante, le concept même d’intérêts reflète le point de vue de la société capitaliste, où les individus sont esclaves de raisons d’agir qui échappent à leur contrôle. Le concept d’intérêt exprime la réduction du besoin au profit. À la place d’« intérêts fondamentaux » ou d’« intérêts de classe », elle parle de « besoins radicaux ». « »L’intérêt de classe » ne peut pas être le moteur d’une lutte des classes qui irait au-delà de la société capitaliste : le véritable moteur, indépendamment du fétichisme, est représenté par les « besoins radicaux » de la classe ouvrière »19 Mais le capitalisme tolère-t-il de tels intérêts radicaux ? Les génère-t-il comme une condition de son propre développement, ainsi que Marx l’affirme ? Et si c’est en effet le cas, alors comment, où, et pourquoi ? Et sous quelles conditions de tels besoins radicaux pourraient-ils être satisfaits dans une société nouvelle ? Comment transformer un monde possible en monde réel ?
Du féodalisme au capitalisme
Après avoir présenté ces quelques concepts généraux, il s’agit maintenant de les appliquer au procès de travail capitaliste et de mettre en lumière ses traits distinctifs, sa singularité en le comparant à un autre procès de travail. Pour développer une critique du capitalisme, il serait tentant de se référer au socialisme mais peu d’indices laissent supposer que le procès de travail dans les pays dits socialistes est fondamentalement différent – et cette comparaison n’éclairerait que faiblement le procès de travail capitaliste. Nous pourrions construire un idéal-type du procès de travail socialiste, mais de telles idéalisations, construites à partir d’une inversion de certaines caractéristiques du capitalisme, présupposent justement une compréhension du procès de travail capitaliste. L’analogie avec les modes de production précapitalistes semble donc la plus appropriée. Il est possible de faire apparaître les contrastes entre le capitalisme et tous les modes de production précapitalistes en soulignant les éléments « extra-économiques » nécessaires à l’appropriation du surtravail en régime capitaliste et inutiles aux autres modes de production. Mais les différences entre les modes de production précapitalistes sont si importantes et leurs points communs sont si rares qu’une telle comparaison promet de faibles retours sur investissement. Mon choix portera donc sur un seul mode de production précapitaliste – le féodalisme – au sujet duquel il a été beaucoup écrit et qui a historiquement existé sous des formes pures de tout élément capitaliste.
La littérature marxiste foisonne de débats sur la nature du féodalisme, habituellement en rapport avec la transition vers le capitalisme20. Cependant, notre objet d’étude n’est ni la nature du féodalisme en tant que tel ni la transition vers le capitalisme : le féodalisme ne nous intéresse qu’en tant que point de comparaison avec le capitalisme. Il n’est donc pas nécessaire d’entrer dans les controverses sur la nature de la dynamique féodale, sa dissolution, le rôle de la lutte de classe dans cette dissolution et dans la genèse du capitalisme, la relation entre la ville et la campagne, ou encore le rôle du marché dans tout ce processus. Notre démarche aura plutôt pour but de donner au procès de travail capitaliste toute son importance, sans que notre modèle de régime féodal ne corresponde à aucun féodalisme historiquement déterminé, car cela requerrait un portrait autrement plus complexe et bigarré que celui que je suis sur le point de dessiner. Mais la comparaison à laquelle je vais me livrer portera néanmoins sur une forme particulière de féodalisme, à laquelle Jairus Banaji renvoie comme à sa forme pure, classique ou cristallisée : celle qui est fondée sur la corvée21. En fin de compte, la preuve du pudding féodal réside dans ce qu’il saura nous révéler du capitalisme.
Une caractéristique essentielle des rapports de production féodaux est l’appropriation du surtravail sous la forme de la rente. Les serfs, pour se maintenir sur la terre qu’ils louent, sont obligés de verser un loyer – en nature, en argent, en corvée ou, plus couramment, en une quelconque combinaison de ces éléments. Je m’en tiendrai ici à la corvée que les serfs effectuent sur la terre de leur seigneur. Le cycle de production repose, dans sa forme la plus simple, sur le schéma suivant : les serfs travaillent sur le domaine du seigneur un nombre déterminé de jours par semaine et cultivent les autres jours leur « propre » terre pour leur propre compte – pour leur survie, en réalité. D’un côté, le surtravail – dont la quantité est précisée – et de l’autre, le travail nécessaire.
Cinq traits distinctifs de cette forme pure de féodalisme doivent être soulignés. D’abord, le travail nécessaire et le surtravail sont séparés à la fois dans le temps et dans l’espace. Les serfs travaillent sur le domaine en « échange » du droit de cultiver un lopin ou une bande de terre. Ensuite, ils possèdent directement leurs moyens de subsistance, puisqu’ils consomment les produits agricoles qu’ils ont eux-mêmes cultivés. Ils sont, troisièmement, capables de faire usage de leurs instruments de production indépendamment du seigneur. Bien entendu, ils coopèrent pour les labours et la récolte, notamment selon un système de rotation des cultures de plein champ, mais ils possèdent leurs propres outils et peuvent les utiliser sans l’intervention du seigneur22. Quatrièmement, les serfs organisent le procès de travail sur leurs propres terres, mais la production du domaine est quant à elle supervisée et coordonnée par ses agents – les baillis, ou intendants du domaine. Les tâches obligatoires sont détaillées avec la plus grande minutie par le droit coutumier et des représentants du seigneur les font respecter dans les cours de justice seigneuriales23. Les activités productives qui forment le surtravail sont donc précisées et sécurisées par des institutions juridico-politiques. Enfin, le droit qu’a le seigneur d’exclure les serfs des terres qu’ils cultivent pour leur propre usage, droit protégé par des appareils d’État locaux, fait qu’il est impossible d’échapper à la corvée. En même temps, les idéologies de l’échange équitable et la protection militaire donnent au système d’exploitation un air naturel et inévitable.
Le surtravail est donc ici transparent et le rapport qu’il entretient avec l’autosubsistance n’est ni automatique ni simultané. Au contraire, les serfs pouvant produire leurs moyens d’existence indépendamment du travail qu’ils fournissent pour le seigneur, le surtravail doit être extrait par des moyens extra-économiques. En bref, comme le surtravail est dissocié du travail nécessaire, l’appropriation du surproduit social est directement enchevêtrée aux domaines politique, juridique et idéologique. Qu’en est-il dans le cas du capitalisme ? Les producteurs directs passent-ils une certaine partie de leur temps à travailler pour les capitalistes et une autre à travailler pour eux-mêmes ? Les travailleurs possèdent-ils leurs moyens de subsistance comme un produit de leurs propres activités ? Les travailleurs sont-ils capables de mettre en œuvre les instruments de production par eux-mêmes, indépendamment du capitaliste ? L’appropriation du surtravail dépend-elle de l’intervention de moyens extra-économiques au cœur du cycle de production ? À toutes ces questions, la réponse est non.
En régime capitaliste, les travailleurs ne peuvent pas transformer la nature par eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins vitaux d’une manière autonome. Dépossédés de tout accès à leurs propres moyens d’existence, qu’il s’agisse des matières premières ou des instruments de production, ils n’ont pour survivre d’autre alternative que de vendre leur capacité de travail – leur force de travail – au capitaliste en échange d’un salaire, qui leur donne leurs moyens de subsistance. En travaillant pour le capitaliste, ils transforment leur force de travail en travail ; leur salaire apparaît comme une compensation pour la totalité de leur période de travail. En réalité, ils ne sont payés que l’équivalent, en termes monétaires, de la valeur qu’ils produisent au cours d’une fraction de journée de travail, par exemple cinq heures sur un total de huit heures. Ces cinq heures forment le travail nécessaire (nécessaire à la reproduction de la force de travail), tandis que les trois heures restantes constituent le surtravail, ou travail non payé. De même que les travailleurs dépendent d’un marché pour vendre leur force de travail en échange d’un salaire, les capitalistes dépendent d’un marché pour vendre leurs marchandises. Le surtravail ne produit pas seulement des choses utiles mais des marchandises qui peuvent être achetées et vendues, c’est-à-dire des choses qui ont une valeur d’échange. En d’autres termes, sous le capitalisme, le surtravail prend la forme de la plus-value, qui se réalise sous la forme de profit sur le marché.
Cinq points de divergence avec le féodalisme doivent être soulignés. D’abord, il n’y a pas de séparation, ni dans l’espace ni dans le temps, entre le surtravail et le travail nécessaire : cette distinction, indispensable à une théorie marxiste du procès de travail, n’est pas empiriquement constatable, car c’est bien la totalité du produit du travail qui est appropriée par le capitaliste. D’une manière générale, le travail nécessaire et le surtravail se présentent à nous de façon indirecte, par une série d’événements difficilement dissociables : le travailleur arrive chaque jour aux portes de l’usine ou du bureau, pendant que le capitaliste et ses agents, constamment sur place, gardent les portes ouvertes, remplacent les machines hors d’usage et réalisent un profit sur le marché. Ce n’est que dans les situations de crise que les rouages du capitalisme peuvent être mis à nu et le travail nécessaire et le surtravail apparaître sans médiation, dans toute leur puissance.
Ensuite, les travailleurs ne peuvent pas vivre de ce qu’ils produisent sur le lieu de travail. Les serfs pouvaient subsister grâce aux produits de la terre, mais les ouvriers ne peuvent pas vivre d’épingles – et encore moins de têtes d’épingles. La seule manière, pour les ouvriers, d’avoir accès aux moyens d’existence (à part, bien sûr, par les associations caritatives ou l’aide sociale…) passe par le marché – par la vente de leur force de travail en échange d’un salaire, lequel est ensuite converti en biens de consommation. Il en va de même pour les capitalistes qui, s’ils veulent rester capitalistes, dépendent du marché pour vendre leurs produits comme pour se procurer de la force de travail. L’existence d’un marché, nécessaire au capitalisme, sur lequel reposent tous les acteurs de la production, distingue radicalement le capitalisme du féodalisme. Bien que les marchés ne soient en aucune manière incompatibles avec le féodalisme, ils ne lui sont pas pour autant nécessaires.
Troisièmement, non seulement les travailleurs ne possèdent pas les moyens de production mais ils ne peuvent pas non plus les utiliser par eux-mêmes. Au lieu de contrôler le procès de travail, ils lui sont subordonnés par leur sujétion aux agents du capital : les cadres qui dirigent le procès de travail. En même temps, et c’est là le quatrième point, cette direction du procès de travail est très différente de la supervision et de la coordination dont les représentants du seigneur ont la charge dans le cas de la production domaniale. Sous le féodalisme, les activités productives sont largement déterminées de l’extérieur du procès de travail, dans les cours de justice seigneuriales. Les fonctions de contrôle et de coordination du procès de travail sont séparées dans l’espace et dans le temps. A contrario, sous le capitalisme, les producteurs directs ne s’engagent pas seulement à rendre un service, ils fournissent un effort de travail utilisable à loisir par le capitaliste. Le patron peut changer les objectifs de productivité et exploite les travailleurs jusqu’à leurs extrêmes limites. L’encadrement n’existe pas seulement pour coordonner, comme dans le cas de la production féodale, mais aussi pour contrôler. Les fonctions de contrôle et de coordination, qui étaient séparées sous le féodalisme, deviennent deux aspects du même procès sous le capitalisme24 : les luttes qui portent sur les activités productives se déroulent sur le lieu de travail, alors que les luttes qui ont pour enjeu les corvées ont pour cadre l’arène juridico-politique des cours seigneuriales25.
Enfin, la même dissymétrie se retrouve dans la reproduction des relations de production. La relation entre le seigneur et le serf est garantie par le droit du seigneur à exclure le serf de la terre, un droit défini et protégé dans les institutions politiques et juridiques, tandis que les relations entre le travailleur et le capitaliste se fondent sur leur interdépendance économique. Sous le capitalisme, la production des marchandises est une production du travailleur d’une part (au moyen du travail nécessaire qui équivaut au salaire), et du capitaliste d’autre part (par le surtravail et sa réalisation sous la forme de profit) : la production des marchandises est donc à l’image des relations de production tandis que, sous le féodalisme, la production à destination du seigneur reste liée à la production pour le serf, par l’intermédiaire de mécanismes politiques et juridiques.
Les institutions politiques, juridiques et idéologiques du capitalisme garantissent les conditions externes de production. Par contraste, leurs homologues féodales intervenaient directement dans le cycle de production pour en garantir la continuité et déterminer son contenu – pour reproduire les rapports de production et les relations de production. Ainsi, les institutions politiques, juridiques et idéologiques du féodalisme reconnaissaient les agents de production pour ce qu’ils étaient – vilains, serfs, hommes libres, intendants, seigneurs. En régime capitaliste, ces institutions idéalisent le statut productif des travailleurs, des capitalistes ou des cadres, car les appareils politiques, juridiques et idéologiques de l’État transforment les relations entre agents de production en des rapports entre citoyens, entre homme et femme ou entre groupes ethniques. En outre, l’État capitaliste disposant, vis-à-vis de l’économie, d’une indépendance relative – ce qui n’était pas le cas de l’État féodal – il peut endosser toute une variété de formes – dictature, fascisme, démocratie parlementaire, apartheid, etc. Cette comparaison rapide sommaire suffit à mettre en évidence la façon dont les conditions d’existence et la reproduction d’un mode de production façonnent les structures politiques et idéologiques.
L’essence du procès de production capitaliste
Tournons à présent notre regard vers le caractère général du procès de travail capitaliste en tant que tel. Un travailleur est employé par un capitaliste – une entreprise. À la fin de la semaine, ce travailleur reçoit un salaire fondé sur un taux – horaire ou aux pièces – établi avant qu’il n’entre dans l’usine, c’est-à-dire avant que l’effort de travail soit fourni. Comment l’entrepreneur capitaliste peut-il s’engager à payer, pour chaque unité produite, un salaire qui ne sera ni trop élevé (pour garantir le prix de vente fixé pour le produit), ni trop bas (pour attirer des travailleurs en leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille) ? Comment le procès de travail est-il organisé de manière à garantir la production de plus-value ?
Affirmer que le capitalisme s’effondrerait s’il n’y avait pas de plus-value, ce n’est pas expliquer pourquoi il existe. Si la lutte des classes peut pousser le prix de la force de travail – le salaire – au-dessus de sa valeur, donc au-dessus du temps de travail socialement nécessaire à sa reproduction, où se trouve la limite à cette augmentation ? Comment l’entrepreneur capitaliste peut-il savoir à l’avance à quel niveau le salaire par unité produite commence à dépasser le prix de vente auquel elle peut prétendre ? En parlant de la baisse tendancielle du taux de profit, Marx supposait, entre autres, que les travailleurs continuent à produire de la plus-value dans des quantités toujours plus importantes mais que le nombre de salariés (capital variable) – et en conséquence la plus-value totale – se réduisait à mesure que s’accroissait le capital total. L’analyse marxiste de l’effondrement du capitalisme est ainsi fondée sur le postulat de travailleurs produisant plus que leur salaire.
Pour comprendre le problème que pose cette production de la plus-value, comparons la situation de l’entrepreneur capitaliste à celle du seigneur féodal. Sous le féodalisme, le surtravail est fixé à l’avance, sous la forme d’une rente ; sous le capitalisme, le salaire est prédéterminé et les capitalistes ou leurs exécutants doivent organiser le procès de travail de façon à assurer l’extraction de travail non payé.
Marx, bien sûr, s’est longuement penché sur les mécanismes de sécurisation de la plus-value dans le procès de travail. Il a ainsi décrit comment, avant les Factory Acts en Angleterre, les capitalistes pouvaient prolonger la journée de travail. Quand on légiféra en faveur de la réduction du temps de travail, les capitalistes eurent recours à l’intensification du procès de travail par des hausses de cadence, l’introduction du salaire aux pièces, la mécanisation. Mais tout cela ne donna que des avantages compétitifs temporaires aux capitalistes individuels car, en fin de compte, les concurrents accéléraient aussi leurs rythmes de travail. Réduire le temps de travail nécessaire à la reproduction de la force de travail, c’est-à-dire baisser les coûts de production tout en accroissant la productivité dans le secteur des produits de première nécessité, était la seule manière durable d’accroître le taux de plus-value.
Ces mécanismes, comme l’analyse que fait Marx du procès de travail en général, reposent sur le postulat selon lequel l’effort de travail est déterminé par la contrainte. Pour leur survie économique, les travailleurs sont supposés être entièrement à la merci du capitaliste ou de son agent, le contremaître. Ce dernier peut intensifier arbitrairement le travail, tant que ses exigences ne compromettent pas le retour du salarié au travail le lendemain et qu’elles restent dans le cadre de la loi. En d’autres termes, Marx n’avait pas de place, dans sa théorie du procès de travail, pour l’organisation du consentement, pour la nécessité d’obtenir des travailleurs leur volonté de coopérer à la transformation de la force de travail en travail. Sans être vraiment justifiée, cette omission peut se comprendre dans le contexte du capitalisme du XIXe siècle, tant la sphère du consentement y était restreinte. Au fil du temps et des luttes ouvrières, le montant du salaire a été fixé toujours plus indépendamment de la dépense individuelle de l’effort de travail, tandis que l’organisation du consentement est venue soutenir l’usage de la contrainte. Contrairement à la légitimité, qui est un état d’esprit subjectif que les individus portent en eux, le consentement s’obtient par l’organisation de pratiques concrètes qui le font naître. Il doit être distingué de la conscience spécifique ou des attributs subjectifs de l’individu qui s’engage dans ces activités. Au sein du procès de travail, le consentement trouve sa source dans l’impression donnée au travailleur de pouvoir prendre des décisions – même si les choix réels qui s’offrent à lui sont restreints. C’est la participation à ce processus de décision qui génère le consentement. Et aussi longtemps que la contrainte n’est utilisée par le capitaliste qu’en cas de transgression des limites du choix – des limites étroites, mais bien précises et reconnues – elle peut elle aussi devenir un objet de consentement26. La sécurisation de la plus-value doit donc être comprise comme le résultat de différentes combinaisons de force et de consentement.
Mais sécuriser le travail non payé n’est pas la même chose que de réaliser la plus-value, et cette séparation pose au capitaliste de nouveaux problèmes. Sous le féodalisme, le surtravail était déterminé et revêtait une forme directement visible et consommable. Le surtravail du mode de production capitaliste n’étant quant à lui ni visible ni consommable, les origines du profit en termes de travail non payé sont masquées de plusieurs façons. D’abord, parce que les entrepreneurs capitalistes accroissent leurs profits par l’introduction de nouvelles techniques et de nouvelles machines – donc, par l’investissement en capital. Le capital apparaît alors comme un pouvoir en lui-même – le pouvoir de générer du profit. De ce point de vue, la variation en intensité de travail ne contribue qu’à la variation du taux de profit autour d’un certain profit moyen : pour ceux qui dirigent le procès de production, la source du profit est donc le capital, et non le travail.
Ensuite, la plus-value est réalisée par l’intermédiaire de la vente des produits sur le marché, où le prix atteint par une marchandise particulière est hors du contrôle du capitaliste individuel. La taille du profit paraît donc déterminée par les forces du marché – l’offre et de la demande – et non par la quantité de temps de travail non payé cristallisé dans les marchandises. La relation entre le prix et le temps de travail cristallisé dans une marchandise étant complexe et obscure aux yeux du capitaliste individuel, le profit, semble non seulement être réalisé sur le marché mais aussi en provenir. Bref, le dilemme essentiel du capitaliste consiste à sécuriser une plus-value tout en la rendant invisible27.
Cet obscurcissement est un trait nécessaire du capitalisme : il garantit la subordination des travailleurs et donc la sécurisation et la réalisation de la plus-value. Si l’existence de travail non payé était transparente, nous nous retrouverions dans un cas de figure caractéristique d’un mode de production précapitaliste, exigeant l’intervention d’instances extra-économiques pour le renouvellement du cycle de production. Comment le travail non payé se retrouve-t-il idéalisé aux yeux du travailleur en régime capitaliste ? Nous avons déjà vu que le temps de travail nécessaire et le surtravail n’étaient pas distincts dans le procès de travail et que le salaire servait à masquer une telle distinction. Mais comment les travailleurs pourraient-ils avoir l’impression de produire l’équivalent en salaire de leurs moyens de subsistance, alors que ce qu’ils produisent n’est rien d’autre qu’une fraction d’un objet utile qu’ils ne verront peut-être jamais ? Le procès de production apparaît aux travailleurs comme un procès de travail, c’est-à-dire comme la production de choses – valeur d’usage – plus que comme la production de valeur d’échange. Cette caractéristique est renforcée par la séparation institutionnelle qui existe entre la propriété et le contrôle – par la séparation des rapports de production et des relations de production. Dans le procès de travail, les cadres dirigeants sont empiriquement perçus par les travailleurs comme des agents de domination, bien entendu, mais aussi comme des vendeurs de force de travail qui, grâce à leur formation et à leur expertise, reçoivent des rémunérations plus importantes que les travailleurs eux-mêmes. En revanche, le fait que les cadres dirigeants reçoivent aussi une partie de la plus-value n’apparaît pas dans le procès de travail.
Bien que la plus-value soit masquée – aux yeux du travailleur comme à ceux du capitaliste – Marx affirmait que certaines tendances immanentes au capitalisme révéleraient aux travailleurs ce qui se déroule derrière les apparences. L’émergence du travailleur collectif, le développement de l’interdépendance et de l’homogénéisation du travail, et, par-dessus tout, la lutte des classes, conduiraient le travailleur à reconnaître l’antagonisme entre ses intérêts et ceux du capital – ancrés dans l’appropriation du travail non payé. Or, l’histoire a montré que ce pronostic était erroné : les travailleurs ne font généralement pas la différence, au sein de leur travail, entre ce qu’ils produisent et ce qu’ils reçoivent28, et les notions d’exploitation et de travail non payé leur paraissent encore plus abstraites aujourd’hui qu’à l’époque de Marx.
Si les travailleurs ne considèrent pas leur propre travail comme une source de profit, à quelles théories du profit souscrivent-ils ? La perception que j’ai rencontrée le plus souvent était que le profit était une sorte de récompense méritée pour les sacrifices passés ou pour les risques de l’investissement capitalistique. D’autres avancent que c’est le marché qui génère le profit, particulièrement comme résultat de la manipulation des prix. Cette similitude entre les théories ouvrières et capitalistes du profit reflète une convergence plus qu’une divergence de leurs intérêts tels qu’ils sont organisés sous le capitalisme avancé. Si les travailleurs conçoivent leurs conditions d’existence comme dépendantes de la survie et de l’expansion de leur entreprise, ils ne peuvent qu’accepter les théories du profit qui proviennent de l’expérience personnelle du capitaliste à la recherche du profit par la vente de ses marchandises29.
Pourquoi la plus-value demeure-t-elle si obscure aux yeux des travailleurs ? Pourquoi l’évolution du procès de travail et de la lutte des classes n’a-t-elle pas permis de démystifier la source du profit ? Pourquoi les travailleurs ne se considèrent-ils pas comme une classe sociale alors même que leurs intérêts sont incompatibles avec ceux du capital ? Le marxisme du XXe siècle offre de nombreuses réponses à ces questions – des réponses qui nous conduisent, au-delà du procès de travail, à l’intérieur de l’État, de l’école, de la famille et de l’industrie culturelle. Autant de réponses qui reposent sur la construction d’une psychologie marxiste. En confrontant certains de ces résultats au cœur même de la production, on reviendra donc au problème central de Marx, mais avec les armes du marxisme.
Conclusion
Certes, le procès de travail capitaliste se définit essentiellement par le mouvement simultané de sécurisation et d’obscurcissement de la plus-value. Mais comment le capitaliste assure-t-il lui-même la plus-value si celle-ci est invisible, même à ses propres yeux ? Les théories marxistes du procès de travail ont fréquemment fait référence à la fragmentation et à l’atomisation de la classe ouvrière sur les lieux de production – traits essentiels de l’obscurcissement de la plus-value – mais elles n’expliquent pas ce qui permet de sécuriser la plus-value30. Or, occulter la plus-value est une condition nécessaire mais non suffisante de sa sécurisation. Il faut non seulement expliquer pourquoi les travailleurs n’agissent pas selon leurs intérêts, réels ou supposés, mais aussi pourquoi ils s’efforcent d’agir selon d’autres intérêts que les leurs. Le procès de travail peut ainsi être compris dans les termes de combinaisons de force et de consentement spécifiques qui, au nom de la recherche de profit, produisent la coopération.
En examinant les changements du procès de travail dans une usine particulière sur une période de trente ans, j’espère éclairer les mécanismes suivants : l’organisation du consentement sur le lieu de travail, la constitution des travailleurs comme des individus plutôt que comme membres d’une classe, la coordination des intérêts du travail et du capital, des ouvriers et des patrons, la redistribution du conflit et de la concurrence. Je m’efforcerai également de discuter les mécanismes par lesquels la plus-value est simultanément obscurcie et sécurisée. Je m’attacherai ensuite à décrire pourquoi les variations qui affectent les marchés et la conscience que les travailleurs apportent avec eux à l’usine n’ont d’effets que dans des limites définies par le procès de travail. Enfin, j’expliquerai l’origine des transformations du procès de travail qui améliorent sa capacité à occulter et sécuriser la plus-value.
références
| ⇧1 | Ce chapitre est fortement influencé par un groupe de marxistes français : ALTHUSSER Louis (1969), For Marx, Allen Lane, Londres ; POULANTZAS Nicos (1973), Political Power and Social Classes, New Left Books, Londres ; et surtout BALIBAR Étienne (1970), “The Basic Concepts of Historical Materialism” in ALTHUSSER Louis et BALIBAR Étienne (1970), Reading Capital, Pantheon, New York, pp. 201-308. Comme de nombreux marxistes contemporains, ces théoriciens français essaient de s’éloigner de toute vision téléologique de l’histoire, selon laquelle la succession des modes de production suit un schéma fixe et inévitable, en accord avec le développement des “moyens de production”. L’indétermination qu’ils introduisent trouve une forme extrême chez HINDESS Barry et HIRST Paul (1975), Pre-Capitalist Modes of Production, Routledge & Kegan Paul, Londres. |
|---|---|
| ⇧2 | MARX Karl et ENGELS Friedrich (1970), L’Idéologie allemande, Editions sociales, Paris, pp. 38-39 |
| ⇧3 | Un mode de production est habituellement considéré comme une combinaison de rapports de production et de moyens de production. J’ai évité d’employer l’expression « moyens de production » pour deux raisons. D’abord, les moyens de production sont souvent présentés comme un ensemble d’objets – matières premières, machines, technique, etc. – perçus comme neutres du point de vue de l’exploitation et de la domination. Je considère, à l’inverse, que les rapports de production impriment leur marque, d’une façon indélébile, sur les formes d’appropriation de la nature. Ensuite, la notion de moyen de production est habituellement associée à une conception téléologique de l’histoire, où l’expansion des forces productives rend nécessaire le renversement du capitalisme et pose les bases du socialisme. Dans ce livre, j’essaie de dissiper cet optimisme excessif. Pour une critique plus détaillée du concept de moyens de production, cf. Burawoy Michael (1979), « The Politics of Production and the Production of Politics: A Comparative Analysis of Machine Shops in the United States and Hungary », Political Power and Social Theory. |
| ⇧4 | La distinction entre les activités et les relations sociales est au fondement du concept de structure sociale que nous employons ici. La structure sociale est un schéma de relations entre des « places libres » que les individus occupent quand ils exercent ces activités, c’est-à-dire quand ils transforment quelque chose en quelque chose d’autre. Les relations sociales préexistent aux individus qui en sont les « porteurs » et qui agissent dans les limites des contraintes que leur imposent ces relations. La sociologie, par contraste, fait fusionner les relations et les activités grâce à des notions comme celle de « rôle social attendu » [role expectations]. La structure sociale devient un ensemble de relations sociales entre des individus concrets qui appliquent les valeurs qu’ils ont intériorisées. Dans la quatrième partie, je m’intéresserai aux mérites respectifs de ces deux conceptions de la structure sociale. |
| ⇧5 | Cela suppose qu’il y ait deux espèces de politiques : celles qui sont liées aux relations dans la production – les politiques de production – et celles qui sont liées aux relations de la production. |
| ⇧6 | MARX Karl (1967), Capital, International Publishers, New York, 3, p. 791. |
| ⇧7 | ALTHUSSER, For Marx, p. 233. |
| ⇧8 | MARX Karl (1967), Capital, International Publishers, New York, 1, p. 72. |
| ⇧9 | Ibid., p. 74. Voir aussi GODELIER Maurice (1973), Ideology in Social Science, p. 338. |
| ⇧10 | D’une part, l’analyse que Marx fait du fétichisme considère l’idéologie comme étant inscrite au sein même de la production des marchandises. D’autre part, Max accorde à la classe dominante la capacité de manipuler et d’imprimer certaines idées aux classes dominantes par son monopole de appareils de diffusion idéologique. Cf. MARX Karl, L’idéologie allemande, p. 64. Par ailleurs, il insiste sur les limites de telles manipulations et dans ses discussions sur l’idéologie politique bourgeoise il montre comment celle-ci correspond aux attentes du capitaliste. Bien entendu, le nombre d’idéologies qui s’accordent avec une expérience vécue donnée varie en fonction du contexte. Alvin Goudner, dans sa stimulante discussion de l’idéologie, formule le problème en des termes similaires en s’appuyant sur les concepts de codes linguistiques restreints et élaborés que l’on trouve chez Basil Bernstein. Cf. GOULDNER Alvin (1976), The Dialectic of Ideology and Technology: The Origins, Grammar and Future of Ideology, Seabury Press, New York. |
| ⇧11 | Nicos Poulantzas exprime bien cette conception : Classes in Contemporary Capitalism, New Left Books, Londres, p. 31. |
| ⇧12 | ALTHUSSER Louis (1970), “Idéologie et appareils idéologiques d’État”, in Positions (1964-1975),Éditions sociales, Paris, p. 108. Version anglaise : ALTHUSSER Louis (1971), Lenin and Philo and other essays, New Left Books, Londres, p. 168. |
| ⇧13 | MARX Karl, Early Writings (1975), Vintage Books, New York, p. 251. |
| ⇧14 | GRAMSCI Antonio (1971), Selections from Prison Notebooks, Intenational Publishers, New York, p. 126. |
| ⇧15 | MARX Karl (1972), « Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy », in The Marx-Engels Reader, ed. Robert Tucker, W. W. Norton, New York, p. 5. |
| ⇧16 | GENOVESE Eugene (1976), Roll, Jordan, Roll, Vintage Books, New York. |
| ⇧17 | Pour une présentation de ces deux conceptions, voir GEERTZ Clifford (1973), The Interpretation of Cultures, Basic Books, 1973, ch. 8. |
| ⇧18 | GODELIER Maurice (1969), Rationalité et irrationalité, Maspero, Paris, Livre 1, p. 55. Version anglaise : GODELIER Maurice (1972), Rationality and Irrationality in Economics, Monthly Review Press, New York, p. 45. |
| ⇧19 | HELLER Agnes (1976), The Theory of Need in Marx, Allison and Busby, Londres. p. 60. |
| ⇧20 | Voir, par exemple, HILTON Rodney (1976), The Transition from Feudalism to Capitalism, New Left Book, London ; ANDERSON Perry (1974), Lineage of the Absolutist State, New Left Books, Londres ; HINDESS Barry et HIRST Paul (1975), Pre-Capitalist Modes of Production, Routledge & Kegan Paul, Londres ; BRENNER Robert (1977), « The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Sminthian Marxism », New Left Review, n° 104, Juillet-Août 1977, p. 25-92. |
| ⇧21 | BANAJI Jairus (1977), « Modes of Production in a Materialist Conception of History », Capital and Class, n°3, Automne 1977, p. 19. |
| ⇧22 | Hindess et Hirst proposent plusieurs rectifications importantes à cette interprétation courante : « Bien que [le travailleur] puisse être propriétaire des outils de production ou avoir des droits de propriété sur la terre, et soit capable de subvenir à ses besoins, il ne maîtrise pas la reproduction des moyens et des conditions de production. Or, c’est principalement par le contrôle de la reproduction des moyens de production que le propriétaire foncier des terres, ou l’exploiteur, sépare le travailleur ou le fermier des moyens de production. Notons cependant que le contrôle de la production du surproduit en régime féodal, ainsi que la propriété et le fonctionnement de certains moyens de production importants (moulins, digues, etc.) sont d’importants moyens de contrôle des conditions de reproduction pour le seigneur. » HINDESS Barry et HIRST Paul (1975), Pre-Capitalist Modes of Production, Routledge & Kegan Paul, Londres, p. 238. |
| ⇧23 | Comme l’écrit George Homans, dans son analyse de l’Angleterre du treizième siècle : « Quiconque a étudié les coutumes féodales a du être frappé par leur incroyable précision. Par exemple, elles ne se contentent pas de préciser qu’un homme doit labourer, semer et aplanir le sol, elles précisent qu’il doit labourer avec autant de bœufs dont il dispose et semer avec des graines qu’il ira chercher au grenier seigneurial mais avec son propre cheval et son propre sac. Les tâches à effectuer étaient mémorisées avec le plus grand détail. Quand d’autres précisions – même les plus évidentes et nécessaires – n’étaient pas mentionnées par la coutume ou soutenues par une longue histoire, elles n’entraient pas dans les habitudes et étaient négligées. » NORTON W. W. (1975), English Villagers of the Thirteenth Century, New York, p. 272. Le portrait très statique adopté par Homans ne provient pas seulement de ses propres biais théoriques, mais aussi de la période particulière qu’il étudie et qui était l’une des plus structurée de l’histoire de l’Angleterre féodale. Pour une représentation plus vivante et nuancée, qui laisse place aux luttes pour la répartition des produits du travail, voir HILTON Rodney (1975), A Medieval Society: the West Midlands at the End of the Twelfth Century, Weidenfeld & Nicholson, Londres, ch. 5 ; POSTAN Michael (1975), The Medieval Economy and Society: an Economic History of Britain in the Middle Ages, Harmondsworth, Penguin Books, Londres, ch. 9. |
| ⇧24 | La fusion entre le contrôle et la coordination permet aux sociologues de faire l’impasse sur la nature capitaliste du travail industriel. |
| ⇧25 | Voir par exemple HILTON Rodney, « Freedom and Villeinage in England », Past and Present, n° 31, Juillet 1965, pp. 3-19. |
| ⇧26 | Cf. ALTHUSSER Louis (1971), Lenin and Philo and other essays, New Left Books, Londres, p. 182. Quand je demandais à mes collègues pourquoi ils travaillaient si dur, leur réponse illustrait cette apparente liberté manufacturée, limitée, et l’existence du consentement sur le lieu de travail. Une réaction courante consistait à m’adresser un regard étonné et à dire : « Tu trouves que je travaille dur ? » avant de repartir en ricanant. De nombreux travailleurs ne pensaient pas qu’ils travaillaient dur et considéraient même qu’ils rendaient à la direction la monnaie de sa pièce en ralentissant dès qu’ils le pouvaient. D’autres répondaient : « Il faut bien gagner sa vie ». Une telle réponse niait la différence entre le fait de venir travailler et l’effort fourni au travail – une distinction souvent mentionnée par des commentaires du type : « Au boulot, ce qu’il y a de plus dur c’est de venir au boulot », ou encore : « Que pourrais-je donc faire d’autre ici ? » ou enfin : « Ça fait passer le temps plus rapidement. On s’ennuierait si on ne travaillait pas ». Travailler dur était une manière de s’adapter aux difficultés liées à la routine, aux tâches monotones. Certains disaient : « Si on ne travaillait pas autant, la compagnie ferait faillite et on se retrouverait à la porte » – façon d’admettre l’existence d’un intérêt commun entre le travailleur et la direction. D’autres, comme mon collègue de l’équipe de jour, Bill, préféraient manifestement travailler dur que « glander ». Je pense que c’était la même chose pour de nombreux autres travailleurs, mais ils étaient peu nombreux à le reconnaître. Ce que je trouve intéressant, parmi toutes ces réponses, c’est que ni la peur ni la contrainte physique n’étaient mentionnées comme des incitations : les ouvriers supposaient qu’il y avait vraiment la possibilité de décider de l’intensité de leur effort. En outre, en se demandant s’ils travaillaient dur ou non, ils mesuraient leur attitude à l’aune des critères de la direction et reconnaissaient donc implicitement qu’ils pouvaient encourir des sanctions pour avoir « glandé » – mais de telles mesures disciplinaires étaient considérées comme légitimes, naturelles et inévitables. |
| ⇧27 | Marx évoque la mystification dont fait l’objet l’origine du profit dans le volume 3 du Capital, en particulier aux chapitres 2, 10, 48 et 50. |
| ⇧28 | Même en France et en Italie, où de nombreux travailleurs pensent que leur travail est la source du profit, et où les théories marxistes sont largement acceptées, rien ne prouve que ces conceptions déterminent directement l’intensité du travail, car les théories marxistes ne peuvent pas devenir une force matérielle – une idéologie – tant qu’elles ne s’incarnent pas dans une expérience particulière au travail. |
| ⇧29 | MARX Karl (1967), Capital, International Publishers, New York, 3, p. 168. |
| ⇧30 | Voir par exemple BRAVERMAN Harry (1974), Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York ; GORZ André (éd.) (1976), The Division of Labor,Humanities Press, Atlantic Highlands, New Jersey ; EDWARDS Richard, « The Social Relations of Production in the Firm and Labor Market Structure », Politics and Society, 5 (1), pp. 83-108. |