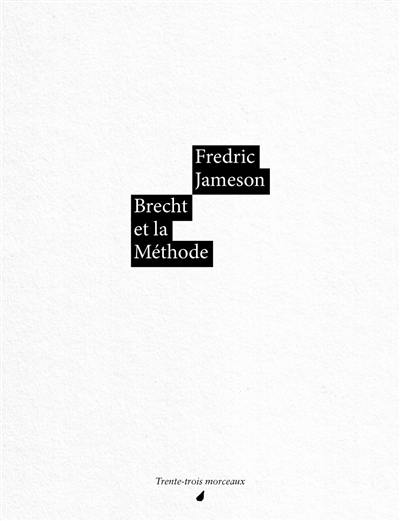
Les Editions Trente-trois morceaux viennent de publier la traduction de l’ouvrage de Fredric Jameson Brecht et la Méthode. A plus d’un titre cette parution est un événement. Elle l’est évidemment pour les (très dormantes) études brechtiennes en France. Mais son intérêt va bien au-delà : elle constitue une contribution majeure à l’appréhension des rapports de l’art et de la politique et à l’apport spécifique du marxisme à cette question.
Son traducteur Florent Lahache, auteur par ailleurs d’un important travail de doctorat sur Brecht, revient, dans l’entretien qui suit, sur la singularité et la productivité de la perspective proposée par Jameson.
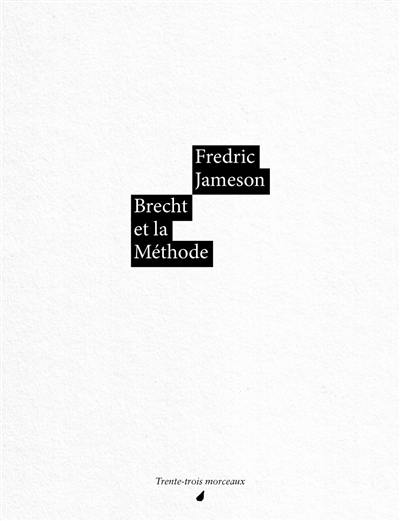
Contretemps – Peut-être faut-il commencer par situer cet ouvrage au cœur de l’œuvre de Jameson et le situer dans sa conjoncture (à laquelle il fait plusieurs fois références). Cet ouvrage paraît en 1998, une quinzaine d’année après qu’il ait étudié le postmodernisme et à l’heure où le marxisme est disqualifié et volontiers stigmatisé. Quel rôle peut alors jouer Brecht dans ce contexte, pour Jameson ?
Florent Lahache — Il y a de fait quelque chose qui ne va pas de soi dans ce travail monographique, l’impression que Jameson effectue une chicane entre ces deux grandes bornes que sont Le Postmodernisme (1991) et Archéologies du futur (2005)[1], et qu’il interrompt au moins partiellement son travail d’analyse du présent. Entre les lignes, c’est un livre très interrogatif, tant sur ses propres positions que sur le devenir du marxisme dans l’après-chute du Mur. Il faut mesurer aussi que se tourner vers Brecht à ce moment là n’a rien d’une évidence : on est alors en pleine « Brecht-fatigue », qui va de pair avec sa canonisation comme auteur scolaire et le développement d’études brechtiennes sur un mode parfois antiquaire. On est loin de l’excitation qui accompagnait sa lecture dans les années qui entourent 1968, quand Godard inscrivait son nom au centre du tableau dans La Chinoise. Brecht est un auteur qui mobilise dans les périodes chaudes ; la question est de savoir quel usage en faire dans une période de dépolitisation.
Brecht fait par ailleurs partie d’une constellation d’auteurs qui accompagne la réflexion de Jameson depuis ses premiers textes. Il a cependant dans ce corpus un statut particulier : à la différence d’Adorno, de Sartre, de Hegel et de Marx, auxquels il a également consacré des ouvrages, Brecht n’est pas un philosophe. Plus encore, il entretient à l’égard de la philosophie une attitude assez ironique, moqueuse, essentiellement parce qu’il soupçonne la pensée abstraite d’avoir partie liée avec l’idéalisme bourgeois. Par contraste, il cherche à développer une dialectique plus directement embarquée dans les choses, dans la matérialité prosaïque des intérêts et de la conflictualité sociale. La dialectique est pour lui une manière un peu rusée de raccourcir le pas entre l’intellectuel et le matériel, de cerner des causalités sans multiplier les médiations, parce qu’il pense qu’il y a des simplifications éclairantes. « La bouffe d’abord, la morale ensuite » est pour lui une simplification éclairante, traduite de Marx dans une langue triviale. Brecht s’amusait qu’on puisse qualifier cette attitude de « marxisme vulgaire », et c’est de toute évidence un aspect qui intéresse Jameson. Il suggère dans l’ouvrage que cette « pensée balourde » revendiquée par Brecht constitue une bonne thérapie contre la sur-sophistication marxiste. On pourrait ajouter : une bonne thérapie dans un contexte d’académisation du marxisme. Car le moment où celui-ci se voit politiquement disqualifié correspond aussi à sa réduction au statut d’objet d’étude pour universitaires, de fétiche un peu mort. Or Marx n’est justement pas pour Brecht un objet de commentaires savants. Quand il en rencontre la théorie à la fin des années 1920, c’est dans une période de crise, une panne d’écriture que la lecture de Marx va aider à dénouer. Brecht entretenait aux idées un rapport de nécessité, et non de complément accessoire purement conversationnel. Sa « vulgarité » intellectuelle est en fait une manière de ne reconduire un rapport ni autoritaire ni anecdotique à la pensée. C’est cela que Jameson vient chercher chez Brecht. Dans le même mouvement, je pense qu’il vient également chercher l’humeur brechtienne, la gaieté brechtienne, perceptible dans son rapport au savoir, dans le plaisir du récit autant que dans son éloge du changement et de la nouveauté. Il faut se souvenir que l’époque où il rédige ce livre est marquée par la montée en puissance de la mélancolie de gauche ; c’est le moment où, autour de la relecture de Benjamin, se développe une atmosphère de deuil politique, qui a partie liée avec un discours de l’impuissance et de la rumination. Cette mélancolie est perceptible à l’arrière-plan du livre, à ceci près que Jameson n’entend rien y céder. Il perçoit dans l’humeur brechtienne un antidote, d’autant plus efficace pour nous qu’il ne s’est pas constitué dans l’euphorie des avant-gardes ou de la révolution de 1917, comme on le dit parfois, mais inversement dans une expérience catastrophique de l’histoire. La gaieté brechtienne fait corps avec une expérience de la désillusion. Dans ce froissement l’un dans l’autre de la désillusion et de la gaieté, il y a pour Jameson quelque chose d’utile à mobiliser, au moment où l’histoire moderne de la révolution apparaît comme irrévocablement devenue chose du passé.
CT – Pourrais-tu présenter la structure générale du livre qui peut décontenancer et éventuellement le mode argumentatif de Jameson : comment réfléchit-il et présente-t-il sa réflexion ?
FL — Lire Jameson est certainement une expérience déconcertante, il y a une série de raisons à cela. La plus évidente tient à son écriture même, qui n’est pas conforme à la prose théorisante française et à son idéal de la belle formule que l’on peut prélever et isoler à la manière d’un aphorisme. Son écriture procède davantage par chaînage et contiguïté. C’est visible dès les premières pages : Jameson ouvre sur la notion d’utilité, qu’il chaîne à celle du didactisme, puis à celle de la méthode, puis à celle du savoir, puis du plaisir de savoir, etc. Elle repose sur des changements de vitesse, le passage d’un style allusif à une très grande précision de détail, d’une rhétorique ordinaire à des moments où la syntaxe devient folle, le complément d’objet se perdant dans des incises, et qui débouchent sur de subites épiphanies théoriques – dans ces pages, son écriture a quelque chose d’euphorique, d’un peu ivre. Lire Jameson suppose d’entrer dans cette temporalité à la fois filée et irrégulière, qui travaille dans une marche dialectique qu’on ne peut arrêter sans manquer la dimension kaléidoscopique de sa construction.
Une autre raison est plus directement méthodologique : Jameson procède par « métacommentaire[2] », c’est-à-dire analyse ses objets en même temps que sa propre situation de lecture. Pour cerner ce que « Brecht », comme nom d’une totalité singulière, signifie pour nous aujourd’hui, il cherche à ressaisir des sédimentations culturelles, à découper des « monades chronologiques » – le Brecht de Weimar, celui de l’exil, celui de Hollywood, celui du Berliner Ensemble, mais aussi le Brecht de Benjamin, celui de Barthes, celui de Heiner Müller, le Brecht des années 1960, celui des pays du tiers monde ou le Brecht lu dans le contexte de la mondialisation. Dans ce travail de périodisation, Jameson redéfinit constamment son objet et multiplie les échelles d’analyse.
Tout cela, sans doute, peut décontenancer. Mais le livre est par ailleurs très charpenté. Pour te répondre sur la structure du livre, on peut dire sommairement qu’il se décompose en trois mouvements. Le premier est consacré aux implications philosophiques de l’œuvre de Brecht (à partir des concepts de distanciation, d’autonomisation des unités narratives, de séparation et du jeu « à la troisième personne »). Le second interprète les régimes de sens des dispositifs brechtiens (à travers la réflexivité, le gestus, les formes brèves, la question de la « fable », de la parabole et la teneur allégorique de ces différents éléments). Le troisième examine les mondes socio-politiques mis en jeu dans les récits brechtiens sous l’angle de leur temporalité spécifique et souvent hétérogène (mondes paysan, chinois, médiéval, industriel et capitaliste), c’est-à-dire dans leur rapport aux modes de production. Ces trois parties centrales sont elles-mêmes encadrées par un « Prologue » et un « Epilogue » assez conséquents qui mettent en perspective les situations historiques de lecture et leur actualité.
CT – Une question qui a trait à la traduction : qu’est-ce qui a constitué, pour toi, la plus grande difficulté ou surprise dans ce travail que tu as mené sur plusieurs années.
FL — Traduire implique de se mettre dans les pas d’un mode de pensée. En l’espèce, c’est un livre dans lequel l’auteur est comme chahuté par son objet : en le suivant phrase à phrase, on perçoit les difficultés, les bifurcations ou les repentirs. C’est sensible par exemple dans les marqueurs métadiscursifs auxquels Jameson est par ailleurs coutumier (« j’y reviendrai », « tournons nous désormais vers cette question », etc.), parce qu’ils donnent le sentiment que Jameson peine à maîtriser cet objet conceptuellement instable qu’est le brechtisme. Ces tics de langage ne sont pas emplis d’assurance, cela m’est apparu en le traduisant. Il y a là cependant quelque chose qui relève aussi d’une « méthode », le parti pris de ne pas masquer les difficultés, mais au contraire de les rendre visibles. Jameson dit ailleurs que l’erreur du commentaire est souvent de contourner les obscurités au lieu de les traiter comme telles. Cela suppose de travailler sans faux-semblants, ce qui n’est pas si fréquent dans le discours théorique, dont il faut bien dire que c’est souvent un genre de show, de démonstration de force intellectuelle. Dans ce cadre, ma position de traducteur a été d’essayer d’être pour ainsi dire aussi brechtien que possible, c’est-à-dire d’aller aux conséquences et de rendre le texte maniable pour un lecteur français.
CT – Un dernier point général : quels sont les outils théoriques de Jameson ? A partir de quels instruments travaille-t-il cette œuvre ? Et que travaille-t-il d’elle (il est peu question par exemple des mises en scène faites). Plus spécifiquement, comment peut-on caractériser ici son marxisme ? Autrement dit, en quoi son analyse serait-elle marxiste ?
FL — La question du marxisme de Jameson mériterait un entretien en soi, mais je crois en l’occurrence plus intéressant de dire ce qu’il invente que ce à quoi il se conforme (ce qui est vrai du reste de Brecht également). On présente généralement Jameson comme un théoricien marxiste du postmoderne, mais c’est d’abord quelqu’un qui vient de l’analyse littéraire, qui a travaillé sur les traditions formaliste et structuraliste, et qui peut mobiliser aussi bien Adorno et Hegel que Bakhtine et Lévi-Strauss pour construire le cadre d’une herméneutique qui, en effet, est marxiste. Son opération première est de réhabiliter le geste interprétatif à un moment où il s’est trouvé massivement déconsidéré dans l’analyse littéraire, et où il ne va pas de soi non plus dans la théorie critique – rappelons que Marx lui-même récusait l’interprétation au profit de la transformation du monde. Jameson postule que l’époque impose pourtant d’y revenir, pour la bonne raison que le moment postmoderne a fait du capital une expérience opaque et déshistoricisée. Son coup de force est de montrer comment cette opacité est l’objet d’un travail de figuration qui se donne à lire dans les œuvres, qui peuvent dès lors fonctionner comme un levier d’analyse de conjonctures indissociablement culturelles et politiques.
Pour mener ses interprétations, Jameson ne craint pas de puiser dans des traditions hétérogènes au marxisme, de la patristique à la phénoménologie, de Machiavel à Lacan ou Deleuze. Ces emprunts n’ont rien d’un bidouillage théorique arbitraire, comme on peut l’observer parfois dans les Cultural studies : ils répondent d’une attention à ses objets, d’une difficulté rencontrée à même l’analyse. Il se peut par exemple que le corpus marxiste ne soit d’aucune utilité particulière pour caractériser la structure du dilemme que Brecht met en scène dans nombre de ses pièces – y compris celles les plus en prise avec le Parti, comme Celui qui dit oui, celui qui dit non. Jameson s’appuie alors sur le livre d’André Jolles, Formes simples, pour détourer la logique « casuistique » qui anime la pensée brechtienne et l’inscrire dans la tradition populaire du récit à « problème », du « cas épineux » qui oblige à repenser nos catégories de jugement. Mobiliser un linguiste hollandais, théoricien mineur au destin obscur, s’avère ici singulièrement éclairant, y compris pour ressaisir quelque chose du marxisme de Brecht, le rôle qu’il fait jouer à la contradiction par exemple.
Cette manière d’élargir la focale trouve son pendant dans la façon dont il aborde le corpus brechtien, pour ainsi dire à plat, en intégrant tous les éléments de sa production : pièces, poèmes, essais, journaux, romans, scénarios, nouvelles, fragments. Certains textes mal connus ou considérés comme marginaux sont mis sur le même plan que les plus célèbres : des poèmes des années 1920, le Roman de quat’sous, Me-ti, Le Vol des Lindbergh aussi bien que La Vie de Galilée, Mahagonny ou Le Cercle de craie caucasien. Ce traitement a pour effet de « défamiliariser » une œuvre qu’on méconnaît à force de la fréquenter toujours par les mêmes entrées. Cela peut étonner que Jameson ne privilégie pas le théâtre, et qu’il interroge effectivement peu les mises en scène, mais c’est sans doute parce qu’il perçoit Brecht avant tout comme l’inventeur de structures narratives. Peut-être est-ce aussi une réception assez française de traiter Brecht presque exclusivement sous le prisme dramaturgique ; en Allemagne, il n’est pas rare qu’on le caractérise plus largement comme un « Dichter », un écrivain ou un poète.
CT – La thèse centrale de Jameson est que « Brecht n’a jamais eu à proprement parler de doctrine. […] ses propositions et ses leçons […] relevaient davantage d’une méthode que d’un ensemble de données, de pensées, de convictions, de principes premiers, etc » [3]. Peux-tu expliquer ce qu’il entend en ce cas par « méthode » et les conséquences de cette proposition sur la perception possible de cette œuvre ?
FL — Avant d’être une thèse, l’idée d’une méthode propre à Brecht est le nom d’un problème : comment circonscrire le noyau du brechtisme, sa substance singulière ? Ce noyau doit bien exister puisqu’une unité est palpable, quelque chose comme un « esprit brechtien » qui parcourt l’ensemble de son œuvre, aussi bien dans ses inventions scéniques que dans ses théories sur la radio, dans son style de réplique, dans l’usage des images poétiques que dans son rapport à la modernité urbaine. La difficulté est qu’il prend des figures si vagues qu’il semble impossible à localiser : un certain sens de la ruse, une manière de retourner l’adversité, une tonalité cynique ou une forme de pragmatisme. Comment théorise-t-on au juste un « état d’esprit » ou une « tonalité » ? Le point de départ de Jameson réside dans un constat négatif, celui d’un effet de dérobade : il y a manifestement une pensée brechtienne, mais celle-ci semble s’appuyer davantage sur des procédures que sur une axiomatique. Affirmer que le brechtisme repose sur une méthode est donc une manière de cadrer cette difficulté : la méthode sera le grand « X », ce qu’il faudra déterminer. Et derrière la sobriété du titre, Brecht et la Méthode, on peut entendre comme une allusion aux romans d’épopée, la poursuite d’une quête dans un roman médiéval.
On pourrait objecter qu’il n’y a là rien de spécifique et rappeler que la pensée de Hegel, de Marx, de Saussure ou de Husserl reposent également sur une méthode plutôt que sur un corpus d’idées, ou que la méthode et la doctrine sont chez eux une seule et même chose. Mais Jameson entend démontrer que le brechtisme n’est précisément pas un système d’idées. Il écarte ce faisant une approche séduisante, celle de traiter Brecht comme un théoricien intermittent dont on pourrait reconstituer la doctrine – parti pris à contre-courant des lectures philosophiques, dont il faut bien reconnaître qu’elles sont insatisfaisantes. La singularité de cette méthode selon Jameson est qu’elle est indissociablement une pratique narrative (des récits et des mises en scène), un style (une manière d’écrire) et un mode de pensée (des propositions et des concepts). Pour saisir le brechtisme, il faut se placer à l’intersection de ces trois domaines : la méthode n’existe pas sur un territoire intellectuellement constitué, mais dans une sorte de triangle des Bermudes narratif, stylistique et théorique. Il arrive à Jameson de dire que le résultat de cette intersection s’exprime dans une « Haltung », une attitude ; il souligne en ce sens que Brecht nourrissait le projet de développer une éthique communiste, un pendant individuel à la « doctrine des rassemblements » que constitue pour lui le marxisme. Le fait est qu’il s’agit d’une méthode en situation, d’une méthode pratique. On ne peut saisir ce qui l’anime si l’on oublie que Brecht cultivait une certaine hostilité à l’égard des constructions trop spéculatives ou trop massives. S’il y a une méthode brechtienne, c’est une approche dans laquelle le général est toujours mis en tension par le particulier, l’absolu par le relatif, et toujours rapportée à des sujets dans un contexte donné. Raison pour laquelle elle n’est pas formalisable ; et raison pour laquelle aussi on ne peut pas la donner en une phrase : elle s’actualise dans des occurrences. Jameson en décrit les traits, la façon dont elle amène à renverser les hiérarchies d’un problème, à faire d’une difficulté une solution, à produire des issues dans ce qui semble être une impasse. C’est une méthode de frayage. Evidemment, à la fin des fins, cette méthode s’avère être une expression de la dialectique – chez Brecht lui-même, l’identité de ce qu’il appelle parfois « la grande Méthode » et de la dialectique ne fait pas de mystère. Encore faut-il voir ce qu’il advient de la dialectique après un tel usage casuistique.
CT – Jameson insiste sur l’attraction pour le Novum de Brecht, la « célébration du changement » et de la transformation (Brecht, selon lui, « affirme que le marxisme est certes une science, mais seulement au sens figuré de ce qui accompagne et théorise le Nouveau » [4]). Il en fait un point décisif. Quelles sont là encore les singularités de Brecht au sens où le « changement » est une catégorie relativement récurrente des œuvres progressistes. Et comment ce Novum s’articule-t-il (ou pas) à la perspective utopique ?
Insister sur le changement permet à Jameson de thématiser une double préoccupation brechtienne, à savoir le plaisir libératoire que procure l’invention, et la désolation devant des impuissances socialement entretenues – ce qu’aujourd’hui on qualifierait de « naturalisation des faits sociaux » et que Brecht formulait dans des termes qui procèdent davantage de Hegel (« ce qu’on laisse inchangé pendant longtemps paraît en effet inchangeable »). Le concept de Novum est emprunté à Ernst Bloch et son travail sur l’utopie ; il est aussi exploité par Darko Suvin à propos de la science-fiction. Il permet de désigner un régime d’événements qui viennent dérégler l’histoire, perturber des contraintes qu’on pense inébranlables. Jameson y recourt pour réfléchir aux limitations représentationnelles devant le cours de l’histoire, en particulier à cette forme d’auto-censure que génère le moment postmoderne : comment imaginer une alternative à la domination quand tout concourt à sa perpétuation ? L’importance que Jameson accorde au Novum a dans le livre quelque chose de stratégique, qui renvoie à la conjoncture politiquement dépressive que tu évoquais dans ta première question. Dès lors qu’il intervient dans l’histoire comme un clinamen, comme une déviation imprévisible, le Novum permet de penser l’advenue d’un élément révolutionnaire d’une manière non programmatique, de sortir de la fausse alternative entre volontarisme et fatalisme. Dans une période qui semble ne laisser aucune place à la praxis, où le marché poursuit inexorablement son cours, mobiliser ce concept permet de sortir d’un rapport de pure déploration à l’histoire. Jameson a un très beau passage sur l’endurance et l’optimisme inhérents aux dialecticiens, quand l’histoire se présente entourée de nuages noirs – Brecht affirmait en ce sens que « les révolutions se passent dans des culs-de-sac ». L’effet de nature dans la société étant l’adversaire explicite de Brecht, l’affinité de cette problématique à sa pensée est assez manifeste : le Novum est ce qui vient chez lui distancier ou étrangéiser l’histoire elle-même, la sortir de sa dimension d’implacable nécessité. Jameson souligne à quel point son intérêt pour le Novum anime toute sa pensée, sur le plan des innovations artistiques, mais aussi de son intérêt pour les inventions modernes en général (techniques, scientifiques, médiatiques, etc.). Ce qui ne veut pas dire que Brecht cède au simple éloge de la nouveauté pour elle-même. Sa fameuse maxime, « ne pas se raccorder à la bonne vieillerie, mais plutôt à la mauvaise nouveauté », indique assez la possibilité que le devenir soit problématique – et qu’il faille pourtant s’en saisir. Jameson fait voir sous cet angle comment son écriture est orientée par quelque chose qui n’est ni l’échec ni la réussite, mais l’apparition fugace d’un possible utopique qui se referme aussitôt : une poétique du « presque », du bref moment où chacun a entrevu ce qui a failli advenir, aurait pu advenir dans d’autres circonstances, et qui du fait même qu’il a été entrevu n’est pas complètement mort. Cette poétique du « presque » amène Brecht à circuler dans l’histoire pour mettre en scène de tels moments de vacillement. Cela explique aussi la cohérence que masque l’hétérogénéité des temporalités dont il s’empare, cet arc tendu qui va des mondes précapitalistes jusqu’à la pointe de la modernité technique.
CT – Jameson fait de Brecht un grand dialecticien, il rend compte de l’importance dans son œuvre et sa pensée de la Trennung (séparation) et de la contradiction. Il cherche à faire valoir la particularité de son marxisme et il le situe, me semble-t-il, dans la centralité accordée à la dialectique dans son œuvre, au primat donné à la contradiction. Comment peut-on dès lors la spécifier en regard d’autres œuvres dialectiques ?
FL — Ta question implique de savoir ce que signifie pratiquer la dialectique en artiste : comment une théorie peut-elle devenir une source de récits et de représentations ? Une telle transposition ne va pas de soi ; elle est même risquée si elle conduit à des pratiques illustratives (version désolante de l’« artiste politique »). Or Brecht n’était pas simplement un lecteur de Marx, mais un écrivain qui s’est servi du marxisme pour inventer des modes d’écriture et de mises en scène. Pour le saisir, je peux essayer de retracer une des réflexions qui traverse le livre.
Jameson souligne à quel point la forme de l’alternative est présente chez Brecht, combien le théâtre épique repose sur une esthétique de la décision : il montre ce qu’il fait (il est anti-illusionniste pour cette raison) et il tend par là-même à montrer ce qu’il ne fait pas (pour qu’une décision soit rendue visible, il faut montrer qu’une autre décision aurait été possible). L’enjeu proprement artistique qui en découle est de parvenir à faire consister sur scène les disjonctions, c’est-à-dire de représenter ce qui n’aura pas eu lieu, qui n’est que virtuel. En un sens, tous les concepts brechtiens (gestus, distanciation, non-pas-mais, séparation, pièces didactiques, etc.) peuvent se ramener à cette problématique : représenter sur scène la coexistence des possibles. Jameson fait alors apparaître un Brecht qui n’est pas si familier, un Brecht occupé par le devenir, par des multiplicités ontologiques, par la ligne de tension entre l’être et le non-être des choses, et qu’il rapporte notamment à son inspiration orientale ou héraclitéenne. Le rôle de la dialectique est décisif à cet endroit. Car Jameson se livre simultanément à un exercice critique : il a clairement à l’esprit la valorisation contemporaine de la multiplicité et des flux, la façon dont une certaine version du deleuzisme officie comme air du temps : l’idée d’une hétérogénéité sans contradiction, d’une pure différenciation non dialectique. A un certain niveau, Jameson suggère que l’esthétique brechtienne n’est pas sans affinité avec cette conception : on trouve bien chez lui, notamment dans sa poésie, une passion pour le jeu des multiplicités, dans ce moment où elles sont encore suspendues, indécises, pures différenciations. Mais ces différenciations n’ont d’intérêt chez lui que du point de vue des pures nouveautés qu’elles font surgir. La fonction de la dialectique, dans son sens le plus massivement hégélien, est ici capitale : les différences se voient dans son théâtre toujours rapportées les unes aux autres, non seulement quant à leur opposition, mais aussi et surtout quant aux réorganisations, aux transformations, c’est-à-dire littéralement aux révolutions qu’elles provoquent. C’est là un point essentiel pour Jameson : l’esthétique brechtienne des alternatives et des virtualités intègre mais dépasse la seule contemplation des différenciations parce qu’elles les dialectisent. Sans cette intervention de la contradiction, la pensée de la multiplicité achoppe sur la question du révolutionnaire. On perçoit par là, même résumé à ce niveau de généralité, le rôle que la dialectique joue pour Brecht dans son travail dramatique : elle n’est pas seulement une théorie mais une sensibilité, un rapport au monde et une manière de le raconter. On perçoit également la façon dont elle peut nous servir dans les discussions contemporaines.
CT – Jameson revient sur la fameuse « distanciation » à laquelle Brecht est généralement associé avec toutes les difficultés de traduction que comporte le terme de Verfremdungseffekt. En quoi consiste l’apport jamesonien à la compréhension de cette opération de « défamiliarisation » ou « d’étrangéisation du réel » ?
FL — Jameson postule que la distanciation n’est pas centrale dans le dispositif de Brecht, qu’elle n’est qu’un nom parmi d’autres de sa méthode. Reste qu’elle est centrale dans la réception de son œuvre, à laquelle elle est en effet associée de manière métonymique – parler de Brecht, c’est parler de distanciation et inversement. Jameson s’en sert donc comme d’un levier pour aborder l’historicité de sa pensée. En l’occurrence, au moment où il rédige Brecht et la Méthode, cette notion rencontre un point de butée : la lassitude dont Brecht a fait l’objet à partir des années 1980 touche exemplairement la distanciation, identifiée à une procédure moderniste, intellectualiste et froide, que le moment postmoderne répudie comme charriant une conception élitiste de l’art. C’est évidemment un cas de complète mésinterprétation (Jameson rappelle comment Brecht se figurait son public : commentant ses pièces avec détachement comme on le ferait pour un match de boxe) ; mais c’est le lot sans doute de tous les idéaux modernistes que d’apparaître renversés dans la configuration culturelle qui lui succède.
Partant, Jameson cherche à replacer la distanciation à l’intérieur d’une histoire plus large. Il la resitue comme une stratégie héritière des Lumières et de la critique de la religion, avec cette particularité d’être simultanément un opérateur artistique et un concept critique : elle s’actualise aussi bien chez des écrivains (chez Voltaire, Swift, Tolstoï, Proust, etc.) que chez des théoriciens (chez Sartre, chez Barthes et dans le poststructuralisme à sa suite). A chaque fois, son effet est de révéler les institutions comme étant les produits d’une histoire humaine qui, comme tels, peuvent être modifiés – c’en est l’aspect proprement politique. A ce titre, Jameson postule qu’elle constitue le noyau de la critique moderne en général. La question est cependant de savoir quelle pertinence elle conserve pour nous aujourd’hui : dans quelle mesure le sujet contemporain est-il encore soumis à l’illusion d’une naturalité des institutions humaines ? Cette question est cruciale, car elle touche aux apories actuelles de la critique de l’idéologie, au présupposé inégalitaire d’une critique fondée sur un principe de dévoilement ou de démystification. Jameson suggère que la distanciation s’est infléchie ces dernières années dans d’autres directions, notamment vers le domaine linguistique (dans une critique de type nominaliste) et celui des présupposés métaphysiques (dans les diverses formes de déconstruction). Mais il avance aussi une hypothèse intéressante, à savoir que nombre de procédures critiques postmodernes (dans la théorie Queer et tout le continent des Cultural studies) ont assimilé l’anti-essentialisme de la distanciation et opèrent à l’intérieur d’un cadre brechtien sans le dire, sans doute même sans le savoir. C’est un point décisif dans l’argumentaire de Jameson, car il permet de penser que nous n’avons d’aucune manière besoin d’opérer un « retour » à Brecht, puisqu’il est en fait déjà partout présent. C’est sans doute une interprétation maximaliste, mais elle permet de comprendre pourquoi Jameson refuse la tentation d’« actualiser » Brecht, de construire un Brecht post-marxiste, postmoderne ou adapté à la culture de masse : selon lui, nous n’en avons simplement pas besoin.
CT – Jameson insiste sur la question économique et celle de sa représentation : les rapports de Brecht à la représentation du Capital. Quels sont les grands enjeux politiques et artistiques de cette gageure brechtienne ?
FL — Comment représenter le capitalisme, c’est-à-dire non seulement dans ses parties (l’argent, la marchandise ou le travail) mais en tant que système général ? Cette question constitue un véritable point de rencontre des préoccupations de Brecht et de Jameson. Chez ce dernier, elle est au cœur de son travail sur la postmodernité. La résistance qu’opposent les mécanismes du capitalisme mondialisé à être représentés l’amène à théoriser le concept de « cartographie cognitive », qui s’adosse chez lui à un théorème : le degré d’aliénation d’un sujet est proportionnel à son incapacité à se représenter le système social ; dit autrement, moins un sujet est capable de comprendre sa position au sein de la totalité, plus grande est son impuissance. Au moment où les centres du pouvoir s’exilent hors des traditionnelles figures étatiques vers des entités multinationales anonymes, ce travail de représentation devient un enjeu politique décisif : c’est une manière de repenser les conditions d’émergence d’une conscience de classe. Dans cette conjoncture, Jameson trouve un laboratoire dans les œuvres, à commencer par celles issues de la culture de masse, le cinéma de complot notamment.
Chez Brecht, on trouve un intérêt premier pour la violence inhérente à l’échange marchand, qui motive le déroulement de pièces comme Dans la jungle des villes ou Homme pour homme, et le conduit à mettre en scène la psychologie sociale d’une série de personnages – escrocs, mendiants, gangsters, usuriers, hommes d’affaires. Mais Brecht rencontre plus précisément la question de la représentabilité de l’économie à la fin des années 1920, au moment où il effectue des recherches sur le fonctionnement de la spéculation boursière pour l’écriture d’une pièce qui n’aboutit pas (personne, raconte-t-il, n’était en mesure de lui expliquer la rationalité des phénomènes boursiers, pas même les spéculateurs). C’est à cette occasion qu’il entreprend la lecture de Marx, puis qu’il écrit ces grandes pièces dont le capitalisme, comme forme anthropologique singulière, est l’objet : L’Opéra de quat’sous, Mahagonny, Sainte Jeanne des Abattoirs, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, mais aussi ce film méconnu qu’est Ventres glacés.
La représentation du capital constitue donc un terrain d’investigation commun. Le point intéressant est cependant que leurs approches ne sont pas tout à fait convergentes. Car Brecht ne s’inscrit pas dans la lignée littéraire à laquelle Jameson est attachée, et qui a historiquement pris en charge ces questions, à savoir la tradition du réalisme. Sur ce point, Jameson se trouve comme divisé entre Brecht et Lukàcs – celui-ci reprochait justement à Brecht d’être un moderniste davantage préoccupé par les inventions formelles que par le réalisme politique de ses œuvres. En pratique, la difficulté centrale repose sur l’ambivalence que Brecht entretient à l’égard de l’abstraction : il lutte tendanciellement contre la montée en généralité, à laquelle il préfère la problématisation du particulier (« la vérité est concrète » est l’un de ses leitmotivs), à ceci près qu’il doit justement construire un point de généralité pour saisir le capitalisme comme système. D’où le fait que Jameson juge les pièces de Brecht à la fois géniales et boiteuses. Cela donne l’occasion d’un des chapitres les plus intéressants du livre à mon sens, Jameson passant en revue les différentes options qui se présentent à Brecht, mais aussi à Balzac, à Zola ou à Eisenstein : faut-il mettre l’accent sur la psychologie des agents soumis au capital, propriétaires, spéculateurs, ouvriers, chômeurs ? Ou bien sur des choses, l’argent, les matières premières, les marchandises ? Ou encore sur des institutions, comme la Bourse, l’Armée du salut ? Ou sur des processus – non pas la richesse ou la misère en elles-mêmes, mais l’enrichissement et la paupérisation ? Comment alors faire tenir la totalité du circuit de la valeur dans un récit – production, distribution et consommation ? Toute la complexité est que le capital ne peut se représenter que comme un système en mouvement, dans une forme qui réunirait synchroniquement l’ensemble de ces entrées.
CT – Une autre affirmation majeure du livre tient au modernisme de Brecht (« par ses discontinuités et sa profonde fragmentation[5] »). Mais en quoi alors ce moderniste peut-il être utile au temps du postmodernisme ?
FL — Brecht occupe une place étrange au sein de la modernité artistique. Par ses expérimentations scéniques, il s’inscrit dans le paradigme des avant-gardes modernistes ; par l’intérêt qu’il accorde à la fonction politique de l’art, il paraît s’en éloigner symétriquement. Son projet semble reposer simultanément sur un idéal d’autonomie formelle et sur une hétéronomie discursive : on a pu lui reprocher d’être tantôt trop formaliste, tantôt de ne l’être pas assez ; lui-même a pu alterner entre rejet et défense des propositions modernistes (musicales et picturales en particulier). Ce problème est plus largement celui de l’art militant : comment faire en sorte que l’élaboration formelle ne soit pas écrasée par un « message » qui la nullifie ? Brecht porte ce problème à un point de tension maximale parce qu’il revendique la portée didactique de son théâtre. Un tel didactisme a toutes les raisons d’être banni pour les modernes : il réduit l’œuvre au statut d’illustration d’un propos, d’ornement formel d’un contenu qui le précède et le domine, quand l’idéal esthétique du formalisme repose au contraire sur l’identité de la forme et du contenu.
C’est à ce paradoxe d’un Brecht moderniste anti-moderniste que Jameson s’intéresse, et qu’il dénoue en montrant que Brecht invente une forme de didactisme singulier parce que fondamentalement réflexif : sa pédagogie n’a pas de contenu autre que la pédagogie elle-même. L’œuvre enseigne bien quelque chose, mais ce qu’elle enseigne, c’est la manière dont quelque chose s’enseigne – ainsi, La vie de Galilée. Il y a bien quelque chose à apprendre, mais ce qui s’apprend est l’apprentissage lui-même : comment on apprend ou, le cas échéant, comment on échoue à apprendre – c’est Mère courage. Autrement dit, le « contenu » des pièces ne repose pas sur telle ou telle idée, mais sur les processus idéatifs eux-mêmes : par quelles circonstances une pensée ou un jugement adviennent-ils ? Quelles en sont les conséquences pratiques ? Quel genre d’individu une opinion fait-elle de vous ? Dans ce cadre, l’efficacité des textes brechtiens est de mettre l’accent sur la forme-problème, sur la puissance de perturbation des dilemmes (on retrouve ici la structure de l’alternative) et non sur une doctrine que les pièces délivreraient de manière professorale ou moraliste. Comme le disait Barthes, l’apport de Brecht est de débarrasser le théâtre politique du prêche : c’est la salle qui juge, pas la scène.
L’utilité de ce modernisme pour nous aujourd’hui me paraît assez limpide de ce point de vue. Jameson fait remarquer que la culture postmoderne est moins farouche à l’égard du didactisme que ne l’étaient les artistes modernes – quelle œuvre aujourd’hui ne revendique pas un propos ? – et que c’est inversement l’attitude formaliste qui se trouve discréditée. A vrai dire, la culture contemporaine est même plutôt saturée de discours. En extrapolant le texte de Jameson, je dirais que la difficulté est que ces discours ne font qu’alimenter l’état des choses. Il existe un corpus d’idées « progressistes » ou « critiques » ordinairement disponibles (sur la crise climatique, la fascisation ambiante, le sort des migrants ou les inégalités sociales) qui peuvent être indéfiniment mises en circulation sans avoir la moindre conséquence, précisément parce que leur mode de circulation et leur forme même sont peu interrogés. Le didactisme brechtien permet de penser que l’enjeu est moins de produire davantage de discours que de trouver des opérations qui suspendent le flux des discours. Le théâtre épique repose sur des techniques d’interruption qui mettent au premier plan les interrogations plutôt que les affirmations, un revers du savoir qui n’est pas l’ignorance, mais la fonction active et contrariante du problème. Cette manière de problématiser nos expériences est sans doute plus utile aujourd’hui que de les recouvrir de partis pris qui n’engagent à rien.
CT – Si l’on parle d’études brechtiennes, quelles seraient les pistes qu’il te semblerait nécessaire de poursuivre, d’actualiser que met au jour Jameson ?
FL — On pourrait en énumérer un certain nombre. Je me limiterai à deux propositions un peu inattendues que Jameson ne développe pas mais qui me semblent intéressantes à considérer au-delà même des études brechtiennes. La première touche à la théorie du sujet mise en jeu par la distanciation, qu’on interprète communément comme opposée à l’identification, au théâtre aristotélicien, etc. Pour Jameson, le théâtre épique repose plutôt sur l’idée que l’identification n’a en fait aucune réalité : le jeu « à la troisième personne » est d’après lui la conséquence logique du fait que l’identification est une notion inconsistante. C’est un mode de représentation qui prend acte de la nature imaginaire du Moi, pour le dire en termes lacaniens, et tout théâtre qui prétend le contraire se soutient d’une duperie. Si l’on a pu objecter à Brecht que le blocage de l’identification était aberrant ou impossible, Jameson renverse donc le sens de l’objection : c’est bien plutôt l’identification qui est aberrante ou impossible. Ce retournement prend la doxa brechtienne un peu à contrepied, mais il est en réalité assez fidèle à Brecht. Il fait apparaître le sujet comme une pure fonction impersonnelle, comparable à un connecteur sémiotique ou narratif : sans contenu propre, qui n’a d’importance que par ce qu’il permet d’articuler à l’intérieur d’une trame d’événements et de matériaux épars. Prise au sérieux, cette hypothèse permet de problématiser une série de prénotions, comme celles d’intersubjectivité ou l’opposition entre individu et collectif – en fait, une bonne part de la psychologie implicite des sciences sociales et de notre manière de penser la politique. Toutes ses propositions sur l’art du comédien touchent en ce sens la théorie politique également. Dans ses essais théoriques, Brecht avait tenté d’élaborer une approche marxiste du rapport entre groupe et individu, en se servant du concept de dividuum, qui pose le sujet non comme un atome mais comme un agrégat de collectifs. Jameson rappelle qu’il concevait le marxisme comme une théorie de l’association des sujets dans un contexte d’agon généralisé, qui permet de penser l’individu autrement que comme une substance insécable et le groupe autrement que comme une foule anonyme abolissant l’individualité. Il y a sur ces questions un terrain de travail intéressant à reprendre, à la fois pour relire un Brecht délesté des querelles sur l’identification, et pour penser la politique à partir des expériences dramaturgiques.
La seconde proposition touche à la conception brechtienne de la critique. Jameson fait l’hypothèse que Brecht se tient constamment à distance des formes traditionnelles de critique de l’idéologie, de leur manière de ranger les discours, de les rapporter à des catégories préconstituées comme celle d’intérêts de classe, de mystification, de superstructures bourgeoises, etc. Cette approche classificatoire est pour lui une manière métaphysique d’aborder la critique, de ranger le monde social sous des concepts plutôt que d’interroger les effets pratiques des textes, des œuvres ou des opinions. Jameson montre exemplairement sur ce point quel genre de dialecticien est Brecht, la façon dont il peut cliver un objet, produire un balancement de perspectives : faire apparaître ce qu’il y a de productif dans une idée réactionnaire, ce qu’il y a de conservateur dans une œuvre progressiste, ce qu’il y a d’utile dans une catastrophe économique, etc. Autrement dit, le découpage passe non par une sociologie des discours, mais par un examen de leurs conséquences pratiques. Ce qui prend alors logiquement la place de l’idéologie selon Jameson, c’est le discours que Brecht appelle « folgenlos », « inconséquent », au sens de dénué d’effet concret. Brecht souligne dans quelques textes assez drôles les efforts remarquables que doivent faire une série d’institutions (à commencer par la littérature, mais aussi l’école, les médias ou la philosophie) pour parvenir à produire une pensée fondamentalement sans conséquence : il faut beaucoup d’effort pour que la pensée ne soit rien, pour qu’elle ne produise aucun effet dans la réalité. Jameson remarque que ce mode de pensée fait boiter les acceptions habituelles de l’idéologie : si son critère est l’improductivité, alors c’en est une conception strictement négative ; si, à l’inverse, la « pensée intervenante » se reconnaît à ses effets matériels, alors c’est le partage entre base et superstructure qui devient caduque. Dans un moment où la critique de l’idéologie doit se réinventer selon de nouvelles modalités, la dimension un peu hétérodoxe des analyses brechtiennes me semble particulièrement stimulante. Elles permettent de se demander de quel concept d’idéologie nous avons besoin aujourd’hui, appuyé sur quelles opérations et pour produire quels effets politiques.
*
Propos recueillis par Olivier Neveux.
[1] Voir Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, trad. Françoise Nevoltry, Paris, Beaux-arts de Paris, 2007 ; et Archéologies du futur – Le désir nommé utopie et autres sciences-fictions, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris, Amsterdam, à paraître en 2021 (republication en un seul volume des deux tomes parus initialement chez Max Milo en 2007 et 2008).
[2] . Cf « Métacommentaire », in L’inconscient politique : Le récit comme acte socialement symbolique, trad. N. Vieillescazes, Paris, Questions Théoriques, 2012, pp. 389-414.
[3] Fredric Jameson, Brecht et la Méthode, trad. F. Lahache, Lyon, Editions Trente-trois morceaux, 2020, p. 13.
[4] Idem, p. 214
[5] Ibid., p. 20.