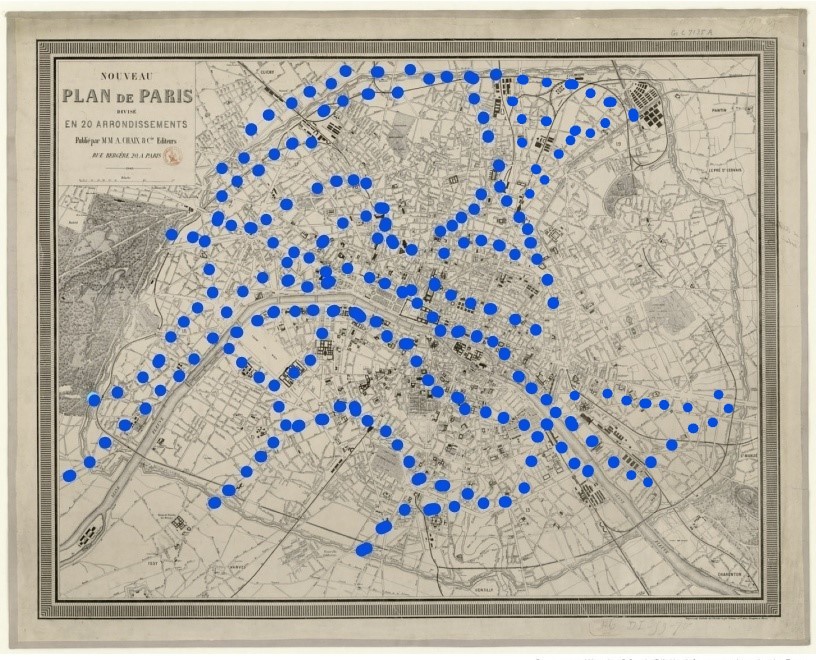
À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.
***
Il ne reste que trois à quatre mille fédérés pour faire face aux dizaines de milliers de versaillais, trois corps d’armée ! Il n’y a plus d’espoir pour les combattants de l’insurrection. Il pleut, la fusillade a un bruit sourd.
Les prussiens viennent en aide à l’armée versaillaise.
Ils ont arrêté les trains depuis lundi en gare du Nord, et posté des sentinelles sur toute la ligne qu’ils contrôlent, avec ordre strict de ne laisser passer personne.
Entre hier soir et aujourd’hui, 10 000 soldats prussiens ont été massés sur toute la ligne, formant un cordon infranchissable, investissant Vincennes avec 100 pièces d’artillerie. Il est impossible de sortir de Paris.
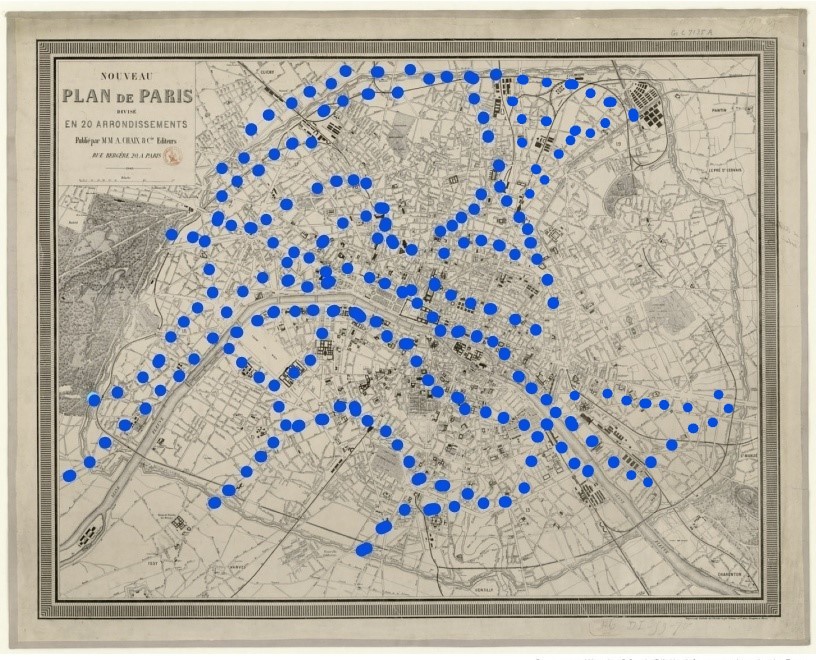
Au Nord, une colonne de l’armée parvient jusqu’à la place de la Rotonde à la Villette. Les soldats entrant dans l’usine à gaz tuent neuf employés, et sans l’intervention du directeur auraient massacré tous ceux de l’établissement. Le soir, un nouvel incendie embrase Paris : les docks sont la proie des flammes.
Les versaillais avancent jusqu’à la porte de Vincennes, s’emparent du faubourg Saint-Antoine, de la gare de Lyon, que les fédérés incendient en se retirant, et de la place du Trône : les troupes sont parvenues au pied du Père-Lachaise. La résistance à Bastille a été héroïque : il y a eu plus de cent cadavres sur la barricade rue de Charenton, et ce soir la place du trône tient toujours.
Dans la nuit, le commandant des chasseurs à pied Versaillais s’étant trop approché de Bastille, il a été enlevé et fusillé. C’est le seul exemple où les fédérés ont fusillé un prisonnier.
Les fédérés se maintiennent encore dans les buttes Chaumont et dans le Père-Lachaise.
Témoignage de Martial Senisse, 20 ans, maçon limousin
[…]
Ce matin, une bruine épaisse tombe sur le quartier. La colonne de juillet brûle. Des obus l’ont traversée et ont mis le feu aux couronnes desséchées, au revêtement de feuillage et de drapeaux que les fédérés avaient apportés là depuis les premiers jours de Février. La colonne repose sur les voûtes maçonnées du canal Saint Martin et ces voûtes se lézardent dangereusement sous l’effet d’un incendie provoqué par cinq péniches de pétrole qui flambent en ce moment sous le tunnel du canal. Des nuages de fumée envahissent la place. […] L’ennemi est en train de nous encercler. Après avoir occupé les bastions proches de la Seine, une colonne a suivi la ligne du chemin de fer de Vincennes, une autre le boulevard Mazas et les premiers versaillais ont atteint dans notre dos le faubourg Saint Antoine. […] Nous n’étions pas plus de cent entre la Bastille et la rue d’Aligre et nous avons tenu tête à toute une armée. Dans le quartier, tous ceux des nôtres qui sont pris sont fusillés sur place. Dès qu’une barricade tombe, nous entendons le bruit des pelotons d’exécution.
[…] J’ai pris le commandement de la colonne des survivants et nous avons fait retraite en direction de Charonne. Derrière nous, les versaillais qui venaient de la Bastille progressaient par le faubourg Saint Antoine et par la rue de la Roquette.
54 ans, avocat, démocrate socialiste, Jean Millière a été nommé chef de bataillon de la garde nationale durant le siège. Très populaire dans le XXème arrondissement, il est élu député lors des élections du 8 février 1871.
Il n’a pas démissionné de l’Assemblée, pas même lorsqu’il a été élu à la Commune, poste qu’il n’a pas pris. C’est l’attaque de Versailles contre Paris qui le conduit à la démission le 4 avril seulement. Il est convaincu que l’appui de la province est décisif pour la victoire de la révolution. Il va s’y employer en créant l’« Alliance républicaine des départements » pour regrouper les Parisien-nes, selon leur lieu d’origine, qui apporte son adhésion à la Commune, le 29 avril.
Témoignage de Prosper-Olivier Lissagaray, 33 ans, journaliste
Millière, arrêté sur la rive gauche, est amené à l’état-major de Cissey. Ce général d’Empire, perdu de sales dettes dont il mourut et qui, ministre de la Guerre, laissa surprendre par sa maîtresse, une Allemande, le plan d’un des nouveaux forts de Paris, avait fait du Luxembourg un des abattoirs de la rive gauche. Le rôle de Millière, on l’a vu, avait été de conciliation et sa polémique dans les journaux d’un ton très élevé. Il était resté étranger à la bataille, quoiqu’on affectât de la confondre avec le chef de la 18e légion ; mais la haine des officiers bonapartistes, celle de Jules Favre le guettait. L’exécuteur, le capitaine d’état-major Garcin, aujourd’hui général, a raconté tête haute ce crime. L’histoire lui doit la parole pour montrer quelle boue humaine les vengeances de l’ordre firent sourdre.
« Millière a été amené ; nous étions à déjeuner avec le général au restaurant de Tournon, à côté du Luxembourg. Nous avons entendu un très grand bruit et nous sommes sortis. On m’a dit : « C’est Millière. » J’ai veillé à ce que la foule ne se fît pas justice elle-même. Il n’est pas entré dans le Luxembourg, il a été arrêté à la porte. Je m’adressai à lui, et je lui dis : « Vous êtes bien Millière ? — Oui, mais vous n’ignorez pas que je suis député. — C’est possible, mais je crois que vous avez perdu votre caractère de député. Du reste, il y a parmi nous un député, M. de Quinsonnaz, qui vous reconnaîtra. »
« J’ai dit alors à Millière que les ordres du général étaient qu’il fût fusillé. Il m’a dit : « Pourquoi ? »
« Je lui ai répondu : « Je ne vous connais que de nom, j’ai lu des articles de vous qui m’ont révolté ; vous êtes une vipère sur laquelle on met le pied. Vous détestez la société. » Il m’a arrêté en disant avec un air significatif : « Oh ! oui, je la hais, cette société. — Eh bien, elle va vous extraire de son sein, vous allez être passé par les armes. — C’est de la justice sommaire, de la barbarie, de la cruauté. — Et toutes les cruautés que vous avez commises, prenez-vous cela pour rien ? Dans tous les cas, du moment que vous dites que vous êtes Millière, il n’y a pas autre chose à faire. »
« Le général avait ordonné qu’il serait fusillé au Panthéon, à genoux, pour demander pardon à la société du mal qu’il lui avait fait. Il s’est refusé à être fusillé à genoux. Je lui ai dit : « C’est la consigne, vous serez fusillé à genoux et pas autrement. » Il a joué un peu la comédie, il a ouvert son habit, montrant sa poitrine au peloton d’exécution. Je lui ai dit : « Vous faites de la mise en scène, vous voulez qu’on dise comment vous êtes mort ; mourez tranquillement, cela vaut mieux. — Je suis libre, dans mon intérêt et dans l’intérêt de ma cause, de faire ce que je veux. — Soit, mettez-vous à genoux. » Alors il me dit : « Je ne m’y mettrai que si vous m’y faites mettre par deux hommes. » Je l’ai fait mettre à genoux et on a procédé à son exécution. Il a crié : « Vive l’humanité ! » Il allait crier autre chose quand il est tombé mort. »
Un militaire gravit les marches, s’approcha du cadavre et déchargea son chassepot dans la tempe gauche. La tête de Millière rebondit et, retournée en arrière, éclatée, noire de poudre, parut regarder le frontispice du monument.
« Vive l’humanité ! » Le mot dit les deux causes : « Je liens autant à la liberté pour les autres peuples que pour la France », disait un fédéré à un réactionnaire. En 1871 comme 1793, le combat de Paris est pour tous les opprimés.
Les débris de bataillons, des groupes de quelques dizaines d’hommes se regroupent dans le XXème, et la mairie de Ménilmontant devient le centre du mouvement. Elle distribue des logements, des uniformes, des munitions, des bons de vivres.
Les barricades sont nombreuses dans les rues inextricables du quartier, mais celles sur les grands boulevards ne sont pas protégées par derrière. La route qui domine le Père Lachaise, les buttes Chaumont, n’est pas gardée. Les canons ne peuvent être regroupés sur les hauteurs, car ceux qui tiennent les barricades refusent de s’en séparer, alors qu’ils sont peu utiles dans ces petites rues.
Quelques membres de la Commune visitent les barricades, mais leurs exhortations sont superflues : ceux qui restent sont les plus déterminés, les plus résolus.
Les rares membres de la Commune que l’on rencontre errent au hasard, absolument ignorés, mais ils n’ont pas renoncé à délibérer.
Ils sont une douzaine rue Haxo, le Comité Central arrive et revendique la dictature. On la lui donne en lui adjoignant Varlin. Du Comité de salut public, personne ne parle plus.
Les obus tombent en pluie sur le XXème, les habitant-es se réfugient dans les caves. Les fédérés accueillaient les explosions aux cris de « Vive la Commune ! »
Témoignage de Benoit Malon, 30 ans, ouvrier teinturier, journaliste
Depuis lundi soir, on voit passer de longues files de plusieurs centaines de prisonniers ramassés un peu partout ; on les lie quatre par quatre, quelquefois on leur attache les mains derrière le dos, d’un soufflet on les décoiffe, et on les conduit entre deux doubles haies de soldats, les officiers ayant le revolver au poing, les soldats le fusil chargé et la baïonnette au bout du canon. A la moindre tentative de fuite, une décharge à bout portant fait du prisonnier un cadavre. Ils n’arrivent pas toujours à Versailles. Lorsque pendant le trajet, il plaît à l’officier qui commande le détachement de faire quelques exécutions, il choisit dans le tas, et les pelotons d’exécution commencent leur lugubre besogne.
[…]A Versailles, cette haine des vaincus dépasse les limites de la rage. Là, on va jusqu’à frapper les malheureux vaincus, on les déchirerait si les gendarmes et les soldats, déjà si féroces eux-mêmes, ne les protégeaient un peu contre cette incroyable fureur qui s’applique à tous les habitants de Paris.
Voici ce qu’en dit un témoin oculaire, correspondant d’un journal modéré, l’Indépendant Rémois :
« L’exaspération contre Paris et les parisiens est grande ici. Ainsi que je vous le disais hier, quand un détachement de prisonniers arrive, la foule se porte sur son passage, et sans la prudence et la fermeté des troupes, il est certain qu’on attendrait pas, pour en faire justice, que la loi puisse leur être appliquée. La colère des versaillais se manifeste contre les fédérés, mais contre tous les habitants de Paris. C’est un repaire de bandits, dit-on autour de moi, et il faut qu’on nous débarrasse de tous ceux qui y sont restés. Qu’on détruise partout le loup, la louve et les louveteaux (c’est ainsi que j’ai entendu désigner les familles parisiennes), et la tranquillité renaîtra pour longtemps. »
Arrivés au lieu de destination, les prisonniers sont parqués en plein air sous un soleil brûlant, ou sous la pluie et dans la boue, selon la température.
D’autres fois, ils sont entassés sur la terre nue, dans les caves ou les écuries du Château, empilés les uns sur les autres, dans la plus effrayante promiscuité, hommes, femmes, enfants. Ils sont dévorés par la vermine, ils ne reçoivent pour nourriture que du pain et de l’eau qu’on leur jette comme à des chiens en quantité insuffisante en les injuriant ignominieusement. Un grand nombre, parmi les femmes surtout, sont atteints de folie. Le manque d’air, l’entassement, la fraîcheur du sol leur causent d’horribles souffrances. Il y a, au milieu d’eux, des enfants de huit ans et des vieillards de soixante-dix ans. De temps en temps un des plus faibles râle dans un coin, quand l’agonie est bien constatée, un gardien le traîne dehors pour y mourir. Au moindre bruit, au moindre cri séditieux qui s’échappe de ce tas humain, les fusils s’abaissent, de sourdes détonations se font entendre, les balles sifflent au hasard. Heureux ceux, qui, mortellement atteints, sont foudroyés, une horrible agonie leur est épargnée !
Il règne un climat d’exaltation, de surexcitation, tant la certitude de la défaite exacerbe toutes les émotions. On se raconte les épisodes vécus dans Paris ces derniers jours, les assassinats, les fusillades de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants, les milliers qui sont conduit-es à Versailles comme prisonnier-es et qui, au moindre signe d’opposition sont tués au revolver.
Il n’y a plus aucune discipline collective, chaque groupe agit à sa guise.
Vers cinq heures, un détachement se rend à la prison de la Roquette, et revient en face quartier général, au 95 rue Haxo, entouré d’une foule énorme, houleuse. Le détachement conduit cinquante-deux prisonniers. Trente-quatre d’entre eux sont des gendarmes et des sergents de ville, détenus comme otages et convaincus d’avoir tiré sur le peuple le 18 mars, quatre sont des mouchards de l’Empire, dix sont des ecclésiastiques, religieux, jésuites, prêtres, deux coupables de complots, Ruault et Largillière, et deux membres de la sûreté Greffe et Dureste.
Sous les imprécations, le cortège entre dans un terrain vague, pousse les otages vers une tranchée située au pied d’un mur.
Un membre de la Commune Serailler voit arriver les prisonniers, dit aux gardes qu’il y a derrière le mur une poudrière, qu’ils vont tout faire sauter. Varlin et Louis Piat s’époumonent pour gagner du temps. On les repousse, si ce n’était la réputation de Varlin, ils auraient aussi été tués. On leur répond si tu n’es pas content, nous allons te régler ton affaire, toi aussi.
Pendant huit minutes, les détonations retentirent, des feux de peloton et des tirs isolés. Un individu crie « Vive l’Empereur! », il est aussi passé par les armes. Au dehors on applaudit.
Un témoin ajoute « pâles, accoudés autour d’une table, les mains aux oreilles, essayant d’étouffer le son, les yeux fermés, nous dûmes tous subir à la fin les applaudissements, ils nous brisèrent le cœur encore plus que la fusillade ».
Le ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, expédie, de Versailles, le 26 mai, aux représentants de la France à l’étranger, la dépêche suivante :
Versailles, 26 mai 1871.
Monsieur, L’œuvre abominable des scélérats qui succombent sous l’héroïque effort de notre armée ne peut être confondue avec un acte politique. Elle constitue une série de forfaits prévus et punis par les peuples civilisés. L’assassinat, le vol, l’incendie systématiquement ordonnés, préparés avec une infernale habileté, ne doivent permettre à leurs complices d’autre refuge que celui d’une expiation légale. Aucune nation ne peut les couvrir d’immunité, et, sur le sol de toutes, leur présence serait une honte et un péril. Si donc vous apprenez qu’un individu compromis dans l’attentat de Paris a franchi la frontière de la nation près de laquelle vous êtes accrédité, je vous invite à solliciter des autorités locales son arrestation immédiate et à m’en donner de suite avis pour que je régularise celte situation par une demande d’extradition.
Recevez, Monsieur, les assurances de ma haute considération.
Signé : Jules FAVRE.
La Belgique et l’Espagne donnent immédiatement leur adhésion.
La Grande Bretagne refuse de répondre.
Dès que la déclaration du gouvernement belge est connue, Victor Hugo, en Belgique à ce moment, adresse à la presse une lettre :
Bruxelles, 26 mai 1871
Monsieur,
Je proteste contre la déclaration du gouvernement belge relative aux vaincus de Paris.
Quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse, ces vaincus sont des hommes politiques.
Je n’étais pas avec eux.J’accepte le principe de la Commune, je n’accepte pas les hommes
[…]
Cet asile, que le gouvernement belge refuse aux vaincus, je l’offre.
Où ? En Belgique.
Je fais à la Belgique cet honneur.
J’offre l’asile à Bruxelles. J’offre l’asile place des barricades, n°4.Qu’un vaincu de Paris, qu’un homme de la réunion dite Commune, que Paris a fort peu élue et que, pour ma part, je n’ai jamais approuvée, qu’un de ces hommes, fût-il mon ennemi personnel, surtout si c’est mon ennemi personnel, frappa à ma porte, j’ouvre. Il est dans ma maison. Il est inviolable.
[…]
Si l’on vient prendre chez moi un fugitif de la Commune, on me prendra. Si on le livre, je le suivrai. Je partagerai la sellette.et pour la défense du droit, on verra, à côté de l’homme de la Commune, qui est le vaincu de l’Assemblée de Versailles, l’homme de la République, qui a été le proscrit de Bonaparte.
Je ferai mon devoir. Avant tout, les principes.
[…]
Victor Hugo
Rubrique annulée vu les circonstances.