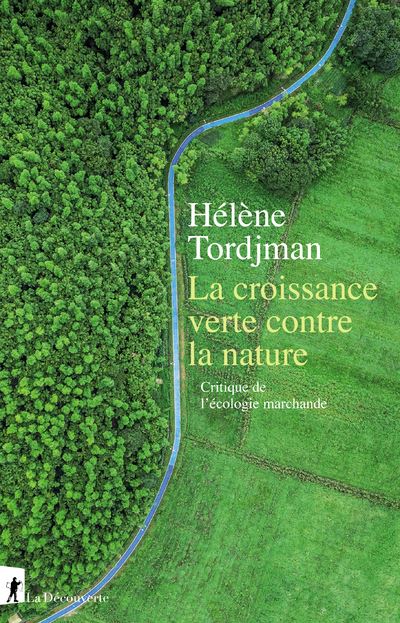
Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature, Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 22 euros.
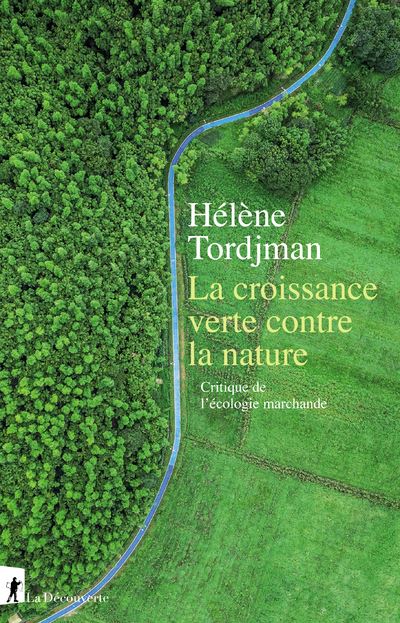
Notre collègue et amie, Hélène Tordjman, vient de publier La croissance verte contre la nature, Critique de l’écologie marchande. Ce livre fera date parce qu’il rassemble une documentation très à jour sur la conceptualisation et la mise en pièces de la nature par un capitalisme menant au bord de l’asphyxie planétaire, pour la nature mais aussi pour les humains. Maintenant que la crise écologique est avérée, que le réchauffement du climat n’est plus discuté et que les alarmes sur la perte de biodiversité se multiplient, on pourrait croire que tout est dit. Peut-être, mais réunir en un volume une synthèse aussi détaillée, précise et référencée à la fois sur les multiples atteintes à la nature et sur les fausses solutions qui y sont apportées est une belle réussite.
La problématique générale du livre est de montrer que s’engager dans la voie d’une réponse marchande à la crise écologique ne peut qu’approfondir cette dernière. Le livre est structuré en six chapitres, plus une conclusion charpentée qui est, en fait, un septième chapitre, j’y reviendrai.
Dès le premier chapitre, l’auteure fait le procès du projet de faire des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences de l’information et de la cognition (en sigle, les NBIC) des « technologies performantes pour augmenter la performance humaine » (p. 21). Autrement dit, il y a là un projet transhumaniste, une utopie au mauvais sens du terme. Car
« développer de tels outils de transformation suppose de penser dans un même mouvement la matière, le vivant, la cognition, les écosystèmes, la biosphère et les galaxies » (p. 27).
Mais,
« puisque, par définition, il est à peu près impossible de prévoir les trajectoires des systèmes complexes, l’ambition d’instrumentaliser par la science et la technique les processus biologiques, les dynamiques climatiques et géologiques ou les institutions sociales avec l’intention d’en maîtriser les résultats agrégés devrait apparaître vaine » (p. 28).
Malheureusement, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, ou bien au Forum de Davos, tous les bons esprits rivalisent d’imagination pour « libérer la valeur économique de la nature » au nom de « tout cela est « bio » puisque c’est vivant » (p. 47). Si « une telle frénésie scientiste et prométhéenne » est considérée comme la solution à la dégradation de l’état écologique de la planète » (p. 49), c’est parce qu’on raisonne « comme si l’on pouvait séparer les effets positifs et négatifs, garder les premiers et régler les seconds séparément. Or, comme l’a montré Jacques Ellul dès 1954, un des caractères de la technique moderne est son « insécabilité » : elle forme un système, un tout, et ses effets ne dépendent pas de l’usage que l’on en fait, ils lui sont inhérents » (p. 49-50).
Avec l’exemple des agrocarburants, le deuxième chapitre illustre l’impasse techniciste dévoilée précédemment.
« On y voit à l’œuvre l’auto-accroissement et l’autonomie de la technique qui produisent des dynamiques autocentrées ou autoréférentielles, ne répondant qu’aux questions que la technique se pose à elle-même » (p. 55).
Il s’ensuit que « la croissance verte […] ne rompt pas avec l’extractivisme et l’idéologie industrielle » (p. 55). Et, des agrocarburants de première génération aux « avancés », rien n’est vraiment changé. Pas plus que « la combinaison de la bioénergie, dont les agrocarburants font partie, et la capture et le stockage du carbone » (p. 93). On retrouvera ce problème avec l’agriculture industrielle car « manger ou conduire, il faut choisir » (p. 70).
En se référant à Marx et à Polanyi, Hélène Tordjman montre dans son troisième chapitre que la fabrication de semences « augmentées » produit de « nouvelles enclosures » capables de déposséder les paysans de tout pouvoir et savoir. Privation des denrées végétales et institutions de droits permettent de normaliser techniquement les semences : la brevetabilité des organismes vivants est en cours. « Un gène simplement découvert n’est pas brevetable, mais s’il est isolé et caractérisé grâce à l’ingéniosité technique et scientifique d’Homo industrialus, il le devient » (p. 113-114).
« Avant la domination de la génétique, la description des variétés protégées se faisait au niveau phénotypique, celui de leurs caractéristiques physiques. De plus en plus, les descriptions se font au niveau génotypique : ce qui est approprié est l’information génétique codant pour ses caractéristiques physiques. Ce déplacement de perspective engendre une forme de dématérialisation des variétés végétales, qui sont perçues comme de l’information, et non plus comme des plantes. Il est ainsi plus facile de les réifier, et leur industrialisation semble moins problématique. » (p. 149).
Dans les quatrième et cinquième chapitres de son livre, Hélène Tordjman critique la transformation de la nature en « capital naturel » – « dernière étape en date d’un processus de réification de la nature entamé aux débuts de l’époque moderne » (p. 160) – et sa réduction à des « services écosystémiques ». Elle rappelle l’idée sous-jacente à l’économie néoclassique de l’environnement selon laquelle il suffit de fixer des prix pour internaliser les effets externes négatifs, car
« une telle vision est qu’on ne protégerait que ce qui a une valeur monétaire et, symétriquement, qu’il serait loisible de détruire ce qui n’en a pas puisque cela ne coûte rien : le calcul utilitariste dans sa version étroitement économique. Autrement dit, nous aurions jusque-là détruit la nature car nous ne nous rendions pas compte de sa valeur. » (p. 157-158).
Un tel édifice conceptuel exige, pour être opérationnel, un « foisonnement » d’institutions, propres à instaurer une « gouvernance internationale » imposant une « soft law » venant d’acteurs « non élus » (p. 176-177), à l’instar du TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), champion des « valeurs économiques de la biodiversité » (p. 182).
À l’époque du capitalisme financiarisé se constitue « une nouvelle classe de marchandises fictives » faite de « séquences génétiques, variétés végétales et races animales, processus naturels, collection d’échantillons biologiques, bases de données d’informations séquentielles numériques, services rendus par les écosystèmes » (p. 190). Lorsqu’on réussit à « découper la biosphère en entités discrètes », alors on peut procéder à la « définition », puis à « l’évaluation monétaire » et à la « valorisation » (p. 191) de la nature et de ses services. Et l’auteure de rappeler le lancement de ces processus par la célèbre étude de Robert Costanza en 1997, évaluant l’ensemble des services écosystémiques mondiaux, en dépit des innombrables problèmes méthodologiques de mesure.
Le sixième chapitre d’Hélène Tordjman se demande si l’on peut « faire confiance à la finance » (p. 245). Sa réponse est évidemment négative. Et elle explique en détail les mécanismes de plus en plus sophistiqués mis au point par les financiers, susceptibles, aux dires de ces derniers, d’orienter l’investissement vers des activités « vertes » (p. 249). Leur imagination est débordante : indices boursiers soutenables, obligations vertes, obligations catastrophes (ou cat bonds, voire pandemic bonds), produits dérivés adossés à la nature, titrisation, benchmark pour établir des standards et labels d’évaluation, etc. L’auteure donne de multiples exemples de grandes sociétés anticipant la survenue de risques sociaux ou environnementaux, non pas pour circonscrire ces risques, mais pour en tirer parti financièrement :
« Les risques sociaux et environnementaux ne sont des risques que dans la mesure où ils ont un impact sur la réputation des entreprises et sont susceptibles de faire baisser leur valeur actionnariale » (p. 277).
Le hic pour la finance est que « ces différents outils ne font pas disparaître les risques, ils les transfèrent simplement d’une classe d’agents à une autre ; il faut toujours quelqu’un en bout de chaîne pour les assumer » (p. 282).
Pour terminer son livre, Hélène Tordjman propose une conclusion étoffée, qu’on peut considérer – je le disais plus haut – comme un septième et dernier chapitre. En effet, elle choisit de présenter une voie pouvant servir d’exemple à développer face à l’entreprise de marchandisation de la nature. Il s’agit de la transformation du modèle de production agricole dominant pour aller vers une agrobiologie. Se référant aux concepts développés tant par Olivier de Schutter, ancien rapporteur du droit à l’alimentation pour les Nations unies, que par des agronomes comme Marc Dufumier,
« la connaissance des relations fonctionnelles permettant à un agrosystème de se reproduire sans apport de la chimie de synthèse, progresse tous les jours, et cette connaissance peut être mise à profit par les paysans, en particulier grâce à des programmes de recherche participative » (p. 302).
La mise en pratique de l’agrobiologie se décline en diversification et rotation des cultures, agroforesterie, agriculture et élevage intégrés, gestion et conservation des sols et de l’eau, lutte biologique et mécanique contre les ravageurs et les maladies, et semences paysannes (p. 305). Économiquement, cela signifie une substitution du travail paysan à la mécanisation à outrance. Hélène Tordjaman n’a pas de mal à montrer que l’autorisation accordée à la filière betteraves de déroger à l’interdiction des néonicotinoïdes, au nom de l’emploi, « est destinée à soutenir un système qui vise à détruire les emplois » (p. 326). On est aux antipodes d’une évolution vers des pratiques autogestionnaires que l’auteure appelle de ses vœux et qu’elle situe à tout instant ainsi : « il n’y a pas beaucoup de sens à différencier effets environnementaux et effets sociaux de l’agriculture productiviste qu’il faut embrasser d’un même mouvement » (p. 61), ce qui, je vais y revenir, est très marxien.
L’intérêt d’un livre se mesure aussi à la discussion qu’il permet d’ouvrir. Voici quelques-unes des questions qui me viennent à l’esprit en lisant celui-ci, dont je répète qu’il est passionnant.
Hélène Tordjman se situe dans la perspective d’auteurs anciens qui ont été parmi les pionniers de la réflexion écologique, notamment Ivan Illich et Jacques Ellul. Elle se réfère fréquemment à eux pour critiquer le caractère techniciste de la civilisation industrielle, au travers du concept de contre-productivité illichien ou de celui d’autonomie de la technique elluéen. Cependant, elle sait bien que la thèse très déterministe de la technique d’Ellul a été discutée et le reste encore. Le paradoxe de cet auteur n’est pas mince, puisqu’il entend actualiser la pensée de Marx, mais il aboutit à une vision encore plus déterministe que celle longtemps en vigueur dans le marxisme traditionnel au sujet du développement des forces productives dont devaient découler toutes les transformations superstructurelles, appauvrissant certainement la pensée de Marx lui-même. Cette discussion ancienne pourrait être reliée à la problématique développée dans ce livre.
Et cela d’autant plus qu’Hélène Tordjman s’avance sur le plan épistémologique en écrivant :
« Marcel Mauss, Joseph Schumpeter, Karl Polanyi ou Louis Dumont avaient déjà en leur temps insisté sur l’intrication des institutions, des représentations collectives et des idéologies, et ce dans toutes les sociétés, qu’elles soient traditionnelles ou modernes. Pour le dire autrement, l’opposition, classique en sciences sociales, entre matérialisme et idéalisme n’a plus lieu d’être : structures économiques, institutions et idéologies sont en interaction permanente, ou, mieux, sont les différentes facettes d’une même dynamique. » (p. 159).
Dans cette liste d’auteurs, Marx est évacué, lui le théoricien de la dialectique ? Et quid des luttes de classes dans cette « dynamique » ? Et que dire de la prétendue disparition de l’opposition entre matérialisme et idéalisme philosophiquement parlant, qui est justement l’un des schémas de l’idéalisme ?
Il s’ensuit une deuxième question. La dénonciation de la marchandisation de la nature met-elle en cause l’ordre marchand ou l’ordre capitaliste ? On sait, depuis Marx, que les deux ordres ne sont pas identiques. Le premier précède dans l’histoire le second, ce dernier se distinguant par l’instauration de rapports sociaux fondés sur la salarisation d’une main-d’œuvre prolétarisée ne possédant que sa force de travail[1]. Ce qui pourrait mettre en porte-à-faux Hélène Tordjman qui écrit :
« Dans le mode de production capitaliste, les détenteurs de capitaux veulent les valoriser, c’est-à-dire tentent d’accroître leur valeur, au travers de l’échange marchand » (p. 12, souligné par moi, JMH).
L’échange marchand de quoi ? Dans le capitalisme, il s’agit de l’échange marchand de la force de travail et pas seulement des biens marchandises.
Dans quel ordre se situe la critique d’Hélène Tordjman ? Au premier – le marchand – si l’on en reste au sous-titre de son ouvrage et qui revient souvent sous sa plume. Mais, elle prend acte aussi que
« Ce modèle procède de la même vision et des mêmes structures socio-économiques mises en place à la fin du XVIIIe siècle, celles d’un capitalisme industriel dominé par une quête frénétique de ressources et de rendement, où le progrès technique est le moyen de ses fins. Ce mode de production nous a menés là où nous en sommes » (p. 98).
C’est dire que la responsabilité des « économistes » est bien en deçà de celle qu’il convient de critiquer :
« L’idée [de marchés de carbone dans le protocole de Kyoto] provient d’une vision du monde des économistes, qui considèrent le marché comme un outil neutre apte à servir des buts très différents, y compris la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique » (p. 224).
Or, il faut voir, il me semble, la vision « économiciste du monde » (p. 239) comme celle de la classe capitaliste, au-delà de la justification pseudo-scientifique donnée par les économistes néoclassiques qui dominent la discipline. En revanche, on approuvera l’auteure quand elle dit :
« La finance verte s’inscrit en droite ligne du phénomène analysé tout au long de ce livre : instrumentaliser les forces du capitalisme pour une « croissance verte et inclusive », c’est-à-dire pour « réparer » les dégâts de ce même capitalisme » (p. 290).
Mais on en vient à une troisième question. S’il est vrai, comme le soutient l’auteure, que la financiarisation de la nature, au travers de ladite « finance verte » est une pièce de la financiarisation générale de l’économie mondiale depuis près d’un demi-siècle, d’où vient cette dernière ? Malgré l’exploration méthodique des éléments faisant de la nature une marchandise dans ce livre, rien n’est dit de la crise du système productif capitaliste, dont les deux contradictions flagrantes du système se rejoignent aujourd’hui : d’un côté, le social, avec une chute de la croissance de la productivité du travail toujours à l’origine de la valeur pour le capital ; de l’autre, l’écologique, avec une difficulté grandissante pour faire rendre gorge à la nature[2]. Crise du système ne produisant pas une rentabilité du capital jugée suffisante, et dont la financiarisation n’est qu’un palliatif trompeur et éphémère. Une illusion pour « réparer les dégâts du capitalisme », sur laquelle je rejoins totalement l’auteure. L’absence de mention des liens entre les aspects socio-économiques et les aspects écologiques de la crise qui sont noués par la finalité ultime de l’accumulation infinie du capital est pourtant un thème cher à l’auteure puisqu’elle écrivait auparavant dans un article :
« Ce qui frappe dans l’analyse qui est généralement faite de la crise du capitalisme contemporain est qu’elle traite de manière séparée les questions économiques et les questions écologiques. »[3]
Le questionnement de la logique profonde du capitalisme permet d’examiner un problème central du livre d’Hélène Tordjman : celui de la « valeur de la nature ». Bien entendu, j’admets d’avance que ce que je vais dire peut être critiqué à son tour. Mais je pense qu’Hélène Tordjman ne traite pas vraiment ce que recouvre la théorisation de ladite valeur de la nature dans la littérature de l’économie néoclassique de l’environnement, dans celle la plus courante de l’Ecological Economics, dont on retrouve les ambiguïtés, sinon les impensés, dans les écrits et postures de l’écologie politique. Autant je partage avec Hélène Tordjman les critiques faites à l’internalisation des effets externes de l’utilisation de la nature, aux méthodes d’évaluation contingentes ou de dispositions marginales à payer, des valeurs monétaires desdits services écosystémiques, de la compensation, critiques déjà anciennes (comme celle portant sur la taxe imaginée par Arthur Pigou[4] en 1920, ou bien celle de David Pearce[5] sur les effets pervers de la compensation monétaire des dégâts écologiques), autant je pense que s’interroger sur la « vraie valeur » de la nature, la « vraie valeur de la pollinisation » (p. 213), la « vraie valeur d’un récif coralien » (p. 219), la « vraie valeur d’une forêt tropicale » (p. 224) est une recherche vaine. « S’il est impossible de concevoir qu’un système de prix puisse refléter les valeurs relatives d’un service par rapport à un autre » (p. 241), à quoi sert le concept de « vraie valeur de la nature » ? Pour ma part, je pense qu’il est une manière d’accréditer l’idée qu’il y aurait une valeur économique intrinsèque de la nature, qui pourrait être ajoutée à d’autres éléments (et il n’en manque pas si l’on en croit le dernier rapport de l’Unesco sur la « valeur de l’eau »[6]).
Cette idée est sous-jacente à la réduction de la nature à du « capital naturel », fort bien analysée, celle-là, par Hélène Tordjman. Mais si la logique du mode de production capitaliste est en cause dans la destruction de la nature, alors il faut relier la critique de cette destruction à la logique de la production de valeur pour accumuler sans cesse du capital. Et je pense que, pour sortir de l’imbroglio théorique néoclassique auquel succombent malheureusement trop d’écologistes et trop d’économistes sensibles à l’écologie[7], il faut reprendre l’essentiel de la critique de l’économie politique de Marx qui seule permet de distinguer richesse et valeur, valeur d’usage et valeur marchande, et, au final, de considérer comme incommensurables les différents registres[8], a fortiori quand certains relèvent de l’éthique ou de la philosophie et d’autres de l’économique.
La plupart des rapports internationaux et des cercles de recherche sur l’économie de l’environnement sont encombrés de cette quête de la « valeur intrinsèque » de la nature. John Dewey avait mis à bas cette notion à propos d’un autre domaine, mais cela peut s’appliquer ici :
« Il y a une ambiguïté dans l’usage des adjectifs « inhérent », « intrinsèque » et « immédiat », qui alimente une conclusion erronée. […] L’erreur consiste à penser que ce qu’on qualifie ainsi est extérieur à toute relation et peut être, par conséquent, tenu pour absolu. […] L’idée que ne pourrait être qualifié d’inhérent que ce qui est dénué de toute relation avec tout le reste n’est pas seulement absurde : elle est contredite par la théorie même qui relie la valeur des objets pris comme fins au désir et à l’intérêt. Cette théorie conçoit en effet expressément la valeur de l’objet-fin comme relationnelle, de sorte que, si ce qui est inhérent c’est ce qui est non relationnel, il n’existe, si l’on suit ce raisonnement, strictement aucune valeur intrinsèque. […] À strictement parler, l’expression « valeur intrinsèque » comporte une contradiction dans les termes. »[9]
Dans une perspective socio-écologique, le refus de la notion de valeur économique intrinsèque signifie, d’une part, qu’on ne peut additionner ce qui relève de l’économie et ce qui relève de la philosophie, et, d’autre part, que la valeur est un rapport social. Cela est vrai aussi bien pour les marchandises que pour les biens érigés en biens communs. Dès lors, les travaux d’André Orléan peuvent servir à Hélène Tordjman de référence pour rendre compte des évaluations autoréférentielles sur les marchés financiers. Et, comme la financiarisation aboutit à une catastrophe, on comprend que celle-ci se reproduit par « la transposition directe de la théorie financière standard à ces nouveaux objets définis par la science » (p. 220), comme ceux de la nature. Mais la thèse keynésienne de l’évaluation autoréférentielle dans le monde de la finance n’est pas d’un grand secours pour comprendre l’enjeu écologique associé à l’enjeu social[10]. D’ailleurs, les travaux des institutionnalistes et des post-keynesiens sont encore assez peu développés sur la soutenabilité sociale et écologique[11].
De plus, il me semble nécessaire de distinguer davantage les trois niveaux que sont la monétisation, la marchandisation et la financiarisation de la nature. Par exemple, si la collectivité, agissant en régie, décide de faire payer l’acheminement et l’assainissement de l’eau, elle lui fixe un prix, monétaire par définition, à hauteur de qu’elle pense nécessaire pour couvrir ce coût. Si elle abandonne ce service à une entreprise privée, l’eau n’est pas simplement monétarisée, elle est marchandisée avec tout ce que cela comprend comme exigence de rentabilité pour les actionnaires. Si l’eau devient le support de titres financiers, on entre dans la troisième phase de la financiarisation, critiquée à juste titre par Hélène Tordjman. Mais, cela est d’un niveau radicalement différent de la monétisation rendue indispensable par la couverture du coût de production. Les modalités du prix en fonction par exemple des conditions sociales de l’usage de l’eau peuvent être soumises à délibération politique.
Examinons pour terminer un dernier thème sur lequel Hélène Tordjman insiste à plusieurs reprises, celui de la substitution du travail au capital, qu’il faudrait entreprendre pour sortir de l’engrenage techniciste et pour, répète-telle plusieurs fois, réduire les inégalités (p. 63, 317, 334).
« Seule la mise en œuvre de processus de production intensifs en travail et peu intensifs en capital peut permettre de résoudre au fond, structurellement, le problème des inégalités sociales » (p. 334).
Est-ce bien convainquant ? Premièrement, les inégalités sociales étaient-elles moindres il y a un siècle ou deux quand les processus productifs étaient beaucoup moins intensifs en capital technique qu’aujourd’hui ? Deuxièmement, autant on comprend que réduire la productivité individuelle du travail permise par l’amélioration des techniques peut s’inscrire dans une perspective de partage de l’emploi et d’allègement de la pression sur les ressources, autant le doute s’installe s’il s’agit de réduire aussi la productivité de l’heure de travail parce que cela nécessiterait une discussion sur la pertinence de la perte d’efficacité des processus productifs. On n’échappe donc pas à penser à tout moment l’articulation entre les quatre variables que sont l’évolution de la production, celle de la productivité horaire du travail, celle du nombre d’emplois et celle de la durée individuelle moyenne du travail[12].
La conclusion, en forme de dernier chapitre, d’Hélène Tordjman, consacrée à l’agriculture est éclairante à ce propos. Bien entendu, le passage d’un agriculture industrielle polluante et dévastatrice des sols, de l’eau, des paysages et des humains à une agrobiologie est un exemple parfait d’une stratégie à construire. Mais c’est sans doute l’exemple le plus simple à comprendre et à mettre en œuvre techniquement (les obstacles sociaux dus notamment au lobby du syndicat agricole majoritaire ne sont certes pas minces). Est-ce aussi simple pour la transformation de l’industrie ? Si je fais du vélo, je peux entretenir et réparer celui-ci, mais je suis incapable de le fabriquer ; il est vrai qu’on peut imaginer que cette fabrication puisse être organisée dans des ateliers à dimension artisanale plutôt que par des industries de grande taille et lointaines. Mais si je prends aussi le train, la production de locomotives et de wagons pose la question du type d’industrie dont nous aurons besoin dans la société post-capitaliste et post-productiviste, ce qui n’est pas aussi simple que de supprimer dans un laps de temps faible les pesticides dans l’agriculture.
C’est la raison pour laquelle pour « résister au rouleau compresseur de la modernité agricole et [agir] pour mettre en œuvre des pratiques alternatives » (p. 339), la société doit penser en même temps la transformation sociale et écologique de l’ensemble de l’appareil productif, dans lequel l’industrie devra trouver une place. La critique de l’idéologie techniciste n’épuise pas l’analyse de l’industrie si l’on se situe dans une perspective de transition véritable.
*
Quand on referme le livre d’Hélène Tordjman, on se dit qu’on dispose avec lui d’une base de travail impressionnante, tant par les informations rassemblées que par les discussions qui s’ensuivent. Que le lecteur soit confiant, c’est un livre dense mais écrit parfaitement, et, ce qui accroît le plaisir, avec des notes d’humour ici et là, qui rendent crédible l’« optimisme de la volonté » par lequel Hélène Tordjman termine son livre avec ce mot célèbre.
Le 11 juin 2021.
[1] K. Marx, Le Capital, Livre I, 1867, par exemple, dans Œuvres, tome I, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1965.
[2] C’est ce que j’ai essayé de montrer dans J.-M. Harribey, Le trou noir du capitalisme, Pour ne pas y être aspiré, réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie, Lormont, Le Bord de l’eau, 2020 ; et En finir avec le capitalovirus, L’alternative est possible, Paris, Dunod, 2021.
[3] Hélène Tordjman, « La crise contemporaine, une crise de la modernité technique », Revue de la Régulation, n° 10, 2e semestre, automne 2011,. Bien sûr, le débat n’est pas clos pour savoir s’il s’agit seulement d’une crise due à la technique.
[4] A.C. Pigou, L’économie de bien-être, 1920, Paris, Dalloz, 1958.
[5] D.W. Pearce, Environmental Economics, London, Longman, 1976.
[6] J.-M. Harribey, « Le discours sur la valeur de l’eau ne vaut pas grand-chose », 7 avril 2021,.
[7] À preuve l’utilisation fréquente par les économistes écologistes de fonctions de production de type Cobb-Douglas pour tenter désespérément de mesurer l’apport productif de l’environnement à la production de valeur économique. Pour une critique, voir J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Paris, Les Liens qui libèrent, 2013.
[8] C’est le thème de mon livre La richesse, la valeur et l’inestimable, op. cit. Voir aussi A. Douai et G. Plumecocq, L’économie écologique, Paris, La Découverte, Repères, 2017. Recension dans J.-M. Harribey, « L’économie écologique tiraillée de tous côtés », Contretemps, 8 septembre 2017.
[9] John Dewey [2011 (1981)], La formation des valeurs (Théorie de la valuation), Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, La Décuverte, p. 108 à 110.
[10] La Revue de la Régulation a fait écho au débat que j’ai eu avec André Orléan sur ces sujets : https://journals.openedition.org/regulation/9483 ; https://journals.openedition.org/regulation/9502 ; j’ai proposé une synthèse dans « Du travail à la monnaie, essai de perspective sociale de la valeur, Examen critique de la vision autoréférentielle de la valeur et de la monnaie », Économie et Institutions, n° 26, 2017, http://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/monnaie-valeur.pdf.
[11] É. Berr, V. Monvoisin, J.-F. Ponsot (dir.), L’économie post-keynésienne, Histoire, théories et politiques, Paris, Seuil, 2018. Recension dans J.-M. Harribey, « L’économie post-keynésienne en bonne voie », Contretemps, 21 février 2018,.
[12] Pour une discussion sur ce problème, voir dans le livre collectif de F. Jany-Catrice et D. Méda (dir.), L’économie au service de la société, Autour de Jean Gadrey, J.-M. Harribey, « De la productivité à la valeur : un problème de mesure ou de paradigme ? », Paris, Institut Veblen, Les Petits matins, 2019, p. 129-138, http://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/autour-de-gadrey.pdf.