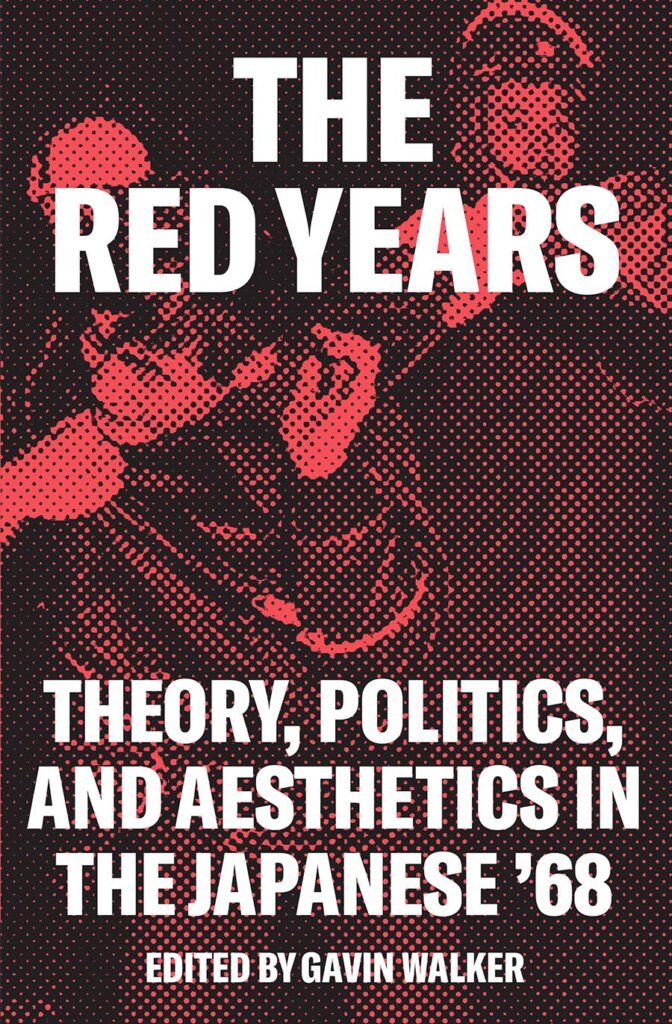
Gavin Walker est professeur agrégé d’histoire à l’Université McGill. Il est l’auteur de The Sublime Perversion of Capital (Duke, 2016), éditeur de The End of Area (Duke, 2019, avec Naoki Sakai), Marx, Asia, and the History of the Present. Il a également publié et traduit Marx. Towards the Centre of Possibility (Verso, 2020) de Kojin Karatani.
Son nouvel ouvrage, The Red Years : Theory, Politics, and Aesthetics in the Japanese ’68 est maintenant disponible aux éditions Verso. Dans cet entretien il revient sur la richesse du marxisme au Japon, si peu connu en France[1], tant dans le débat intellectuel de la seconde moitié du 20ème siècle que dans ses effets politiques au cours des années 1950-70.
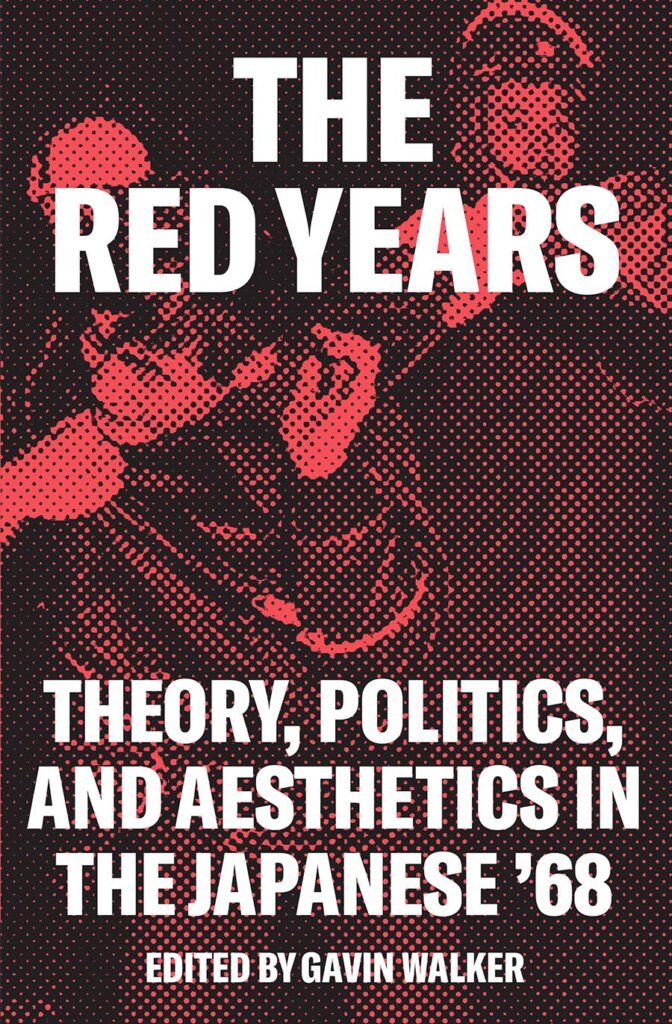
Contretemps : Dans The Sublime Perversion of Capital (Duke University Press, 2016), vous écrivez que « le marxisme était l’un des courants plus dominants de la recherche théorique dans la vie intellectuelle japonaise pendant la majeure partie du XXe siècle. » Vous écrivez quelque chose de similaire dans l’introduction du Marx de Karatani. Towards the Centre of Possibility (Verso, 2020) : « Il est probablement à peine croyable pour la majorité des marxistes d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale qu’au XXe siècle on pouvait facilement soutenir que le pays le plus marxiste de la planète était le Japon d’après-guerre. » Comment évaluez-vous la traduction et la réception du marxisme japonais en dehors du Japon ? Pourquoi l’histoire intellectuelle du marxisme au Japon est-elle si profondément liée à la réception japonaise de l’œuvre de Marx ?
Gavin Walker (GW) : Pour commencer par répondre à la première partie de votre question, concernant la traduction et la réception de la pensée marxiste japonaise en dehors du Japon, je dois dire qu’il y en a eu relativement peu, surtout si l’on considère l’ampleur et le volume incroyables des écrits marxistes en japonais depuis les années 1920. Certaines figures du début et du milieu du vingtième siècle, comme le critique culturel et philosophe Tosaka Jun ou le théoricien de l’économie politique Uno Kozo, (1897-1977) ont bien sûr connu des réceptions partielles en anglais, comme ce fut le cas pour d’autres auteurs dans différents domaines, allant de l’histoire à l’étude de la religion en passant par la littérature japonaise, bien que ces derniers n’aient pas nécessairement été vus ou catégorisés comme représentatifs de la tradition de la théorie marxiste au Japon. En anglais et dans d’autres langues européennes, il y eut une série de petites réceptions localisées , la lecture très originale, bien que partielle et idiosyncratique, d’Uno par Thomas Sekine au Canada dans les années 70 et 80, la lecture plus « orthodoxe » de Uno (et le lien direct avec la lignée de Uno lui-même) par Makoto Itoh dans son important ouvrage Value and Crisis (récemment réédité). Nous pouvons également évoquer le rôle des historiens marxistes comme Toyama Shigeki, Takahashi Kohachiro et d’autres dans les débats internationaux sur la transition du féodalisme au capitalisme, le rôle des philosophes marxistes d’avant-guerre comme Tosaka Jun ou Miki Kiyoshi dans la réception occidentale plutôt étroite et largement orientaliste de la philosophie de l’école de Kyoto. Mais tout cela ne représente qu’une toute petite partie, très éclectique, d’une vaste tradition. Ensuite, il y a les figures situées hors du Japon, mais actives dans d’autres langues, qui sont elles-mêmes d’orientation largement marxiste et qui, par conséquent, font remonter un certain héritage à la généalogie japonaise de la pensée marxiste, notamment Harry Harootunian. Le lien le plus important avec la tradition marxiste japonaise dans le monde occidental est peut-être concentré dans la figure de Kojin Karatani, dont nous parlerons plus tard, je pense. Nous essayons d’augmenter le nombre de traductions de textes canoniques de la tradition marxiste japonaise, en particulier au sein des Historical Materialism book series mais également dans d’autres cadres. Il s’agit d’une tâche de la plus haute importance.
La deuxième partie de votre question, pourquoi l’histoire intellectuelle du marxisme au Japon est si profondément liée à la réception japonaise de l’œuvre de Marx, est une histoire beaucoup plus longue et compliquée, qui n’a pas vraiment été racontée en tant que telle et que nous ne pouvons même pas aborder ici de manière adéquate pour des raisons de longueur mais qui est fondamentale pour la formation des sciences humaines modernes tout court au Japon.
Premièrement, la réception précoce de Marx au Japon, qui commence à la fin du XIXe siècle et atteint un degré d’influence remarquable dans les années 1920, a eu un effet profond sur le reste de l’Asie en raison de la culture de l’impérialisme japonais d’avant-guerre en Asie et donc de l’hégémonie du japonais en tant que langue dans la traduction et la diffusion des textes du reste du monde. Dans ce contexte se sont développés trois éléments parallèles : 1) l’analyse, à partir du scénario historique développé dans Le Capital de Marx, de la transition du féodalisme au capitalisme, un processus qui n’était pas facilement compris comme pleinement « achevé » en Asie mais plutôt en cours. Il s’agissait essentiellement d’un mode d’enquête sur le développement historique des sociétés asiatiques qui avaient formé pour la première fois des États-nations modernes à la suite de l’expérience de l’impérialisme et de l’empiétement du capitalisme, en termes de commerce mondial, en termes « internes » d’intensification des luttes de classe dans les campagnes et de développement de formes sociales propres à la société capitaliste et cette enquête traitait donc l’œuvre de Marx comme un moyen scientifique de comprendre le processus local de développement dans un monde où le capitalisme devenait déjà globalement hégémonique ; 2) le développement de la philosophie marxiste et de la critique spéculative dans laquelle le marxisme a fourni un mode d’analyse sociale adapté à la compréhension des sentiments, des formes culturelles et de la vie esthétique spécifiquement modernes ; 3) le travail de traduction, d’édition et de publication qui était fondamentalement soutenu par l’ancrage du marxisme dans l’université.
Deuxièmement, certaines spécificités de l’après-guerre ont fait que la tradition marxiste a été refoulée de la représentation outre-mer. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, dans le cadre d’une collaboration avantageuse entre les conservateurs japonais et l’occupation américaine, ont été historiquement « recréés » comme une « ethnie homogène » limitée plus ou moins aux premières expansions impériales du début de la période Meiji (le royaume Ryukyu, incorporé sous le nom d’Okinawa, et Hokkaido, la terre natale du peuple autochtone Ainu). Cet archipel nouvellement créé, prétendument homogène, qui aurait maintenant existé de toute éternité, n’était en fait qu’une forme de désaveu de l’empire d’avant-guerre, dont l’existence a profondément marqué le XXe siècle asiatique, aboutissant à une situation étrange d’un nouvel ethnocentrisme japonais tourné vers l’intérieur du Japon « domestique » tandis que l’hégémonie impériale américaine héritait plus ou moins de l’hégémonie sur une grande partie de l’empire japonais. La « représentation » de la pensée japonaise à l’extérieur du Japon, sous l’impulsion des programmes d’études régionales (« area studies »[2]), s’est faite en complicité avec une nouvelle vision fortement orientaliste de la « japonité » et cette histoire du marxisme, de la philosophie moderne et des dessous intellectuels de l’empire, a été remplacée dans le soutien officiel de l’Occident par des traductions de l’UNESCO servant cette image du « pur » allié japonais : les crypto-fascistes comme Watsuji Tetsuro ou le mysticisme ethnique de Daisetz Teitaro Suzuki ont été largement diffusés, peignant une image du nouveau Japon totalement compatible avec la Pax Americana dans le Pacifique.
Cette structure archétypale de la relation américano-japonaise de l’après-guerre a joué un rôle démesuré dans la diffusion de la tradition marxiste du Japon dans le reste du monde. Bien sûr, après la fin de la guerre froide, cette structure a commencé à s’effondrer et de nouveaux moments d’internationalisation sont apparus en ce qui concerne la théorie marxiste au Japon. Il reste cependant un travail énorme à faire pour inscrire cet énorme corpus dans un dialogue avec ses équivalents étrangers et il n’est vraiment pas exagéré de dire que la langue japonaise est peut-être le corpus linguistique le plus important de la théorie marxiste après l’allemand, le français et l’anglais.
CT : Qui est Kōjin Karatani ? Quelle est sa relation intellectuelle avec l’œuvre de Kōzō Uno ?
G.W : Kojin Karatani (1941 -) est toujours très actif : il s’agit d’une figure intellectuelle remarquable. Il reste, probablement sans exagération, la dernière figure authentique de l’après-guerre de la tradition japonaise assez unique de grands intellectuels publics ancrés dans la tradition marxiste. Karatani, dont la vie politique a commencé avec l’émergence de la première Nouvelle Gauche au Japon autour du mouvement étudiant de 1960, est apparu comme une figure publique dans le domaine de la critique littéraire. Ses travaux ultérieurs sur Marx, au début des années 1970, ont fait de lui un intellectuel public essentiel et une personnalité célèbre, mais ce sont probablement les décennies des années 1980 et 1990 qui ont façonné sa réputation de figure marquante de la pensée sociale et de la critique culturelle. Karatani a fréquenté le département d’économie de l’Université de Tokyo, où il a reçu l’enseignement de Suzuki Koichiro, une figure majeure du cercle autour de l’œuvre de Uno Kōzō. Il est certain que Karatani a longtemps été influencé par Uno, du moins dans le domaine économique, mais c’était le cas d’une grande variété de figures du marxisme et de la politique de la Nouvelle Gauche dans les années 50-80. Je ne dirais pas qu’Uno a été la principale influence sur Karatani, mais certainement une influence. Je pense que l’influence du séjour de Karatani à Yale, la proximité avec Jacques Derrida, Paul de Man, Geoffrey Hartmann, etc., a probablement été tout aussi essentielle. Le travail de Uno a été largement lu bien au-delà de ce que l’on appelle « l’École de Uno », un point que nous aborderons sous peu lorsque nous l’examinerons plus en détail.
CT : Il est intéressant de noter que Marx. Towards the Centre of Possibility est d’abord paru (1974) en feuilleton sous la forme de sept articles dans Gunzō, une revue littéraire « aux côtés des nouvelles et des romans en feuilleton. » En outre, dans la préface de cette édition anglaise, Karatani écrit qu’alors qu’il est entré au département d’économie de l’Université de Tokyo, où il a rencontré plusieurs membres de « l’École de Uno », il s’est tourné vers la littérature et a perdu tout intérêt pour l’économie. Effectivement, en lisant ce livre, j’ai été frappé par les références littéraires et la façon dont ces références l’ont aidé dans sa lecture du Capital. Pourriez-vous revenir sur le rapport de Karatani à la critique littéraire ?
G.W : Le travail de Karatani a fondamentalement commencé dans le champ de la critique littéraire ou peut-être de la » critique » en général. Cela ne concerne pas nécessairement les objets de son analyse mais surtout son « style » et ses « protocoles de lecture » (la référence derridienne est importante dans ce sens). Les « exemples » de Karatani ont été, dès le début, des critiques comme Kobayashi Hideo et Yoshimoto Taka’aki, des figures fondatrices de l’intersection de la critique littéraire et sociale. En ce sens, son travail a toujours porté sur l’écriture, l’inscription, l’avènement de la langue nationale, le rapport entre langue et subjectivité, le rapport de la parole au texte. Surtout, Karatani a développé une manière d’écrire sur les œuvres sociales, politiques et philosophiques qui privilégiait la textualité, à une époque où, par exemple, les lectures dominantes de Marx étaient hautement conceptuelles. On peut noter ici sa propre remarque dans la nouvelle préface à l’édition anglaise de Marx. Towards the Centre of Possibility qu’il écrivait sous une certaine influence de trois figures : Yoshimoto Taka’aki, Uno Kōzō et Hiromatsu Wataru. Toutes ces figures, Yoshimoto en politique et en critique, Uno Kōzō en économie, Hiromatsu en philosophie, ont lu Marx de manière créative, mais toujours en se concentrant sur les concepts et les développements théoriques. Les influences de Karatani étaient liées, surtout à cette époque, à Saussure et à l’avènement et aux suites du structuralisme, ce qui l’a amené à développer une sorte de projet parallèle à la déconstruction dans la critique littéraire française et américaine, en démêlant les oppositions binaires du texte, en remontant les références marginales jusqu’au centre des œuvres, en rendant compte des apories structurantes révélées par les textes sur eux-mêmes, etc. Je pense que le Marx. Towards the Centre of Possibility de Karatani, s’il avait été traduit il y a 45 ans, lors de sa publication originale, aurait eu un impact significatif dans le contexte mondial, notamment parce que cette lecture stylistique et cette lecture croisée de Marx et de la critique littéraire post-structuraliste n’était pas encore un mode d’analyse établi. Il a eu un impact énorme au Japon, en partie parce qu’il montrait une autre voie pour la pensée marxiste, une voie qui n’était pas « suturée » à la politique (selon les termes de Badiou) après l’implosion de la Nouvelle Gauche en 1972-73.
CT : La méthode de lecture de Marx par Karatani semble, par certains aspects, assez proche de celle d’Althusser. L’œuvre d’Althusser était-elle lue dans la Nouvelle Gauche japonaise ? A-t-il eu une influence sur Karatani ?
G.W : Althusser était très lu au Japon et continue de l’être. Après le français, l’espagnol et l’anglais, le japonais est probablement la langue la plus importante pour l’étude d’Althusser dans le monde. Des penseurs majeurs de la gauche, notamment Imamura Hitoshi, ont traduit et introduit l’œuvre d’Althusser en japonais dans les années 1970, y compris une importante monographie complète sur la pensée d’Althusser dès 1975 (Rekishi to Ninshiki) [Histoire et connaissance]. L’œuvre d’Imamura, malheureusement inconnue en dehors du Japon, est particulièrement importante à cet égard. Yoshihiko Ichida, lui-même une figure importante de la théorie critique et de la pensée sociale au Japon (Ichida est bien sûr également connu en France pour ses travaux sur Althusser, Foucault, Spinoza et d’autres) a fait remarquer un jour que « tout comme la France a Jean Hyppolite sur Hegel, le Japon a Imamura Hitoshi sur Althusser. »[3] Je pense qu’Ichida voulait dire quelque chose de très important par cette remarque : l’accent mis par Hyppolite sur la dimension linguistique de Hegel dans des textes comme Logique et Existence déjà au début des années 50 a préparé le terrain pour une nouvelle vision de Hegel dans la pensée de la période 68, tout comme Imamura a préparé le terrain pour une nouvelle lecture totale d’Althusser qui ne deviendra dominante que des décennies plus tard. Depuis les années 70, des centaines de livres sur et autour d’Althusser ont été écrits en japonais, dont le texte essentiel Althusser : une philosophie de conjonction (2015) d’Ichida, une lecture importante basée sur un travail approfondi dans les archives de l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine). Quant à l’influence d’Althusser sur Karatani, je pense qu’elle est plus ambiante, atmosphérique que directe, Karatani partage certes avec Althusser un » anti-humanisme théorique « , mais leurs références maîtresses divergent : Spinoza, Machiavel, Gramsci pour Althusser ; Saussure, Wittgenstein, Nietzsche, Freud pour Karatani. La pensée de Karatani a son propre développement généalogique qui ne dérive pas de la pensée française des années 68 mais lui est plutôt parallèle.
CT : Le livre suivant que vous avez édité (The Red Years) porte sur le Japon de 1968. Dans quelle mesure la lecture de Marx par Karatani représente-t-elle une rupture avec la focalisation de 68 sur le jeune Marx, Karatani étant plus intéressé par la textualité du Capital, influencé par Saussure mais aussi par les psychanalystes ?
G.W : La lecture de Marx par Karatani représente une rupture très nette avec les écrits de la période de 68 sur Marx, notamment ceux centrés d’une manière ou d’une autre sur la théorie de l’aliénation. Les travaux axés sur la « théorie de l’aliénation », centrés sur le jeune Marx, des années 60 au Japon étaient une réaction ferme à la « vieille gauche », tout comme en Europe et en Amérique du Nord. «L’aliénation» en est venue à signifier tout ce contre quoi on se révoltait : la « vieille gauche » formaliste et socialement conservatrice avec, au Japon comme en France, son stalinisme de pensée, de style et de culture ; la nouvelle culture de consommation de l’après-guerre ; l’éloignement et la solitude de la société de masse ; les normes changeantes de la vie sexuelle et esthétique. Toutefois, cette « aliénation » a entraîné non seulement des ruptures avec le passé, mais aussi des formes de continuité, notamment le fantasme de « l’homme non aliéné », comme si, une fois « l’aliénation » résolue, la politique devenait inutile dans le « paradis réalisé » de l’humanité. Karatani, et d’autres, ont certainement considéré ce genre de lectures comme naïves, pré-psychanalytiques et politiquement utopiques, au sens péjoratif du terme. La traversée du fantasme dans le scénario analytique n’est pas une sorte de « cure » avec un point final d’inversion absolue mais un processus continu dans lequel des effets de subjectivation émergent. Pour Karatani, il est clair que sa lecture de Marx était centrée sur Le Capital et que toute discussion sur le jeune Marx devait être comprise à partir du système théorique et du mode de lecture établis dans l’œuvre de maturité de Marx qui fournissait un point de départ complètement différent de celui de la « théorie de l’aliénation ».
CT : Kōzō Uno est probablement le théoricien marxiste japonais le plus connu au monde et il a eu un impact énorme sur Karatani. Dans son livre, Karatani explique que l’influence de Uno réside avant tout dans l’accent mis sur l’échange. Pourriez-vous expliquer cette idée que le capitalisme est marchand par essence ?
G.W : Quelques points sont importants à souligner en ce qui concerne la pensée de Uno Kōzō. Tout d’abord, l’œuvre de Uno a eu un impact important, polyvalent et large sur le marxisme et la gauche en général au Japon, bien au-delà de la seule « École Uno ». Le travail de Uno Kōzō a été lu et soutenu par toute la Nouvelle Gauche, des simples groupes d’étude aux organisations de lutte armée et traité comme l’avant-garde du développement scientifique et formel de la pensée économique marxienne. Dans les années 1950-70, si vous travailliez au sein de la pensée marxiste au Japon, que vous étiez d’accord ou non avec son travail, vous auriez eu à prendre position sur le système théorique de Uno Kōzō, qui s’était déjà entouré d’un ensemble de personnalités toutes importantes : Suzuki Koichiro (qui enseigna à Karatani), Iwata Hiroshi (dont la théorie du « capitalisme mondial » fut influente dans les années 60) et bien d’autres, qui n’ont pas tous fait partie de « l’École Uno » en tant que telle. Karatani n’est en aucun cas un produit de « l’École Uno» au sens étroit du terme, et son travail se situe à l’écart de ce type de débat interne et hautement scolastique.
Afin de comprendre le travail de Uno Kōzō, je pense qu’il est important de mentionner quelques facteurs. Premièrement, la pensée de Uno et ses interventions méthodologiques distinctives ont émergé du « débat sur le capitalisme japonais » de la période d’avant-guerre. Ce débat portait essentiellement sur la question de savoir si le capitalisme japonais était ou non un capitalisme pleinement mature formé après la Restauration de Meiji de 1868 et même si la Restauration elle-même était ou non une « révolution démocratique bourgeoise » ou s’il s’agissait plutôt d’une révolution bourgeoise « incomplète » qui n’avait pas réussi à « moderniser » complètement l’espace national, parce que si les relations de propriété et les marchés du travail avaient été modifiés ; les éléments essentiels du « retard » japonais, tels que l’existence du système de l’empereur, la nature régionale et familiale de la classe politique et les relations paternalistes dans l’industrie et le gouvernement restaient en effet intacts en tant que « vestiges du féodalisme ». Bien entendu, ce débat reflétait fondamentalement des débats similaires dans le monde non occidental, où il fallait théoriser l’articulation volatile d’éléments ostensiblement « pré-modernes » ou « féodaux » avec le colonialisme et le développement du capitalisme qui se trouvait déjà dans son régime impérialiste d’accumulation. Lors de ce débat au Japon, Uno Kōzō a essentiellement soutenu que les deux camps, l’un traitant de la généralité du capitalisme et l’autre de sa voie de développement locale et particulière, avaient mal compris la difficulté d’appliquer directement Le Capital de Marx à une situation spécifique, locale, nationale ou régionale. C’est de la confrontation avec l’impasse du débat qu’est née la base méthodologique distinctive de Uno Kōzō, la théorie des « trois niveaux d’analyse » : 1/ le niveau du « principe » ou du « capitalisme pur », le capitalisme pris dans sa « moyenne idéale » ; 2/ le niveau des étapes ou des régimes d’accumulation dans le développement capitaliste, mercantilisme, libéralisme, impérialisme, avec leurs formes distinctives ; 3/ l’analyse conjoncturelle d’un caractère immédiat, empirique et direct de la situation locale et actuelle.
Karatani a souvent été particulièrement intéressé par les discussions de Uno Kōzō sur l’échange comme toile de fond de ses propres développements théoriques qui ont culminé ces quinze dernières années dans sa théorie des « modes d’échange ». Uno Kōzō a souvent fait remarquer que le capital naît de l’interrelation, ou du « rapport » (« l’intercourse »), entre deux communautés et que l’échange initial est ensuite internalisé dans chaque formation elle-même. Plus largement, Uno Kōzō a essayé de concevoir comment il se fait que, selon les termes de Marx,
« il est (…) impossible que le capital soit produit par la circulation et il est tout aussi impossible qu’il ait son origine en dehors de la circulation. Il doit avoir son origine à la fois dans – et cependant ailleurs que dans – la circulation. »[4]
En ce sens, le travail de Uno Kōzō, et en particulier ses principaux travaux théoriques des années 1950, a développé toute une analyse logique de la position particulière de la marchandise force de travail au sein de la pulsion du capital, notant que cela marque l’endroit où l’intérieur logique du capital et son extérieur historique s’interpénètrent, engendrant une force instable d’excès au cœur des circuits internes supposément lisses et purs du capital. En développant autour de ce point une discussion théorique approfondie de sa dynamique d’impossibilité ou d’irrationalité, Uno Kōzō formule une série de thèses originales sur le plan méthodologique, sur le concept de population et particulièrement autour des figures du logique et de l’historique dans l’analyse critique du capitalisme.
CT : Karatani est présenté comme un auteur de la théorie critique japonaise ? Comment définiriez-vous cette théorie critique, s’inscrit-elle dans le cadre de l’École de Francfort ou faut-il l’entendre dans un sens plus large ?
G.W : Tout comme la « théorie critique » est devenue un terme qui en anglais est largement en rupture de la « Kritische Theorie » inspirée de l’École de Francfort et est devenue une sorte de rubrique fourre-tout pour la théorie sociale, politique et esthétique contemporaine d’orientation critique, en japonais le terme typiquement utilisé pour cela est gendai shisō, littéralement « pensée contemporaine ». Le point culminant de la théorie critique au Japon a probablement été les années 1980 et le début des années 1990. Le phénomène appelé » nouvel académisme » (nyū aka) a accompagné une sorte de boom du lectorat et de la visibilité du courant principal des œuvres de théorie sociale et littéraire critique. Ce phénomène, dans lequel Karatani et le critique Asada Akira ont joué un rôle clé, était lié au rôle important de la « théorie française » au Japon, un indice de la francophilie répandue dans le pays, en particulier dans les domaines de l’esthétique et de la culture. Discuter de manière adéquate de l’histoire et de la fonction de la francophilie au Japon, qui est bien sûr liée de manière complexe à la japonophilie française, au « japonisme » fin- de-siècle, etc., nous éloignerait du sujet de cet entretien mais il est important de souligner que la pensée sociale et politique japonaise a été puissamment transformée dans le sillage de 68 par la philosophie et la théorie sociale françaises du 20e siècle. La revue Hihyō kūkan [Espace critique] de Karatani et Asada a été un véhicule important de ce travail, aux côtés de revues plus explicitement politiques comme Jōkyō [Situation], une revue directement formée à partir de l’expérience Zenkyōtō de la longue période de 68 et Gendai shisō : revue de la pensée d’aujourd’hui, une revue clé dans le développement de la théorie critique au Japon. Cette » tradition » n’est plus aussi forte qu’autrefois, mais elle conserve une importance au sein de l’université, mais surtout, dans le secteur de l’édition. Je dirais qu’une caractéristique singulière du cas japonais est le fait que, contrairement aux États-Unis, où la « théorie française » et ses développements étaient largement confinés à l’université (bien que le domaine des arts soit une question distincte), au Japon, l’œuvre de Karatani, ou bien Kōzō to chikara (Structure et pouvoir – Au-delà de la sémiotique) d’Akira Asada en 1983 (importante méditation post-marxiste sur la pensée française de la période post-68, Deleuze et Guattari, Lacan, Foucault, entre autres), pouvaient quasiment devenir des best-sellers parmi le grand public. Ce genre de phénomène est impensable dans la plupart des autres pays et ses effets se poursuivent aujourd’hui, même si l’essor du « nouvel académisme » s’est essoufflé dans les années 90.
CT : Vous avez récemment édité un livre sur 1968 au Japon (The Red Years. Theory, Politics and aesthetics in the Japanese ’68, Verso, 2020). Dans l’introduction de ce livre vous écrivez que 1968 au Japon a probablement été le plus long ’68 sur terre, s’étendant du renouvellement de l’Anpō, ( Traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon connu sous le nom d’ANPO, abréviation de Anzen Hosho Joyaku, traité de sécurité garantie) en 1960 à la fin de l’Armée Rouge Unie en 1972. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous parlez d’un long ’68 pour une telle période ?
G.W : Je remonterais même plus loin et suggérerais que les débuts de la période de 68 au Japon se situent en 1955. A ce stade, la crédibilité d’une telle thèse peut être mise à rude épreuve si l’on suggère que 68 est le nom d’une période de presque 20 ans (1955-1973) mais il y a certaines raisons essentielles à cela. La première est que l’histoire de la « nouvelle gauche » au Japon est très différente de celle de la plupart des pays d’Amérique du Nord ou d’Europe. La nouvelle gauche est généralement considérée comme émergeant des suites des « révélations » sur Staline dans le « rapport secret » de Khrouchtchev au 20e congrès du parti communiste de l’Union soviétique au début de 1956 et de la réaction à l’invasion soviétique de la Hongrie plus tard la même année. La désillusion qui a suivi cette période, parallèlement à la scission sino-soviétique déjà en cours, a entraîné des changements majeurs parmi les militants communistes dans divers endroits du monde. D’une certaine manière, cela a été l’impulsion pour la formation d’une orientation politique communiste en dehors de la direction dirigée par Moscou et même le sentiment chez de nombreux jeunes que les PC officiels avaient « trahi » la cause, devenant des bureaucraties ossifiées et inflexibles. Il est évident que les questions historiques et théoriques que cette période soulève ne peuvent être traitées sérieusement de manière comprimée et ceci n’est qu’un aperçu trop simple. Mais au Japon, ce processus a eu lieu essentiellement deux ans plus tôt et de manière indépendante. La fin des années 1940 et le début des années 1950 ont été une période remarquable pour le mouvement communiste au Japon. La gauche dans son ensemble bénéficiait d’un large soutien malgré les répressions des forces d’occupation américaines. Le succès de la révolution chinoise de 1949 avait donné un nouvel élan et une subjectivité victorieuse à la cause communiste en Asie. Au début des années 1950, le Parti communiste japonais était en pleine mutation, avec de nombreuses tendances politiques en son sein. Sous la large influence de la ligne chinoise, le parti avait un élément clandestin, souterrain et même une préparation à la lutte armée, un flirt avec la stratégie de la « guerre populaire prolongée » entreprise par le parti chinois dans la guérilla contre l’impérialisme japonais. Le PCJ a mis en place des expériences politiques remarquables, par exemple, le sanson kōsakutai ou Unité d’Opération des Villages de Montagne dans lequel les jeunes militants et cadres du parti se rendaient clandestinement dans les villages ruraux et les campagnes exploitées en périphérie pour » faire la révolution « . L’histoire de l’échec de cette expérience est compliquée et a également à voir avec les réformes agraires de l’occupation américaine mais l’expérience de ce moment révolutionnaire clandestin a eu une longue influence sur la gauche. En 1955, lors du 6e congrès du PCJ, cette expérience, et en fait toute la période d’organisation clandestine ou souterraine, a été rejetée par le parti comme un « aventurisme d’ultra-gauche » et une nouvelle ligne parlementaire est devenue hégémonique au sein du parti. Cette répudiation a frappé les jeunes militants comme une trahison stupéfiante. En ce sens, le passage du PCJ au parlementarisme en 1955 a créé les conditions d’une gauche communiste en dehors du parti officiel, une sorte de nouvelle gauche naissante deux ans avant que la situation soviétique et internationale ne fasse de même à l’échelle mondiale. Cette nouvelle gauche a ensuite constitué le contexte social des premières manifestations contre l’Anpo et de la génération Zengakuren de 1960, qui a à son tour donné naissance à la génération Zenkyoto de 1968. L’après 68 a atteint son point culminant en 1972, décrit dans un chapitre remarquable de The Red Years par Yutaka Nagahara, lui-même l’un des principaux intellectuels marxistes du Japon contemporain. Dans le sillage de l’incident du Mont Asama de 1972, au cours duquel les militants de l’Armée rouge unie ont pris des otages et se sont livrés à une ultime fusillade avec la police, les meurtres internes de l’organisation furent révélés à la suite de l’incident, retournant définitivement la majorité de la société contre les sectes de gauche. Les mouvements post-étudiants ont fait l’objet d’une certaine admiration pour leur ténacité et leur engagement, mais en 1972, la vague de 68 avait commencé à s’estomper. Par la suite, les organisations qui ont émergé, notamment le Front armé antijaponais d’Asie de l’Est et l’Armée Rouge Japonaise Internationale au Liban, étaient beaucoup moins centralisées et se sont largement consacrées à des actions armées symboliques et nihilistes. Les anciennes sectes de la Ligue communiste, les fractions Kakumaru (Marxistes Révolutionnaires) et Chūkaku (Noyau Central) qui s’étaient engagées dans un cycle féroce de tueries intestines, se replièrent sur leur noyau dur sectaire. Cela mit, plus ou moins, fin à 68. C’est un tournant vaguement comparable au tournant de la fin des années 70 vers le concept de « guérilla urbaine » en Europe, les Brigades rouges, Action directe, la RZ, etc. Cela ne veut pas dire que l’orientation politique des sectes et des organisations armées était nécessairement « mauvaise » mais elle était clairement l’indice d’un désespoir général face à la dépolitisation et à la démoralisation du mouvement de masse de 68 qui s’était maintenu au-delà de ses propres capacités et de son horizon, tombant ainsi dans une sorte de nihilisme. Je ne rejette pas ce nihilisme en tant que tel, mais il est clair qu’il s’agissait d’une réaction au poids écrasant de la défaite.
CT : Pourquoi pensez-vous qu’il est politiquement pertinent de mettre un terme à la fin des « années rouges » japonaises ?
G.W : Je pense que c’est politiquement pertinent pour deux raisons. Premièrement, c’est une façon « traduite » de dire que nous devrions mettre fin à la période des années 1990, avec son discours sur la « fin de l’histoire ». Ce sont en réalité les années 80 et 90 qui constituent l' »anti-68″, une période de reflux, une période de chute du pouvoir soviétique, de désillusion, d’affaiblissement de la force active du marxisme et avec elle, des liens sociaux qu’une politique forte de résistance à l’ordre dominant rendait possible. Deuxièmement, c’est un refus d’une stratégie historiographique très spécifique, employée sans détour dans la majorité des histoires des « global 60s« , et caractérisée par son détachement assumé et ses fantasmes de « maturité » après les « indiscrétions de jeunesse » de 68. Personnellement, je trouve ce genre de narcissisme d’âge mûr, obsédé par la justification de la lâcheté politique et théorique et le glissement d’une politique émancipatrice vers un libéralisme blasé, complètement répugnant. Rien n’est moins séduisant que le discours du maître d’école selon lequel la révolution est un produit de la jeunesse, après quoi la rationalité raisonnable s’installe et on peut se passer du fanatisme immature pour défendre l’apathie. C’est une trahison de tout ce qui constitue une politique (et une pensée) digne de ce nom : la passion, l’endurance, la persévérance, le refus, la résistance, l’antagonisme, le courage, la vérité, l’engagement. L’analyse historique de la politique révolutionnaire est aujourd’hui l’un des champs « professionnels » les plus déprimants de l’histoire sociale institutionnelle, engagée dans le grand mot d’ordre du libéralisme : « c’est compliqué. » Nous devons donc refuser ce genre de saccage écervelé de l’histoire de la politique émancipatrice mais cela ne signifie pas que nous devions produire des hagiographies et des récits héroïques sur une période de lutte intense et épuisante. En finir avec le discours de la « fin de 68 », ce n’est pas la figer au firmament comme un « grand moment » ; c’est au contraire lui redonner son dynamisme, son ouverture, son impétuosité, son actualité.
CT : En Allemagne de l’Ouest, dans les années 1960 et 1970, il y a eu un important débat parmi les membres de la Nouvelle Gauche concernant la persistance du fascisme dans la structure de la Nouvelle République Fédérale (certains maoïstes ont même développé la thèse d’une Faschisierung de l’Allemagne de l’Ouest). Dans quelle mesure l’attitude du Japon au cours des années 1930 et 1940 (non seulement son alliance avec l’Allemagne national-socialiste, mais aussi son invasion de la Chine) a-t-elle été un sujet pour la Nouvelle Gauche japonaise.
G.W : Il ne fait aucun doute que les vestiges du fascisme constituaient une question importante, voire centrale, au sein de la Nouvelle Gauche. Comme en Allemagne de l’Ouest, les autorités d’occupation américaines de l’après-guerre, bien qu’elles se préoccupaient, en théorie, de poursuivre les fascistes de premier plan, ont en fait réhabilité un grand nombre de figures du régime fasciste en guise d’obstruction provisoire contre la gauche, les communistes, et dans le cadre de la guerre froide naissante. Au moment où la nouvelle gauche émergeait fondamentalement comme une force sociale majeure les « vestiges du fascisme » avaient été pleinement réintégrés dans l’ordre de l’après-guerre, comme en témoigne le Parti libéral démocrate, pratiquement le seul parti au pouvoir dans le Japon d’après-guerre. Lors de l’occupation emblématique de l’université de Tokyo en 1969, les portes du campus, de part et d’autre des barricades, portaient d’un côté le célèbre dicton de Mao « on a toujours raison de se révolter » et de l’autre le slogan « détruisez l’université impériale » (teidai kaitai). L’université de Tokyo, dans la période d’avant-guerre et de l’entre-deux-guerres, était bien sûr « l’université impériale de Tokyo », l’institution phare de l’enseignement supérieur du vaste empire japonais ; l’implication, bien sûr, était qu’en 1969, l’impérialisme japonais vivait sous d’autres formes. L’héritage colonial et impérialiste de l’État japonais n’était pourtant pas nécessairement dans tous les cas une priorité un sujet au premier plan de la lutte. Le Japon lui-même étant devenu subordonné à l’impérialisme américain dans la période d’après-guerre, il était facile pour le Japon de laisser de côté son rôle antérieur d’agresseur impérialiste. Mais la période de 1968 a également vu une augmentation remarquable de la visibilité des luttes des minorités, d’Okinawa, du peuple Ainu, des minorités coréennes et chinoises résidentes et de la discrimination anti-buraku ou « caste inférieure ».
L’année 1968 a été marquée, par exemple, par l’incident dit « Kin Ki Ro », au cours duquel un Coréen-Japonais de deuxième génération, Kim Hui-ro, a pris en otage un groupe de clients d’un hôtel de la ville de Shimizu, accusant l’État japonais de discrimination à l’égard de la minorité coréenne et de maintien du « système de division » dans la péninsule coréenne. Cet incident, et ses conséquences, ont eu un long retentissement, notamment lors du procès de Kim. Au sein du groupe de soutien à la défense de Kim se trouvait Suzuki Michihiko, le traducteur de l’ouvrage de Fanon Les damnés de la terre, qui soutenait que la minorité coréenne post-impériale au Japon était placée dans une position impossible, coupée de ses racines mais privée d’une pleine « japonité », qui ne pouvait qu’exploser dans la violence révolutionnaire. Deux ans plus tard, en 1970, l’écrivain et militant Tsumura Takashi écrivait son extraordinaire ouvrage Warera no uchi naru sabetsu (La discrimination en nous), qui plaidait pour que la nouvelle gauche se tourne à nouveau vers l’Asie pour se repentir du « péché originel » du Japon, à savoir l’impérialisme et la colonisation du continent asiatique. Tsumura était assez brillant et son texte eut un certain écho, même si son audience eut mérité d’être plus grande encore. Dans les dernières années de cette saison de politique révolutionnaire, l’organisation de lutte armée appelée « Front anti-japonais d’Asie de l’Est » a émergé avec le fameux attentat à la bombe de 1974 contre les bureaux de Mitsubishi Corporation à Tokyo commis par la cellule « Wolf » du groupe, et dans son sillage, les cellules « Fangs of the Earth » et « Scorpion« , entre autres, ont rejoint leur campagne clandestine d’attentats à la bombe « anti-impérialistes, anti-coloniaux ». Les travaux théoriques et la position politique pratique du « Front anti-japonais d’Asie de l’Est » connu également pour ses remarquables manuels de guérilla urbaine, longtemps interdits, intitulés « Hara hara tokei » (Le tic-tac) étaient uniques au sein de la nouvelle gauche en ce qu’ils se concentraient sans relâche sur l’héritage colonial de l’État japonais à Hokkaido (Ainu Mosir) et Okinawa, Le groupe a adopté la ligne résolument non populiste selon laquelle rien de moins que la destruction du « Japon » lui-même permettrait de rembourser les dettes de l’agression japonaise en Asie. Leur impact pratique a été faible mais reste un moment peu étudié et remarquablement influent.
CT : Pourquoi caractérisez-vous ces « années rouges » comme une défaite structurante ?
G.W : Il est impossible de considérer l’année 1968 dans les pays capitalistes dits « avancés » comme une victoire. Je ne dis pas du tout cela pour dénigrer 68 ou pour rejoindre le chœur des réactionnaires qui nous diraient que les revendications pour lesquelles on a lutté en 68 n’étaient qu’utopiques et infantiles. Je pense que les enjeux de 1968 étaient considérables et que la lutte de la Nouvelle Gauche mondiale doit être soutenue. Le fait est, cependant, que la Nouvelle Gauche, même avec le passage à la lutte armée, n’a pas été capable d’inverser les tendances qu’elle observait : la réorganisation de l’impérialisme mondial, les prédations de la société capitaliste à l’échelle mondiale, la guerre et la destruction engendrées par la géopolitique de la Guerre Froide, l’aliénation et le retrait de toutes les formes de communauté sous la domination de la société marchande, la dérive culturelle mortifère de la bureaucratie. Aujourd’hui, pratiquement tous les aspects de ce que la Nouvelle Gauche a combattu sont pires, plus profonds et toujours plus intransigeants. Ce serait donc une farce totale d’appeler 68 une « victoire ». C’est une défaite. Mais je pense que Yutaka Nagahara, un critique marxiste brillant et crucial dans le contexte japonais, a dit quelque chose de très important dans sa contribution à The Red Years. Au lieu de traiter 68 comme quelque chose de « post-événementiel », une sorte d’emblème de ce qui a été, maintenant apposé sur un fait historique désormais inaccessible, nous devons le transformer en quelque chose de « pré-événementiel », un trait de notre histoire qui constitue une tentative de politique émancipatrice, libératrice, un fondement historique de quelque chose qui est à venir, une nouvelle rupture anticipée. Nagahara appelle cela « livrer la politique à cette défaite ». Je suis convaincu que c’est en tout cas ce que nous devons faire : livrer la politique à 68 pour qu’il fonctionne non pas comme un échec passé, mais comme une possibilité présente.
CT : Quel est l’état de la gauche japonaise d’aujourd’hui ?
G.W : Je ne suis pas le mieux placé pour répondre car la question a un caractère pratique et conjoncturel immédiat. Les universitaires comme moi ne devraient pas faire de proclamations sur le statut de la gauche mais plutôt fournir des interventions en histoire et en théorie qui peuvent être utilisées dans la pratique subjective de la politique. Je pense qu’il y a, au Japon comme partout dans les pays capitalistes avancés aujourd’hui, un retour au marxisme, un retour à l’histoire du communisme et un retour à des directions d’analyse émancipatrices contre l’impasse de la politique parlementaire libérale. Il est clair que les jeunes au Japon, comme ailleurs, sont à la recherche de toute possibilité politique qui reconnaît dans l’ordre dominant une voie d’anéantissement. La crise climatique, exacerbée au Japon par la dissimulation continue par les entreprises et l’État de la catastrophe nucléaire de Fukushima à la suite du tremblement de terre et du tsunami de 2011 dans la région de Tōhoku, a également radicalisé de nombreux jeunes contre l’ordre parlementaire bourgeois sclérosé au Japon, sa rigidité autodestructrice et son despotisme délétère et brutal sur la question environnementale. Les nouvelles générations de marxistes existent bien sûr aussi dans le système universitaire japonais qui a toujours développé une recherche théorique de très haute qualité et il y a de nombreux exemples importants, comme la massive participation japonaise au projet MEGA. Cela dit, une certaine partie du « retour du marxisme » aujourd’hui au Japon, comme ailleurs, consiste en un retour formaliste et scolastique à la marxologie, politiquement liée à une social-démocratie conciliante. C’est une grave erreur. Les débats stériles sur le placement des virgules dans les manuscrits non publiés de Marx sont d’une utilité quasi nulle pour la politique contemporaine. La tradition créative et combative du travail théorique et politique marxiste au Japon, en particulier dans les années 1950-80, devrait être réactivée. La tradition de lutte de la nouvelle gauche doit être maintenue. Dire que « les hommes font l’histoire, mais pas dans les circonstances qu’ils ont choisies » est un rappel que si vous pouvez faire l’histoire, vous ne pouvez pas non plus y échapper. Le « retour à Marx » doit aussi être un « retour au marxisme » et surtout un « retour à la politique », la politique concrète de faire du marxisme dans des conjonctures spécifiques, sans quoi, il en restera à des débats talmudiques sur l’interprétation textuelle. Notre tâche est de produire une pensée de lutte, de combat et pas simplement d’améliorer notre vision de l’histoire intellectuelle du 19e siècle. Si une nouvelle génération au Japon découvre que la tradition linguistique de cet archipel contient une vaste encyclopédie de cette « pensée de la lutte » qui peut être une référence pour le monde entier, ce serait un outil véritablement puissant pour une politique émancipatrice aujourd’hui.
*
Propos recueillis par Selim Nadi, traduction Christian Dubucq.
[1] Signalons un n° d’Actuel Marx de 1987 consacré à la question.
[2] Champ d’études promu durant la guerre froide et visant à produire des connaissances (culturelles, politiques, etc..) sur les sociétés jugées exposées à la l’influence et la progression du communisme (en Asie notamment). Ndt.
[3] Ichida Yoshihiko, » Kaisetsu » dans Imamura Hitoshi, Archuseru zentetsugaku, éd. rév. [titre original : Aruchuseru : Ninshikironteki setsudan] (Tokyo : Kodansha, 2007), 374.
[4] Marx, Capital, vol. 1 dans MECW, vol. 35 (New York: International Publishers, 1996), 165-166.