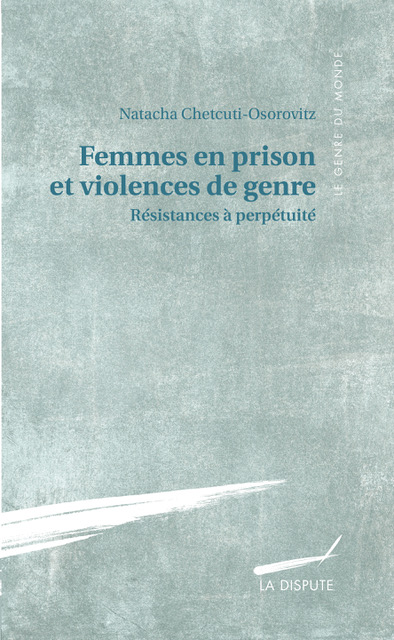
Nous publions un extrait du livre Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité de la sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz, paru aux éditions La Dispute (2021).
Femmes déviantes, rebelles, violentes… C’est à rebours de ces stéréotypes que cet ouvrage se consacre aux femmes incarcérées pour de longues peines. Natacha Chetcuti-Osorovitz, en s’appuyant sur les récits de détenues, reconstruit des itinéraires marqués par la violence de genre que ces femmes ont subie en amont de leur passage à l’acte et de leur condamnation. C’est à la mise en évidence de ce continuum de violences que tient d’abord l’originalité de ce livre.
Dans le même esprit, l’auteure montre comment le parcours pénal est façonné par un dispositif disciplinaire où les femmes doivent se conformer à l’ordre social de genre. In fine, cette ethnographie de longue durée traite de ces questions d’actualité que sont la carcéralisation, le consentement, les violences de genre et l’émancipation.
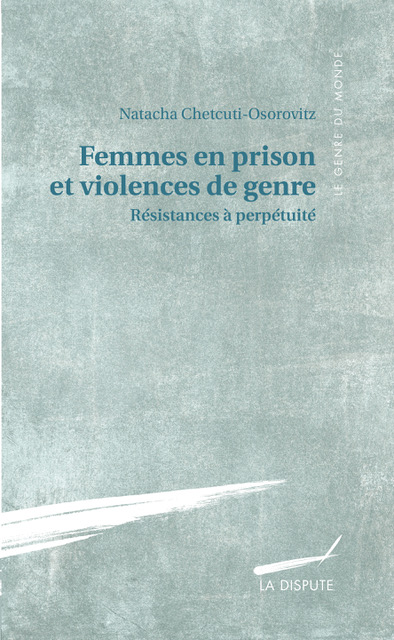
Dans l’introduction de cet ouvrage, j’ai exposé ma préoccupation principale : étudier le processus de mise en récit de l’expérience pénitentiaire par les détenues en moyennes et longues peines, en France, aujourd’hui. J’ai porté mon attention, dans un premier registre, sur l’expérience carcérale et son déroulement, en fonction du dispositif appelé parcours d’exécution de peine. Il s’agissait d’analyser les possibilités de la production d’un discours sur soi au cœur même de l’enfermement carcéral, et le façonnage psychologique du dispositif disciplinaire d’évaluation pénale. La question centrale est la suivante : comment construire un récit, au plus près de soi, à travers un procédé disciplinaire qui vise à une unicité de parcours en fonction de normes assujettissantes ?
Produire une parole sur soi pour se libérer du processus carcéral, alors que celle-ci est prise – voire conditionnée – à l’intérieur d’un système de répression, est un exercice complexe. En interrogeant les catégories de discours et de jugement sur lesquelles se fonde, pour chaque détenue, le couple « auteure/victime », j’ai procédé à l’examen de ces catégories selon le contexte d’interaction et d’énonciation. Ce cadre analytique permet de faire apparaître le rapport souvent dysfonctionnel entre l’usage juridique des notions victime/auteure et leur inscription dans le réel des femmes incarcérées, réel façonné par des logiques de domination en termes de rapports sociaux consubstantiels. Dans la perspective de la « critique du droit », ce constat vient ainsi interroger les classifications juridiques dans leur contexte social contemporain, « récepteur […] des questions de pouvoir et du jeu des acteurs »[1].
Fondé sur une analyse des rapports sociaux de sexe, cet ancrage théorique a permis de mettre en perspective le continuum des violences de genre dans la construction de la typologie des itinéraires biographiques. Ce continuum des violences de genre pris à l’intérieur des socialisations sexuées – de classe sociale, de sexualité, de racialisation – laisse entrevoir la force plus ou moins visible de ces rapports sociaux dans les trajectoires des détenues. Si les rapports de domination passent à l’intérieur des corps et dans les manières de se situer socialement, l’approche matérialiste des rapports sociaux de sexe interroge les pratiques de résistance, en fonction de la mise à distance plus ou moins aisée face à la division sexuelle du travail dans toute son étendue.
Mais comment penser des formes « émancipatoires », dans le sens de la théorie, de la pratique et de la politique – ces trois éléments pris simultanément –, sans prendre en compte la production des subjectivités carcérales, à l’intérieur des « agencements machiniques »[2] qui les façonnent ? Comment sortir du rapport social de domination, échapper aux rapports de pouvoir quand l’expertise pénale est entièrement prise dans des attendus normatifs de genre ? L’analyse des récits de vie des détenues rencontrées montre que la majorité d’entre elles a été victime de violences masculines. Le traitement pénal vient leur signifier qu’il ne suffit pas d’être victime de violences de genre, encore faut-il être la bonne victime. D’une certaine manière, les femmes qui dérogent aux devoirs de leur sexe/genre sont considérées comme responsables d’une destinée qu’elles mériteraient. La dissymétrie entre les violences commises par les condamnées et celles subies dans le continuum des violences de genre est balayée par l’impensé sociologique, selon lequel les femmes respectables ne sont pas violentes ou acceptent d’être victimes, ou encore y cèdent. C’est tout le paradoxe de ce processus disciplinaire : il rend possible la reconnaissance du statut de victime de violences de genre, alors que ce statut n’a pas pu s’énoncer comme tel avant le moment carcéral et, en même temps, il reste arc-bouté sur un critère d’évaluation qui est celui de la reconnaissance du statut d’auteure de violences.
Le traitement pénal des illégalismes politiques renferme, lui, beaucoup de spécificités. Dans le dernier chapitre du livre, j’ai exposé la posture des prisonnières autodéfinies comme politiques en tant que militantes basques face au régime de carcéralisation. Le traitement pénal qui leur est appliqué vient nous éclairer, entre autres aspects, sur la volonté d’effacement de la visibilité des opposantes politiques dans le contexte contemporain. L’analyse du processus de réflexivité des prisonnières autodéfinies politiques, à partir de l’approche en termes de « cas limite », a permis de montrer la manière dont elles résistent au dispositif disciplinaire, précisément en fonction de leur élaboration et de leur pratique politiques.
Le deuxième registre d’analyse de ce travail d’enquête porte sur la mise en œuvre contrainte d’une identification à un collectif « femmes » et « détenues » dans l’établissement des sociabilités carcérales. En prenant en compte les socialisations antérieures à la vie carcérale – en fonction du rapport générationnel, du genre, de la classe sociale, de la conjugalité, du travail et de l’emploi, de la religion, de l’engagement politique[3] –, je me suis interrogée sur la possibilité de production de solidarités collectives. Comment les éléments de socialisation antérieurs à l’incarcération constituent-ils des points d’appui, des ressources ou, au contraire, des contraintes dans le quotidien carcéral pour soi-même, mais aussi dans la manière d’établir des liens avec les codétenues et l’ensemble des personnes intervenant au centre de détention pour femmes ? La vie carcérale et sa spatialité imposent des proximités quotidiennes auxquelles il est difficile d’échapper. Toutefois, de nouvelles configurations relationnelles peuvent voir le jour. Elles permettent de trouver des échappées, mêmes passagères, pour maintenir une vie tenable dans la longue durée de l’incarcération.
Je ne me suis pas référée de manière centrale à la notion d’« institution totale » de Goffman, comme cadre théorique d’analyse de la carcéralisation : « un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent une vie ensemble recluse dont les modalités sont explicitement et rigoureusement réglées »[4]. Cette notion est depuis une dizaine d’années critiquée – au sens noble du terme – par de nombreux·ses auteur·e·s de la sociologie carcérale[5], qui privilégient, ainsi que je l’ai fait, la notion d’« organisation sociale », au service d’une institution : le ministère de la Justice. Ces dernier·ère·s justifient l’emploi de cette notion en mettant en avant l’accroissement des droits pour les prisonnier·ère·s, du fait d’une plus grande possibilité de recours aux institutions extérieures (Observatoire international des prisons, Contrôleur général des lieux de privation). L’ouverture de la prison par la direction de l’administration pénitentiaire (dépendante du ministère de la Justice) à une plus grande variété de personnes extérieures (chercheur·e·s, artistes, bénévoles d’association) aurait également facilité la levée des murs de l’organisation prison. Si ce constat est juste, toutefois la discussion scientifique n’est pas aussi tranchée à l’égard de l’environnement carcéral. L’enquête ethnographique de longue durée m’a permis de constater que cette ouverture est fonction du type d’intervenant·e·s, de la tonalité des sujets et questionnements de recherche, aux projets artistiques et à leurs objectifs. C’est ainsi qu’en 2018 le ministère de la Justice a mis fin à la convention qui le liait avec le Génepi[6], association étudiante anticarcérale et féministe qui dispensait depuis plus de quarante ans un soutien scolaire en détention. Il est reproché à l’association d’avoir diminué son nombre d’interventions en détention et d’avoir adopté des positions hostiles à la politique du gouvernement. On peut également se demander si les associations et structures d’accueil présentes en détention ne vont pas péricliter avec la mise en place du plan pénitentiaire de 2018 et le développement dans les prisons du système de financement et de gestion en partenariat public-privé, qui a pour conséquence le transfert des missions d’accès à la formation, pour les personnes détenues, au secteur privé.
En conduisant une recherche spécifique sur les femmes incarcérées, mon enjeu était de rendre visible une réalité que la sociologie a longtemps, et pour une grande part négligée, voire marginalisée, par l’accent quasi exclusivement porté sur l’incarcération des hommes. Le développement de cette recherche permet de reposer la question de l’invisibilité des violences de genre, de la division sexuelle du travail, du privé et du public, mais également d’analyser la fonction de l’emprisonnement.
Le dernier jour du terrain, une prisonnière avec qui j’ai beaucoup échangé, m’a demandé ce que je pouvais dire de l’utilité de la prison, après tous ces mois passés à leurs côtés. Il m’a été difficile de répondre immédiatement à cette question, sinon que, contrairement à ce qu’il est commun de dire et d’entendre, je ne pense pas que la prison fonctionne comme une loupe de la société, mais que son organisation permet de percevoir comment ces processus disciplinaires se sont étendus à toutes les sphères de la société : dans les termes utilisés quotidiennement en détention – parcours de peine, dangerosité, expertise, évaluation, confinement –, que l’on retrouve par exemple dans le monde de l’éducation spécialisée et des professionnel·le·s de l’enfance ; dans le rôle de la surveillance électronique des populations – présence des caméras dans l’espace urbain –, et d’autres formes de contrôle – reconnaissance faciale, données numériques. À la différence près que, dans la « société de surveillance » numérique[7], on ne s’y rend pas par la coercition, mais par le désir de se rendre visible ou par l’impuissance à pouvoir faire autrement. Pour Bernard Harcourt, nous sommes ainsi entrés dans une nouvelle circulation du pouvoir qui façonne l’ensemble de nos subjectivités sans que nous ne maîtrisions l’usage des informations que chaque individu fait circuler sur lui-même, ses pratiques et son environnement.
Ces analyses ne posent pas un regard exotique sur la vie carcérale, ni ne servent de vade-mecum en vue d’améliorer le confort des prisonnières ou pour justifier la construction de nouvelles prisons. Je défends un autre enjeu, selon la formule de Jean Genet, celui « de faire varier les limites de l’innocence »[8], en interrogeant l’ordre hétérosexiste reproducteur des violences faites aux femmes.
Dans cette recherche, j’ai voulu faire parler celles dont la parole est généralement portée par d’autres, sans pour autant en devenir leur porte-parole. La restitution sociologique des biographies des femmes incarcérées est au centre de l’analyse. Leurs savoirs, en tant que sujet de l’expérience carcérale et pénale, ont constitué l’outil principal, tout au long de l’écriture. Pour autant, à la fin de ce travail, je me suis rendu compte qu’une question importante n’avait jamais été posée : comment les prisonnières peuvent-elles penser autrement le travail juste de la peine ? Il est volontiers admis qu’une prisonnière ou un prisonnier se raconte, décrive son expérience de la détention et vende ses mémoires. En revanche, il est difficilement accepté qu’un·e détenu·e puisse penser la loi, le droit et le pouvoir. La prisonnière peut raconter ce qu’elle vit, mais elle doit laisser à l’expert·e les réflexions que cette vie lui inspire. Cette procédure de l’écriture, réglée par les mécanismes du pouvoir, permet de spécifier chaque discours, de plonger l’opinion dans l’ignorance de la réalité carcérale et d’imposer ainsi un schéma de pensée. Déjà en 1971, le groupe d’information sur les prisons refusait de servir ainsi le pouvoir. Au-delà du simple témoignage, les prisonniers et prisonnières donnent leur « théorie » de la prison et non pas, comme les autorités le font, une théorie sur la délinquance. Cette question ouvre vers d’autres promesses de recherche et de dialogue avec la méthode proposée par Alinsky[9], relative à l’organisation de l’intervention sociale et ce qu’il appelle la « stratégie conflictuelle», dans sa critique du travail social forclos, à travers des procédés thérapeutiques d’adaptation qui oblitèrent les rapports d’assujettissement, les rapports de force et les systèmes d’oppression. Sa proposition d’autodétermination des groupes sociaux, selon leurs propres intérêts, constitue une ouverture pour penser le rapport entre empirisme et pouvoir d’agir, tout en restant au plus près des intérêts du groupe concerné – seule manière, selon Alinsky, de construire une relation de négociation. C’est tout le contraire du processus pénal qui s’inscrit dans l’injonction au changement.
Tout terrain d’enquête sociologique doit appréhender la stricte parole du sujet, sans forcer la formulation du récit, en respectant les non-dits, notamment à propos de la nature du délit de chacune. C’est aussi la raison pour laquelle je n’ai pas mis en avant automatiquement la raison de l’incarcération dans le rendu des extraits de récits, au risque de surdéterminer le sens des propos des unes et des autres.
J’ai appris dans ce monde carcéral qu’il est difficile de tenir compte de l’émotion de l’autre. Pour résister dans le quotidien, l’émotion doit être sobre. Pas de masques. Pas de théâtre non plus. L’ordinaire est fait de ce mouvement entre le trop et le pas assez, qui tient lieu de positionnement et de juste mesure dans le rapport à l’autre.
*
Illustration: changTing flickr.
[1] Martine Kaluszynski, « Accompagner l’État ou le contester ? Le mouvement “Critique du droit” en France. Des juristes en rébellion », Criminocorpus (en ligne), « Les rebelles face à la justice », articles mis en ligne le 29 septembre 2014, p. 18.
[2] Félix Guattari, Les Années d’hiver, 1980-1985, Les Prairies ordinaires, Paris, 2009.
[3] Pour une analyse des relations amoureuses et sexuelles entre femmes en prison et sur les manières dont sont mobilisées les catégories de genre et de race dans le monde carcéral, voir : Natacha Chetcuti-Osorovitz, « Lesbian Life in Prison. Surveillance, Refuge, and Self-Naming », in Marianne Blidon et Stanley Brunn (sous la direction de), Handbook of the Changing World LGBTQ Map, Springer, New York, à paraître en 2021.
[4] Erving Goffman, Asiles…, op. cit., p.41.
[5] Georges Benguigui, « La paranoïa pénitentiaire », in Georges Benguigui, Fabrice Guilbaud, Guillaume Malochet (sous la direction de), Prisons sous tension, op. cit. ; Corinne Rostaing, La Relation carcérale…, op. cit.
[6] Génepi, Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées, association créée en 1976 à la suite des grandes mutineries du début des années 1970.
[7] Bernard E. Harcourt, La Société d’exposition. Désir et désobéissance à l’ère numérique, Seuil, Paris, 2020.
[8] Ces deux thèmes majeurs que sont l’innocence et la culpabilité couraient au fil des tracts et des interventions du Groupe d’information sur les prisons (GIP). Genet a lancé le débat et Foucault a écrit pour le défendre l’article « Violence et brutalité », paru dans Le Monde, le 2 septembre 1977 ; ce texte est devenu la préface aux Textes des prisonniers de la « Fraction armée rouge » et dernières lettres d’Ulrike Meinhof, Maspero, « Cahiers libres », Paris, 1977.
[9] Saul D. Alinsky, Rules for Radicals, Random House, New York, 1971, traduit par Jean Gouriou, Manuel de l’animateur social, Seuil, « Esprit », Paris, 1976, repris sous le titre Être radical, Aden, Bruxelles, 2012.