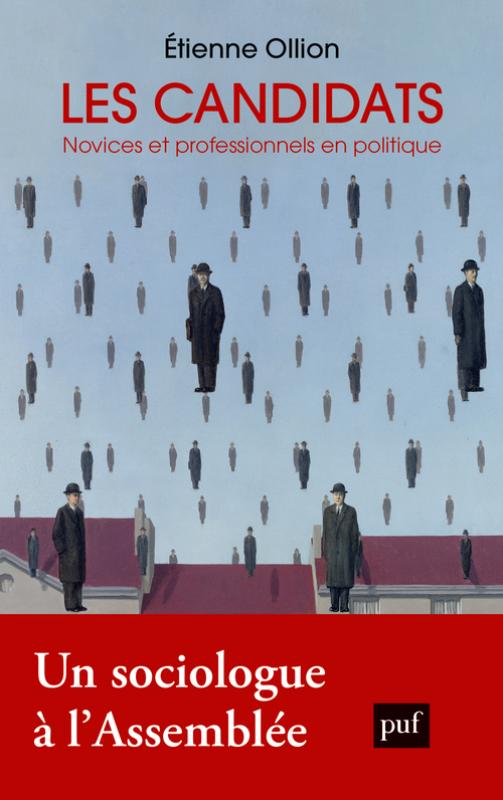
À propos de : Étienne Ollion, Les candidats. Novices et professionnels en politique, Paris, PUF, 2021.
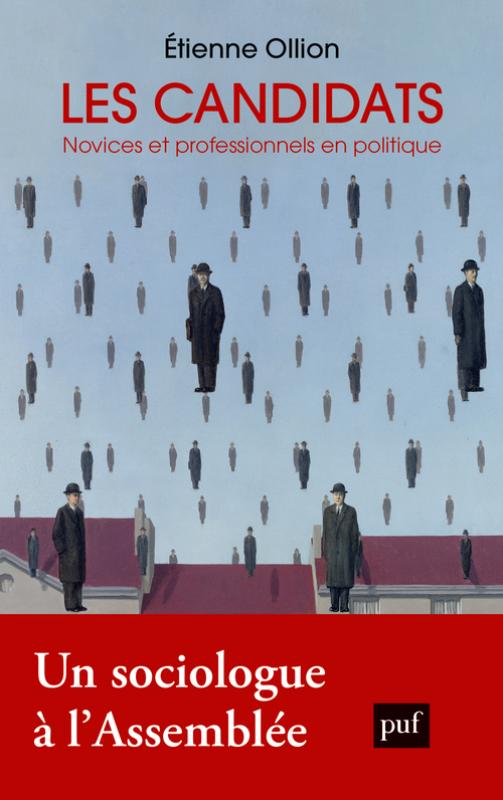
Contretemps (CT) : Commençons par un rapide retour en arrière. Tu as fait ta thèse sur la question des sectes et, pendant ou depuis, tu t’es penché sur divers sujets, y compris sur le plan des relations internationales… Pourquoi le Parlement français ? À quel moment et pour quelle(s) raison(s) as-tu commencé à t’intéresser à cet espace ?
Étienne Ollion (EO) : J’ai commencé à m’intéresser à ce sujet fin 2014. D’une part parce que j’avais une vague intuition qu’il s’agissait d’un bon observatoire pour étudier certains phénomènes politiques, en particulier la « professionnalisation politique ». Et de l’autre parce que j’avais croisé le parlement dans un précédent travail et que je trouvais ce lieu curieux. L’anthropologue Emma Crewe dit des parlements qu’ils ont « tous ce que les chercheuses en sciences sociales aiment » : on peut y observer des rites, des conflits, des rapports de pouvoir… Donc quand j’ai pu, via un collègue, obtenir un badge d’accès pour entrer assez librement à l’Assemblée nationale, j’ai saisi l’occasion.
CT : Mené en solo, ce livre fait suite à un livre à plusieurs mains, Métier : député, publié en 2017 en compagnie de Julien Boelaert et Sébastien Michon. Comment ce nouveau livre se situe-t-il par rapport à son prédécesseur ? Tu indiques en introduction que ce dernier devait mettre un point final à ton travail sur le sujet, finalement relancé…
EO : Le livre hérite clairement des travaux passés, menés conjointement avec Sébastien et Julien. Il reprend ou prolonge certaines analyses statistiques qu’on a pu réaliser ensemble, il raffine certains arguments qu’on a pu développer dans Métier : député ou après. Il intègre aussi d’autres travaux menés collectivement, comme une analyse des parcours politiques en France, que nous avions commencé à travailler avec Thomas Collas. Le livre puise donc dans une série de travaux menés collectivement, depuis plusieurs années.
Là où il s’en écarte, c’est que les travaux précédents, et ce premier livre en particulier, se centraient sur un constat statistique. On montrait que le temps passé à attendre dans des positions politiques secondaires, avant d’accéder au mandat de député, avait fortement augmenté entre les années 1970 et les années 2010. Cette enquête nous permettait d’apporter des éléments sur les débats, vifs à l’époque, sur ce qu’on appelait un peu vite la « professionnalisation politique ».
Paru en avril 2017, notre premier livre est tombé, sans que ce soit prévu évidemment, au milieu d’une campagne menée largement autour de l’injonction à « renouveler les visages » ou, comme le disait Emmanuel Macron, à « déverrouiller le système ». Mais il est aussi rapidement devenu obsolète, puisque le constat d’un allongement tendanciel du temps passé en politique au cours des dernières décennies s’est retrouvé partiellement invalidé après les élections de 2017. En deux mois, un livre de sociologie politique était devenu un livre d’histoire de la politique.
Si cette arrivée de personnes avec des parcours en politique plus variés qu’avant ne faisait pas les affaires de mon éditeur (j’en profite pour m’excuser !), ils créaient par contre les conditions d’une expérience naturelle pour tester toute une série d’hypothèses sur ce que la « professionnalisation politique » fait à la politique. Car si on parlait beaucoup des méfaits d’une longue expérience en politique, rares étaient les occasions d’observer in situ l’effet de ces socialisations politiques sur la pratique de la politique.
Avant même le second tour de l’élection législative, j’ai donc redemandé une autorisation d’accès à l’Assemblée nationale, qui me l’a rapidement accordée. J’ai alors pu suivre les premiers pas des novices, et les observer comme j’avais observé leurs collègues lors des années passées. La nouveauté des Candidats, c’est donc que je m’intéresse aux pratiques des élus. J’essaie aussi, sur la base de l’ethnographie, peu présente dans le premier livre, de décrire la texture de la politique contemporaine. En observant des corps extérieurs plongés dans un espace codifié qu’ils ne connaissaient pas, j’ai pu analyser, à travers les réactions des novices, de quoi est faite la condition politique moderne.
CT : Tu viens de mentionner l’ethnographie, au sens de l’enquête de terrain prolongée, appuyée par des observations ; une méthode éprouvée en sciences sociales. Mais ton livre mobilise aussi d’autres techniques, moins connues, en particulier le recours à des « cartes auto-organisatrices ». Peux-tu nous en dire davantage ?
EO : Le livre croise en effet diverses méthodes : ethnographie, entretiens, observations, travail sur archives aussi. Mais j’ai également voulu tester la réalité de la promesse macroniste, qui consistait à dire qu’avec le changement des visages viendrait un changement dans la manière de faire de la politique. Il y avait toutefois un problème : comment démontrer cela ? Il y a en effet bien des manières d’être député, et je ne pouvais pas tous les suivre individuellement, même en recourant à plusieurs méthodes.
La réponse a consisté à collecter des données exhaustives et diverses, afin de saisir les différentes manières d’être député, depuis le travail à l’Assemblée jusqu’à la circonscription, en passant par les médias qui jouent un rôle central. Mais une fois ces données collectées, certaines automatiquement, certaines manuellement, il fallait en proposer une représentation qui rende justice à ce caractère multidimensionnel.
C’est dans ce cadre que nous avons, avec Julien Boelaert, eu recours à un outil d’intelligence artificielle, les cartes auto-organisatrices (self-organizing maps). Comme l’analyse factorielle de Pierre Bourdieu, c’est une méthode de réduction de dimensionnalité, mais elle a certaines propriétés qui rendaient son usage bien plus intéressant pour nous. En particulier, cela permettait de bien représenter l’espace parlementaire, avec ses lignes de fracture et ses hiérarchies. Sur cet espace parlementaire, on peut alors positionner les novices et les autres élus, aux parcours plus classiques, et ainsi voir la place qui leur est dévolue.
CT : C’est-à-dire ? Qu’en ressort-il ?
EO : L’analyse statistique est de ce point de vue claire : les novices ont été relégués aux seconds rôles dans une assemblée pourtant profondément renouvelée. Elles et ils n’ont pas réussi à obtenir les positions de pouvoir, à porter des lois d’importance, à percer dans les médias. En tout cas, pas autant que les autres parlementaires. Or si on veut changer la politique, il faut accéder à ces espaces, se voir confier des responsabilités. Ça n’est pas ce qui s’est produit. Au contraire, les anciens députés, et presque autant les anciens collaborateurs parlementaires, ont accaparé ces positions, au grand dépit de leurs collègues.
CT : Tu dis aussi que même du point de vue des visages, la promesse du renouvellement des élus n’a pas été qu’un vœu pieux, puisqu’elle a accouché… sur une Assemblée particulièrement élitaire, marquée par une surreprésentation des classes supérieures. Peux-tu revenir sur cet apparent paradoxe
EO : Il faut être nuancé ici, même si les résultats sont nets. D’un côté, de vrais changements ont eu lieu. L’Assemblée a été largement féminisée, rajeunie. Et, bien sûr, des personnes qui n’avaient plus accès à la politique nationale depuis des décennies, les novices, ont été élues. Et tout cela doit beaucoup aux efforts faits par La République en Marche, puisque ses députés constituent les gros bataillons.
Mais cela tient finalement aux critères que s’était donnés la commission nationale d’investiture, qui avait retenu ces éléments comme centraux. Et pas, par exemple, celui de la profession ou de l’origine sociale. D’où une assemblée fortement renouvelée, partiellement diversifiée, et en même temps incroyablement homogène puisque près de deux tiers de ses élus sont de classe supérieure. Bien sûr, l’Assemblée n’a jamais été « représentative » (au sens descriptif) de la société, mais quand le décalage en 2017 est net : élites d’un côté, absence des classes populaires de l’autre, les tendances oligarchiques habituelles n’ont été que renforcées.
CT : Le livre est publié chez un éditeur universitaire, néanmoins on sent, dans la construction et l’écriture, que tu t’efforces de t’adresser à un public plus large que celui des seuls spécialistes. Comment as-tu abordé cet aspect de la « transmission » de ton travail, sachant qu’en parallèle, tu écris aussi dans des revues spécialisées ? Vois-tu cela comme deux registres nettement différents ou… ?
EO : À vrai dire, je crois que j’écris toujours comme cela : j’accorde de l’importance à la manière de faire passer des messages. Dans ce livre, je cite en effet de la littérature, un film ou des polémiques apparues sur les réseaux sociaux. Mais, par le passé, j’ai aussi commencé un article essentiellement statistique par une nouvelle de Jorge Luis Borges… Cet intérêt pour la forme va au-delà de l’écriture. Je m’intéresse à la construction du récit, à la place donnée à certains arguments par rapport à d’autres…
Le choix de l’éditeur s’est fait car on m’a proposé d’écrire un livre qui resterait appuyé sur ce travail de fond, qui serait donc utile pour des collègues, tout en m’invitant à m’ouvrir à un public plus large. L’éditrice, Monique Labrune, et la responsable de la communication, Camille Auzéby, ont fait le pari qu’on pourrait élargir l’audience du texte sans diluer le propos, qu’on pourrait intéresser les lectrices et lecteurs à condition d’aller directement à l’essentiel, d’avoir un fil rouge. J’ai donc délesté le livre de toute une série d’éléments requis dans la discussion scientifique : des éléments de preuve, de références scientifiques, etc., afin de le rendre plus lisible.
CT : Le sous-titre du livre suggère une division entre « novices » et « professionnels » mais, en réalité, tu montres qu’il y a professionnel et professionnel, de même qu’il y a novice et novice, des vrais et des faux, pour aller vite… Pourrais-tu revenir sur ce point ?
EO : Le sous-titre du livre renvoie à la question souvent posée dans le débat public de ce que font, ce que peuvent faire les novices et les professionnels en politique. Mais c’est vrai que je prends quelques distances avec ces notions dans le texte.
Je ne suis par exemple pas très à l’aise avec la notion de « professionnel », qui a fait florès ces dernières années. Je trouve que sa critique tend à occulter que le fait d’être payé pour faire de la politique est un acquis démocratique obtenu par la gauche dans le courant du XIXe siècle, sans lequel l’Assemblée serait composée uniquement de riches notables. Professionnel, ça agrège aussi des parcours différents, entre des élus qui ont passé des vies en politique en enchaînant les mandats électifs locaux, et ceux qui, parfois très jeunes, n’ont eu qu’une seule expérience, par exemple dans un cabinet ministériel, avant un mandat. Les premiers comme les seconds ont toujours « vécu de la politique », mais de manière très différente en termes de temps, de cadre, d’attentes, de proximité au pouvoir.
Non seulement ce sont donc deux parcours très différents, mais ce que je montre, c’est que cela donne lieu à des pratiques de la politique différentes, que cela offre des chances de succès très inégales aussi pour accéder à des positions supérieures.
Je serais plus indulgent avec la notion de « novice », que j’ai, elle, reprise. Elle permet de se défaire de la communication faite, pendant la campagne, autour du terme de « société civile ». On se souvient que ce terme avait été mis en avant par En Marche ! pour désigner les candidats investis qui n’avaient pas eu de mandat. Selon eux, la proportion dans leurs rangs s’élevait à environ la moitié des candidats présentés par le parti. Mais l’habileté de cette définition est que des personnes qui avaient déjà eu une expérience politique, parfois intense et très utile, comme celle des collaborateurs parlementaires, n’étaient pas considérées comme « expérimentés », alors même que tous les travaux récents de science politique montrent bien qu’il s’agit là d’une voie royale vers la politique nationale. « Novice », au contraire, me semblait mieux correspondre.
CT : En quoi ce livre contribue-t-il à éclairer ce qu’est aujourd’hui ce que l’on appelle, à tort ou à raison, la démocratie représentative, voire la démocratie tout court, notamment du point de vue de la professionnalisation de l’activité politique ?
EO : Le livre propose un constat, assez sombre, de la démocratie représentative contemporaine. L’Assemblée ne représente plus qu’un groupe social, et le changement n’a pas eu lieu, même après un renouvellement massif. On pourrait s’arrêter là, et trouver que le constat, pour dramatique qu’il soit, n’est ni très surprenant, ni très nouveau. Mais ce que je cherche à faire dans ce travail, c’est à réfléchir aux causes qui produisent ce phénomène, et notre inertie démocratique. Pourquoi, même quand il existe une volonté (au moins chez certains) de changer le cours des choses, la dérive exécutive et autocratique de la Ve République continue-t-elle ?
À travers l’étude de cette Assemblée pas comme les autres, le livre propose des éléments pour comprendre ces freins à un fonctionnement bien plus démocratique. Il les situe d’abord dans les institutions. Je crois que sans changement profond des règles qui organisent notre vie politique, il sera impossible de remédier aux maux déjà bien diagnostiqués. Cela passe probablement par une réforme constitutionnelle, mais cela se joue à d’autres niveaux, que j’essaie d’identifier comme autant de leviers d’action.
Cette réflexion invite alors à interroger des solutions parfois évoquées pour mettre fin à la crise de la démocratie, dont les listes citoyennes ou le tirage au sort. En effet, le livre montre qu’en l’absence de réforme structurelle sur les moyens et la place donnée aux parlementaires, des nouveaux venus sans expérience seront toujours soumis à un exécutif qui dispose de ressources bien supérieures. Pire encore, ils pourraient du fait d’un manque de compétences proprement politiques, renforcer la place de l’exécutif et permettre au régime de fonctionner de manière plus, pas moins, présidentialiste. L’idée centrale est qu’on ne change pas la politique simplement en changeant les visages, et il faut penser à cela quand on propose ces solutions, faute d’accroître encore un peu plus la méfiance vis-à-vis de la démocratie. Ca ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire, ou les récuser en bloc. Ça veut dire qu’il faut se donner les moyens de contrer ces effets si on décide de les mettre en place.
CT : Tu évoques en conclusion, en référence à Sartre, l’« existence sérielle » des personnes qui figurent sur la file d’attente. On peut alors penser au Bourdieu de « La délégation et le fétichisme politique », d’autant plus que tu connais de près son travail (tu as notamment édité la version complète d’Invitation à la sociologie réflexive). Pourtant, ce dernier semble peu mis à contribution, du moins visiblement. Pourquoi ?
EO : D’un point de vue conceptuel, le livre propose de travailler la notion de « file d’attente ». Je montre en effet que jusqu’en 2017, s’engager en politique consistait à s’inscrire dans une longue file d’attente qui amenait vers les positions nationales. Les candidats à la députation devaient souvent patienter des années, voire des décennies, avant d’obtenir le poste convoité.
Penser cette fermeture du champ politique en termes de file d’attente a, de mon point de vue, plusieurs avantages. D’une part, cela permet de sortir des débats posés de façon binaire, pour ou contre la « professionnalisation politique ». Les files d’attente forment les élus, elles les rendent plus expérimentés, plus compétents, plus capables de proposer et de s’opposer. Mais dans le même temps, cette attente les conforme aussi – elle les rend plus semblables, elles homogénéisent les points de vue sur le monde politique, et sur le monde social. D’autre part, cela permet de comprendre l’extrême aigreur des personnes qui se sont vues doubler en 2017 par ceux qui ont contourné la file d’attente. Pour les premières, qui avaient patiemment attendu leur tour, cette élection et l’arrivée d’En marche ! leur ont fait perdre un investissement, parfois l’investissement d’une vie. D’où les protestations, souvent dans le registre de la trahison. Il existe une économie morale de la file d’attente.
C’est dans ce cadre que justement que je mobilise Sartre, qui dans la Critique de la raison dialectique (1960) évoque les individus placés dans cette situation d’existence sérielle. En faisant la queue, ils restent selon lui pris dans leur solitude, leur individualité. C’est l’exemple de l’autobus bondé qu’attendent des individus placés en file indienne. Quand celui-ci arrive, chacun va tout faire pour monter, plutôt que de remettre en cause l’organisation des transports qui conduit à cette pénurie. Ils vont privilégier le salut individuel au mouvement collectif. La série produit de l’individualité, en tout cas au moment crucial où votre sort se joue. C’est exactement ce que j’ai pu observer, en 2017 ou après.
Quant à Bourdieu, je trouve qu’il est présent ! Si je le cite moins, c’est peut-être dû à un effet de canonisation de ses travaux. On sait que les idées, quand elles deviennent classiques, sont moins explicitement référencées. Ses travaux sur la représentation politique rentrent dans cette catégorie. Mais Bourdieu est aussi mobilisé, plus explicitement, à d’autres endroits. Par exemple quand j’évoque les deux modes d’être typiques en politique, les carrières longues et les carrières rapidement ascensionnelles. Dans Homo Academicus, Bourdieu parlait justement de la gravitas, cette manière de traverser avec lenteur et patience les différentes étapes de la carrière, qu’il opposait à la celeritas, la progression des jeunes gens pressés qui ne respectent pas l’ordre des successions. 2017, c’est là encore un conflit entre ces deux modes de progression : ceux qui ont attendu, et ceux qui ne veulent pas attendre. Une lutte des classes d’âges en quelque sorte, une lutte qui déclasse les plus âgés. Et l’analyse du parlement comme espace multidimensionnel est dans la droite ligne des travaux qu’il avait pu mener, mais avec des méthodes un peu plus récentes.
CT : Comme te situes-tu par rapport à la thèse du « bloc bourgeois » proposée par Bruno Amable et Stefano Palombarini ?
EO : Leurs travaux sont assez différents de celui-ci, et donc assez complémentaires. Leur approche, qui s’inscrit dans les débats de l’économie politique institutionnelle, vise à montrer que la stabilité du système politique est rendue possible par l’existence d’un « bloc social » dominant, qui parvient à convaincre une majorité d’électeurs. C’est selon eux la situation en France dans sous la Ve République, mais de moins en moins à mesure que la gauche et la droite sont traversées par des lignes de fracture qui les rendent irréconciliables. Le bloc bourgeois, c’est l’alliance de partis européistes et libéraux qui n’avait jamais gouverné en France, et qui s’impose avec Macron. C’est un cadre analytique intéressant pour étudier la fragmentation de l’offre politique, l’évolution des stratégies des partis, mais c’est assez différent de ce que je fais.
Le but de mon livre, au-delà de l’étude de l’Assemblée de 2017, et plus largement de l’analyse de la condition politique contemporaine, c’est de se demander s’il est possible de modifier la démocratie en profondeur sans changer les règles du jeu politique. Comme je le disais, ça me paraît peu plausible, et il est urgent de mettre des questions à première vue secondaires ou peu intéressantes sur la table : celles des modalités de la délibération, de la décision collective. C’est un enjeu absolument central, qui va bien au-delà des enjeux constitutionnels auxquels on les réduit parfois.
*
Crédit : Photo de Markus Spiske via Unsplash.