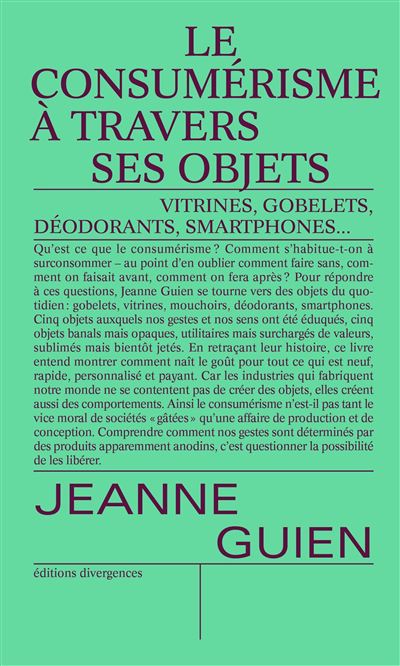
Jeanne Guien, Le consumérisme à travers ses objets, Editions Divergences, 2021, 228 pages
17 euros
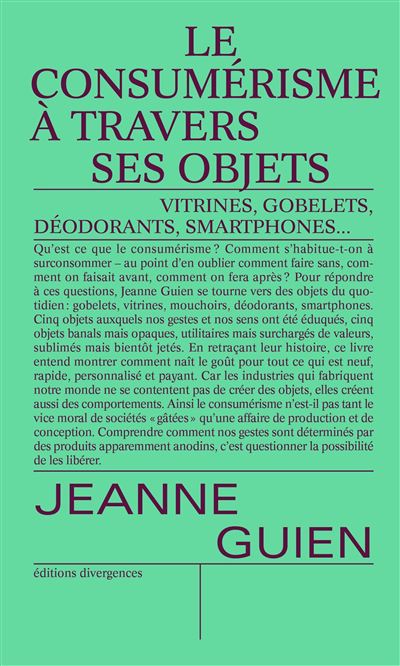
Jeanne Guien nous propose dans cet ouvrage d’explorer l’histoire matérielle de cinq objets de consommation courante, à rebours des approches sémiologiques ou instrumentalistes. Etudier le consumérisme à travers ses objets, c’est pour l’autrice une façon d’interroger la constitution de rapports économiques et sociaux non pas d’un point de vue surplombant ou abstrait, mais au contraire de regarder comment les objets forment des nœuds de ces rapports en étant à la fois vecteurs et sources du capitalisme moderne.
L’auteure a soutenu en 2019 une thèse sur l’obsolescence programmée. Alors que dans celle-ci, elle s’intéressait à la formation des discours relatifs à la consommation et à la production, ce livre déploie un regard centré sur les objets. Elle prolonge et complète ainsi l’approche historique de sa thèse, en changeant simplement le traceur, dans ce qu’elle propose être l’étude conjointe des niveaux symboliques et physiques de l’histoire économique.
Les cinq objets étudiés sont les gobelets, les vitrines, les mouchoirs, les smartphones, et les déodorants et sont traités séparément dans l’ordre mentionnés, à travers les cinq chapitres du livre. Ce sont bien deux catégories d’objets qui sont étudiées : les « ustensiles du quotidien » d’un côté, soit les gobelets, les mouchoirs et les déodorants et les « objets-médias » de l’autre. Celles-ci se recoupent toutefois, et l’objet-ustensile peut se révéler média, par exemple lorsque le gobelet charrie des messages publicitaires sur sa surface[1].
Les objets-ustensiles constituent les cibles « intuitives » de la dénonciation du consumérisme. Objets à usage unique, jetables ou à durée de vie très limitée, ils occupent dans la vie quotidienne une place pourtant centrale, notamment en ce qu’ils promettent une « protection » ou un « entretien » du corps physique. Tandis que leur caractère éphémère va de pair avec un mode de production fortement capitalistique et lucratif, cette place dans l’intimité et dans le rapport au corps est à relier aux normes et régulations sociales. L’ouvrage insiste sur le rôle de la publicité et des stratégies commerciales des firmes pour s’ancrer dans ces normes sociales, en jouant notamment sur les rapports de domination de genre et de classe. Ces objets sont également l’objet de contestations et de politisations qui offrent de nouveaux contextes pour l’action stratégique des firmes.
Sur le plan de l’économie, le livre relève le caractère oligopolistique des marchés du mouchoir, du gobelet et du déodorant. Il montre comment les positions dominantes des firmes sur ces marchés se constituent au cours du XXème siècle, à cheval entre l’âge de l’usine et l’âge de la finance (François et Lemercier, 2021). Surtout, celles-ci reposent sur un entreprenariat marchand et institutionnel visant à faire advenir des marchés jusqu’alors inexistants ou restreints. Ainsi de Kimberly-Clark (pour les mouchoirs) ou de Dixie (pour les gobelets jetables), exemples frappants de « fabrique d’un marché » (p.21) opérée par des entrepreneur.ses étasuniens au début du XXème siècle, et qui sont aujourd’hui les leaders au niveau mondial. En s’appuyant sur des ressources rendues abondantes (forestières, produits chimiques) et sur un marché interne sensible à leur stratégie commerciale, ces firmes grandissent d’abord aux États-Unis pour ensuite disperser leur production comme leur consommation à travers le monde. Le fait qu’ils soient « jetables » permet à leur produits d’emprunter et de se greffer sur certains canaux porteurs de l’économie capitaliste globalisée : restauration rapide, distributeurs automatiques, transport de longue distance etc.
Le succès des objets-ustensiles ne saurait toutefois se résumer à leur « success-story » commerciale, lue comme le produit d’une stratégie économique rationnelle et respectable. L’ouvrage de Jeanne Guien nous rappelle utilement comment ces objets sont aussi les acteurs matériels d’une hygiénisation fondée sur des stéréotypes de genre et de race, opportunément maniés par les publicitaires soucieux d’écouler leurs produits. L’exemple du déodorant est à ce titre frappant : constatant que leurs premiers produits anti-transpirants peinaient à s’écouler, puisqu’ils proposaient de répondre à un « problème » (la sudation) dont peu d’individus pensaient être « victimes », les industriels mettent sur pied une véritable « campagne de la honte », culpabilisant les femmes à propos de leur odeur corporelle (p. 192). Plusieurs affiches reproduites en noir et blanc dans le livre illustrent comment ces campagnes au ton direct – qu’on pourrait croire parodiques si elles n’étaient pas sourcées – participent à créer un problème hygiénique et social auprès des femmes étasuniennes dans les années 1920, faisant par la même occasion décoller les ventes pour Odorono, commanditaire de ces campagnes. Si ces campagnes alimentent un tabou préexistant à propos de la transpiration, elles en accentuent ici le caractère sexiste, en insistant sur la « séduction » comme objectif typiquement féminin. L’évolution du message publicitaire, lorsque les firmes se tournent vers le marché masculin et affublent leurs produits de nouveaux qualificatifs dérisoirement ridicules (les déodorants « techniques », « performants » ou encore « sauvages »), confirme l’intérêt d’étudier les objets non seulement comme réceptacles, mais aussi producteurs des normes sociales.
Les convergences entre stratégies publicitaires et projet hygiéniste se manifestent encore plus intensément lorsqu’elles rencontrent des pratiques de distinctions économiques et raciales. Le gobelet à usage unique est ainsi présenté comme un outil de protection face aux bactéries de la foule, anonyme, mais souvent noire, qui se retrouveraient sur les gobelets de fontaines d’eau potable ou même les verres de bar (p. 40). Guien remonte même plus loin dans le temps pour évoquer, avec Elias, le processus de civilisation à travers les usages différenciés des textiles non vestimentaires, quand le mouchoir n’était pas encore à usage unique, mais déjà marqué par le stigmate social : « Ne pas mélanger les torchons et les serviettes, les mouchoirs et les foulards, servit littéralement à ne pas mélanger les classes » (p.110).
Enfin, les objets-ustensiles sont la cible typique de la critique écologiste du consumérisme. Les gobelets jetables ne sont-ils pas en 2022 l’objet attendu des discussions « politiques » portant sur le niveau d’ambition de l’action publique environnementale ? L’auteure nous invite à ce sujet à regarder comment les critiques sont quasi-systématiquement réappropriées par les industriels menacés dans leur raison productive. Sur le plan de l’utilisation des ressources, le recours à différents labels plus ou moins crédibles permet aux marques de faire valoir un « sourcing » vert et déculpabilisant lors de l’achat. De l’autre côté, la question des déchets est au contraire renvoyée à la responsabilité des consommateurs à qui incomberaient l’immense pouvoir de « faire des déchets des ressources » en triant, de manière rigoureuse et gratuite, voire en « supprimant » les déchets de sa vie quotidienne. Jeanne Guien note avec Max Liboiron[2] comment la qualification juridique des gobelets permets aux enseignes de restauration rapide de se dessaisir de cette responsabilité et des coûts y afférant. Enfin, le remplacement des solutions jetables par des alternatives réutilisables est décrite comme un alignement de certains intérêts industriels avec la contestation écologiste.
Du côté des objets-médias, si certains motifs économiques sont comparables – en particulier le rôle du marketing et le caractère oligopolistique des marchés – les chapitres qui y sont dédiés insistent sur leur rôle de « frontière », de « traducteur » de luttes économiques et politiques de l’époque moderne. Proposant d’étudier la vitrine ou le smartphone comme des « dispositifs marchands » (Callon et al, 2008), Guien propose une connexion opportune avec la sociologie économique. L’histoire très récente du smartphone est l’occasion d’une relecture et d’une discussion de la notion d’obsolescence à l’ère moderne. A l’inverse, celle de la vitrine permet de revenir sur les mutations de l’économie depuis l’âge du commerce (François et Lemercier, 2021).
Si le smartphone est un objet déjà richement commenté et étudié, y compris de façon critique, son omniprésence dans nos sociétés doit être vue par l’auteure comme celle d’une « technique architecturale » dotée de ce qu’Ivan Illich nomme un « monopole radical » (Illich, 1975), c’est-à-dire qu’il est une « condition sine qua non du maintien de certains liens et du déroulement de certaines activités » (p. 145). Son importance n’est pas que quantitative (nombre d’unités vendues, profits générés par ses producteurs et ceux qui s’en servent), et doit être évaluée à l’aune des « obsolescences » dont il est porteur. Dépassant les élucubrations typologiques sur l’obsolescence, dont elle avait déjà montré l’inutilité (Guien, 2019, p. 22), l’auteure nous propose de nous fier à une distinction simple, et surtout non-exhaustive : les obsolescences technique et les obsolescences psychologiques du smartphone. La première catégorie est semble-t-il constitutive de l’histoire de l’objet : il vient déjà dépasser le téléphone mobile non tactile, qui lui-même était un remplaçant du téléphone fixe. Surtout, sa dynamique n’est pas linéaire : le nombre de nouveaux modèles sortis par an ne cesse d’augmenter pour l’ensemble des marques – Apple faisant même figure de producteur raisonnable, puisqu’il ne sort « que » quatre modèles en 2019, contre plusieurs centaines pour Huawei par exemple. Le smartphone serait donc, non plus une technique obsolescente, mais une technique de l’obsolescence : son remplacement fréquent ferait entièrement partie de la stratégie commerciale des producteurs. L’opposition virulente des firmes à la réparation, et la confiscation des capacités d’action des usagers sur leurs objets en serait une preuve, même si l’annonce récente d’une reconnaissance du « droit à réparer » par Apple pourrait laisser entrevoir un changement de stratégie commerciale et industrielle à cet égard[3]. De manière générale, le smartphone s’inscrit pleinement dans une « naturalisation » du remplacement technique, empruntant à J. Schumpeter l’autorité intellectuelle pour affirmer l’existences de « lois », telle que la fameuse « loi de Moore » prédisant l’inéluctable progression des capacités techniques des appareils électroniques. L’objectif de l’auteure est bien de déconstruire le caractère naturel de ces représentations, en nous montrant combien les lois et autres « principes » du progrès sont le fruit de l’usage instrumental et motivé de concepts intellectuels (p. 161). L’autre versant des obsolescences portées par le smartphone – les obsolescences psychologiques » – donne à voir comment là encore les efforts publicitaires participent à donner à l’objet une dimension événementielle et mystérieuse, dans l’objectif – constant celui-ci – de vendre le maximum d’unités.
Enfin, le propos de Guien se fait plus philosophique lorsqu’elle affirme que les smartphone produisent de l’« obsolescence humaine ». Puisque qu’ils « produisent un monde dans lequel les capacités ou qualités humaines préexistantes deviennent inutilisables et ridicules » (p. 173), notamment par le recours à une exploitation intense des forces de travail et des ressources naturelles, on comprend qu’ils agiraient comme des forces historiques de la domination, plus que d’en être les simples conséquences.
L’histoire matérielle des vitrines s’inscrit dans un temps plus long, et croise celle du commerce. Utilisées d’abord par les grands magasins, ou dans les galeries qui offrent une nouvelle façon de vivre et d’occuper l’espace de la rue pour les citadins aisés, la vitrine se déploie ensuite en parallèle avec la standardisation du commerce et l’apparition des supermarchés. De « dispositifs de curiosité » (Cochoy, 2011) cherchant à capter l’attention du passant, les vitrines font progressivement l’objet d’une science à part entière, le merchandising, qui s’émancipe de la simple publicité, en convoquant l’architecture, le design et la psychologie pour mettre en scène les produits, le magasin, la marque, et leur donner des qualités particulières. Véritables « dispositifs marchands » permettant l’intermédiation entre producteurs et consommateurs, les vitrines s’outillent plus récemment pour mesurer, calculer et évaluer l’attention et l’intérêt que les individus prêtent aux produits (p. 95). L’intermédiation est économique, mais aussi politique. Jeanne Guien propose ainsi très utilement de rapprocher l’étude des vitrines comme dispositifs marchands de leur « politisation » par les mouvements sociaux. Dépassant une lecture qui ne verrait dans le bris de vitres qu’un acte de vandalisme, le chapitre revient sur les différentes pratiques de bris et sur leur inclusion dans un « répertoire d’action » (Tilly, 1978) propre à chaque mouvement social. Ainsi, du bris de vitrine de luxe par les suffragettes réclamant le droit de vote au début du XXème siècle, aux gilets jaunes cassant sur les Champs-Elysées, on comprend aisément comment le bris de vitrine est ciblé, et ne saurait être traité comme l’expression d’une violence informe, non spécifique et spontanée. Le recours à d’autres types de contestation des vitrines (collages, tags, extinction des éclairages) montre bien selon l’auteure comment la vitrine forme un medium politique, un objet de politisation des inégalités économiques. Puisqu’elle marque une frontière entre le dedans et le dehors, entre ce qui est visible (les client.es mais aussi les vendeur.ses soumis.es à l’exigence de bonne présentation) et invisible (les travailleur.ses logistiques et de production), la vitrine est bien cet objet technique d’intermédiation marchande et politique.
Le livre nous montre donc comment l’enjeu de la qualification (Callon, 2000) est une donnée d’importance lorsqu’on étudie l’histoire des objets. Cette qualification repose sur des représentations existantes, en même temps qu’elle en fait émerger de nouvelles. Elle est surtout sujette à un maniement stratégique ou contestataire. Cette dimension est très souvent rappelée par l’auteure, qui nous montre comment faire de l’histoire matérielle intégrant à la fois le rôle des structures sociales et de l’agency (capacité d’action) des acteurs.
Plus encore, Jeanne Guien nous montre que la qualification (des objets, des humains) est produite par certains objets, notamment ce qu’elle a appelé les « objets-médias ». Quand ils deviennent dispositifs marchands – ainsi que propose de les lire l’auteure – smartphones et vitrines sont par exemple rendus capable de produire des effets structurant sur l’économie et sur les rapports sociaux. A ce titre, leur politisation, voire leur contestation frontale (le bris de vitrine) pourrait être utilement explorée par la sociologie des agencements marchands, parfois suspectée de dépolitiser les enjeux de l’activité économique (Mirowski et Nik-kah, 2008). Cette proposition appelle toutefois d’autres travaux destinés à vérifier l’applicabilité du concept à ces objets. Il conviendrait en particulier de préciser 1) quels sont les marchés intermédiés et 2) qui sont les acteurs à l’origine de cette intermédiation.
On appréciera enfin l’effort réflexif déployé par l’auteure en conclusion, qui invite le lecteur à considérer les enjeux matériels et économiques de l’objet-livre. Cet effort ne surprendra pas si l’on considère que le propos général est moins moral (critiquer le consumérisme) qu’engagé dans une objectivation des modalités d’existence de notre vie matérielle. Seule la connaissance de ces modalités peut permettre de les dépasser et d’en faire des projets d’émancipation matérielle crédibles.
Callon, M., Méadel, C., Rabeharisoa, V., 2000. « L’économie des qualités ». Politix. Revue des sciences sociales du politique 13, 211–239. https://doi.org/10.3406/polix.2000.1126
Cochoy, F., 2011. De la curiosité: l’art de la séduction marchande, Individu et société. A. Colin, Paris.
François, P., Lemercier, C., 2021. Sociologie historique du capitalisme. La Découverte, Paris.
Guien, J., 2019. Obsolescences. Philosophie des techniques et histoire économique à l’épreuve de la réduction de la durée de vie des objets. Paris 1.
Muniesa, F., Millo, Y., Callon, M., 2007. « An Introduction to Market Devices ». The Sociological Review 55, 1–12. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2007.00727.x
Mirowski, P., Nik-Khah, E., 2008. “Chapter 7. Markets Made Flesh: Performativity, and a Problem in Science Studies, Augmented with Consideration of the FCC Auctions”, in Do Economists Make Markets ? Princeton University Press, pp. 190–224. https://doi.org/10.1515/9780691214665-009
Tilly, C., 1978. From mobilization to revolution. Addison-Wesley, Reading, Mass.
[1] Notre choix de découper cette recension entre objets ustensiles et objets-médias, alors que l’auteure n’accorde finalement que peu d’importance à cette distinction formulée en introduction, doit être comprise comme la mise en avant des principaux enseignements de chaque chapitre plus que comme une exégèse sur le propos général du livre. Chaque objet traité est à la fois objet-ustensile et objet-média.
[2] https://discardstudies.com/2014/07/09/modern-waste-is-an-economic-strategy/
[3] https://repair.eu/fr/news/too-good-to-be-true-apple-announces-giving-access-to-some-spare-parts-and-repair-information-to-consumers/