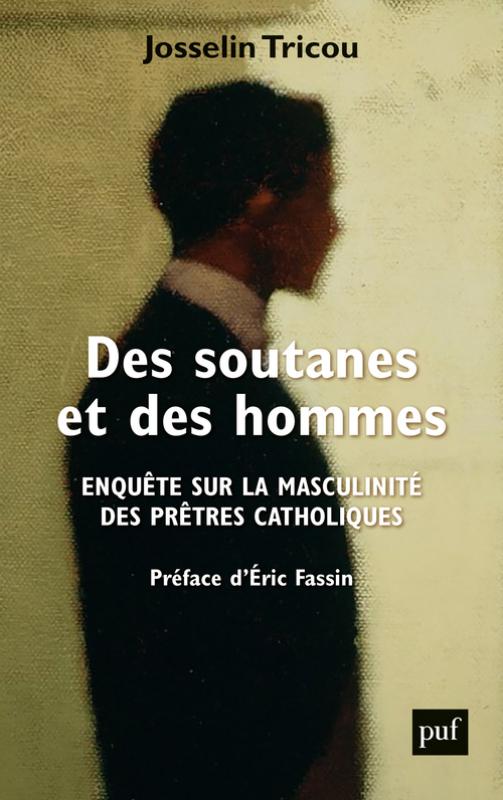
Josselin Tricou, Des soutanes et des hommes. Enquête sur la masculinité des prêtres catholiques, Presses Universitaires de France, 2021, 472 p., 23 euros.
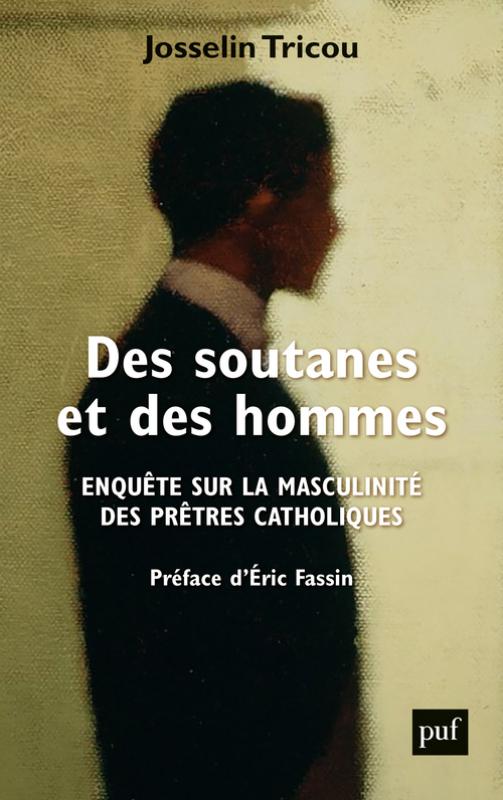
Après cette longue démonstration, il me semble essentiel de revenir sur trois points. En premier lieu, il me paraît nécessaire de préciser l’articulation entre genre et sexualité, pour la distinguer de la confusion entre genre et homosexualité entretenue par le discours catholique contre « la-théorie-du-genre ». Deuxièmement, il m’importe de faire le lien entre l’obsession de la masculinité dans le monde catholique, d’une part, et d’autre part le déni de la réalité systémique des violences sexuelles exercées au sein du clergé contre des femmes et des enfants. Si le livre ne prend pas celles-ci pour objet, je suis convaincu que cette obsession de la masculinité donne des clés pour comprendre cet aveuglement. Tout se passe en effet comme si la problématisation, pour emprunter le terme de Michel Foucault, n’était pas la même pour l’Église et pour la société : n’est-ce pas là une clé du divorce avec l’époque ? Troisièmement, je souhaite préciser ce qu’implique la dimension nationale, mais aussi raciale, effleurée dans le dernier chapitre. Il convient de le faire d’abord d’un point de vue méthodologique, puisque cette étude sur l’Église catholique, institution universelle, est centrée sur la France. Toutefois, l’enjeu est aussi théorique, puisqu’il permet d’expliciter la dimension implicitement intersectionnelle de mon travail. Dans un contexte où l’islam est souvent présenté comme l’envers de l’identité nationale, le capital d’autochtonie attribué au catholicisme se traduit, sur le terrain ecclésiastique, par une problématisation de la masculinité réservée aux seuls prêtres français (alors que le nombre d’étrangers va croissant) ; en fait, il s’agit bien, implicitement, de politiques de la masculinité blanche.
S’il y a évidemment des prêtres hétérosexuels, et s’il y a bien sûr des prêtres, homosexuels ou hétérosexuels, qui luttent contre l’homophobie, le clergé catholique ici décrit semble en grande partie homosexuel ; mais surtout, dans son ensemble et plus encore dans sa hiérarchie, il se révèle obsédé par l’homosexualité. En un sens, c’est pour cette raison que, accompagnant la logique de mon objet d’étude, je l’ai suivi dans cette sorte de raccourci qu’il effectue sans cesse entre genre et sexualité, et plus précisément entre masculinité et homosexualité : celle-ci est d’ailleurs omniprésente dans les pages qui précèdent, tandis que celle-là est l’objet même de l’enquête. Or, non seulement il serait pour le moins problématique de réduire le genre aux hommes, en oubliant les femmes, mais en outre, il est possible d’affirmer que les études sur le genre et la sexualité visent à déconstruire l’équivalence telle qu’elle est posée aujourd’hui par la politique catholique : on n’est pas condamné à penser l’homosexualité comme un défaut de masculinité, ni la virilité comme une preuve d’hétérosexualité. Tout au long de ce travail d’enquête, il s’est agi pour moi, non de partager l’obsession cléricale pour la question homosexuelle, mais de la prendre pour objet.
1/ À partir du moment où, depuis le Moyen Âge, le catholicisme a lié le presbytérat au célibat, le sens de l’un et de l’autre en a été changé. Le célibat a été relativisé, puisqu’il n’était plus embrassé pour lui-même mais comme une condition d’accès au presbytérat ; et dans le même temps, la sacralisation du presbytérat passait désormais par le célibat. Dès lors, l’idéal sacerdotal qui s’est noué dans cette association a fini par se constituer historiquement en un « projet de genre[1] » qu’on peut dire atypique : en effet, il est défini en miroir de la forme hégémonique de la masculinité séculière, marquée au contraire par une hétérosexualité active. Si le prêtre a même fini par perdre son pouvoir économique et politique qui le rattachait encore à la norme masculine, il a néanmoins continué de bénéficier d’un prestige symbolique fondé sur cette sacralisation par le célibat.
2/ Il est vrai que cette masculinité sacerdotale particulière est depuis longtemps investie comme une sorte de « placard » par ceux qui se sentent non conformes dans des sociétés hétéronormées, et donc en particulier les homosexuels, comme l’ont établi des travaux historiques. Mais, s’il y a toujours eu des prêtres homosexuels, deux éléments fondamentaux ont transformé le sens de cette homosexualité ecclésiastique pour la période étudiée : d’une part, la politique hétérophile et homophobe du Vatican a paradoxalement créé les conditions d’un désintérêt des hétérosexuels et d’un afflux d’homosexuels au sein du clergé, soit d’un chassé-croisé ; d’autre part, la placardisation croissante dans l’institution ecclésiastique s’inscrit aujourd’hui à contre-courant du mouvement général de sortie du placard dans la société.
3/ Au-delà du « plafond de vitrail[2] » qui entrave la promotion des femmes dans la vie ecclésiale, ce système met au contraire à disposition un « escalator de verre[3] » pour les clercs au placard, tout en rappelant les autres (les « taupes ») à la discrétion, voire au secret. Ce phénomène, décrit de l’intérieur par David Berger, transforme le « haut clergé » en une sorte de « société secrète » à la Simmel, définie par deux traits : d’une part, une culture du double-entendre obscure aux yeux des profanes, qui assure à ses membres d’importantes latitudes et des gains notables, tant symboliquement que matériellement, garantissant ainsi leur loyauté ; d’autre part, des rites d’institution forts, marquant les corps et instituant des distinctions très nettes vis-à-vis de l’extérieur mais aussi très subtiles à l’intérieur du clergé : l’assurance d’une mise à distance des profanes produit ainsi, chez ces hommes, un sentiment puissant d’élection. La « race maudite », décrite par Marcel Proust, peut alors se vivre comme « peuple élu ».
4/ Pour renforcer la logique du placard au moment même où celui-ci reculait dans la société, ce haut clergé n’a pas hésité à développer des politiques hétéronormatives violentes, tant à l’égard du monde qu’en son sein. L’homophobie intériorisée par les clercs homosexuels (qu’ils soient « pratiquants » ou pas) a été redoublée en une forme de schizophrénie existentielle chez nombre d’entre eux. Il est vrai que, pendant longtemps, l’Église n’a pas eu besoin d’être activement hétérophile ou homophobe pour que ce système du placard ecclésial fonctionne de manière invisible. Mais, dans un contexte marqué par la révolution culturelle des années 1970, sous le feu de critiques internes, l’Église se convertit à l’hétérophilie. Toutefois, en valorisant enfin l’hétérosexualité conjugale au lieu d’y voir un pis-aller reproductif, l’Église a perdu, sans s’en rendre compte, après les classes populaires, les hétérosexuels. Parmi ceux-ci, les clercs progressistes ont d’ailleurs quitté largement le sacerdoce pour se marier à la fin des années 1970[4] ; en revanche, les homosexuels sont restés. Pourtant, à partir des années 1980, quand les États abandonnent progressivement leurs politiques de répression à l’égard des homosexuel·le·s, l’Église se rallie à une homophobie explicite et agressive. Or cette politique a paradoxalement fait que seuls les jeunes hommes catholiques homosexuels, surtout issus des milieux bourgeois ou conservateurs, trouvent encore avantage à entrer dans le sacerdoce ou la vie religieuse : pour ceux-ci, n’est-ce pas la meilleure garantie de respecter l’injonction de « chasteté » portée par le Catéchisme de l’Église catholique ? Et, par contraction du corps clérical, leur proportion augmente entre 1980 et 2000, si dangereusement aux yeux des autorités[5] qu’il faut agir pour que cela ne se voie pas trop. Les catholiques assistent alors sans le savoir à ce que j’ai appelé le « grand chassé-croisé des sexualités à la porte des sacristies », comme on avait assisté entre le xviiie et le xixe siècle au « grand chassé-croisé des classes sociales sur le chemin de l’Église[6] ». Le système entre en crise. Et si les évêques craignant de manquer de prêtres (mais se montrant incapables de penser autrement la présence catholique dans le monde) continuent de recruter tous ceux qui viennent à eux, pendant ce temps-là, le Vatican, tout en étant le lieu d’une relative liberté de mœurs homosexuelles, lance sa croisade morale contre la (supposée) « théorie du genre », pour endiguer toute reconnaissance légale de l’égalité entre les sexes et les sexualités sans doute, mais aussi pour faire taire dans ses propres rangs, en instrumentalisant ses fidèles contre tous ses clercs de base tentés de se dire et d’agir pastoralement dans l’ouverture. Il fallait surtout renforcer à tout prix l’homophobie intériorisée du clergé, puisque la société ne s’en chargeait plus. La « démocratisation sexuelle » et la mise en place de dispositifs légaux de consécration de la conjugalité homosexuelle menacent, en effet, de gripper définitivement un des derniers mécanismes sociaux qui rend le sacerdoce attractif dans les sociétés sécularisées. Or, cette obsession de maintenir le placard ecclésial empêche l’institution de traiter le sexisme et les violences faites aux enfants pour ce qu’ils sont : des fléaux systémiques.
5/ La perte de plausibilité de la « civilisation paroissiale » et la disqualification culturelle de la masculinité sacerdotale n’ont fait qu’accroître le « grand chassé-croisé des sexualités à la porte des sacristies » et renforcer la nécessité, pour les membres du clergé catholique, de donner des gages à la masculinité hégémonique et donc à la norme hétérosexuelle. J’ai pu ainsi proposer la typologie suivante des politiques de la masculinité mises en œuvre à cet effet.
Les trois formes de politique de la masculinité étudiées, en cours de déploiement, sont toutes issues du pôle d’identité du catholicisme, elles n’ont pas de pendants ayant dépassé le seuil de visibilité médiatique du côté du « pôle d’ouverture ». Ce dernier pôle est d’ailleurs vieillissant, tant il est concurrencé par le catholicisme identitaire et invisibilisé par la « réussite paradoxale » de La Manif pour tous. La politique de « l’égalité des vœux » entre religieux hétérosexuels et homosexuels qu’il aurait pu promouvoir a été réduite au silence. D’autre part, on a pu observer, notamment dans le cadre du diocèse de Fréjus-Toulon, des hybridations « tradismatiques » de ces politiques et le début de la constitution d’un bloc stratégique masculiniste au sein du pôle d’identité du catholicisme français, malgré les divergences des différentes constellations ou « archipels » qui le composent.
Tableau 3. Tableau récapitulatif des différentes tentatives de politique de la masculinité recensées au sein du champ catholique français
| Constellations ecclésiales | Vieux ordres religieux | Restitutionnistes | Charismatiques | Bastions catholiques |
| Régime de genre | Queerisant | Néosacerdotal | Sponsal | Bourgeois |
| Conditions de possibilité sociale d’émergence d’une… | ||||
| Politique de la masculinité | D’égalité des vœux / Affirmant l’indifférence aux sexualités / mais il s’agit d’une politique empêchée | Viriliste / Pour laquelle la virilité ostensible est gage d’hétérosexualité | Redifférentialiste / À travers laquelle le prêtre se positionne en expert de l’autre masculinité (et accompagne la transformation de la masculinité laïque en une masculinité rénovée incorporant certaines critiques faites à la masculinité hégémonique bourgeoise pour se relégitimer), afin de maintenir le rendement symbolique de la sienne. | Libérale-conservatrice / Signant la complicité du prêtre avec une masculinité hégémonique libérale-conservatrice et hétéronationaliste |
Sans doute les prêtres les plus conservateurs peuvent-ils instrumentaliser la pédocriminalité à des fins de dénonciation du « lobby gay » dans l’Église : c’est que ces violences restent le tabou le plus structurant du corps clérical contemporain. Il n’empêche que l’institution est ébranlée. La crise actuelle autour des révélations de violences sexuelles commises par des prêtres sur les enfants, mais aussi sur des adultes – dont les religieuses qui commencent elles aussi à parler[7] – est en train de bouleverser l’agenda conservateur : elle fait resurgir dans le débat ecclésial des thématiques et des mobilisations délégitimées depuis les années 1980, comme celles de l’ordination de prêtres mariés ou de la place des femmes dans les organes de pouvoir de l’Église[8].
Il semble que le système clérical, instituant ainsi non seulement l’homosexualité mais toute sexualité en secret d’État et sacralisant le pouvoir clérical sans contre-pouvoir, a créé également un effet d’aubaine pour tous ceux qui, cherchant avant tout dans le sacerdoce une emprise sur leur prochain, sont devenus (ou étaient déjà) des prédateurs sexuels. Ils ont trouvé, dans l’aura sacrale du prêtre, un facilitateur de passage à l’acte face aux fidèles et, dans le fonctionnement en silos de l’institution, une assurance de minimiser les risques de dénonciation publique. La peur généralisée de l’outing, devenue une arme politique parmi les prélats, a fait le reste : tous se tiennent mutuellement par leurs petits secrets. Mais peuvent-ils faire autrement quand, précisément, le caractère « invivable » des normes sexuelles catholiques, qui s’imposent sans aucune gradualité aux clercs, constitue nécessairement ceux-ci en fautifs, et donc, exposés à perdre leur poste, en obligés de l’institution ? Les uns ont peur que les autres fassent des révélations sur leur sexualité, forcément non conforme au regard des règles ecclésiastiques, et réciproquement. Toutefois, ces normes catholiques sont totalement décalées par rapport aux normes de la société dans laquelle vivent ces prêtres : leur obsession homophobe est à contre-courant de la tolérance croissante de la société, qui à l’inverse tolère de moins en moins les violences sexuelles infligées aux femmes et aux enfants.
Mais il faut aller plus loin et affirmer que l’occultation des violences sexuelles faites aux femmes et des enfants n’est pas tant de l’ordre du refoulement que d’un désintérêt profond : ce monde d’homosocialité est obsédé par sa propre homosexualité, et la masculinité érigée en problème de sexualité les aveugle face à l’enjeu en même temps que face à la gravité des abus sexuels au sein de l’institution. Au moment même où ceux-ci deviennent socialement insupportables, ils restent, pour beaucoup de prêtres, un problème secondaire. Le décalage avec la société vient donc de cette manière de minorer ce qui apparaît à beaucoup, hors de l’Église, comme un enjeu majeur : le clergé n’a pas pris, et commence à peine à prendre la mesure de cette transformation des normes, tant l’Église s’est constituée en réaction contre elle. Faut-il s’en étonner ? Les rares lanceurs d’alerte au sein du clergé sont bien souvent aussi ceux qui dénoncent également l’homophobie systémique de l’Église.
C’est ainsi que l’obsession homosexuelle, ou homophobe (c’est tout un), constituée en problème, est l’envers du déni des abus. Finalement, l’Église offre à voir une figure inversée de la démocratie sexuelle : tandis que les sociétés occidentales voient de moins en moins l’homosexualité comme un problème, c’est précisément ce qui compte à ses yeux. Et alors que la question du consentement sexuel devient de plus en plus le critère de toute sexualité, il est absent des questions de l’Église[9]. C’est dire aussi le degré de fermeture de cette institution. En un sens mon travail le montre aussi par la nécessaire érudition qu’il faut avoir pour enquêter sur elle. Cette nécessité dit quelque chose de son enfermement dans ses propres préoccupations sans prêter attention à ce qui se passe autour d’elle, ou du moins sans le comprendre, sinon pour le dénoncer comme le « mariage pour tous », la « PMA », etc.
L’enquête resituée dans cet ouvrage concerne le clergé catholique français. Le rapprochement de ces deux adjectifs peut apparaître comme une forme d’alliance de mots : pourquoi se limiter à une dimension nationale quand l’Église romaine prétend parler un langage universel, et le fait dans une multitude de langues ? En outre, il est clair qu’il n’est pas possible de parler des politiques de la masculinité dans le clergé français sans prendre en compte la politique menée par le Vatican en matière de genre et de sexualité. Il faut le reconnaître d’emblée : le parti pris de limiter l’enquête au clergé français correspond, en grande partie, à des contraintes pratiques : plutôt que de multiplier les pays d’observation, au risque de la superficialité, il a paru plus intéressant d’approfondir l’enquête sur le terrain français, en profitant de ma familiarité avec ce monde et ses réseaux.
Toutefois, ce nationalisme méthodologique me semble trouver un début de justification théorique. En effet, la dimension nationale de l’enquête, menée en France, ne doit pas empêcher de remarquer la composition internationale des enquêtés : on l’a vu dans le dernier chapitre, les prêtres de nationalité étrangère constituent une proportion importante du clergé en France. Or toutes les batailles, au sein de l’Église catholique française, semblent faire l’impasse sur ces étrangers : tout se passe comme s’ils ne comptaient pas dans les enjeux nationaux. Même quand les prêtres parlent d’immigration, ils ne semblent pas prendre en compte la réalité migratoire dans le clergé, où les Africains sont fortement représentés.
Ou plutôt, si ces immigrés – temporaires ou définitifs – sont parfois pris en compte dans le discours, c’est seulement pour leur attribuer les violences à l’égard des religieuses. C’est ainsi faire écho aux stéréotypes culturalistes répandus dans la société sur les mœurs africaines, réputées peu compatibles avec la démocratie sexuelle. Ces clichés qui ne sont pas exempts de racisme soulignent en même temps que les problèmes liés à l’hétérosexualité sont renvoyés vers l’étranger. Autant dire que le problème de l’homosexualité est un problème national : la masculinité est un enjeu franco-français. C’est bien pourquoi tous les conflits autour des politiques de la masculinité, à l’intérieur de l’institution, se jouent entre Blancs. Car la dimension nationale est inséparable de connotations raciales. Il ne s’agit pas d’accuser le clergé, dans son ensemble, de racisme ; je voudrais plutôt proposer l’hypothèse selon laquelle la masculinité, telle qu’elle est construite, à la fois comme norme et comme problème, est une masculinité blanche.
Il ne faut pas s’en étonner. La question ne concerne pas seulement la partie du clergé qui s’avère proche de Valeurs actuelles, comme on l’a vu, ou de mouvements clairement affiliés à l’extrême droite comme l’éphémère Printemps français né lors la radicalisation du mouvement social contre le « mariage pour tous » ou même du mouvement intégriste et maurassien Civitas qui lui préexistait. De manière plus fondamentale, c’est aussi la montée d’un discours sur l’islam, religion étrangère à la culture française, qui constitue en creux le catholicisme comme une religion « de souche ». Dans un contexte de mise en avant des « valeurs chrétiennes de l’Europe », le clergé catholique bénéficie ainsi d’un capital d’autochtonie que ne dément pas la présence en son sein de nombreux prêtres étrangers. Le catholicisme identitaire renvoie donc, dans un même temps, à une identité religieuse et nationale, voire raciale. La politique sexuelle, contre la « théorie-du-genre » et pour une masculinité virile, n’est d’ailleurs pas étrangère aux politiques masculinistes d’une extrême droite identitaire qui se réclame, au moins culturellement, d’une histoire chrétienne.
Le repli identitaire d’une partie de la hiérarchie catholique inscrit donc l’Église catholique française dans une réaction contre la démocratie sexuelle, on l’a évoqué à mainte reprise, mais également contre la démocratie raciale. Et c’est sur ce point qu’on voudrait achever le parcours, en mettant en avant ce qui est resté sous-jacent tout au long, soit une logique qu’il faut bien qualifier d’intersectionnelle. Le genre et la sexualité, on l’a vu, croisent la classe, avec la montée en puissance d’un catholicisme bourgeois qui s’est affiché avec la revanche versaillaise de la Manif pour tous. Il apparaît aussi que ce catholicisme national est, implicitement ou explicitement selon les moments, blanc. En ce sens, l’Église catholique n’est pas en dehors du monde : elle participe d’un contexte général de réaction, tant sexuelle que raciale, qui passe par la mise en exergue de la dimension nationale, paradoxale pour cette institution qui revendique un message universel.
*
Les femmes ont été écartées artificiellement de ma mise en récit. Il est grand temps de les évoquer, notamment ces femmes membres du clergé catholique au sens sociologique mais non au sens institutionnel que sont les religieuses et qui, à bien des égards, sont parmi les principales victimes de l’oppression cléricale et de son déni qui la redouble.
Le mouvement #Metoo est un excellent laboratoire d’évaluation de ce déni. Rappelons que la mobilisation est partie de l’affaire dite « Harvey Weinstein » qui débute en octobre 2017, mettant en cause l’ancien producteur de cinéma américain accusé d’avoir abusé de sa position de pouvoir pour agresser sexuellement et violer une centaine d’actrices. Le phénomène a ensuite enflé grâce au hashtag #MeToo invitant chaque femme à témoigner sur les réseaux sociaux. L’usage du hashtag #MeToo sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes est devenu en quelques mois un phénomène planétaire. Cette prise rapide s’explique notamment par : 1) la renommée mondiale du milieu d’origine de la dénonciation : le cinéma hollywoodien ; 2) la dynamique virale propre aux mobilisations numériques ; 3) ses multiples répliques locales, comme en France le succès de sa variante #BalanceTonPorc ; et enfin, 4) sa mise en récit médiatique cadrée par la perception d’un avant et d’un après, présupposant que la publicisation des violences sexuelles par des femmes victimes était nouvelle à une telle échelle et allait forcément changer les choses.
Qu’en est-il au sein du catholicisme et du clergé français ? Une double focale est nécessaire pour répondre à cette question : il s’agit d’évaluer la nature et la dispersion des différentes réactions catholiques au sein de l’espace national ; mais aussi de comparer le volume global de ces réactions par rapport aux réactions catholiques dans les autres espaces nationaux et dans l’espace mondial.
À l’échelle mondiale, il y a eu un effet #MeToo certain dans le champ catholique : après des enfants, ce sont des religieuses en Italie, en Inde ou encore au Chili qui, aujourd’hui, s’autorisent à parler des violences sexuelles – mais aussi spirituelles et psychologiques – qu’elles ont subies de la part de prêtres[10]. Par comparaison, le catholicisme français semble avoir été bien atone face et au sein de cette mobilisation. Ont sans doute joué en faveur de cette atonie la bascule du catholicisme français dans un régime de minorité et sa très forte polarisation actuelle.
Certes, les médias catholiques se sont fait les relais de l’information au sujet du mouvement #MeToo, ont interrogé le sens de cette mobilisation, chacun selon ses propres intérêts dans le champ polarisé des prises de position catholiques :
-le quotidien La Croix sur un mode informatif et interrogatif afin de respecter les canons de la neutralité journalistique ;
-le magazine Témoignage chrétien, assimilé à la fraction contestatrice du « pôle d’ouverture » – dont la rédactrice en cheffe actuelle fut qui plus est la cofondatrice du collectif féministe catholique, le Comité de la jupe –, emboîte le pas de la mobilisation en proposant dans plusieurs numéros spéciaux des articles déconstruisant le machisme inscrit au cœur des religions monothéistes, donnant la parole à des personnalités féministes dans et hors du monde catholique. Le magazine va plus loin en faisant un lien entre violences faites aux femmes et pédocriminalité au sein de l’Église, dénonçant le monopole du pouvoir masculin comme leur cause commune et finit par proposer un nouveau hashtag #WeToo[11] élargissant l’espace de la dénonciation en ce sens. Mais c’est plutôt le hashtag sectoriel d’origine étatsunienne #MeTooChurch qui s’imposera finalement ;
-Famille chrétienne, chambre d’écho du « pôle d’identité », reprenant les positions du « féminisme » différentialiste promu par Jean-Paul II, reconnaît l’injustice faite aux femmes devant l’ampleur des violences publicisées. Mais le magazine dénonce immédiatement la logique victimaire du mouvement et son effet de « chasse aux sorcières » vis-à-vis des hommes[12]. Surtout, il pointe comme cause de ces violences l’hypocrisie d’une société séculière « libertaire » laissant les jeunes garçons en proie à la pornographie avant de leur demander de se tenir[13] ;
-le magazine La Vie cherche à tenir une ligne de crête entre ces deux pôles, mais aussi à témoigner d’une fidélité réflexive à l’égard de la politique vaticane. Son directeur de rédaction profite de la sortie dans l’Observatore Romano – l’organe de presse officiel du Vatican – d’un article dénonçant les conditions de travail des religieuses au Vatican dans la lignée de #MeToo (l’article étant écrit par une journaliste de La Vie) pour questionner en éditorial la condition féminine au sein de l’Église[14]. Mais, pragmatique, il évite la question qui fâche de l’impossible accès des femmes aux ministères ordonnés, en produisant une liste édifiante de femmes et de religieuses présentes aux plus hauts postes de la Conférence des évêques de France.
À côté de ces réactions du monde catholique, la hiérarchie ecclésiale française, en revanche, ne s’est pas saisie de la mobilisation #MeToo comme d’une « proposition d’engagement[15] » – au-delà de ce que Becker appelle « le commérage[16] », repérable sur les profils Facebook de nombreux prêtres. Le silence des évêques français tient-il à leur accablement face au grand dévoilement d’actes pédocriminels au sein du clergé ? Est-ce de l’indifférence à l’égard de la cause des femmes de la part des représentants d’une des dernières institutions leur refusant officiellement l’accès aux postes de pouvoir ? Est-ce par un souci, propre à leur fonction, de maintenir l’unité d’un catholicisme en tension comme on l’a vu ci-dessus ?
Début mars 2019 (date de rédaction de cet épilogue), seule la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref) s’est positionnée indirectement en faveur du mouvement, en soutenant officiellement l’appel de la Conférence étatsunienne des mères supérieures à briser la loi du silence sur les violences sexuelles subies par les religieuses au sein de l’Église. Il faut dire que plusieurs éléments lui ont facilité cette prise de position contrastant avec la réserve des évêques et du Padreblog.
D’abord, la Corref est un organisme récent et mixte. C’est en 2000 que les deux conférences – masculine et féminine – des supérieur·e·s majeur·e·s des ordres religieux présents en France fusionnent. Or, cette fusion a contribué à redynamiser ces structures de concertation anciennes qui, jusque-là, étaient tournées vers des enjeux internes ou romains. Récente, la Corref bénéficie donc d’une sorte de virginité publique. Et, forte de cette virginité, elle a tiré son épingle du jeu médiatique en se positionnant en décalé par rapport à une Conférence des évêques de France dont l’image publique apparaît dégradée, notamment du fait de sa communication sur la pédocriminalité dans le clergé. Ensuite, les ordres religieux qu’elle représente sont pour la plupart internationaux. Or, les circulations transnationales en leur sein permettent de s’extraire de la perspective francocentrée qui est celle des évêques et du clergé séculier, et font bénéficier ses membres des expériences diverses de leurs coreligionnaires étranger·e·s : empowerment des religieuses féministes nord-américaines, révolte des religieuses chiliennes, etc. Enfin, la Corref est présidée depuis peu par une femme, sœur Véronique Margron, théologienne reconnue et ouverte au dialogue avec les sciences sociales comme le montre la « disputatio » publique qu’elle a accepté d’avoir sur le sujet « chaud » pour l’Église catholique de la « différence des sexes » avec Éric Fassin, le 27 mai 2011, dans la cathédrale de Rouen avant sa présidence[17] – ce qui est devenu exceptionnel chez les intellectuel·le·s organiques d’un catholicisme qui se vit comme fragilisé.
C’est ainsi que la Corref s’est révélée le seul organe officiel de l’Église en France à être sensible et à anticiper la nouvelle crise qui est en train d’éclater à l’échelle mondiale dans le prolongement de #MeToo au sein de l’Église catholique : une crise de dévoilement des violences sexuelles faites aux femmes que l’appareil romain va devoir gérer alors que la crise de dévoilement des violences sexuelles faites aux enfants semble loin d’être achevée. Or l’institution ne pourra sans doute pas se sortir de cette double crise sans déconstruire une masculinité cléricale qui, bien qu’atypique et marginale par rapport aux formes hégémoniques de masculinité dénoncées à travers #MeToo, se révèle finalement elle aussi « toxique », comme le disent certaines militantes féministes. Mais le clergé français, aujourd’hui raréfié, pour une part surmené, pour une autre sous-informé voire désinformé sur les enjeux de genre et de sexualité, et pour une troisième part sur la défensive, comme nous l’avons montré dans ce livre, semble loin d’en être capable.
Il aura fallu attendre finalement la conjonction de plusieurs événements pour que la société civile catholique exprime enfin son dégoût et sa lassitude, et que les autorités catholiques se décident à en parler, en commençant par le pape lui-même reconnaissant un véritable « esclavage sexuel » dans certaines communautés : l’effervescence médiatique autour du sommet mondial sur « la protection des mineurs dans l’Église » qui s’est tenu à Rome du 21 au 24 février 2019, la parution opportuniste du livre de Frédéric Martel au même moment, l’effervescence autour du procès du cardinal Philippe Barbarin dont le verdict a été rendu le 8 mars 2019 et la diffusion d’un documentaire « choc » sur la chaîne Arte : Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église (Éric Quintin et Marie-Pierre Raimbault, 2017) deux jours avant. Cette prise de conscience du caractère systémique des violences sexuelles, et plus généralement des violences de genre, sur les religieuses est fragile. Rien n’assure qu’elle ne s’épuise pas avec le temps. Il reste que l’Église a elle-même enclenché un processus d’autocontrainte qui ne peut que le lui rappeler « à temps et à contre-temps » – pour reprendre une expression de saint Paul (2 Tim 4, 2) reprise par le concile Vatican II.
Depuis le milieu des années 1980, en effet, les cas de violences sexuelles sont de plus en plus médiatisés en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Concernant l’Église catholique romaine, cette couverture médiatique croissante s’est principalement concentrée sur les agressions sexuelles sur mineurs garçons et sur leur dissimulation par sa hiérarchie. La France, où l’emprise du catholicisme a largement diminué mais où son empreinte reste profonde, n’a pas échappé à une telle médiatisation. Plusieurs condamnations en justice de prêtres catholiques ayant commis des violences sexuelles sur des hommes, mineurs au moment des faits, et surtout de leurs responsables hiérarchiques pour non-dénonciation, ont marqué les deux dernières décennies : celles des évêques à la retraite Pierre Pican en 2001 et André Fort en 2018 ; celle, surtout, du cardinal-archevêque de Lyon en exercice Philippe Barbarin en première instance en 2019, avant sa relaxe en appel en janvier 2020, lequel verra finalement sa démission acceptée par le pape deux mois plus tard. Deux films à succès ont également fortement alimenté cette construction en problème public des violences sexuelles sur mineurs garçons et de leur dissimulation par l’Église en France : les films étatsunien Spotlight (Tom McCarthy, 2016) et français Grâce à Dieu (François Ozon, 2019). Par un effet de mise en abyme, chacun de ces films, agent de cette mise à l’agenda public, a projeté sur le devant de la scène des entrepreneurs clés de la dénonciation : l’équipe d’investigation du journal Boston Globe dans le premier film, à l’origine de la chute de l’archevêque de cette ville ; des victimes elles-mêmes réunies au sein du collectif La Parole libérée dans le second, à l’origine de la chute de celui de Lyon. Ce processus de mise à l’agenda public des violences sexuelles sur mineurs dans l’Église a conduit en 2018 la représentation nationale à se saisir de la question, avec la demande, émanant d’un groupe de sénateurs, de création d’une commission d’enquête parlementaire centrée sur l’Église. Celle-ci se transformera finalement en « Mission d’information qui s’intéressera plus largement à la prévention de la pédophilie dans les institutions accueillant des enfants[18] », mais conduira l’Église sous pression à se saisir du dispositif en instituant elle-même une commission d’enquête indépendante. La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a été installée le 13 novembre 2018, sous la présidence de Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, à la demande de la Conférence des évêques de France (CEF) et de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref). Or, celle-ci a elle-même pris en compte dans son périmètre d’investigation tant les violences sexuelles sur personnes mineures, garçons et filles, que sur personnes adultes dites « vulnérables », ce qui a permis aux équipes de recherche d’inclure les religieuses dans leurs enquêtes.
[1] R. Connell, Masculinités, op. cit.
[2] B. de Gasquet, « La barrière et le plafond de vitrail », art. cité.
[3] M. Buscatto, B. Fusulier, « Présentation. Les “masculinités” à l’épreuve des métiers “féminins” », art. cité.
[4] J. Potel, Ils se sont mariés… et après ?, op. cit.
[5] D. Cozzens, Le Nouveau Visage des prêtres, op. cit.
[6] G. Le Bras, Études de sociologie religieuse, t. 1, op. cit.
[7] https://www.france24.com/fr/20180307-revolte-soeurs-vatican-sexisme-eglise-catholique-nonnes-religion-egalite-femmes ; Morgane Giuliani, « Femmes violées dans l’Eglise : un scandale d’une ampleur colossale », Marie Claire, www.marieclaire.fr/abus-sexuels-eglise-catholique-femmes-temoignages,1295220.asp
[8] « L’archevêque de Poitiers et le mariage des prêtres », La Nouvelle République, 10 mars 2019 : https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/l-archeveque-de-poitiers-se-declare-favorable-au-mariage-des-pretres
[9] C. Lalo, J. Tricou, « Crise de la pédophilie dans l’Église catholique : une confrontation de scripts sexuels », art. cité.
[10] Constance Vilanova, « #MeToo et la libération de la parole chez les religieuses », La Croix, 1er août 2018 : https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/MeToo-liberation-parole-chez-religieuses-2018-08-01-1200959162
[11] www.temoignagechretien.fr/wetoo/
[12] www.famillechretienne.fr/politique-societe/societe/reponses-aux-questions-derangeantes-sur-le-feminisme-238155
[13] Issue de la même fraction du catholicisme français, la journaliste Eugénie Bastié publie un an après un livre qui suit la même logique. Son titre, Le Porc émissaire, est révélateur. Elle y dénonce le « lynchage » des hommes.
[14] www.lavie.fr/debats/edito/ni-servantes-ni-muettes-06-03-2018-88493_429.php
[15] Luc Boltanski, La Souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié, 1993.
[16] H. S. Becker, Outsiders. Étude de sociologie de la déviance, op. cit.
[17] Véronique Margron, Éric Fassin, Homme, femme, quelle différence ?, Paris, Salvator, 2011.
[18] Manon Rescan, « Le Sénat rejette la création d’une commission d’enquête sur la pédophilie dans l’Église », Le Monde, 17 octobre, 2018.