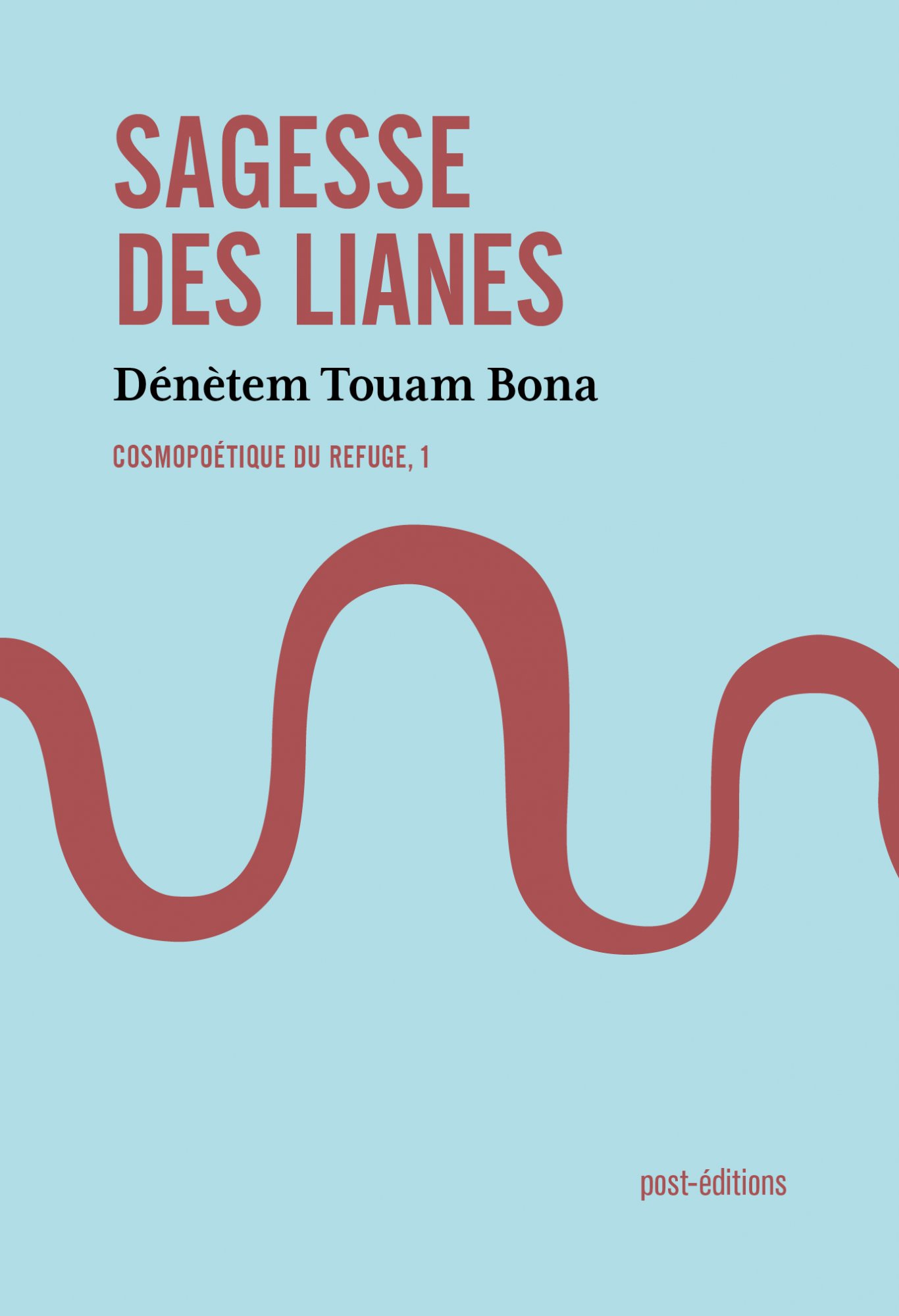
« Au point de départ de toute quête initiatique – et la vie en est une ! -, il y a l’expérience poétique : la saisie du monde comme totalité comme totalité vivante, l’intuition que tous les éléments qui nous entourent nous traversent et nous composent – le végétal, le minéral, l’eau, l’air, les ondes magnétiques – se répondent, s’entrelacent et forment un seul et même « cosmos ». La sagesse des lianes consiste non seulement dans l’expérience de ces liens cosmopoétiques, mais aussi dans la capacité à faire d’eux des cordes tendues d’arcs de combat. C’est pourquoi je vois dans les lianes – en tant que figuration des plantes et des biomes alliés – les esprits auxiliaires des luttes pionnières « indigènes » contre la marchandisation intégrale du vivant et l’uniformisation des modes d’existence »[1].
Son premier livre Fugitif, où cours-tu ? retraçait la complexité de l’expérience de la fugue pour les vies constituées comme « mineures », pensée tout autant comme une lutte pour un « droit à l’opacité » pour reprendre l’expression d’Edouard Glissant, l’un des multiples compagnons de route de l’auteur, que comme tentative de soustraction et de dé-liaison des chaines coloniales.
Dans Sagesse des lianes, son nouvel ouvrage sorti en fin d’année dernière chez Post-éditions, le penseur et artiste Dénètem Touam Bona prolonge ses réflexions sur cet art du camouflage et de la subversion en choisissant de se concentrer sur la figure de la liane, sur les populations humaines et non-humaines, aux paysages et aux récits qu’elle convoque dans nos imaginaires. Il esquisse ainsi une philosophie en clair-obscur des corps, des pratiques sociales ou rituelles qui ont historiquement incarné la résistance au capitalisme colonial.
Évoquant tour à tour la résistance de différents mondes marrons ou afrodiasporiques, la figure raciste de Tarzan, l’usage toxique des plantes à Saint Domingue, le Krump, la liane fait émerger d’autres architectures subversives, d’autres modes de penser, de créer et de lutter ensemble. Lien et levier métaphorique, elle devient également l’occasion d’une réflexion sur la possibilité d’alliances, d’un « liannaj » entre différentes expériences de la minorité et de la domination.
Au moyen d’une écriture poétique ciselée et espiègle, Dénètem Touam Bona s’attache également à dénouer les formes de scléroses symboliques hantant les récits et les concepts en vogue dans les pensées hégémoniques de l’écologie actuelle. Il se propose même au contraire d’en questionner la pertinence afin de tracer des « cosmopoétiques » capables d’intégrer « soin du vivant et reconstruction de soi (éthique et politique) dans un même mouvement de réexistence « enlianant » corps et territoires ».
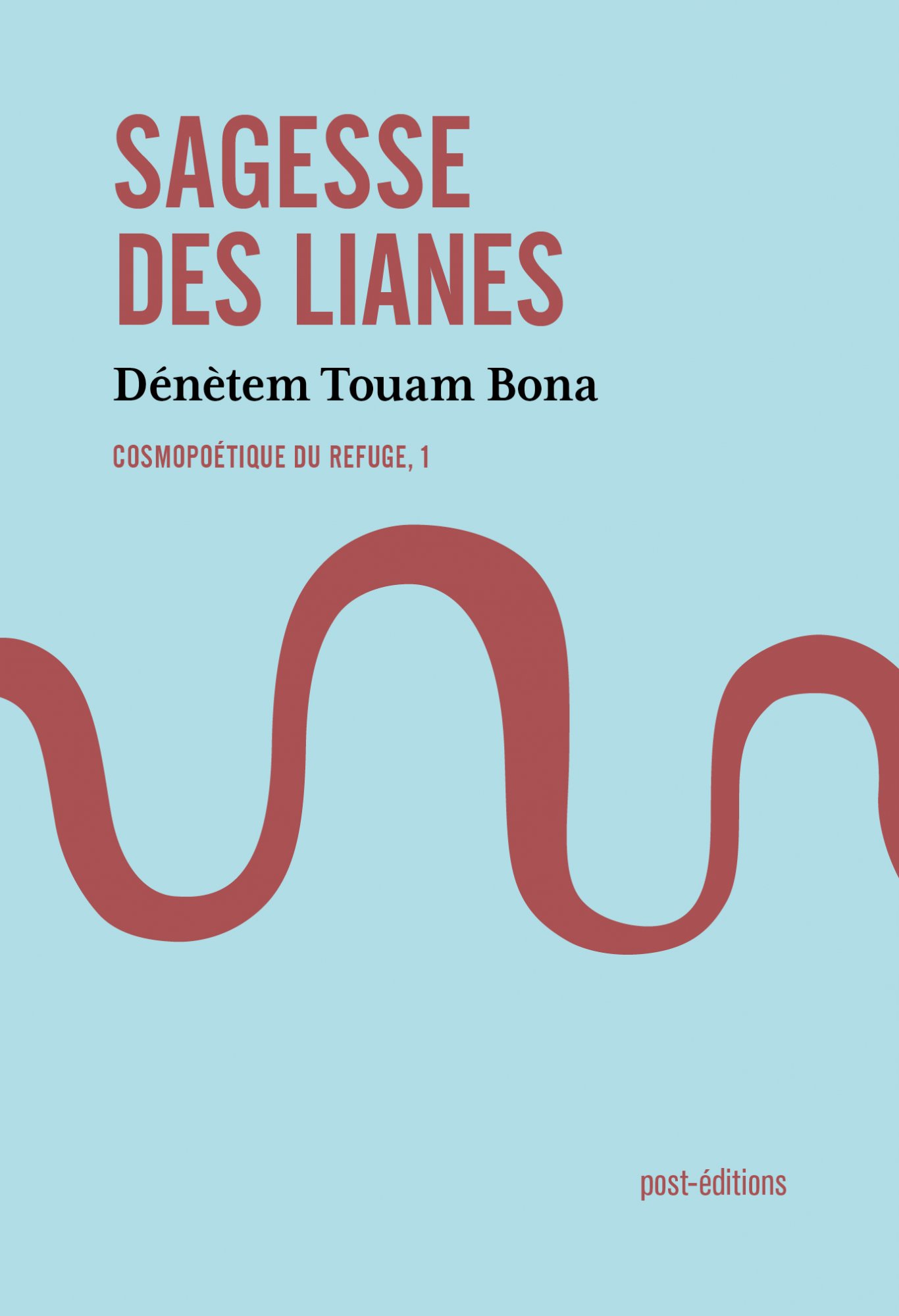
Cy Lecerf Maulpoix – Comment se sont tissés tes premiers liens avec l’écriture, notamment jusqu’à l’écriture de ton premier livre, Fugitif, où cours-tu ?
Dénètem Touam Bona – Ça fait longtemps que j’écris mais il a fallu que je conquière la confiance et l’estime pour m’imaginer comme auteur. Aujourd’hui, il est devenu peut-être un peu plus évident d’écrire ou de faire de l’art pour de nombreuses personnes afrodescendantes. Pour ma part, cela restait une chose à conquérir. Pendant longtemps, je n’ai pas fait grand-chose, je me cherchais, La figure du zombie est assez présente chez moi : sortir de l’état de somnambule, être travaillé par l’envie de faire des choses mais ne pas oser. J’ai donc fait plein de détours. J’ai longtemps été maitre d’internat, ce qui me permettait d’être inscrit en fac. J’ai une formation de philo au départ sans me retrouver vraiment dans la philosophie telle qu’elle m’était enseignée. En allant à Lille, j’ai intégré l’association Genepi qui m’a permis de lui donner un sens concret. La philosophie prenait sens dans un rapport à un terrain spécifique. La rencontre avec les textes de Foucault, notamment Surveiller et Punir m’a fait entrer dans l’univers d’un auteur que l’on ne m’avait jamais enseigné à la fac et m’a fourni des éclairages sur la réalité carcérale dans laquelle j’évoluais avec l’association.
Et puis, il y a eu la découverte des mondes marrons à partir de l’écoute d’un entretien de l’écrivain guadeloupéen Daniel Maximin. Que des sociétés d’esclaves fugitifs aient pu voir le jour, que des peuples marrons comme les Businenge de Guyane ou les Garifunas d’Amérique centrale aient pu se perpétuer jusqu’à nos jours, cela remettait complètement en question l’histoire qui m’avait été contée à l’école. Car derrière le récit de l’abolition, derrière l’héroïsation de Victor Schoelcher (l’auteur du décret d’abolition), il y a le mythe de l’esclave docile et le blanchiment de l’histoire. Blanchiment au sens où l’acteur principal de cette histoire reste le Blanc. Blanchiment au sens où le geste d’humanité de Schoelcher permet d’innocenter la République de crimes contre l’humanité au fondement de la puissance française : la traite et l’esclavage négriers. Ces histoires d’hommes et de femmes noirs luttant pour s’arracher à la damnation m’ont permis de me réconcilier avec ma part africaine. Mon père, Ing-Na Touam Bona, était un opposant centrafricain qui, jusqu’à sa mort, a lutté contre les régimes de Bokassa et de Kolingba, un exemple parmi d’autres des autocraties africaines dont l’armée française constitue l’assurance-vie. Je ne pouvais donc me reconnaître dans une histoire de victimes.
Par ailleurs, il n’y avait rien en France d’intéressant sur le marronnage. On distinguait un petit marronnage d’un grand marronnage, une terminologie liée à la nomenclature esclavagiste. Dans des travaux historiques sur le marronnage comme ceux de Gabriel Debien ou Yvon Debash, il était réduit à des fuites « instinctives ». Un homme, une femme esclavisés ne fuient pas par instinct comme un rat soumis à une décharge électrique, ils fuient d’abord pour ne plus être niés dans leur humanité, ils fuient parce qu’ils rêvent d’une autre existence, d’un autre monde : I have a dream ! D’où mon intérêt pour les aspirations et « utopies » des esclavisés. Ce n’est pas dans les archives laissées par les maîtres qu’on trouve le meilleur témoignage de cette spiritualité politique, mais dans les archives musicales, chorégraphiques, cultuelles des Amériques noires.
J’ai donc voulu aller en Guyane pour en savoir plus. Je savais que vingt pour cent de la population appartenait à des communautés marronnes. J’ai eu mon premier poste là-bas même si à cette époque, je ne me sentais pas capable d’enseigner. J’ai eu un poste de documentaliste à Patou sur le Maroni en Guyane en 2002, en partant à l’arrache. Enseigner dans les anciennes colonies a été une façon de financer mon travail de recherche, mon enseignement étant lui-même une expérimentation.
Cy Lecerf Maulpoix – Entre Fugitif, où cours-tu ? qui se concentrait sur la fugue comme processus de libération et de résistance des communautés marronnes et ce second livre qui choisit de mettre en lumière la figure de la liane, quels échos y-a-t’il ?
Dénètem Touam Bona – Pour moi, la liane n’est qu’une figuration parmi d’autres de ce que j’appelle la fugue. Passer par la liane plutôt que par la fugue permet de montrer de façon plus explicite le lien entre la thématique du marronnage et de l’écologie. La figure de la liane, je la pense davantage comme un trickster, une divinité farceuse. Biologiquement, à la différence d’une espèce comme la fougère, la liane peut regrouper des conifères, des vignes, une multitude de familles végétales qui n’ont pas grand-chose à voir, à part leur mode de propagation, grimpante ou rampante, ou leur dimension filaire ou textile par exemple. Le fait de ne pas disposer de tronc les amène à toujours développer des tactiques d’accrochage complexe. Elles peuvent passer par des torsions, se distordre autour d’autres supports. Elles relaient et relient, et participent ainsi à la structuration d’un monde forestier.
À la différence du rhizome qu’on ne voit pas, une liane comme le ficus étrangleur rend visible une ambivalence du vivant. La liane n’est pas bonne en soi. Elle peut mettre en relation mais peut aussi étouffer ou étrangler.
Au-delà de la liane, il s’agit aussi pour moi de réhabiliter une pensée critique qui, dans toutes les cultures et les époques, est toujours passée par des images, par des contes, des fables, des proverbes, etc. Réhabiliter une forme sensible : l’image en tant qu’outil et véhicule de la pensée
Cy Lecerf Maulpoix – Tu écris « la liane n’existe pas : elle n’existe que sur un mode « figuré » en tant que tour de langage et de tours de main »…
Dénètem Touam Bona – Quand je décris la liane, je décris en fait mon propre mode opératoire. Je m’en suis rendu compte après coup. Une image ne permet pas seulement de fixer des contenus de pensées, mais aussi des opérations, toute une cartographie. Pour moi, la poésie, c’est une manière de penser en condensation : un entremêlement de strates différentes, hétérogènes, comme une constellation.
En France, qualifier le travail de poétique revient souvent à dire que ce n’est pas vraiment rationnel. La poétique est réduite à l’émotion, à la sensibilité, à la rêverie…
Cy Lecerf Maulpoix – Une série de figures ou de termes sont très en vogue en ce moment dans les pensées de l’écologie, l’horizontalité, l’invitation à « atterrir » pour reprendre le concept de Bruno Latour. Tu évoques le fait que cette « écologie » ou en tous les cas des pratiques dites terrestres se pratiquent déjà ailleurs différemment. Dans quelle mesure ces termes t’interrogent ?
Dénètem Touam Bona – Une des choses qui nous possède, dans notre société occidentale et occidentalisée, c’est le mot d’ordre comme le souligne Gilles Deleuze. Aujourd’hui, une des choses qui m’étouffe, ce sont tous les mots d’ordre auxquels nous sommes constamment confrontés, y compris au sein de mouvements qui essayent de remettre en question l’ordre mais qui, paradoxalement, ont souvent recours à des mots d’ordres. Je comprends que politiquement, à tel moment stratégique, on a besoin de mots d’ordre. Le problème c’est que cela déborde le moment stratégique. Dans une pensée comme celle d’Edouard Glissant, de Walter Benjamin ou de Montaigne, ce qui importe, c’est le tremblement. Il s’agit de remettre en question la grammaire du verbe « trembler ». On ne tremble pas forcément devant quelque chose. Le tremblement qu’on impulse dans le travail d’écriture, et dans n’importe quelle pratique de création, peut ébranler les certitudes les mieux ancrées, les fondations des édifices théoriques et idéologiques les plus majestueux. Le KRUMP par exemple est une danse sismique, une façon de convertir le tremblement de rage des vies noires bâillonnées en célébration des puissances de réexistence.
Par son buissonnement, par la multiplicité de ses « em-branchements », de ses fourches diaboliques, de ses ombres et formes fugitives, la forêt est le lieu par excellence du trouble : trouble de la vision et de l’identité, troubles de la perception. Ce que j’appelle, avec une pointe d’ironie, la « sagesse des lianes » ne peut que faire trembler les évidences et fracturer la « réalité objective ». Une sagesse pas si sage donc, une sagesse qui déstabilise, mais qui parce qu’elle remet en question un équilibre illusoire ouvre à la métamorphose. Les Soufis, à travers notamment le « sema », la danse des derviches tourneurs, font du vertige un vortex vers d’autres dimensions de l’existence.
Penser est une danse. On ne peut danser avec des articulations sclérosées, des muscles complètements rigides voire tétanisés. La souplesse qu’exige une pensée vivante, en résonance avec les sujets qu’elle aborde, ce ne sont pas les formules stéréotypées, les slogans, les expressions fétiches qui l’apportent mais le recours à la créativité du langage, à des usages imprévus et féconds de la langue, des torsions-distorsions du corps de la langue. Face aux « novlangs » qu’impose l’ordre dominant, cette appauvrissement terrible du vocabulaire et des usages de la parole, la langue tordue de la poésie et du chamane, l’opacité du parler « marron » ne peuvent être que subversifs.
Cy Lecerf Maulpoix – Tu écris « D’un certain point de vue, le marronnage n’est pas « écologie décoloniale », mais l’abolition de l’écologie en ce qu’il intègre soin du vivant et reconstruction de soi (éthique et politique )». Quelles sont alors les limites de cette expression d’ « écologie décoloniale »?
Dénètem Touam Bona – Le seul danger, c’est éventuellement de faire croire qu’on peut garder l’écologie tout comme on pourrait conserver l’économie. Même s’il est difficile de se passer de ces termes, ce qu’il faut viser c’est l’abolition de l’écologie et de l’économie, cette compartimentation de l’existence qui est l’actrice même des désastres que nous vivons. Il y a une légitimité à parler d’écologie décoloniale, à faire comprendre qu’il y a d’autres façons d’aborder l’écologie : depuis la cale, depuis le ghetto, depuis les vies noires et prolétaires exposées sciemment aux rejets les plus toxiques des sociétés industrielles. Il faut juste éviter de fétichiser le terme « décolonial ». Dans une France qui reste réfractaire à tous les mouvements subalternes, le geste de Malcom Ferdinand est important car il offre des repères et des perspectives différentes concernant les questions dites « écologiques ». Il ne suffit pas d’accoler l’adjectif « décolonial » à un domaine, que ce soit l’écologie, l’art, la pédagogie, etc., pour que la décolonisation opère. Mais c’est valable pour tous les termes de ce type qui affiche une prétention. Vieux problème : le mot n’est pas la chose….
Cy Lecerf Maulpoix – S’il est important de décoloniser notre rapport au vivant, de quelle écologie hérite-t-on justement ?
Dénètem Touam Bona – J’ai beaucoup aimé Héritage et Fermeture d’Alexandre Monnin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. J’en ai notamment retenu l’idée qu’il faut savoir hériter de ce que l’on veut éliminer. Il faut savoir démêler les nœuds toxiques dans lesquels on est pris pour pouvoir tramer autre chose à partir des fils dénoués.. Quand on pense couper, parfois on ne fait que refouler et cela revient comme un mauvais esprit.
Dans mon livre, je parle d’arracher la liane des mains de Tarzan, il s’agit déjà de prendre conscience de liens et de nœuds toxiques au sein de l’écologie. La figure de Tarzan me permet de figurer en quoi un certain imaginaire est toujours présent où le damné, l’esclavagisé, le colonisé n’existent qu’en tant que décor qu’en tant que faune superflue. Tarzan, c’est l’incarnation non seulement du suprématisme blanc, mais aussi du patriarcat, et d’une certaine culture du viol. C’est un blanc orphelin, abandonné dans la jungle à l’état de bébé. C’est un sujet qui s’auto-construit, se produit lui-même. C’est une création ex-nihilo. Sans transmission d’expérience de la part de communautés humaines, il parle avec des animaux, il finit par mieux connaître la forêt que les Africains eux-mêmes. Il incarne cette arrogance de l’occident qui prétend mieux gérer des ressources, mieux prendre soin des territoires, les mettre en valeur, En tant que héros protecteur de la forêt, il incarne la complicité entre écologie et colonialisme. L’écologie en tant que mission de sauvegarde. Ce qui menace les dits écosystèmes, c’est l’exploitation colonialiste et capitaliste. En construisant un héros blanc, défenseur de la nature, on blanchit l’Occident des crimes coloniaux mais aussi de la dévastation des milieux colonisés. Le film et le livre « Tarzan » sont quasiment contemporains de la création des premiers parcs naturels en Afrique. A l’origine de ces parcs, il y a l’idée que les Africains menaceraient de destruction leur forêt. Guillaume Blanc dans L’invention du colonialisme vert a fait un travail d’une grande justesse là-dessus, sur la façon dont cette naturalisation de l’Afrique des territoires indigènes en général s’articule à une déshumanisation des territoires et des communautés.
Cy Lecerf Maulpoix – En cela, le liannaj apparait justement comme une réponse, un autre imaginaire…
Dénètem Touam Bona – Oui, il s’agit de déjouer l’usage colonial de la liane. Car c’est aussi une figure qui entrave, qui fait partie de la sauvagerie de la forêt, amazonienne, tropicale ou équatoriale. La liane appartient à une forêt qu’il faut dresser. Dans tous les récits coloniaux, la forêt est inextricable, elle nous empêche de voir et de progresser, elle intègre l’imaginaire toxique d’une forêt chevelue et hirsute. Avec le personnage de Tarzan, ce qui jusqu’alors était perçu comme une entrave devient l’expression même de la souveraineté du Maître sur la « jungle » : sa vitesse, son moyen de locomotion, avec toujours une position de surplomb. La vitesse et le fait de s’affranchir de l’apesanteur en font un héros moderne. Dans cette fantasmagorie coloniale, les lianes se réduisent à des cordes en libre-service, ce qui est plutôt amusant quand on pense à la réalité biologique des lianes: des plantes qui ont des racines plus profondes encore que celles des arbres.
Il ne faut donc pas laisser la liane au colon, à Tarzan. Il faut pouvoir puiser dans les sociétés amérindiennes, mélanésiennes qui déploient autrement la puissance de la liane au moyen de rituels pour celer leurs liens vis-à-vis des autres.
Cy Lecerf Maulpoix – Hériter, ce serait donc aussi réclamer et transformer ce qui a été dérobé ?
Dénètem Touam Bona – Dans la question de l’héritage se loge aussi celle de la subversion. On peut conjuguer les mémoires de résistances, subvertir les héritages qui nous ont été imposé. C’est ce que fait par exemple Bintou Dembélé en chorégraphiant Les Indes Galantes. Qu’est-ce qu’on fait d’une pièce aussi coloniale ? Dans son travail avec Clement Cogitore à l’opéra Bastille, Bintou Dembélé a proposé une « sub-version », version underground et hérétique de la partition du « Maître », en fonction d’enjeux contemporains. Les Indes galantes de Rameau, c’est assez fort en terme de soft power. C’est la galanterie française étendue au monde entier, avec ses codes et manières de vivre, de s’habiller. L’envers extrême de l’homme galant, c’est le nègre ou l’indien.
Bien sûr, il y a des moments où il faut abattre des statues, des éléments qu’on ne peut pas tolérer. Parfois il faut garder une trace. Il n’y a pas de mode d’emploi généralisable. Sinon cela perdrait son sens.
Mais on choisit aussi ses ancêtres. L’Europe ne se réduit pas à l’Occident moderne colonialiste et capitaliste. Il y a d’autres histoires que des auteurs comme Sylvia Federici ont développées. Je me reconnais dans les sorcières, les hérétiques, les communards, les suffragettes, les spartakistes de Berlin…. Un des objectif de l’exposition La sagesse des lianes au Centre international d’art et du paysage de Vassivière [2] était de mettre en résonance les radicalités des mondes afrodiasporiques avec celles des Nords.
Cy Lecerf Maulpoix – Si le marronnage comme tu le soulignes, existe à la fois dans la plantation et hors d’elle, qu’il recoure « à l’anonymat des villes ou à l’ombre des forêts », c’est cependant la forêt qui, cette fois-ci devient un espace privilégié pour une « cosmopoétique du refuge » dans ton livre. Pourquoi ?
Dénètem Touam Bona – Le marronnage historiquement se produit majoritairement dans des lieux forestiers. Mais il est important de ne pas s’arrêter au premier degré.
Il s’agit moins de la forêt au sens botanique que du geste même de cultiver la forêt, cultiver l’ombre, l’ombre protectrice. Cette ombre on peut la cultiver au cœur de la cité, voire de la smart city. C’est l’usage qu’en fait Ernst Jünger dans son Traité du rebelle ou le recours aux forêts. La forêt, c’est l’ombre, l’opacité. S’il y a une chose par laquelle passe le pouvoir, c’est l’injonction de la transparence. Ce qui nous guette, c’est la menace de perdre notre ombre, c’est à dire de devenir des spectres.
Par ailleurs l’étymologie du mot forêt renvoie au dehors. L’Occident, n’est pas le premier à utiliser cette opposition entre espace sauvage et civilisé, elle s’esquisse déjà dans des grande sociétés hiérarchisées comme celle de Sumer, notamment avec le mythe de Gilgamesh : l’un de ses premiers actes héroïques est de tuer l’esprit de la foret.
Cy Lecerf Maulpoix – Une partie de l’écologie blanche démontre un intérêt grandissant pour des manières d’être au monde, des rapports autochtones au vivant. Dans quelle mesure celles-ci relèvent selon toi d’une appropriation problématiques ?
Dénètem Touam Bona – Cela rejoint des questions liées à des formes d’extractivisme, d’ « orientalisme » au sens d’Edward Saïd, ou comment l’occident se produit lui-même à travers le portrait de l’autre. Pour aller vite, la naturalisation positive de l’indigène et la naturalisation négative se rejoignent, le bon sauvage et le méchant cannibale, ce sont les deux faces d’une même médaille. Comme la réserve naturelle et la mine, c’est complémentaire.
Lorsque les africains découvrent les premières caravelles portugaises, ils vont reprendre la figure de sirène sur la proue du bateau, l’enchevêtrer avec leurs génies des eaux et en faire Mami Wata, une nouvelle divinité. Il s’agit alors d’une appropriation, d’un usage déviant d’un élément européen, en vue d’autres fins.
Cy Lecerf Maulpoix – S’agit-il de ce mouvement carnavalesque que tu décris souvent ?
Dénètem Touam Bona – Le « carnavalesque » renvoie pour moi à une dimension de retournement, de torsion vis-à-vis de l’ordre social. C’est aussi ce qui m’intéresse dans le mouvement de la liane. La torsion de la parole poétique, son opacité constitue un appel au déchiffrement, et donc à reprendre le fil. La parole poétique tout comme la parole des devins-guérisseurs donne des éléments, des indices, des pistes, mais elle n’explique pas tout, ce qui fait son efficacité c’est justement son inachèvement. Elle offre donc toujours plusieurs lectures possible, elle est par essence polyphonique. L’opacité, c’est l’équivalent de l’humus d’où peut surgir aussi bien une fleur, qu’un légume ou un arbuste. Penser poétiquement, c’est faire confiance en l’intelligence de ceux qui traversent nos textes, c’est avoir foi en leur capacité de reprise.
Cy Lecerf Maulpoix – Si le liannaj permet aussi de figurer l’alliance entre différents mouvements minoritaires ou de luttes sociales, comment distinguer les complicités nécessaires des alliances toxiques ?
Dénètem Touam Bona – Je me questionne toujours sur le terme d’alliance. Mais on n’a pas dix mille mots pour parler de la possibilité d’enlianer les luttes. Comme l’analyse bien Barbara Stiegler, la force du néolibéralisme en tant que dispositif, c’est qu’il parle au nom du vivant. Il nous propose un récit, une histoire sur la vie. La puissance d’assimilation, de récupération qu’a le néolibéralisme nous oblige à être toujours prêts à se défaire de certains mots, à quitter certaines positions quand elles sont phagocitées. Comme les Marrons, il faut toujours tenter d’être là où on ne nous attend pas, et s’attendre à ce que nos nouvelles positions soit récupérées.
Les alliances dont il faut se défier sont celles qui sont liées à des intérêts dominants même s’ils se présentent sous la forme d’une bienveillance. Je parle là d’une bienveillance qui maintient une position surplombante, une sorte de continuation de la mission civilisatrice. Jean Baudrillard décrivait déjà la société de consommation comme une société de bienveillance. Aujourd’hui, nous sommes au summum de ça. Dans la « bienveillance », il y a une forme de « sur-veillance » insidieuse qui prétend veiller à notre bien.
Cy Lecerf Maulpoix – Face aux quêtes de visibilité dans l’espace public ou les médias au sein de nombreuses luttes, cette opacité que tu évoques plusieurs fois n’a-t-elle pas aussi à voir avec un sabotage, avec cette capacité à se dérober aux regards, à la surveillance généralisée ? À discrètement ou secrètement court-circuiter les mécanismes d’oppressions et d’exploitation ?
Dénètem Touam Bona – D’un côté, je soutiens les luttes légitimes pour avoir accès à la visibilité, quand on est balayeur chez Canal + par exemple, on n’existe pas. Cette demande de visibilité est légitime dans la mesure où elle correspond à une exigence de participation à l’espace public. Le problème, c’est quand cela devient une obsession, quand l’on n’interroge plus la structure même de la représentation qui peut être toxique. De tout temps, lorsque l’on met trop l’accent sur la visibilité, ce qui prend le pas sur des combats réels, c’est la promotion de sa propre posture et de ses propres intérêts.
Personne n’échappe à ces tentations. L’exigence de visibilité est légitime mais portée à un certain point elle devient toxique. On n’a jamais été dans une société aussi narcissique, la société du spectacle et du contrôle vont ensemble.
Il n’y a pas de solution a priori. Il y a toujours un équilibre à trouver entre différentes stratégies. Je ne suis pas l’activiste ou le militant type. Je fais ce que je peux en écrivant, en participant à des projets de création. Je pense qu’on va vers des périodes où il va falloir ré-apprendre à agir de façon dissidente, furtive, subversive sans le décréter ou le déclamer. On va vers des périodes sombres. On ne peut pas attendre que cela arrive, il y a des choses que l’on peut déjà faire dans le clair-obscur, au niveau de l’intime, de l’action politique ou militante. Il faut réhabiliter cette modalité mineure.
On ne retient par exemple de la chute du mur de Berlin que le moment de sa chute. Alors que ce qui l’a rendu possible, c’est un temps énorme, nourri d’une multitude de de micro-actions, de gestes mineurs pour faire trembler, fissurer l’ordre dominant.
C’est important de prendre une Bastille, d’abattre un mur, de déboulonner une statue, mais si on ne se focalise que sur ça, on oublie toute une écologie de codes, de pratiques, de gestes mineurs qui introduisent une variation dans l’ordre et qui vont rendre possible l’insurrection, voire une révolution.
Pour écouter ou lire Dénètem Touam Bona :
Illustration, « La sagesse des lianes », exposition sur l’Île de Vassivière
[1] La Sagesse des lianes, Post-éditions, 2021, p.73