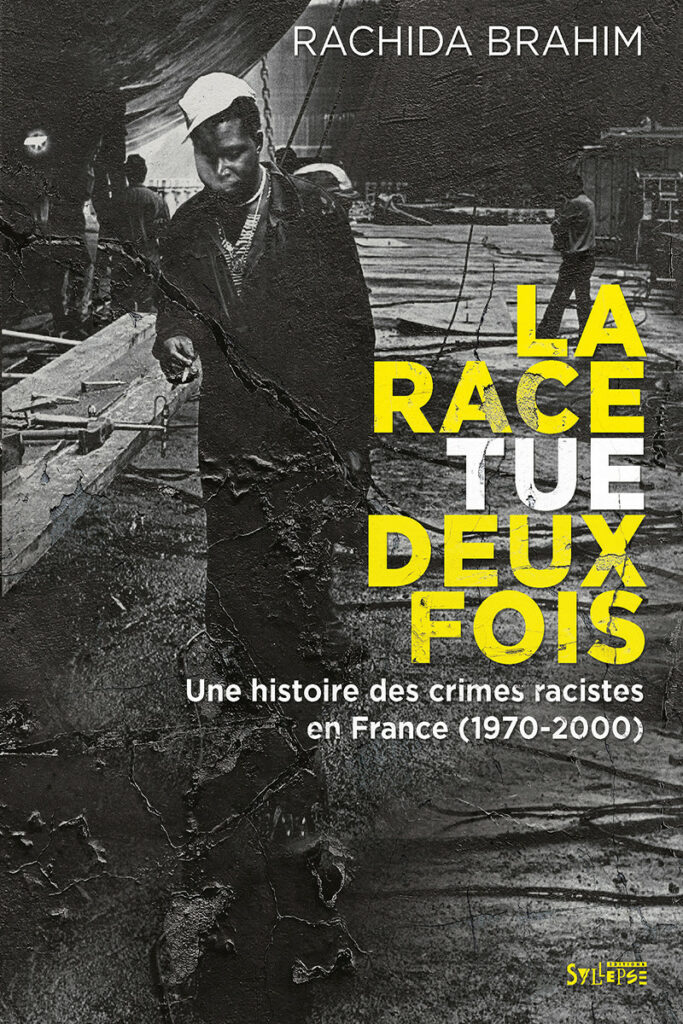
Dans son livre La race tue deux fois (éd. Syllepse), Rachida Brahim étudie des centaines de cas de crimes racistes, des années 1970 aux années 2000, montrant notamment comment leur dimension raciale a généralement été dissimulée par les institutions.
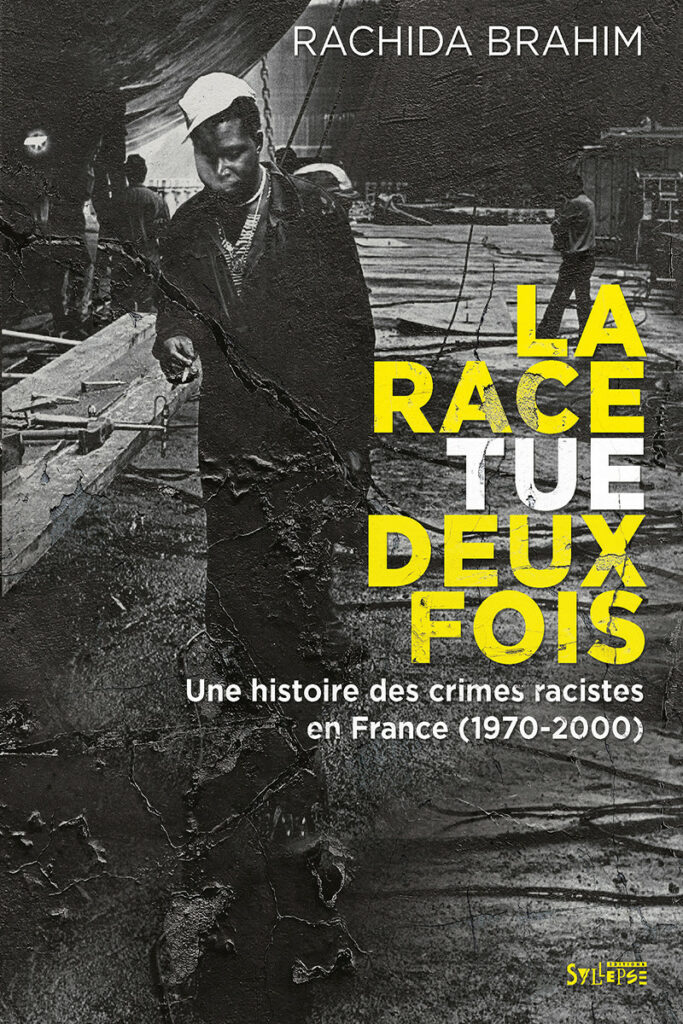
Les violences prenant pour cible des Algériens ont été déracialisées grâce à une réécriture des faits tendant à dissimuler les mobiles racistes. Cette opération s’observe à l’échelle préfectorale à travers l’action des fonctionnaires de police et des préfets. Elle est également perceptible à l’échelle ministérielle à travers les échanges entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’intérieur. Des listes de crimes et agressions sont envoyées par l’ambassade d’Algérie à Paris au ministère des affaires étrangères et au ministère de l’intérieur. Dès 1971, au sein de la Direction de la réglementation, le sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontière, Maurice Cantan, répertorie les plaintes transmises, recueille des informations auprès des différentes préfectures et anticipe les prochaines requêtes de l’ambassade en demandant aux préfets de lui adresser « un rapport pour tout incident concernant des Algériens[1] ». Des instructions précises sont par ailleurs envoyées aux services départementaux de police pour être en mesure de répondre aux « accusations de racisme et de laxisme » portées par l’État algérien. Une note de service, rédigée au mois de janvier 1974, demande aux directions départementales des polices urbaines (DDPU) d’établir et d’envoyer à la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP), une « fiche spéciale » pour chaque acte de violence commis à l’encontre de « Nord-Africains[2] ». La note insiste sur la nécessité de spécifier si l’auteur des faits a été arrêté et si le corps de la victime, dans les cas des homicides, a pu être identifié. Il est par ailleurs demandé aux agents de la DDPU de stipuler « dans la mesure du possible, compte tenu de l’état de l’affaire, le mobile apparent en indiquant s’il est ou non de caractère racial ».
Dans les fiches spéciales auxquelles j’ai pu accéder, cette mention ne repose sur aucun élément concret. L’agent qui rédige le document en question au sein des DDPU commente des faits qu’il n’a pas directement traités, mais qui ont été centralisés grâce aux télégrammes envoyés par les services de police qui maillent le territoire. L’indication quant au mobile de l’infraction ne dépend pas des résultats d’une enquête qu’il aurait menée, mais de la teneur du peu d’éléments qui lui sont transmis. À de nombreuses reprises, les policiers se prononcent sur ce point en inscrivant : « Caractère racial non établi. » Par ces termes, ils ne décrètent pas l’absence de racisme, mais indiquent surtout que celui-ci n’a pas été mis en évidence. Dans les rapports préfectoraux ou les comptes rendus d’enquêtes, les mobiles sont étayés avec plus de précision, on constate dans ce cas que le mobile raciste est régulièrement écarté au profit de considérations plus ordinaires. L’auteur des faits aurait été motivé par la volonté de régler un différend ou aurait agi en état d’ivresse. On relève alors des raisonnements illogiques, des formulations hypothétiques, des argumentaires légers ou absents, ou encore un certain écart entre les faits établis et les mobiles invoqués. À titre d’exemples, voici quelques-unes des explications avancées.
En juin 1973, le préfet de Haute-Garonne est amené à se prononcer sur une affaire au cours de laquelle des hommes à bord d’une voiture ont ouvert le feu sur un groupe de ressortissants algériens, blessant l’un d’entre eux. Le rapport indique que la voiture en question était immatriculée dans le Loiret, cet élément est, d’après lui, suffisant, « il tend à faire croire qu’il s’agit d’un règlement de comptes et non d’un attentat de caractère raciste perpétré par des éléments locaux[3] ». Après l’agression à l’arme blanche de trois Maghrébins à Saint-Maur-des-Fossés au mois d’août 1975, le commissaire de police met en cause quatre individus et indique que le différend a commencé à l’intérieur d’un bar. L’auteur des coups de couteau a pris la fuite. Le commissaire soutient que « le mobile du crime n’est pas encore déterminé avec précision, mais qu’il est permis d’affirmer qu’il ne s’agit absolument pas d’une affaire de racisme [4] ».
Les violences visant des Marocains à Frontignan durant l’été 1973 font l’objet d’un traitement similaire. Interrogé par la Direction de la réglementation sur les faits consignés par les ambassades marocaine et algérienne, le préfet de l’Hérault signale que la justice suit son cours et joint à sa lettre le rapport du commissaire responsable de l’enquête. La reconstitution des faits a révélé que durant le bal du 14 Juillet, un « Nord-Africain », qui n’a pas été retrouvé, aurait eu un geste déplacé envers une femme. Une bagarre a alors éclaté entre trois amis de son conjoint et des « Nord-Africains ». Les trois amis en question ont également porté des coups à un Maghrébin qui passait à proximité. Le lendemain, ils agressent à nouveau plusieurs Maghrébins étrangers à l’affaire du bal. L’un d’entre eux est attaqué sur une place publique et trouve refuge dans un bar. Au bord du canal qui traverse la ville, trois autres sont frappés à coups de poing et de ceinturon, deux d’entre eux sont jetés à l’eau. Le commissaire ne commente pas les expéditions punitives qui relèvent d’un racisme assumé d’après les témoignages des victimes. Il évoque une « simple affaire de violences et de coups et blessures comme on en rencontre très fréquemment dans les bals publics » et conclut en soulignant la responsabilité des plaignants eux-mêmes :
Contrairement à ce que veut laisser croire le consul, les Algériens ne sont pas systématiquement victimes de violences ou d’un racisme déplacé. Au contraire, ce sont souvent ces étrangers qui ont une attitude et une conduite inadmissibles[5].
La brigade de Frontignan relevant de la Gendarmerie nationale dirige pour sa part l’enquête sur les expéditions menées deux mois plus tard, le 9 septembre 1973, contre deux « baraquements » dans lesquels résident des Maghrébins. L’agression a été perpétrée par deux hommes qui, armés et se faisant passer pour des policiers, ont fait sortir de leur logement, regroupé et mis en joue dix ressortissants marocains en leur ordonnant de quitter le pays. Au moment où certains ont tenté de s’enfuir, « des coups de feu causant des blessures légères » ont été tirés. Dans leurs témoignages, les victimes relatent l’incompréhension et la peur intense qui les a saisis. Toutes déclarent n’avoir aucun ennemi. Certaines rapportent les menaces et les propos suivants : « Personne ne bouge ou ne parle, car sinon on tire ! », « Maintenant, il faut que vous partiez dans votre pays ! », « Vous allez ramasser vos affaires et prendre le bateau ! Autrement… » À la question du gendarme concernant l’état d’ivresse des agresseurs, l’une des victimes répond : « Je n’ai pas remarqué si mes agresseurs étaient pris de boisson[6]. » Quel que soit l’état d’ébriété des contrevenants, ces faits qui semblent également motivés par le racisme à l’encontre d’un groupe précis sont néanmoins suivis de cette conclusion :
La colonie nord-africaine est bien acceptée par l’ensemble de la population et n’a jamais posé de problèmes. Il semble que l’agression dont ont été victimes les ressortissants marocains en cause soit l’œuvre d’individus ayant agi après la sortie des cafés et probablement sous l’emprise de la boisson. Les hypothèses d’un acte de vengeance, de jalousie ou d’affaires de racisme semblent pouvoir être totalement exclues.
L’interprétation des faits imputés à des Niçois en décembre 1975 soulève également des questions quant au regard que portent les autorités sur ce type d’actes. Le 6 décembre, le SRPJ écrit au sous-directeur de la réglementation pour l’informer de l’arrestation de six individus auteurs de plusieurs expéditions contre des ressortissants tunisiens et algériens. Pour faire suite aux renseignements supplémentaires demandés par Maurice Cantan, le directeur central de la police judiciaire précise que les contrevenants ont avoué avoir commis quinze agressions contre des Nord-Africains entre le milieu de l’année 1974 et novembre 1975, qu’ils « agissaient à mains nues, mais aussi parfois avec des bâtons, des chaînes, des bouteilles ou des pierres ». Il estime pourtant « qu’il s’agit de jeunes voyous n’appartenant à aucune formation politique. Leur mobile ne paraît pas être véritablement raciste, mais est constitué par la recherche de la violence[7] ». Dans la logique du directeur du SRPJ, il semble que le racisme ne peut être un mobile que lorsque celui-ci relève d’une idéologie d’extrême droite à laquelle les contrevenants adhèrent officiellement. Dans le cas contraire, les violences régulièrement et spécifiquement dirigées envers des Maghrébins, comme dans le cas ci-dessus, peuvent être comprises comme un « besoin » pour les agresseurs « d’exprimer leur agressivité ».
À travers les documents étudiés sur l’ensemble de la décennie, une conviction partagée semble se dégager : les violences envers les Maghrébins ne relèvent pas d’un mobile raciste parce qu’il n’y a pas de racisme en France, et dans le cas contraire, s’il y avait effectivement du racisme en France, les Maghrébins eux-mêmes en seraient responsables. Autrement dit, s’ils sont détestés, c’est qu’ils sont détestables.
La manière dont les autorités ont analysé les violences qui ont traversé la région marseillaise en 1973 éclaire plus précisément ce raisonnement. Alors que les agressions se multiplient après le meurtre du chauffeur, la campagne antiraciste menée par le MTA et les organisations d’extrême gauche rencontre une forte résonance médiatique. Les militants dénoncent les crimes, mais également l’indifférence dont feraient preuve les autorités françaises. Pour contrecarrer ces théories, le 25 septembre, le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin, rend publics les résultats d’un rapport sur « la criminalité immigrée[8] ». Il indique le nombre d’affaires impliquant des « Nord-Africains » qui ont été recensées et résolues entre le 1er janvier et le 20 septembre 1973. À partir des données statistiques établies par ses services, en ce qui concerne les violences dont les « Nord-Africains » sont victimes, il précise que les mobiles restent majoritairement ceux du règlement de comptes, de l’ivresse ou du crime crapuleux. Raymond Marcellin déclare par conséquent qu’il est « manifestement faux de dire qu’il existe un état d’esprit raciste généralisé en France ». Lors d’une conférence de presse, Georges Pompidou confirme cette idée en s’exprimant en ces termes sur le sujet :
« Nous exécrons le racisme, la France est profondément antiraciste […]. Un bruit inconsidéré a été fait autour des attentats entre Algériens et Européens. » Tout en niant le racisme, ce dernier s’en tient à une interprétation culturaliste et précise que s’il existe un problème, il tient davantage au fait que « les travailleurs immigrés sont exagérément concentrés dans quelques localités, ce qui entraîne des difficultés en raison même des différences de mode de vie[9] ».
À l’échelle locale, lors d’une séance de travail sur « les problèmes de l’immigration » qui se tient à la préfecture des Bouches-du-Rhône, un représentant de la préfecture de police et le commissaire central des services de police du département s’accordent pour dire « qu’aucun des crimes commis ne pouvait être imputé à un groupement organisé quelconque qui l’aurait fait commettre sous une action délibérée du racisme[10] ». En décembre, après l’explosion qui a lieu au consulat général d’Algérie, la presse marseillaise relate les propos du préfet de police qui affirme dans la même lignée « qu’il ne s’agit pas d’un attentat raciste ». Dans le rapport annuel sur l’activité judiciaire qu’il rédige à la fin de l’année à l’intention de son ministère de tutelle, le commissaire central adjoint, chef de la Sûreté urbaine, s’exprime quant à lui plus longuement sur les faits qui ont marqué l’actualité[11]. Le titre qu’il donne au chapitre consacré à ces évènements résume la problématique qui traverse le traitement de ces violences durant les années 1970 et que l’on retrouvera durant les décennies suivantes : « Les règlements de comptes d’août et septembre : racisme ou droit commun ? » La réponse qu’il apporte est ambivalente et témoigne à nouveau de cette volonté exprimée à différentes échelles de l’État de maintenir les crimes racistes dans la sphère du droit commun. Dans un premier temps, pour expliquer les difficultés rencontrées par ces services, il met en cause la spécificité de ces affaires. Ce faisant, il admet indirectement qu’elles ne relèvent pas du droit commun :
La police judiciaire n’a pas pu faire appel dans ces espèces d’un type tout à fait nouveau ni son expérience, ni à sa documentation générale, ni à ses fichiers spécialisés, ni davantage à ses informateurs habituels des milieux de droit commun. Il aurait fallu une connaissance profonde des milieux en cause, de leur motivation, de leur organisation, de leur responsable, de leur politique. La sûreté urbaine de Marseille confrontée pour la première fois à des problèmes dont elle ignorait tout ne disposait pas de ces éléments.
Il reconnaît également la motivation raciste en mentionnant le cas « d’accrochages comme il s’en produit souvent à Marseille, qui dans un autre contexte n’auraient pas eu de suites fatales, mais qui ont dégénéré parce que le réflexe de race a pu agir comme révélateur, comme fixateur d’intentions diffuses, de passages à l’acte qui ne se seraient peut-être pas exprimés sans lui ». Plus loin, pourtant, il réaffirme l’ancrage de ces violences dans le droit commun et les violences ordinaires en stipulant que « si des violences à caractère racial ont été exercées dans certains cas très limités, et personne ici n’en a jamais disconvenu, on peut tenir pour certain que des règlements de comptes de droit commun se sont commis sous le couvert de la flambée ambiante de xénophobie ».
Le bilan qu’il adresse à l’attention du consul général d’Algérie à Marseille montre la préférence accordée à cette deuxième interprétation. Sur sept affaires qui ont lieu après le meurtre du chauffeur marseillais et pour lesquelles le représentant de l’État algérien demandait des détails, le commissaire déclare que pour une seule d’entre elles « il est assez vraisemblable qu’on se trouve effectivement devant une vengeance raciale ». Dans ce cas précis, le corps de la victime a été retrouvé quelques heures après la mort du traminot, près du dépôt de bus appartenant à la compagnie pour laquelle il travaillait. En ce qui concerne les six affaires restantes, le commissaire conclut à des « querelles de droit commun » ou à des règlements de comptes qui ont surtout lieu entre « Nord-Africains[12] ».
Dans le rapport annuel sur l’activité judiciaire, le commissaire finit par dépasser cette tension entre violences spécifiques et violences de droit commun en livrant sa propre analyse sur l’origine de la violence. On retrouve ici la figure stigmatique de l’homme arabe. Le vrai problème réside, d’après lui, dans la présence même des migrants maghrébins. La solution quant à elle ne saurait être apportée par « la seule action préventive et répressive de la police » envers ceux qui se livreraient à des exactions motivées par le racisme. En d’autres termes, le chef de la Sûreté urbaine suggère une fermeture des frontières à l’immigration maghrébine.
L’histoire à Marseille va dans le sens d’une ségrégation de plus en plus nette de la colonie nord-africaine inassimilée et inassimilable qui vit chaque jour davantage en milieu fermé, en économie interne de groupe, repliée sur elle-même, donnant naissance dans le tissu qui la compose à un courant communautaire et confraternel de compensation très forte.
[…] Pourra-t-on fermer les yeux longtemps sur le départ des locataires français devant les musulmans dans certains immeubles, des enfants français devant les jeunes arabes dans certaines classes, de la clientèle française devant les clients étrangers dans certains cafés, certains hôtels, certains commerces ? Peut-on penser sérieusement en fin de compte que le calme reviendra, que l’horizon s’éclaircira si enfin la vindicte populaire peut s’exprimer sur le nom de criminels racistes identifiés et convaincus ? Si on ne le pense pas, on fait tout comme[13].
À l’échelle ministérielle, les échanges entre les services du ministère des affaires étrangères et ceux de la Direction de la réglementation témoignent pour leur part d’une pratique courante au cours de la décennie. Quand l’opération n’a pas déjà été réalisée à l’échelle des commissariats ou des préfectures, celle-ci consiste à réécrire les faits provenant des différents départements de manière à dissimuler les éléments qui attesteraient d’un mobile raciste. L’action est particulièrement visible dans le cas des violences imputées à des agents de police. Au sein des rapports mettant en scène des Maghrébins, un certain nombre de qualificatifs reviennent régulièrement. L’homme arabe est souvent un homme fou ou ivre. Il est « malade des nerfs », a les « intestins fragiles comme tous les Nord-Africains » et pratique l’automutilation. Il se blesse seul pendant les gardes à vue ou présentait déjà, avant son arrivée au poste, des ecchymoses sur le corps. Lorsqu’ils dénoncent des violences, on estime « qu’ils abusent de la confiance de leurs consuls » ou qu’ils se livrent « des explications fantaisistes ».
Par exemple, certains des faits qui ont conduit à la mort de Mohamed Diab ont en partie été occultés. À Paris, en novembre 1972, le ressortissant algérien avait été inculpé pour violence et outrage public à la pudeur. D’après les policiers, arrivé au poste, il aurait frappé des agents, l’un d’entre eux a déclaré lui avoir tiré dessus en état de légitime défense. La sœur et la femme de Mohamed Diab ont quant à elles évoqué des propos racistes et une exécution sommaire. Tout en validant la thèse de la légitime défense, l’enquête administrative a néanmoins souligné les erreurs commises par le sous-brigadier auteur des coups de feu. Parmi elles : la radicalité de la solution employée pour maîtriser « le forcené », l’aide qu’auraient pu apporter les six fonctionnaires au moins qui étaient présents, le fait que le sous-brigadier ne portait pas son arme de service qui aurait causé moins de dommages que le pistolet-mitrailleur dont il s’est emparé[14]. Lorsqu’il est amené à répondre aux demandes de renseignements formulées par le ministère des affaires étrangères qui fait lui-même suite à une requête de l’ambassade d’Algérie, le directeur de la réglementation indique qu’une enquête administrative a été effectuée. Cela étant, il n’en mentionne pas les résultats et s’en tient à la version du sous-brigadier. Ce faisant, il le place en position de victime effectivement en état de légitime défense. Il déclare par ailleurs que seuls trois fonctionnaires étaient présents et ne dit rien des erreurs relevées ni des témoignages contradictoires apportés par les membres de la famille[15].
Cette pratique semble s’effectuer d’un commun accord entre les ministères de l’intérieur et des affaires étrangères. Le 7 juin 1977, le consul général de Charleville-Mézières écrit au préfet de l’Aisne pour « exprimer son indignation » et s’enquérir des mesures qui seront prises à l’encontre de trois fonctionnaires de police qui ont violenté un ressortissant algérien, lors d’une garde à vue, dans la nuit du 30 mai. Ce dernier aurait été libéré avec « une plaie ouverte au crâne, des contusions multiples au visage, ainsi qu’une forte marque de strangulation[16] ». Le préfet sollicite la Direction de la réglementation pour connaître la marche à suivre. Le directeur de la réglementation écrit pour sa part au ministère des affaires étrangères. Il lui adresse une copie du rapport de police, commente les faits en déclarant « qu’un ressortissant algérien a abusé de la bonne foi de son représentant consulaire » et lui demande à son tour quelles sont ses instructions. Le rapport de police explique que le ressortissant algérien a été arrêté en état d’ivresse sur la voie publique. Pour leur part, les agents de service déclarent avoir remarqué une légère plaie saignante sur le crâne du prévenu dès son interpellation et affirment qu’alors qu’il était en cellule, « le prévenu s’est blessé volontairement en donnant plusieurs coups de tête sur le coin d’un banc en béton. De ce fait, il a agrandi volontairement la plaie qu’il portait au cuir chevelu ». Aucun élément n’est apporté sur les contusions et les traces de strangulation[17].
Compte tenu de ces divers éléments, le ministère des affaires étrangères estime qu’il convient de rester évasif et de minimiser l’affaire[18]. Il rédige les consignes suivantes :
J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’il ne m’apparaît pas souhaitable de répondre aux autorités algériennes par la voie diplomatique. Je crains en effet que l’on ne donne ainsi à cette affaire une importance qu’elle n’a pas. Aussi, à mon avis, serait-il de beaucoup préférable qu’elle reste sur le plan local. Si vous partagez ce point de vue, je suggérerais que le préfet convoque le consul et lui donne de vive voix les explications qu’appellent les démarches de ce chef de poste consulaire. Dans l’éventualité où ce dernier insisterait pour avoir une réponse écrite, il n’y aurait aucun inconvénient à ce que le préfet lui donne satisfaction sur ce point, mais sous une forme assez imprécise et prêtant aussi peu que possible à controverse.
Pour sa part, bien qu’il ait manifestement conscience des violences illégitimes exercées par les forces de l’ordre, le sous-directeur de la réglementation, Maurice Cantan, prend invariablement le parti des policiers incriminés. Le 16 avril 1974, sur un ton ironique, il annote à la main un dossier concernant une violence policière à l’intention de son supérieur, Guy Fougier[19] :
Monsieur le directeur, à Paris comme à Lyon, ces Algériens une fois arrêtés sont bien maladroits, pris de crise de nerfs dans les locaux de police, ils se heurtent au mobilier… Ce qui leur occasionne des hématomes d’un rond parfait autour des yeux… Cependant, dans le cas présent, étant donné qu’il y a une instance judiciaire pour coups à agent je pense que l’on peut envoyer cette lettre au ministère des affaires étrangères[20].
Les deux affaires auxquelles fait référence Maurice Cantan mettent en scène des policiers qui ont répondu aux plaintes à leur encontre en expliquant que les Algériens interpellés se sont blessés seuls. L’affaire parisienne a lieu en 1974. Le 23 janvier, M. Lounis, premier conseiller à l’ambassade d’Algérie à Paris, demande un rendez-vous en urgence à Maurice Cantan. Il est venu accompagner d’un homme « pour faire constater l’état dans lequel cet Algérien se trouvait quinze jours après son interpellation. J’ai pu constater que ses yeux étaient entièrement injectés de sang et qu’il portait au-dessus et en dessous de ses yeux de gros hématomes ». L’Algérien affirme qu’au commissariat, les policiers ont voulu lui passer une camisole de force, qu’ils l’ont frappé à coups de poing et de pied, qu’il a craché du sang, qu’ils l’ont tenu par la gorge, qu’il manquait de s’étouffer et que les gardiens ont continué. Les fonctionnaires soutiennent pour leur part qu’il a fait une crise nerveuse, qu’il s’est blessé en se cognant contre des meubles et qu’ils ont eux-mêmes porté plainte pour coups à agent[21].
L’affaire lyonnaise s’est produite quelques semaines auparavant, en novembre 1973. L’ambassade d’Algérie avait alors demandé qu’une enquête soit menée pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles deux ressortissants qui présentaient de multiples traces de coups avaient été violentés au poste de police de la gare de Lyon-Perrache. Une enquête a bien été effectuée par l’IGPN. Le rapport est rédigé sur un ton assez familier[22]. L’inspecteur relate son entretien avec les deux Algériens. Il s’emploie d’abord à les décrire. Le premier est né en 1951, il est représenté comme « un homme de taille moyenne », « de constitution apparente frêle », « à l’air sombre, nerveux et émotif », « il comprend très bien le français et le parle avec aisance, il a de la dialectique ». Le second est né en 1946, l’inspecteur écrit « qu’il a le visage d’un Peau-Rouge et la chevelure d’un papou. Il a une mine rebondie et un aspect calme et jovial. Il déclare ne pas savoir notre langue, mais on ne saurait s’y fier. Ce qui est certain, c’est qu’il sait écouter en silence, mais sa maîtrise ne va pas jusqu’à se taire. Lorsque des propos le choquent, on voit qu’il a compris alors jusqu’aux nuances ». D’après leurs témoignages, quatre policiers étaient présents au poste cette nuit-là, tous parlaient l’arabe. Alors qu’ils étaient venus signaler la perte d’une montre, un agent leur aurait conseillé « d’aller faire ça chez leur Boumédiène », après quoi les deux hommes auraient été retenus, humiliés et frappés pendant six heures. L’inspecteur rapporte également la version des policiers. Il accrédite leurs propos en présentant les Algériens comme des individus « surexcités et gesticulants », « postillonnant aux visages » des fonctionnaires, « fumant des cigarettes », « parlant en arabe, ce qui leur était interdit de faire », « sans doute ivres », « provoquants », « impossibles à canaliser et refusant de répondre aux questions qui leur étaient posées ». D’après lui, ces derniers ne seraient pas restés au commissariat plus de vingt ou trente minutes. Les traces de coups sur l’un des deux hommes sont expliquées ainsi :
Le gardien prend l’Algérien par le revers de la veste, le secoue un peu pour l’obliger à rester en place et à l’écouter. Cet Algérien, au reste, pique une sorte de crise nerveuse, devient hilare, se cogne la tête contre les panneaux SNCF accrochés au mur. Il s’appuie contre la porte du bureau du chef de poste ; celle-ci n’était pas fermée, il tombe à la renverse et se débat au sol, cogne dans le mur, dans les meubles. Le gardien craignant qu’il ne se fasse du mal, se précipite, le relève et l’Algérien finit par se calmer.
L’inspecteur note et décrédibilise par ailleurs les déclarations du seul témoin présent, un vagabond qui était en garde à vue. Il aurait évoqué « une gifle assez violente » tandis que le policier concerné « suggère qu’il a pu être induit en erreur et avoir cru qu’il le frappait alors qu’en fait il s’était borné à palper les blessures de l’Algérien ». L’inspecteur fait enfin observer que les fonctionnaires alors en poste « ont la pratique des Nord-Africains. Entre le 1er janvier et le 21 novembre 1973, ils ont eu affaire à 855 d’entre eux et aucun ne s’est plaint alors même qu’il n’ait pas été rare que leur interpellation ait été mouvementée ». La Direction de la réglementation transmet ces explications en précisant que « les témoignages recueillis, notamment celui d’un vagabond amené au poste de police peu de temps auparavant, ne font pas état de sévices de la part des policiers, mais d’une certaine confusion due à l’état de surexcitation des deux Algériens[23] ».
[1] Note sur la campagne contre le racisme, Paris, 8 juin 1971. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[2] Note de service : violences concernant les Nord-Africains, fiche spéciale, Direction centrale de la sécurité publique, DGPN, Paris, 10 janvier 1974. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[3] Télégramme envoyé par la Direction des affaires politiques d’Afrique du nord et du Levant du ministère des affaires étrangères à l’ambassade de France à Alger, Paris, 26 juin 1973. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/13.
[4] Compte rendu d’enquête envoyé par le commissaire de police de Créteil à la DDPU du Val-de-Marne, Créteil, 9 décembre 1975. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[5] Compte rendu d’enquête envoyé par le commissaire central, chef de la circonscription de police de Sète-Frontignan, au préfet de région, Sète, 22 août 1973. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[6] Procès-verbal d’enquête préliminaire, compagnie de Sète, brigade de Frontignan, gendarmerie nationale, 10 septembre 1973. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[7] Note du directeur central de la Police judiciaire pour le directeur de la réglementation et du contentieux, Paris, 19 décembre 1975. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[8] « “Il n’y a pas en France d’esprit raciste généralisé” d’après un communiqué de ministère de l’intérieur », Le Provençal, 25 septembre 1973.
[9] « La conférence de presse de Georges Pompidou », Le Provençal, 28 septembre 1973.
[10] Note sur les problèmes de l’immigration dans les Bouches-du-Rhône, Paris, 9 novembre 1973. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[11] Rapport annuel sur l’activité judiciaire à destination de la Direction centrale de la sécurité publique, DGPN, Marseille, décembre 1973. Cabinet du préfet, préfecture des Bouches-du-Rhône, archives départementales des Bouches-du-Rhône, 135W341.
[12] Lettre du commissaire central adjoint, chef de la Sûreté urbaine au consul général d’Algérie, Marseille, 7 septembre 1973. Cabinet du préfet, préfecture des Bouches-du-Rhône, archives départementales des Bouches-du-Rhône, 135W52.
[13] Rapport annuel sur l’activité judiciaire à destination de la Direction centrale de la Sécurité publique, DGPN, Marseille, décembre 1973, op.cit.
[14] Enquête administrative sur la mort d’un ressortissant algérien, Monsieur M. D., le 1er décembre 1972, adressé par le contrôleur général au directeur de l’IGPN, Paris, décembre 1972. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/13.
[15] Lettre du ministre de l’intérieur au ministre des affaires étrangères, direction des affaires politiques d’Afrique du Nord et du Levant, sous-direction de l’Algérie, Paris, 13 décembre 1972. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/13.
[16] Lettre du consul général de Charleville-Mézières au préfet de l’Aisne, Charleville-Mézières, 7 juin 1977. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[17] Rapport du commissaire central de Saint-Quentin au préfet de l’Aisne, Laon, 28 juin 1977. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[18] Lettre du ministre des affaires étrangères au ministre de l’intérieur, Paris, 10 août 1977. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[19] Guy Fougier est un ancien préfet de l’Algérie française. Entre 1971 et 1978, il est à la tête de la Direction de la réglementation.
[20] Note manuscrite à l’attention du directeur de la réglementation, dossier R358, affaire B. D., Paris, 16 avril 1974. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[21] Note de Maurice Cantan sur les sévices dont aurait été victime dans un commissariat de police un ressortissant algérien, Paris, 23 janvier 1974. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[22] Rapport de l’inspecteur général au directeur de l’IGPN, Paris, 7 décembre 1973. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.
[23] Lettre du ministre de l’intérieur au ministre des affaires étrangères, Paris, 1er mars 1974. Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, DLPAJ, ministère de l’intérieur, archives nationales, 19960134/14.