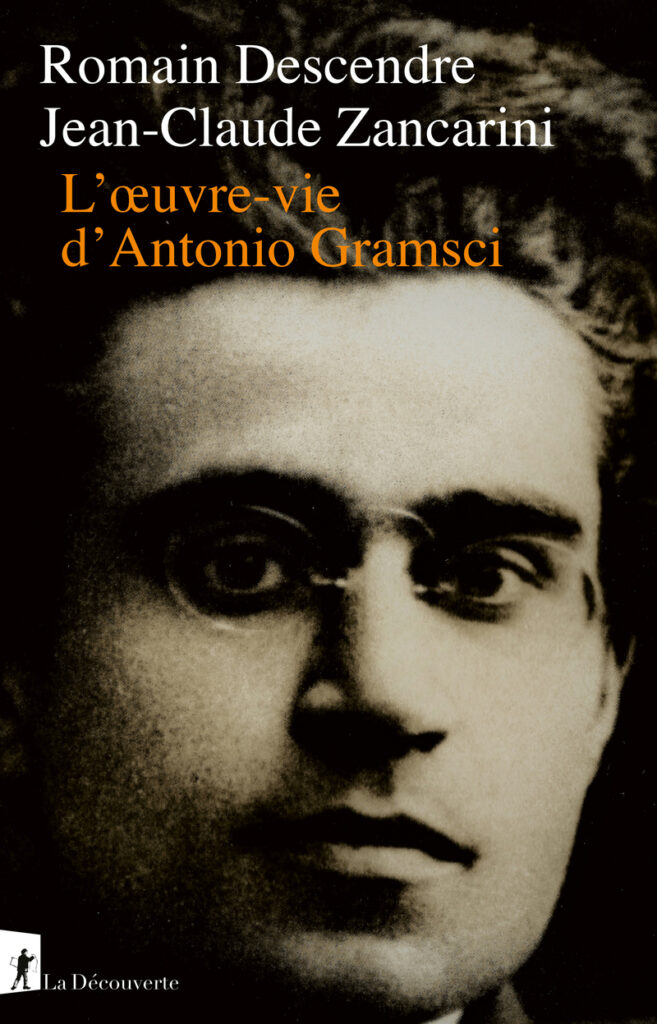
Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini viennent de publier aux éditions la Découverte un livre appelé à faire date sur Antonio Gramsci. Alors que son nom fait l’objet régulièrement de tentatives d’appropriation venant de tous les secteurs du champ politique, y compris l’extrême droite, ce livre propose une lecture extrêmement précise et riche de ce que les auteurs nomment « l’œuvre-vie » de Gramsci, tant on ne peut séparer chez lui la vie du dirigeant communiste et l’œuvre du théoricien marxiste.
Dans cet extrait du chapitre 21, les auteurs reviennent sur l’élaboration du concept de « guerre de position », sa signification théorico-politique et la manière dont il l’amènera à « repenser l’État, le rôle des intellectuels dans la société civile et à faire évoluer le concept d’hégémonie, bien au-delà de son énonciation comme ‘hégémonie du prolétariat' ».
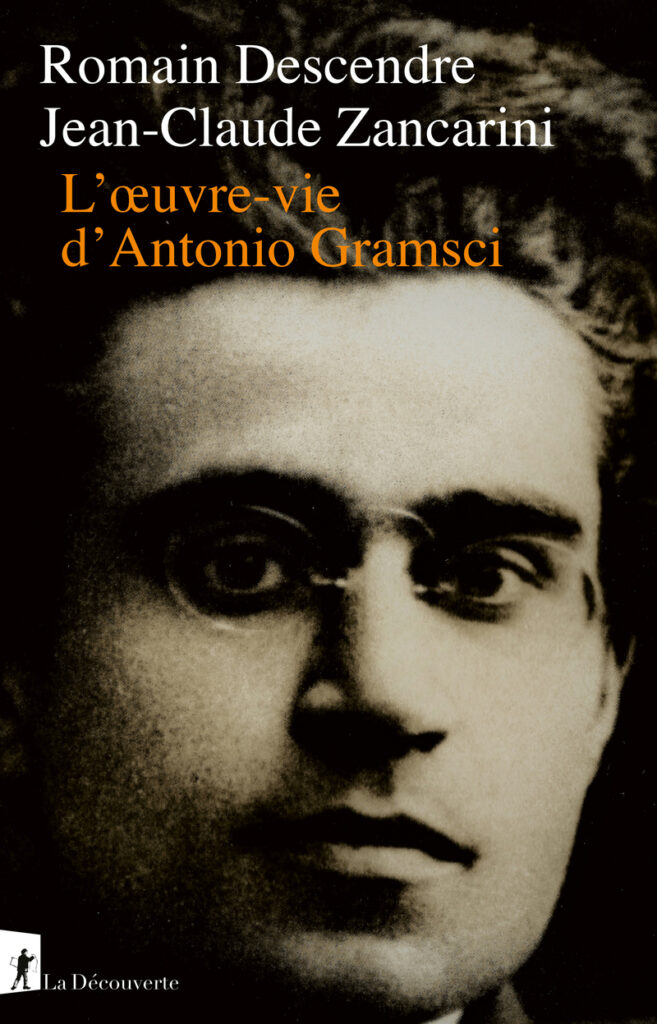
Le débat heurté sur la question de la Constituante et sur la ligne politique à suivre pour lutter contre le fascisme a des effets théoriques importants sur la réflexion de Gramsci. Durant les mois où le débat se déroule, Gramsci écrit des notes en lien avec son désaccord politique, qui tendent à définir une ligne alternative à celle du VIe congrès de l’Internationale appliquée par le parti italien.
L’aspect le plus notable est l’élaboration de la notion de « guerre de position » qui apparaît dans la deuxième série de ses Notes de philosophie, dans deux notes du cahier 7 écrites en novembre-décembre 1930, au moment-même du débat sur la Constituante. La « guerre de position » s’oppose à l’idée de « guerre de mouvement » (ou « guerre de manœuvre ») : Gramsci estime qu’il ne faut plus envisager la révolution comme insurrection généralisée et passage immédiat à la dictature du prolétariat ; la guerre de mouvement, qui a permis la prise du pouvoir par les bolcheviks en 1917, ne permettrait plus d’obtenir la victoire.
Dans l’une des notes de la rubrique « Structure et superstructure », Gramsci réfléchit à la traduction politique du « passage de la guerre de mouvement à la guerre de position »[1]. Il considère que « le petit livre » de Rosa Luxemburg, Grève de masse, parti et syndicat (1906), fondé sur l’analyse des événements de 1905 en Russie, est emblématique « de la théorie de la guerre de manœuvre appliquée à la science historique et à l’art politique » :
L’élément économique immédiat (crise, etc.) est considéré comme l’artillerie de campagne dans la guerre, dont la fonction était d’ouvrir une brèche dans la défense ennemie, suffisante pour que nos propres troupes y fassent irruption et obtiennent un succès stratégique définitif ou du moins dans la direction nécessaire au succès définitif. Naturellement, dans la science historique, l’efficacité de l’élément économique immédiat était bien plus complexe que celle qu’avait l’artillerie de campagne dans la guerre de manœuvre, parce qu’il était conçu comme ayant un double effet : 1) d’ouvrir la brèche dans la défense ennemie après avoir décomposé et fait perdre à l’ennemi lui-même sa confiance en soi, en ses forces et en son propre avenir ; 2) d’organiser en un éclair ses propres troupes, de créer les cadres, ou au moins de placer en un éclair les cadres existants (élaborés jusque-là par le processus historique général) à leur poste d’encadrement des troupes disséminées ; de créer en un éclair la concentration de l’idéologie et des fins à atteindre. C’était une forme de déterminisme économique rigide, avec cette circonstance aggravante que ses effets étaient conçus comme très rapides dans le temps et dans l’espace : c’était donc un pur et simple mysticisme historique, l’attente d’une sorte de fulguration miraculeuse.[2]
Gramsci poursuit sa réflexion et estime qu’il faut prendre acte du passage, au cours de la dernière guerre, « de la guerre de manœuvre à la guerre de position ». Dans cette séquence historique, « la guerre de position n’est pas en effet seulement constituée par les tranchées pures et simples, mais par tout le système organisationnel et industriel de l’armée déployée […] ». Cela ne signifie pas que la guerre de manœuvre et les tactiques offensives n’existent plus mais que leur rôle a changé :
Il faut considérer qu’elles sont réduites à une fonction tactique plus qu’à une fonction stratégique […]. Cette même réduction doit advenir dans l’art et la science de la politique, au moins pour ce qui concerne les États les plus avancés où la « société civile » est devenue une structure très complexe et résistante aux « irruptions » catastrophiques de l’élément économique immédiat (crise, dépressions, etc.) : les superstructures de la société civile sont comme le système des tranchées dans la guerre moderne[3].
Gramsci compare plus avant la guerre de position dans la guerre moderne et dans la politique révolutionnaire et remet en cause la thèse défendue par Rosa Luxemburg. Une « attaque furibonde d’artillerie contre les tranchées ennemies » ne détruit en réalité que « la superficie de la défense », qui demeure efficace au moment de l’assaut des troupes :
Il en va de même dans la politique durant les grandes crises économiques, et les troupes qui attaquent ne s’organisent pas non plus en un éclair dans le temps et dans l’espace, par effet de la crise, pas plus qu’elles n’acquièrent un esprit combatif ; réciproquement, les défenseurs ne se démoralisent pas et n’abandonnent pas les défenses, fût-ce parmi les décombres, et ils ne perdent pas confiance dans leur propre force ni dans leur propre avenir. Ce n’est pas que les choses demeurent telles qu’elles sont : mais elles ne se déroulent pas en un éclair ni par une marche en avant définitive, comme s’y attendraient les stratèges du cadornisme politique[4].
Derrière la critique des thèses économistes de celle qu’il nomme affectueusement « la Rosa », il conteste les thèses du VIe congrès de l’Internationale communiste, qui voyait dans les prémices de la crise du capitalisme la certitude d’une offensive mondiale du prolétariat et de sa victoire. Le parti italien, faisant sienne cette thèse, prévoyait une victoire rapide sur le fascisme. Quand Gennaro avait laissé entendre qu’ils se reverraient bientôt libres, du fait de l’évolution internationale favorable à la révolution, Antonio lui avait répondu, on s’en souvient : « Je ne crois pas que la fin soit si proche. Je te dirai même que nous n’avons encore rien vu, le pire est à venir ». Gennaro n’avait pas su quoi répondre[5].
La scène se répète à Turi en décembre 1930, après le débat sur la Constituante, au moment de l’arrivée de Bruno Tosin. Antonio lui demande combien de camarades il y avait à Turin et dans la province pendant qu’il y menait son activité politique. Athos Lisa écrit dans ses Mémoires :
Tosin réfléchit un moment puis il répondit : « Peut-être une centaine ». Le visage de Gramsci se contracta, avec cette expression caractéristique qu’il prenait quand il devait exprimer un jugement sévère. Puis, sans préambule, il dit à Tosin, tout en le tenant par le bras dans un geste amical : « Et c’est avec ce nombre de communistes que vous vouliez faire la révolution ? »[6]. Bruno Tosin, comme Gennaro, ne put répliquer : « Je dois reconnaître, écrivit-il ultérieurement, que je ne pus répondre que par un silence embarrassé. »[7]
La critique est d’autant plus claire que Gramsci désigne les responsables de cette erreur d’appréciation : « les stratèges du cadornisme politique ». Le général Luigi Cadorna (1850-1928) fut le chef d’état- major de l’armée italienne à partir de 1914 ; partisan de l’attaque frontale contre les forces autrichiennes, il fut responsable de la déroute italienne de Caporetto en octobre-novembre 1917. Une note du cahier 2 (écrite en octobre-novembre 1930) ne laisse aucun doute sur ce que signifie le terme « cadornisme » :
« Cadorna [était] un bureaucrate de la stratégie ; quand il avait fait ses hypothèses “logiques”, il donnait tort à la réalité et se refusait à la prendre en considération »[8].
Les « stratèges du cadornisme politique » sont donc les bureaucrates de l’Internationale et du parti italien qui ont décidé le « tournant » et la ligne d’offensive générale du prolétariat…
D’autres notes écrites au même moment, dans la même deuxième série des Notes de philosophie (cahier 7 [b]), mais aussi dans le très politique cahier 6 commencé aussi en novembre-décembre 1930, montrent une cohérence de la réflexion théorique de Gramsci née de son désaccord avec le « tournant » politique du mouvement communiste : elles portent aussi bien sur la stratégie politique à suivre que sur la conception même de la philosophie[9]. On y trouve des indications sur la nécessité de « dire la vérité en politique » : « dans la politique de masse, dire la vérité est une nécessité politique, précisément »[10].
Quant aux effets d’une conception de la philosophie qui tend à importer dans la réflexion historique et politique la « loi des grands nombres » en l’étendant, des sciences naturelles, aux sciences historiques et politiques, elle risque de provoquer des « catastrophes, dont les pertes “sèches” ne pourront jamais être compensées »[11]. D’autant que « les représentants du nouvel ordre en gestation, par haine “rationaliste” envers ce qui est vieux, diffusent des utopies et des plans fantaisistes »[12]. La déviation « rationaliste », née d’une conception de la philosophie marxiste marquée par le positivisme et le matérialisme vulgaire, s’oppose à une vision historiciste et à une approche philologique de l’histoire.
Dans la note qui évoque les « catastrophes » que risque d’engendrer un matérialisme historique réduit à une « sociologie » marxiste, Gramsci oppose sa méthode historique et philologique à celle du marxisme orthodoxe en vigueur en URSS :
L’« expérience » du matérialisme historique est l’histoire même, l’étude des faits particuliers, la « philologie ». […] La « philologie » est l’expression méthodologique des faits particuliers compris comme « individualités » définies et précisées. À cette méthode s’oppose celle des « grands nombres » ou de la « statistique », empruntée aux sciences naturelles ou du moins à certaines d’entre elles.[13]
Le tableau d’ensemble est clair : sur la base d’un désaccord politique fondamental sur le « tournant » de l’IC et de son propre parti, Gramsci mène un travail théorique qui ne cessera de se préciser, en forgeant des outils conceptuels sur la stratégie et la politique et en pensant une « philosophie de la praxis » à substituer au matérialisme historique orthodoxe (voir le chapitre 23).
Revenons à la notion de « guerre de position » et à la fin de la note 10 du cahier 7. Gramsci y fixe un programme, qui s’adresse à l’évidence aux communistes : « Il s’agit donc d’étudier, en profondeur, quels sont les éléments de la société civile qui correspondent aux systèmes de défense dans la guerre de position »[14].
Gramsci y revient très peu de temps après, toujours dans la deuxième série des Notes de philosophie du cahier 7, dans « Guerre de position et guerre de manœuvre ou frontale »[15]. Il se demande si la théorie de Trotski sur la révolution permanente n’est pas liée à une confusion entre guerre de mouvement et guerre de position, confusion qui naît d’une erreur d’analyse sur le moment historique et les caractéristiques du pays où la guerre est menée.
La théorie de Trotski « sur la permanence du mouvement » pourrait bien être « le reflet politique de la théorie de la guerre de manœuvre […], en dernière analyse le reflet des conditions générales, économiques, culturelles, sociales d’un pays où les cadres de la vie nationale sont embryonnaires et relâchés et ne peuvent devenir “tranchées et forteresses” ». En reprenant la réflexion menée à propos de Rosa Luxemburg, Gramsci précise pourquoi, après la victoire de 1917 remportée par les bolcheviks à la suite d’une guerre de mouvement, on a désormais à faire à une guerre de position :
Il me semble qu’Ilitch [Lénine] avait compris qu’il fallait un changement de la guerre de manœuvre, appliquée victorieusement en Orient en 17, à la guerre de position qui était la seule possible en Occident où […], en peu de temps, les armées pouvaient accumuler des quantités illimitées de munitions, où les cadres sociaux étaient par eux-mêmes encore capables de devenir des tranchées très bien munies. C’est ce que me paraît signifier la formule du « front unique » qui correspond à la conception d’un seul front de l’Entente sous le commandement unique de Foch. Sauf qu’Ilitch n’a pas eu le temps d’approfondir sa formule, sans compter qu’il ne pouvait l’approfondir que théoriquement, alors que la tâche fondamentale était nationale, c’est-à-dire qu’elle demandait une reconnaissance du terrain et une fixation des éléments de tranchée et de forteresse représentées par les éléments de société civile, etc. En Orient, l’État était tout, la société civile était primitive et gélatineuse ; en Occident, entre État et société civile, il y avait un juste rapport et dans le vacillement de l’État on discernait aussitôt une robuste structure de la société civile. L’État était seulement une tranchée avancée, derrière laquelle se trouvait une chaîne robuste de forteresses et de casemates ; plus ou moins d’un État à l’autre, on le comprend, mais ceci demandait précisément un examen soigneux de type national[16].
On comprend encore plus clairement quel programme national d’étude, État par État, pays par pays, Gramsci se propose de mener – « un examen soigneux de type national » – et l’on comprend qu’il faudra examiner de front la société civile et l’État – que l’on ne pourra plus considérer sous son seul aspect coercitif. En Occident, la société civile est partie intégrante de la force de résistance, à la fois politique et militaire, des États qu’il s’agit de conquérir. La nécessité de la guerre de position naît de cette réalité complexe.
Ce concept conduira Gramsci à repenser l’État, le rôle des intellectuels dans la société civile et à faire évoluer le concept d’hégémonie, bien au-delà de son énonciation comme « hégémonie du prolétariat ». En 1932, il écrira d’ailleurs que « la guerre de position, en politique, c’est le concept d’hégémonie »[17]. Toute cette réflexion stratégique et politique se comprend donc bien comme une pensée alternative à la ligne qui s’est imposée dans le mouvement communiste avec le « tournant ». Il y a là une accélération théorique dans la pensée politique et stratégique de Gramsci que nous étudierons dans les prochains chapitres.
[1] Q 7 [b], § 10 : « Struttura e superstruttura » (novembre 1930). Après le titre de la note, Gramsci renvoie aux notes portant le même titre de rubrique dans la première série des Notes de philosophie du cahier 4, dans lesquelles il a commencé à développer l’idée selon laquelle « la lutte pour le pouvoir et pour la conservation du pouvoir crée les superstructures » et se développe sur leur terrain (Q 4 [b], § 13 [§ 12], été 1930), qui est celui du « rapport des forces politiques » ((Q 4 [b], § 39 [§ 38], octobre 1930).
[2] Q 7 [b], § 10, QC, p. 859.
[3] Q 7, § 10, p. 860.
[4] Ibid.
[5] « Rapporto Gennaro », loc. cit., p. 210.
[6] Athos Lisa, Memorie, op. cit., p. 97.
[7] Bruno Tosin, Rapporto [1969], in ibid., p. 98.
[8] Q 2, § 122 [§ 121], QM 1, p. 374 : « Cadorna ». Gramsci commente un article de Spectator [Mario Missiroli], « Luigi Cadorna », Nuova Antologia, 1er mars 1929.
[9] Ces aspects ont été signalés par Fabio Frosini, « Note sul programma di lavoro sugli “intellettuali italiani” alla luce della nuova edizione critica », Studi storici, n° 4, octobre- décembre 2011.
[10] Q 6, § 19, QC, p. 700 : « Nozioni enciclopediche. Sulla verità ossia sul dire la verità in politica », novembre-décembre 1930.
[11] Q 7 [b], § 6, QC, p. 856 : « Il “Saggio popolare” e la sociologia », novembre 1930.
[12] Q 7 [b], § 12, QC, p. 863 : « L’uomo-individuo e l’uomo-massa », novembre- décembre 1930.
[13] Q 7 [b], § 6, QC, p. 856.
[14] Q 7 [b], § 10, QC, p. 860.
[15] Q 7 [b], § 16, QC, p. 865-867 : « Guerra di posizione e guerra manovrata o frontale », novembre-décembre 1930.
[16] Q 7 [b], § 16, QC, p. 866.
[17] Q 8 [c], § 52, QC, p. 973, février 1932.