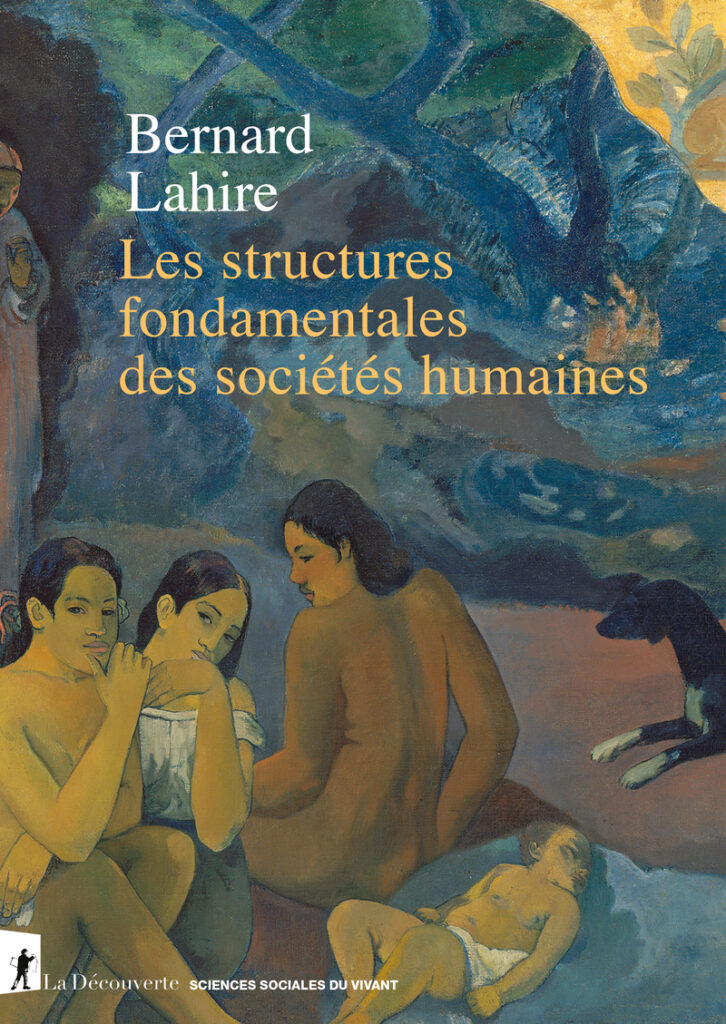
Le sociologue Bernard Lahire vient de publier Les Structures fondamentales des sociétés humaines (éd. La Découverte), dans lequel il reprend notamment la question de l’origine et de la perpétuation des inégalités et rapports de domination. Christophe Darmangeat, lui-même auteur de plusieurs livres sur ces questions (notamment celui-ci ou encore celui-là), rend compte dans cet article de cet ouvrage extrêmement ambitieux.
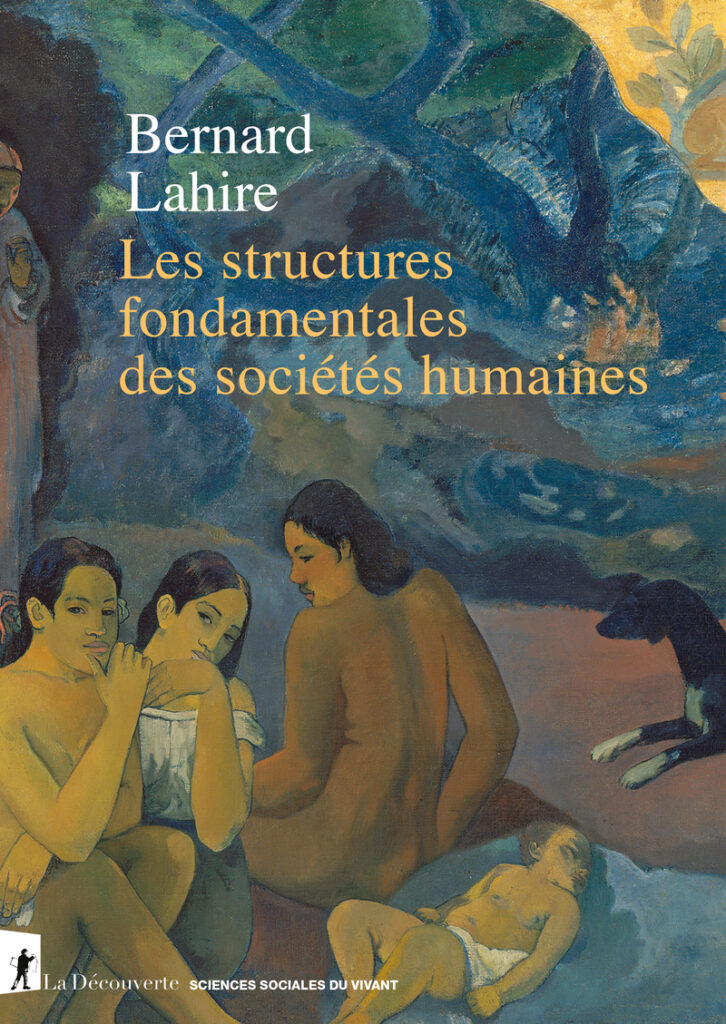
On dit souvent des grandes idées scientifiques qu’elles peuvent être exprimées de manière très simple et qu’elles apparaissent après coup si évidentes qu’on se demande pourquoi personne ne les avait énoncées plus tôt. À l’aune de ces deux critères, le monumental travail de Bernard Lahire est incontestablement le fruit d’une grande idée.
Celle-ci peut être résumée ainsi : la tradition sociologique a toujours utilisé indifféremment les concepts de « social » et de « culturel », en les réservant à l’espèce humaine. Or si tout ce qui est culturel est nécessairement social, l’inverse n’est pas vrai. Homo sapiens est certes la seule espèce vivante à être significativement culturelle, mais très nombreuses sont les autres espèces sociales. Il est donc non seulement possible, mais nécessaire, de ne pas limiter le comparatisme aux seules sociétés humaines, ainsi que l’ont fait les plus grands esprits de l’anthropologie (tels Alain Testart, auquel B. Lahire se réfère abondamment), mais d’y inclure l’ensemble des formes sociales expérimentées par le vivant.
Seule cette démarche permet de prendre la mesure des contraintes qui ont pesé sur les sociétés humaines, dont la diversité ne s’est jusqu’ici déployée qu’au sein d’un espace finalement restreint. Et seule, elle oblige à prendre au sérieux des faits qui apparaissent d’ordinaire comme des évidences qui n’auraient besoin d’être ni relevées, ni expliquées. Pêle-mêle : pourquoi aucune société humaine n’a-t-elle jamais organisé la domination des femmes sur les hommes, ou celle des jeunes sur les aînés ? Pourquoi, plus largement, toutes les sociétés humaines sont-elles pétries de rapports de dépendance ? Pourquoi sont-elles également toutes pétries de liens de solidarité au sein du groupe et de rivalité (ou d’hostilité) vis-à-vis des groupes extérieurs ? Pourquoi y observe-t-on l’omniprésence du don et du contre-don en tant que ciment des relations sociales ? etc.
Comme B. Lahire le dit lui-même, le caractère novateur de son travail concerne bien moins les connaissances stricto sensu, que le paradigme qui les organise et les éclaire sous un jour inédit, en révélant des propriétés jusque-là négligées, afin d’en finir avec une « cécité collective à l’égard de nos conditions générales d’existence en tant qu’humains » (p. 905).
Le texte, d’une vaste érudition, embrasse des disciplines rarement réunies sous une seule plume et se divise en trois grandes parties.
La première représente un « manifeste pour la science sociale » (pour reprendre le titre d’un article du même auteur). Celui-ci dresse l’impitoyable réquisitoire d’une sociologie et d’une anthropologie qui, de nos jours, ont tourné le dos aux ambitions et au programme qui avaient motivé leur existence en tant que disciplines scientifiques. Inversement, il propose un vibrant plaidoyer pour renouer les fils rompus de cette tradition :
Théologiques, les sciences humaines et sociales le sont au sens où elles développent de profondes tendances antiscientifiques : pour elles, pas de lois de l’histoire, ni de logiques de transformation d’un type de société vers un autre (les sciences sociales contemporaines sont très largement antiévolutionnistes), pas de mécanismes généraux qui structurent les sociétés les plus variées, mais seulement des sociétés qui varient dans l’histoire en fonction d’un mixte de « choix » opérés par les hommes et de contingences, ou en fonction de mécanismes qui seraient propres à chaque type de société donnée (p. 34).
La deuxième partie pose le cadre général du raisonnement, en montrant la nécessité et l’intérêt de replacer les sociétés humaines au sein de l’ensemble, plus vaste, des sociétés animales :
La sociologie n’aurait jamais dû, en tant que science générale des faits sociaux, se cantonner à l’étude des faits sociaux humains. (p. 264)
Si la volonté de bâtir un pont entre les sciences sociales (humaines) et les sciences du vivant (en particulier l’éthologie) n’est certes pas inédite, il faut souligner que la voie suivie ici est tout à fait originale. Elle se démarque en effet soigneusement des tentatives précédentes, notamment la sociobiologie ou à la psychologie évolutionniste, qui se voient vertement critiquées pour leur réductionnisme génétique ou pour le peu de crédibilité de leurs lourdes hypothèses. Pour autant, entre les positions incarnées dans un débat célèbre entre M. Sahlins et E. Wilson, il importe de dégager une troisième voie :
L’Homme est à la fois le produit naturel d’une longue histoire évolutive, biologique et sociale, et le résultat spécifique d’une mutation progressive mettant la culture au cœur de son évolution propre (histoire). C’est pour cette raison qu’il est aussi légitime de regarder l’ensemble du monde du vivant (de la bactérie à l’Homme) sous l’angle de la vie sociale, même minimale, qui s’y déroule, car tout être vivant perçoit son environnement, interagit avec les différents éléments de celui-ci et communique des informations, que de considérer cette vie sociale comme soumise à des variations culturelles. (p. 279)
Cette mise en perspective permet de dégager un certain nombre de lois, de tendances ou de « lignes de force », liées aux caractéristiques de notre espèce, et qui se sont ainsi exprimées dans ses constructions culturelles et sociales dont la troisième partie explore les principales dimensions.
La plus fondamentale de ces caractéristiques est selon B. Lahire « l’altricialité secondaire », un terme technique qui recouvre à la fois l’état de dépendance prolongé du petit humain pour sa survie, et celui de l’enfant et de l’adolescent qui doivent assimiler connaissances techniques et sociales afin de trouver leur place d’adulte. La domination des parents sur leurs enfants apparaît dès lors comme la « matrice » de l’ensemble des rapports de domination qui se sont déployés dans les sociétés humaines.
Tant qu’on ne saisit pas le lien intime entre ces différentes propriétés de l’espèce humaine, on ne peut véritablement comprendre que l’altruisme, l’empathie et la forte capacité d’apprentissage, autant de traits qu’à peu près tout le monde s’accorde à trouver « positifs », et la dépendance ou la domination, qu’on perçoit souvent comme des traits négatifs, ne sont que les deux faces d’une seule et même pièce. Aucun mammifère altriciel, et les humains pas plus que les autres, n’échappe à cette équation, même si l’espèce humaine est la seule à pouvoir la juger et la critiquer. (p. 566)
Est-il besoin de le préciser, la démarche de B. Lahire est empreinte d’un matérialisme rigoureux. C’est à partir de la réalité – en particulier, celle de la dépendance du jeune humain – qu’il s’agit de comprendre certaines formes idéalisées ou fétichisées, en particulier dans le domaine magico-religieux :
On ne verra pas un hasard, par conséquent, dans le fait que certaines de ces sociétés envisagent la possibilité que l’esprit des ancêtres puisse se réincarner dans les nouveau-nés, comme dans une préfiguration symbolique ou une métaphore des processus effectifs de transmission d’un capital culturel ancestral (p. 633)
C’est une même démarche matérialiste qui lui permet de relier le dualisme omniprésent dans les systèmes de représentations humains à la dualité biologique des sexes :
Tout se passe comme si le système des oppositions symboliques prenait appui notamment sur cette partition biologique fondamentale qu’est la partition sexuée. Et ce n’est donc pas un hasard si, à l’opposition masculin/féminin, vient s’accrocher toute une série d’oppositions que les travaux anthropologiques structuralistes ont très largement contribué à mettre en évidence : haut/bas, supérieur/inférieur, dessus/dessous, dehors/dedans, droite/gauche, clair/obscur, dense/vide, lourd/léger, chaud/froid, etc. (p. 755)
Parmi les analyses opérées par B. Lahire sur des dimensions sociales fort diverses, certaines apparaîtront sans doute plus convaincantes que d’autres. Pour ne parler que de thèmes sur lesquels j’avais moi-même tenté de réfléchir, les développements concernant la domination masculine, la division sexuée du travail, ou ce qu’on pourrait appeler les formes élémentaires de la coopération et de l’inimitié sont particulièrement fructueux, et me conduisent à reconsidérer d’un œil neuf une partie de mes propres réflexions.
D’autres points, en revanche, m’inspirent certaines réserves. C’est le cas du chapitre sur l’État, lui aussi analysé comme une extension du rapport parental. À lire B. Lahire, on éprouve le sentiment que l’État ne ferait en quelque sorte que concentrer des fonctions qui existaient déjà en-dehors de lui, sans en exercer de radicalement nouvelles.
Or en portant ainsi l’accent sur la continuité, on néglige une dimension essentielle de l’Etat, qui n’existe précisément pas dans les sociétés qui en sont dépourvues : la préservation des rapports sociaux en dernière instance par l’exercice de la violence – fonction qui n’est jamais mieux exprimée que lorsqu’on évoque les « forces de l’ordre ». En concentrant entre ses mains la violence légitime, l’État n’est pas seulement le dépositaire d’un type de domination qui traverserait toutes les sociétés : il est le vecteur d’un type de domination inconnu jusqu’alors.
Plus généralement, l’accent placé sur les continuités tend inévitablement à faire passer au second plan certaines ruptures, au risque de provoquer quelques illusions d’optique ; ainsi, même si l’idée n’est jamais formulée de cette manière, la lecture du texte donne parfois le sentiment que les sociétés humaines devraient composer avec une quantité invariable de rapports de domination, dont elles ne pourraient que modifier la forme.
À la suite d’A. Testart, B. Lahire insiste par exemple sur l’importance des relations de dépendance au sein des sociétés sans richesse, notamment australiennes. Il y accrédite même l’idée de hiérarchies entre hommes adultes et de la présence d’authentiques « chefs », jouissant de privilèges matériels de capacités de commandement, et en se fondant sur les affirmations de J. Dawson. Ce témoignage fait pourtant figure d’exception fort douteuse sur un continent dont les premiers habitants ont été régulièrement qualifiés d’anarchistes, tant ils refusaient toute forme d’obéissance et de coercition dans le domaine séculier.
On peut donc se demander si, à insister sur l’existence bien réelle de certaines dominations dans toutes les sociétés humaines, on ne perd pas un peu de vue que ce n’est pas seulement leur forme, mais aussi l’étendue et le poids de ces dominations qui ont considérablement varié au cours de l’évolution sociale.
D’une manière encore plus générale, B. Lahire donne par moments le sentiment de forcer sa démonstration, en poussant un peu trop loin le pouvoir explicatif de ses catégories. Le fait religieux, par exemple, se présente sous un jour très différent d’un type de société à un autre, en particulier en ce qui concerne les propriétés attribuées aux êtres surnaturels et les relations que les humains doivent entretenir avec eux. S’il ne faire guère de doute que « Dieu le père » ou les ancêtres auxquels on voue un culte constituent des formes idéalisées de l’autorité parentale, peut-on réellement en dire autant, par exemple, des êtres du Temps du Rêve australien ? La question (sans aucun doute, aussi vaste que difficile) mériterait un examen attentif.
Quoi qu’il en soit, ces inévitables discussions sur l’analyse de tel ou tel phénomène social ne constituent en rien un argument contre l’idée centrale du livre. De même qu’une fois posés les principes généraux du matérialisme historique, seuls des travaux minutieux – et éventuellement contradictoires – peuvent permettre de découvrir la manière dont ils s’exercent dans chaque situation historique concrète, les lignes générales mises en évidence par la comparaison inter-espèces constituent des guides pour le raisonnement et non des solutions toutes faites qui permettraient en un tournemain de déchiffrer tous les rapports sociaux humains en nous dispensant de les étudier. Et si l’on peut penser que sur tel ou tel aspect, les développements de B. Lahire mériteraient d’être complétés ou nuancés, ces considérations n’invalident nullement le cadre général que son ouvrage a l’immense mérite de proposer.
Dès lors, on pourrait se demander quelles conclusions politiques – au sens le plus large du terme – se dégagent d’une telle entreprise. L’époque assimile volontiers le fait d’identifier des déterminismes à une position conservatrice : énoncer les causes d’un phénomène, surtout si celles-ci plongent leurs racines dans un passé lointain, reviendrait ainsi à le légitimer ou à proclamer son caractère inéluctable. Inversement, l’attitude émancipatrice consisterait à nier les déterminismes pour proclamer notre liberté. S’inscrivant dans une tradition qui est aussi celle de ce que K. Marx et F. Engels, eux aussi abondamment cités, appelaient le « socialisme scientifique », B. Lahire prend le contrepied de telles assertions :
En tant que scientifiques, nous n’avons d’autre choix que de nous confronter au réel, d’être prêts à remettre en question nos conceptions si elles se révèlent fausses et de chercher à rendre raison des constats quand ils sont à peu près établis ; mais en tant que réformateurs ou révolutionnaires, nous nous devons aussi de ne pas mépriser les faits, même si nous pouvons éprouver une jouissance quasi enfantine à les détruire par un simple effort d’imagination, et de nous interroger sur ce que nous pouvons en faire pour nous donner une chance de les contester dans la réalité. (p. 914)
Ajoutons à cela une idée qui traverse l’ouvrage de part en part, mais sur laquelle on ne saurait trop insister : si l’espèce humaine, tout comme n’importe quelle espèce vivante, a dû et devra encore composer avec les déterminismes qui pèsent sur son existence, sa capacité à produire une culture cumulative lui permet également de s’émanciper, partiellement ou totalement, de ces déterminismes.
On pense évidemment à l’exemple de la domination masculine, mais B. Lahire le souligne également à propos de l’opposition entre « nous » et « eux » – sans doute, un des passages les plus réussis de sa démonstration, où il écarte le facteur génétique pour montrer que le ciment de ces groupes tient avant tout aux liens de proximité tissés durant la période altricielle. À l’instar d’autres animaux sociaux, les humains sont ainsi enclins à former des groupes coopératifs hostiles les uns aux autres ; mais dans notre espèce, le progrès économique et technique a peu à peu étendu la taille de ces groupes en même temps qu’il réduisait leur nombre (p. 859), au point de faire émerger depuis deux siècles la perspective de la dissolution des divisions nationales et la constitution d’une véritable unité politique humaine.
Pour finir, on comprend parfaitement les raisons qui ont poussé l’auteur à multiplier les sources et à développer ses arguments dans un écrit aussi ample : pour défendre des idées si largement à contre-courant de l’opinion académique dominante, au moins dans les disciplines de sciences humaines concernées, il lui fallait faire la démonstration qu’il s’appuyait sur un vaste corpus de données qui tissent un consensus. Le volume qui en résulte, bien qu’il soit écrit dans la plus simple et la plus limpide des langues, possède une taille qui a malheureusement de quoi intimider bien des lecteurs. Souhaitons donc de voir paraître au plus vite un texte qui, sans en trahir les nuances, en présente les idées principales sous une forme plus ramassée, et qui pourra ainsi trouver le large public qu’elles méritent.