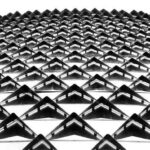Racisme, État-nation : un récit français
L’État-nation est-il à bout de souffle ? L’histoire n’est pas neuve, ses différentes crises systémiques et ses contradictions au cours des dernières décennies non plus. Les récents évènements américains avec la mort de Georges Floyd relancent une nouvelle fois ce débat avec en toile de fond celui du racisme institutionnel, énième convulsion d’un système aux abois. Ces images d’un Africain-Américain tué par un policier en service, projetées à la face du monde, n’épargnent évidemment pas la Nation française dans laquelle cette vision fait écho.
Des actes d’une violence extrême, mais qui ne semblent pas émouvoir outre mesure nos classes dirigeantes. Elles semblent au contraire bien décidées à feindre l’indifférence voire l’incompréhension, volontairement aveugles au caractère systémique du problème, toujours aussi complaisantes avec un racisme qui depuis bien trop longtemps déjà ronge la carcasse vieillissante nationale. Les récentes allégations de l’ex-ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, prêt à tout pour ne pas froisser comparses fonctionnaires et opinion publique, n’aident en rien le débat. Courbant toujours un peu plus l’échine devant la toute-puissance syndicaliste policière, l’ex premier flic de France se veut en adéquation parfaite avec cette demi-mesure caractéristique de nos sociétés actuelles, cette philosophie du milieu, dénonçant du bout des lèvres le caractère raciste d’actes isolés au sein des forces de l’ordre dans leur grande majorité irréprochable. Là encore, la campagne de communication est rodée, toujours prête à évoquer le racisme dans l’institution, mais jamais le racisme d’institution.
Ici, il est toujours question d’actes isolés, du vilain agent qu’il faudra redresser tel un morceau de bois courbé. Rien n’est ici parfait, mais on se targue d’y travailler en somme… La France n’est-elle pas au fond un modèle ? N’a-t-elle pas concouru dans son histoire à promouvoir des valeurs universalistes pour l’ensemble de l’humanité ? Mais ce curriculum vitæ falsifié par le récit national n’est-il pas justement ce qui empêche la remise en question ? Le racisme structurel, au-delà même de la police, n’est-il pas au final la marque ou tout du moins un élément constitutif de notre modèle organisationnel ? Si tel était le cas, ôter le racisme de nos structures ne reviendrait-il pas à une réforme profonde de ces dernières ? N’est-il tout simplement pas temps de réinventer de nouvelles institutions ? Au risque de tirer des conclusions trop hâtives sur ces questions complexes, il va falloir poser quelques définitions, à commencer par celles des deux concepts majeurs de cet essai, le racisme et l’État-nation.
Naissance d’une nation
Depuis toujours, les Hommes ont en effet observé le racisme sans forcément le nommer ou le conceptualiser. Certains historiens en retrouvent la trace dès l’antiquité quand d’autres l’associent spécifiquement à la période coloniale. Un travail éminemment complexe tant la question des origines et du sens du racisme semble difficile à agripper. Si rétrospectivement certains actes historiques ont pu être définis comme racistes, le terme ne se démocratise pourtant qu’au début du XXe siècle. La « question raciale » quant à elle, fascine depuis plus longtemps et trouve sa résonance intellectuelle au cours du XIXe siècle à l’image des travaux de Joseph Arthur de Gobineau et son Essai sur l’inégalité des races humaines paru en 1853. Depuis ces bases théoriques pseudo-scientifiques, le concept n’a cessé de prendre différentes postures, employé et manipulé au gré des évolutions des sociétés. C’est la raison pour laquelle nous défendrons ici une version disons « étendue » du racisme, pas seulement biologique mais aussi religieuse, culturelle ou encore sociologique, à l’image des problématiques de notre temps. Une position qui divisera probablement mais qui reste assumée. Au fond, l’argument défendu ici reste que les relations raciales sont le produit de luttes, de rapports de pouvoir.
Une fois cela posé, c’est maintenant au tour de l’État-nation. Le concernant, certaines prémisses peuvent être aperçues avec l’essor de la monarchie, cette dernière ayant évidemment érigé des socles encore aujourd’hui bien visibles. Nous pourrions donc citer la création d’un monopole monétaire, la centralisation administrative et fiscale ainsi que dans une certaine mesure l’unification juridique. À cela s’ajoute effectivement une délimitation du territoire par des frontières plus ou moins fluctuantes au cours des siècles. Au fond, la problématique ici n’est pas tant de comprendre si ces éléments participent à une sorte de doxa nationale, mais bien d’évaluer la particularité de l’État Nation. In fine ces marques de souveraineté sont également constitutives de formes d’organisation concurrentes du sujet d’étude. La différenciation d’avec le concept d’État au sens strictement juridico-administratif, réside dans la juxtaposition du concept de « Nation », matérialisant au passage l’idée souvent abstraite de « peuple », allant même jusqu’à la notion « d’esprit du peuple » (Volksgeist), entité pleinement consciente d’elle-même, prise en un sens dans son destin historique. Cependant, ce rappel aux allures évidentes n’est peut-être pas si inutile que cela tant Nation, peuple et État se confondent, dilués dans un seul et même récipient.
La Nation, c’est étymologiquement « naître » (lat. natio), elle est ainsi dès sa formation intimement liée au sang et à l’appartenance. Cicéron en son temps utilisait le terme pour désigner les « peuplades », le « peuple ». Le grec distingue quant à lui trois notions pour désigner la Nation à savoir : demos (politique), ethnos (culture) et genos (filiation, sang). Il n’est donc plus question ici seulement d’un rapport d’allégeance à une autorité coercitive pour le dire hâtivement, mais bien avec l’État-nation dans la cultivation d’un sentiment d’adhésion, où l’individu se sait faisant partie intégrante d’un tout, d’une seule et même entité. À certains égards, il y aurait aussi dans ce besoin, une réminiscence de la noblesse jugeant l’authenticité de sa filiation par le sang. Il faudrait en quelque sorte juger l’authenticité du peuple par son sang. Or, d’évidence, lorsque l’on veut identifier un peuple à un territoire uniquement par le sang, d’irréductibles contradictions se dressent, ignorant délibérément la contagieuse mobilité des peuples.
Cette ethnicité toute relative sera pourtant galvanisée pendant des décennies par certains nationalismes, énième concept que l’on pourrait définir à l’aide de Ernest Gellner comme « le principe qui exige que l’unité politique et l’unité nationale se recouvrent »[1] (superposition de l’ethnos et du demos). Une formule complémentaire pourrait être « le fruit de l’exaltation du sentiment national voir un attachement passionné à la Nation ». Définition mise à part, Nation et appartenance semblent donc entremêlées. Les idéologues du XIXe siècle débattront d’ailleurs longuement sur le mode d’acquisition de cette « bio-culturalité », évoquant tour à tour le sang, le sol ou la langue comme éléments fondateurs. L’on sent donc poindre d’ores et déjà un lien subtil entre lignage, État Nation et peuple. Mais cela reste encore insuffisant pour réellement adjuger un lien tangible avec le racisme comme le veut le postulat de départ.
Pour ce faire, les analyses développées par Immanuel Wallerstein[2] constituent un point de départ possible de cette réflexion, avec pour ligne de mire cette fenêtre particulière de l’histoire, celle de l’impérialisme, moment d’apogée des Nations. L’éclosion d’une « économie-monde » entre pays du centre et périphériques va favoriser au cours du XIXe siècle la mise en place d’une concurrence entre puissances européennes et forger une forme de culte national. Mais au final dans quelle mesure nationalisme et capitalisme impérialisme vont-ils se concilier ? Comme le faisait remarquer très justement l’un des premiers théoriciens du sujet, John Atkinson Hobson, au début du XXe siècle, ces deux idées semblent de prime abord parfaitement antagonistes[3] puisqu’il s’agit d’intérêts divergents, privés d’un côté et nationaux de l’autre.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la classe capitaliste a pour ainsi dire pénétré, via son mode de production, l’ensemble des couches sociales intérieures, provoquant ni plus ni moins une saturation du marché. Devant la chute tendancielle des taux de profit, elle va de manière presque naturelle décider de se lancer dans une vaste entreprise d’exportation de capitaux. L’investissement étranger va donc aller bon train, mais ces flux monétaires sans volonté de contrôle réel débouchèrent vers une série d’escroqueries et de scandales financiers sans pareil. Notons ici que l’exportation tous azimuts de capitaux n’implique pas de facto une forme politique spécifique.
La donne change cependant du tout au tout lorsque le grand capital demande cette fois explicitement aux gouvernements de venir protéger leurs intérêts au sein des territoires périphériques. Il ne faut pas omettre que l’expansion coloniale a toujours eu comme agent fondateur l’État. Le capitaliste du XIXe siècle a donc recours à un mécanisme utilisant la politique contre les risques du jeu, au travers de création de monopole, de protection et de renfort lors des différents conflits. Ce pivotement précis redonna ainsi à cette classe possédante toute sa place dans le grand échiquier national. Ferry dira d’ailleurs plus tard à ce sujet « La politique coloniale est la fille de la politique industrielle » (1890), signe d’une réconciliation à ce moment précis de l’Histoire.
Ce recours à l’État dans les affaires privées n’a pas aujourd’hui disparu, et d’une certaine manière la « socialisation des pertes » lors des crises économiques récentes constitue une démarche quelque peu similaire. Parallèle mise à part, ce changement de paradigme n’était pas uniquement profitable aux intérêts privés. Les crises économiques successives à partir de la deuxième partie du siècle avaient en effet engendré une somme importante d’individus « oisifs ». Devant une telle masse « superflue », le risque reposait maintenant sur la faculté pour l’État de gérer cette nouvelle problématique.
L’idée de progrès et d’expansion illimitée arriva donc à point nommé pour envoyer cette main-d’œuvre aux confins des colonies, exportant le pouvoir gouvernemental et renforçant au passage cohésion et appartenance nationale. Pourrait-on cependant aller jusqu’à dire que le nationalisme est une forme politique du capitalisme ? Peut-être pas complètement, mais le mode de production, sans pour autant être l’unique stimulus, joua un rôle non négligeable dans le façonnement et le renforcement du sentiment national. Mais au-delà de l’influence d’une classe capitaliste sur l’idéologie nationaliste, l’idée est aussi et de poser la compatibilité, voire l’interopérabilité entre capitalisme et racisme.
Le racisme dans ses prémisses idéologiques a toujours défendu une vue verticale de l’humanité. Il y a ainsi dès les premières conceptualisations, une volonté de classifier, d’organiser telle une science avide de catégories aussi arbitraires soient-elles. Cette verticalité n’est pas sans rappeler évidemment l’ordonnancement qui convient à la maximisation des profits, nécessaire et obligatoire à la constitution du capital. Par-delà la rivalité exacerbée des puissances dominantes du centre, semble donc se dessiner inévitablement au cours du procès colonial une certaine idée hiérarchique, vitale au maintien du système en place. Racisme et capitalisme vont donc au cours du XIXe siècle s’abreuver l’un l’autre, se co-développer.
La philosophe Hannah Arendt écrivait dans son essai sur l’impérialisme :
« […] quoi qu’il en soit, les races dans cette acceptation furent seulement découvertes dans les régions où la nature était particulièrement hostile. Ce qui les rendait différentes des autres humains ne tenait pas du tout à la couleur de leur peau, mais au fait qu’elles se comportaient comme partie intégrante de la nature […] Elles n’avaient pas créé de monde humain, une réalité humaine. »[4]
Ces populations périphériques ont donc été sans surprise dès le départ, renvoyées à leur « naturalité », dépossédées jusqu’à leur humanité. Ces premiers rapports hautement hiérarchisés vont donc façonner les relations de « l’homme blanc » au contact des populations autochtones. L’épisode célèbre de la joute entre Juan de Quevedo et Bartholomé de LasCasas sur le sort des indigènes au XVIe siècle cristallise également cette même idée[5]. LasCasas prendra la défense de ces populations argumentant que ces hommes et femmes possédaient à l’image des Européens une âme et qu’en ce sens ils ne pouvaient être traités de la sorte.
Pourtant, après ce maelström révolutionnaire que fut l’année 1789, toutes les conditions semblaient réunies pour une abrogation pure et simple des inégalités au sens large imposées par l’ancien régime. La première période de la toute jeune Nation française (1789-1793) posa la question de l’égalité et de la liberté avec une telle virulence qu’il semblait presque impossible d’envisager un retour arrière. Malgré des débuts prometteurs, la courbe ascendante de l’universalisme ne semble pas avoir pris l’envol tant espéré. En effet, et sans vouloir négliger l’immense apport des révolutions françaises successives, elles n’ont pas su résoudre la question coloniale.
S’il en est ainsi, c’est qu’au-delà du simple mépris, le racisme constitue également un adjuvant nécessaire à l’économie capitaliste. Si le gouvernement espagnol accepte de ne pas exterminer entièrement les populations d’Amérique, c’est avant tout pour résoudre un problème de main-d’œuvre. De même que très vite la Convention Nationale tempéra ses pensées anticolonialistes pour supporter « l’intérêt national ». Cette contradiction entre besoin et mépris persiste tel un fil conducteur. Il y a donc bien ici un point central qui consiste à dresser, n’en déplaise à certains, un trait d’union entre capitalisme, Nation et racisme au cours de l’Histoire.
C’est peut-être aussi ce qui explique les dissensions nombreuses au sein de certains camps au XIXe siècle, cette impossibilité de faire coïncider intégralement universel et mode de production hiérarchisé. La médiation qu’est la fraternité n’a vraisemblablement pas suffi à recouvrir le gap initial même à notre époque. Il n’est donc pas étonnant d’avoir vu une partie de la bourgeoisie policer la radicalité des débuts et s’éloigner d’une plèbe devenue inconfortable. Il lui fallut dans un pur esprit de conservation chercher à certains moments de son développement les compromis, penchant un temps vers le consulat et l’empire avant d’instituer une IIIe République symbole de conservatisme et de stabilité. L’émergence d’un « capitalisme productiviste » gomma la dimension parasitaire dès le début et participa à une « approbation » au sens large, ravivant les médiations de propriété et de méritocratie.
Dernière précision, la bourgeoisie ne fut pas une masse homogène, de nombreux antagonismes internes persisteront notamment au tournant du XXe siècle. La bourgeoisie ayant également longtemps hésité sur les formes à adopter avant de se fixer sur le capitalisme nationaliste. La précédente démonstration ne tend pas à déduire la forme Nation du seul mode de production capitalisme, ou de simplement associer cette construction politique au seul projet bourgeois. Cela serait évidemment faire preuve d’une grande maladresse, tout du moins de retomber inlassablement dans des mythes poursuivis par l’extrême gauche à certains moments de son histoire.
Passé, présent, futur
Lorsque l’Europe quelque peu essoufflée par deux guerres mondiales consécutives se retire et abandonne une partie de ses anciennes conquêtes, les problèmes et le rapport à ces populations ne s’interrompent pas pour autant, bien au contraire. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le « flux » migratoire s’inversant, les Nations et notamment la France doivent maintenant gérer l’assimilation de ces nouveaux venus.
On assiste alors à une évolution du concept même du racisme par les anciennes puissances. Ce qui était considéré auparavant comme une forme de rejet biologique ou anthropologique va se transformer peu à peu, au sein d’un même cadre social, en un racisme de la « différence ». Ce n’est pas tant le caractère d’appartenance qui se manifeste à l’intérieur du territoire, mais bien le soulignement de l’incompatibilité, de la différence donc, sous des bases cette fois plus seulement physiques, mais aussi culturelles, religieuses, etc. D’une manière ou d’une autre le problème persiste. Malgré là encore un certain lyrisme et des envolées républicaines, ce corps étranger semble incompatible et même dangereux à l’unité pleine et indivisible de la Nation. Une certaine tension au sein de la Nation culturelle (ethnos) s’installe durablement.
Ainsi, l’apparente nationalité acquise pour certains après 18 ans, car nés sur le sol français n’est pas officieusement porteuse des pleins droits et donc de la pleine citoyenneté aux yeux des autorités. Il n’y a qu’à observer les tics de langage de certains politiciens ou journalistes parlant systématiquement de populations « issues de l’immigration ». Une manière de faire qui démontre bien une non-reconnaissance consciente ou inconsciente de ces sujets, cherchant perpétuellement à les rattacher vers une base extérieure. Ce phénomène que nous nommerons « l’hypocrisie du sol » va de pair avec l’idéal du sang mentionné précédemment (genos). Ce dernier, même si non-officiellement admis, renvoie la citoyenneté à un critère génétique qui ne peut provenir que de la naissance, et ne peut donc être acquis par un autre moyen.
Les Nations en tension tendent souvent à faire rejaillir cette caractéristique, rarement compatible aux idéaux démocratiques. Au final, pas besoin de lois ouvertement ségrégationnistes pour que ces modes de pensées ou ses comportements prospèrent. L’illustration d’Arendt évoquée précédemment sur des indigènes renvoyés à leur « naturalité » n’est pas morte bien au contraire. Pour développer quelque peu cette idée, il est intéressant de reprendre la thèse de « l’Homo-Sacer » du philosophe italien Giorgio Agamben[6]. Ce statut issu du droit romain antique désigne initialement une personne exclue de la cité, pouvant être tuée par n’importe qui (qui occidit parricidi non damnatur), mais qui ne peut faire l’objet d’un sacrifice humain lors d’une cérémonie religieuse (neque fas est eum immolari). En somme, un individu dépossédé de ses pleins droits civiques, pouvant être tué sans crainte de représailles, mis au ban de la société, renvoyé à son simple état naturel (vie nue/zoé).
Même si Agamben semble initialement appliquer cette définition aux réfugiés politiques ou aux déportés, elle fait tout de même écho au traitement et à la stigmatisation d’une partie de la population actuelle. Le cas de la violence policière constitue une illustration parfaite. Le fait, pour un officier de police, de venir molester et frapper de manière décomplexée dans un plein sentiment d’impunité, vient davantage signifier la non-reconnaissance d’une pleine citoyenneté de la victime que le simple fait d’outrepasser son périmètre d’action légale. L’agent de police n’est même plus pour ainsi dire vraiment dans l’illégalité car jamais vraiment inquiété par sa direction lorsqu’il fait face à ces citoyens de « seconde zone ». La hiérarchisation citoyenne est bel et bien en marche. Bien qu’en apparence extrêmement contrôlée, notre police n’est que très rarement inquiétée (selon les chiffres de la directrice de l’IGPN, sur 378 affaires suite aux manifestations des gilets jaunes seulement 2 ont donné suite à des sanctions administratives[7]).
Mais loin de vouloir ici se focaliser uniquement sur le problème policier et sans vouloir non plus revenir sur l’intégralité du processus ayant permis l’émergence d’une organisation et la constitution de pratiques violentes particulières, il apparaît tout de même important de préciser que cette violence institutionnelle légitime s’est organisée et formée au temps là encore des colonies. Au-delà du caractère systémique, il est primordial d’établir la filiation coloniale. La professionnalisation de la police fut elle aussi construite par les idéologues de l’impérialisme au contact des résistances culturelles des régions périphériques. Le soldat des colonies s’est donc transformé petit à petit en policier, et il n’est pas inintéressant non plus de rappeler que la réussite du l’entreprise coloniale fut aussi le fait de « l’efficacité » et du développement de ces polices. Là encore, cette institution porte en elle les traces d’un passé sulfureux. Mais cette « tradition » ne se limite pas à la période coloniale stricto sensu.
L’histoire récente en France est suffisamment chargée pour établir une liste conséquente d’actes racistes. On repense notamment à la persécution des ouvriers algériens en 1961, l’affaire Malik Oussekine en 1986 avec l’utilisation de cette police à moto dans les cortèges remis au goût du jour lors des manifestations gilets jaunes, ou évidemment l’interpellation d’Adama Traoré plus récemment. Il est bon de rappeler également les contrôles au faciès incessants[8] et plus généralement, la multiplication des plaintes qui explosent ces dernières années. Les « Défenseurs des Droits » recensaient un total de 363 réclamations en 2011 contre 1520 en 2018[9]. Mais malgré des chiffres à la hausse, la période actuelle est-elle nécessairement synonyme de recrudescence de violence policière ? Peut-être pas totalement en réalité.
Bien que plus dénoncées, il faut davantage constater un déplacement de la violence vers des sphères plus visibles, aux cœurs même des cités. La vague « gilets jaune » et la réaction de l’opinion provoquée par des « blancs » matraqués, éborgnés, mutilés, autrefois associés à une forme citoyenne « légitime » sont hautement révélatrices. L’émoi n’a jamais été aussi vif quand 20 ou 30 ans auparavant les mêmes actes s’effectuaient quotidiennement dans les banlieues sur les « invisibles » de la République. Loin des yeux, loin du cœur… Nos « ban-lieues » ne sont-elles pas justement devenues des lieux périphériques en dehors de la vie de la cité ? « Centre » ville et « périphérie » urbaine ne font-ils pas étrangement écho aux éléments évoqués précédemment ?
Les concepts fondamentaux des Nations impérialistes ne cessent de revenir au cœur de nos territoires. La somme des similitudes est longue, et démontre toujours un peu plus la stagnation de nos sociétés et leur incapacité d’appropriation complète du sujet. Nous parlions en introduction de la déstabilisation d’un système, cette crispation de la part de l’État matérialisée par la violence policière constitue uniquement la partie visible de l’iceberg. Le racisme structurel révélé une nouvelle fois au grand jour vient tendre le débat et affaiblir un mode d’organisation déjà bien en souffrance à l’intérieur comme à l’extérieur.
Le néolibéralisme, forme impérialiste dégénérée s’il en est, vient depuis plusieurs décennies créer des déplacements de souveraineté difficilement acceptables pour nos institutions. Les hégémonies des GAFAM, symptôme là encore des lois défaillantes du marché, viennent balayer d’un revers de la main la modernité de l’ancien temps. Les États se crispent et répondent violemment par un retour des nationalismes exacerbés à grand renfort de politiques protectionnistes (Orban, Poutine, Trump, mais également dans une certaine mesure Macron dans sa manière de cliver le débat politique marchant allégrement sur les plates-bandes de l’extrême droite). L’ouverture et le multilatéralisme post Seconde Guerre mondiale s’effrite toujours un peu plus, renvoyant les gouvernements dans des jeux de rivalités dangereusement similaires à ceux de la fin de la période impérialiste.
De plus, les « générations d’immigration » successives, bien que souvent pointées du doigt dans un élan de facilité en période de tension, ne constituent pas en réalité l’ennemi intérieur tant redouté. Il faut bien davantage chercher du côté de la prolifération une nouvelle fois du néolibéralisme et de la soumission des pouvoirs politiques actuels face à cette idéologie plastique. Cette dernière, en pénétrant la moelle des structures, a même supprimé l’indépendance libérale traditionnelle entre pouvoir politique et pouvoir économique. À l’image des idées développées par Wendy Brown[10], nous assistons actuellement à la combinaison d’une dérégulation de l’économie et de politiques interventionnistes des États. Cette terrible association amène à la destruction des acquis sociaux et l’État social à proprement parler. La rationalisation à outrance de secteurs comme l’éducation, la santé ou la justice tant à briser la cohésion tant recherchée initialement.
De manière plus générale, « l’universalisme de surplomb » est acculé de toutes parts et semble avoir de plus en plus de mal à camoufler son passé et ses pratiques nauséabondes. Il est pour nos politiques de plus en plus difficile de détourner voire d’utiliser le débat public sur des sujets comme le voile ou la laïcité pour feindre le racisme. Nous avons là en face des yeux l’essoufflement d’un système cherchant à consolider une base sur des leviers grossiers vieux de 150 ans. Il est relativement aisé de voir dans ces postures un révélateur des hantises nationales, et comme le disait Abdelmalek Sayad, c’est bien « l’État qui se pense en pensant l’immigration ». Emmanuel Macron déclarait à ce sujet dans une de ces allocutions publiques
« le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l’ethnicisation de la question sociale en pensant que c’était un bon filon » […] « Ce combat noble est dévoyé lorsqu’il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou faussée du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu’il est récupéré par les séparatistes[11] ».
Les accusations de séparatisme pleuvent mais qui a quitté le navire en premier lieu ? La ghettoïsation n’a pas été le fruit d’une démarche unilatérale des populations. Mais ce développement soi-disant endémique du multiculturalisme, du communautarisme n’est-il pas au final plutôt le résultat de politiques assimilationnistes défaillantes couplées à un néolibéralisme grimpant ? Ne déclenchent-ils pas également une forme de racisation institutionnelle du travail ? Il n’y a qu’à constater le pourcentage de métiers dits « non ou faiblement qualifiés » parmi les populations racisées en France.
Le phénomène n’est pas pour ainsi dire nouveau. La dichotomie entre travail manuel et travail intellectuel désignée par une certaine aristocratie au cours du XIXe siècle continue de transparaître sous des formes diverses. Pour le formuler autrement, est très vite apparue l’idée d’une race ouvrière souvent assimilée au mauvais voire au dangereux. Zola dans Travail ou le roman socialiste (1901) s’attelait à décrire ces mécanismes comme avec le maitre fondeur Morfain, le décrivant comme « le descendant immédiat de ces ouvriers primitifs, dont le lointain atavisme se retrouvait en lui, silencieux, résigné, donnant ses muscles sans une plainte, ainsi qu’à l’aube des sociétés humaines ».
Ce dédain doublé de haine perdure toujours aujourd’hui évoluant au gré du concept de « l’immigré » au sein du territoire national. Le rapport entre lutte des classes et racisme donne de facto lieu à des formes extrêmement hétérogènes au cours des siècles. À l’heure actuelle, la plus dominante est celle du « Maghrébin », du « musulman » qui viendrait remplacer une culture millénaire, s’approprier le travail des honnêtes travailleurs de souche. Ces désignations sont devenues dans l’histoire contemporaine le véritable ennemi intérieur, fusionnant au passage catégories socio-économique, morale et anthropologique. On sent bien là poindre le lien qui ne demande qu’à être tissé entre race et prédisposition, fait là encore de schémas catégoriques arbitraires.
Ces nouvelles déterminations confèrent donc au racisme non plus seulement une dimension anthropologique, mais également économique. Détermination réciproque en somme du racisme de classe et racisme ethnique. Ces formes d’opposition et de rejet ne se cantonnent pas non plus uniquement entre classes historiquement antagonistes, mais au sein même d’une classe ouvrière faisant au passage un peu plus éclater l’idée de « classe pour soi ». Le capitalisme lutte encore une fois avec ses contradictions historiques, car bien que rejetées dans leur majorité, ces populations constituent une main-d’œuvre indispensable, malléable, participent à la concurrence du marché du travail et in fine perdurent en majorité dans une hérédité ouvrière.
Casser la République
L’immigré n’est plus depuis longtemps un étranger au sens propre, mais reste perçu comme tel. Le concept « d’identité nationale » repris avec ferveur par Nicolas Sarkozy durant sa présidence agit comme l’énième rappel d’un registre politique aussi vide que fictif. Une culture française aurait évolué pendant plusieurs siècles au gré des fluctuations des individus et des époques mais devrait maintenant brutalement se figer. L’ethnos serait donc pris d’une impossibilité brutale d’évoluer pour ces conservateurs adeptes de traditions. À force d’actionner continuellement ces leviers, des ressentiments profonds se créent et se transmettent de génération en génération auprès des populations françaises stigmatisées.
Déployée sur plusieurs décennies la fracture d’un côté comme de l’autre semble inévitable. Avec cela c’est bien l’immigration-intégration qui tourne au vinaigre et avec elle c’est la société de la normalisation sociale qui prend l’eau. Ces « sujets-immigrés » échappent de plus en plus au giron du biopouvoir. L’appareil idéologique d’État ne semble plus être en mesure de gommer les parties non désirées de ces sujets actifs, ramenant toujours un peu plus l’institution à sa perte de création de monopoles des identités. La société en refusant d’élargir son ethnos et en voulant faire entrer par la force ces individus se crispe et s’affaiblit. C’est ici le symbole d’une nation malade qui voit sur le temps court ces nouveaux venus non pas comme une richesse mais comme un poison symbole d’altérité.
L’idée pugnace que les gouvernements de la seconde moitié de la cinquième république ont donné l’impression d’avoir fourni l’effort suffisant en dénonçant le passé colonial français persiste. Le candidat Emmanuel Macron peut bien se gargariser de qualifier la colonisation de crime contre l’humanité, le problème reste toujours de considérer le dossier définitivement clos, d’avoir refermé le livre pour de bon avec le sentiment du devoir accompli. Mais cette histoire continue de s’écrire chaque jour et jamais l’autocritique n’a su faire le lien pourtant nécessaire entre passé, agissements présents et améliorations futures.
Le constat est donc double. D’une part capitalisme rampant et racisme ont alimenté la machine nationaliste au cours des siècles. Le mode de production a, au gré de ces mutations diverses, insidieusement continué de pénétrer nos institutions. L’autre situation réside dans la menace culturelle constante de l’autre, oubliant que les peuples n’ont jamais été des formations figées. Un certain discours tant pourtant à faire penser le contraire, renforçant les idées d’une limite intégrationniste. La critique n’est donc pas tant dans la mise en place d’un récit unificateur que dans l’impossibilité à le faire évoluer.
Le racisme, sous des formes plurielles, continue de pénétrer pernicieusement nos modus operandi. Cette substance au cœur même du fondement de nos institutions explique en partie leur incapacité à la réforme. Phénomène plastique, les définitions vont et viennent comme les adjectifs. Qu’il soit institutionnel, sociologique, théorique ou encore spontané, la pluralité dont il fait preuve laisse pantois. C’est peut-être aussi pour toutes ces raisons qu’il apparaît aujourd’hui primordial de continuer de poser ces questions. Comment endiguer si la structure cautionne ? Comme endiguer si la structure génère ? Voilà également les raisons qui poussent à une refonte complète, presque utopiste, des institutions sur un socle et des bases différentes.
Il s’agit bien ici de montrer également l’inéquation entre les idéaux de départ (1789) et leur mise en pratique. Cela rejoint inévitablement la question délicate de l’universel. Il ne faut oublier, comme le rappelait Étienne Balibar en s’inspirant de la pensée hégélienne, de penser tout le paradoxe inné d’un tel concept[12]. Énoncer l’universel pour le penseur allemand s’est inévitablement et toujours le particulariser. En accord ou non avec cette hypothèse, il serait temps de nourrir à nouveau l’universalisme, en nous donnant peut-être cette fois les moyens de nos ambitions. Derrière cette question délicate que nous nous garderons de résoudre en lieu et place, nous nous contenterons d’évoquer un texte de Thomas Branthôme qui faisait la promotion d’un
« universalisme non-hiérarchisé, qui appelle à lui l’ensemble des hommes dans leurs origines diverses pour tisser un universalisme de rencontre provoquant ainsi une incessante mise à l’épreuve de soi par l’autre et de l’autre par soi : c’est l’universalisme latéral. C’est celui qu’il convient de construire. Car comme l’écrivait Henri Bergson […] l’universel n’est jamais donné »[13].
Rien n’est en effet donné, et rien n’est non plus éternel ni acquis pour de bon. Le but de cette réflexion est bien également de remettre au centre du creuset républicain « l’immigration » et ses acteurs, que l’on tend à dissimuler. La Nation démocratique n’est peut-être pas un modèle mort et enterré mais si nous ne voulons la voir disparaître au profit de formes plus radicales, il va nous falloir faire évoluer en profondeur nos visions de l’Autre. La nation politique et culturelle doit pouvoir s’adapter et la médiation fraternelle de la devise française doit pouvoir s’exprimer pleinement. L’ouverture vers l’autre ne doit plus être synonyme de la déperdition de l’identité française. Pourtant c’est bien à partir de mythes dépassés que l’incompatibilité se construit. L’institution doit se débarrasser de ce sentiment d’ascendant culturel aux relents coloniaux. Nous terminerons par les mots forts de sens de Norman Ajari dans un entretien donné au journal Mediapart :
« Je pense qu’il est de notre devoir d’essayer de changer les termes de la discussion. […] en sortant du fétichisme de la République que brandit le président, mais avec lui la gauche radicale, jusqu’à l’extrême droite. Je me félicite que la république soit cassée en deux. Ce n’est pas suffisant : il faut encore la jeter au fleuve et la laisser couler, comme la tête coupée de Colomb »[14].
Casser pour mieux reconstruire en somme.
Notes
[1] Ernest Gellner, Nations et Nationalismes, Payot, 1989.
[2] Immanuel Wallerstein, Capitalisme et économie-monde 1450-1640, Flammarion, 1980.
[3] John A. Hobson, Imperialism : A Study, James Pott & Compagny, 1902.
[4] Hannah Arendt, L’impérialisme, Les Origines du Totalitarisme, Point, 2010.
[5] Bartholomé de las Casas, Historia de las indias, Seuil, 2002.
[6] Giorgio Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, L’Ordre Philosophique, 1997.
[7] Laurent Bonelli, Les forces de l’ordre social, Le Monde Diplomatique, Juillet 2020.
[8] Simon Auffret, Contrôles d’identité : les jeunes 7 fois plus contrôlés que le reste de la population, Les Décodeurs Le Monde, Juillet 2017.
[9] Ivan du Roy et Ludo Simbille, Basta ! https://bastamag.net/webdocs/police/ ; PMG, Les gendarmes à l’origine de 13 % seulement des réclamations au Défenseur des droits, L’Essor, Mars 2019.
[10] Wendy Brown, Neo-liberalism and the End of Liberal Democracy Johns Hopkins University Press Volume 7, Issue 1, 2003.
[11] Emmanuel Macron, 14 Juin 2020.
[12] Etienne Balibar, Des Universels, Galilée, 2016.
[13] Thomas Branthôme, Minuit à l’heure de l’universalisme, AOC Media, Juin 2020.
[14] Rachida El Azzouzi, Norman Ajari: «La pensée décoloniale casse la République en deux», MediaPart, Juin 2020.