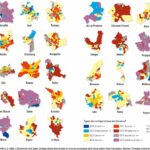L’abstention : un enjeu central pour la gauche de rupture
Co-auteur avec Vincent Tiberj et d’autres chercheurs, de Extinction de vote ?, Tristan Haute revient dans cet entretien sur les grandes tendances qui entourent la participation électorale, les fluctuations de l’abstention et les enjeux quant aux formes de politisation et d’engagement, en particulier des classes populaires et des jeunes générations.

Contretemps – Les années 2020-21 semblent être celles de l’explosion de l’abstention électorale dont la cause principale est généralement attribuée au Covid, mais on sait bien qu’il s’agit d’un phénomène de plus long terme. Peux-tu replacer la période contemporaine dans une histoire plus longue de l’évolution de l’abstention en France, et de ce que cette histoire révèle des évolutions des comportements électoraux ?
Tristan Haute – Il est vrai qu’on a souvent expliqué l’abstention massive lors des élections municipales de 2020 (44,7 % de participation au premier tour contre 63,6 % en 2014) puis régionales et départementales de 2021 (32,59 % au premier tour contre 49,91 % aux régionales de 2015) par le contexte sanitaire. Mais, si, en mars 2020, les personnes les plus à risque semblent avoir davantage boudé les urnes, ce n’était déjà plus le cas dès juin 2020. L’impact de la crise sanitaire a donc été plus global.
En premier lieu, la parole gouvernementale et les controverses politiques se sont concentrées sur la gestion de la crise, rendant bien difficile le fait de faire campagne autour d’autres enjeux. En second lieu, la crise et sa gestion ont alimenté, et c’est en partie une spécificité française, une défiance préexistante à l’égard des institutions politiques. En troisième lieu, en limitant les possibilités de campagne sur le terrain mais aussi en engendrant un repli des citoyennes[1] sur une forme d’entre-soi social, la crise sanitaire a participé à entraver la mobilisation électorale.
Pour autant, la crise sanitaire n’a fait que renforcer des processus préexistants : une abstention croissante liée à une défiance accrue à l’égard des institutions politiques et à un rapport au vote qui s’est transformé. Malgré des « pics » de mobilisation comme lors de l’élection présidentielle de 2007, l’abstention progresse de scrutin en scrutin depuis les années 1980 en France. Pour autant, cette abstention est loin d’être systématique : lors des dernières séquences électorales présidentielles et législatives, ce sont toujours moins de 15 % des électrices qui n’ont voté à aucun tour de scrutin et cette proportion n’a que peu augmenté entre 2002 et 2017 (+1,5 points). À l’inverse, c’est la participation intermittente, c’est-à-dire le fait de ne voter qu’à une partie des élections, qui progresse (+11 points entre 2007 et 2017) et devient majoritaire (51 %).
De plus, comme le montre mon collègue Vincent Tiberj[2], cette intermittence du vote, si elle reste minoritaire parmi les générations les plus anciennes, occupe une place de plus en plus majoritaire dans les jeunes générations. Cet écart générationnel révèle à quel point le vote s’est transformé. Il est de moins en moins perçu par les plus jeunes citoyennes comme un « devoir », fortement « ritualisé », et son statut d’acte d’expression politique le plus légitime et le plus efficace est aujourd’hui remis en cause.
Contretemps – L’abstention n’est pas un phénomène homogène. Peux-tu préciser comment se distinguent les différentes élections du point de vue de la participation ? Et comment l’abstention est différenciée selon les groupes sociaux ? Au-delà des générations dont tu as parlé, quelles sont les catégories pertinentes : CSP, statut (public/privé), diplôme, groupes professionnels, origine… ?
Tristan Haute – S’il y a intermittence du vote, cela signifie qu’il y a des élections plus mobilisatrices que d’autres, ou plutôt moins démobilisatrices. Aujourd’hui, le contexte de l’élection et ses enjeux, tels qu’ils sont perçus par les citoyennes, jouent un rôle déterminant dans leur mobilisation. Les élections présidentielles mobilisent davantage les citoyennes parce qu’elles les identifient comme celles qui auront les conséquences les plus importantes sur l’action publique en général et sur leur quotidien en particulier. À l’inverse, les élections législatives, devenues un scrutin de ratification, ou les élections départementales, régionales ou européennes, dont les répercussions des résultats semblent moindres aux yeux des électrices, mobilisent significativement moins.
Jusqu’en 2020, les élections municipales se trouvaient dans une situation intermédiaire : la proximité avec les élues, dans une partie des petites communes, pouvait compenser l’absence de véritables enjeux, faute de concurrence par exemple. Car l’offre électorale apparaît aussi de plus en plus comme un facteur déterminant : lorsqu’elle est restreinte, la démobilisation électorale s’en trouve renforcée, comme l’illustre parfaitement le cas de l’élection présidentielle de 2017 qui, contrairement aux précédentes séquences présidentielles, a vu un déclin de la participation entre les deux tours.
Pour autant, il ne faut pas oublier que la participation électorale est une pratique socialement inégalitaire. Avec la hausse de l’intermittence du vote, qui pourrait bien se traduire à terme par une hausse de l’abstention constante, le risque est grand qu’une majorité sociale devienne une minorité électorale pour reprendre les mots des politistes Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen[3].
Non seulement, du fait de la dynamique générationnelle déjà évoquée, les urnes sont de plus en plus grisonnantes, mais les classes supérieures y sont très nettement surreprésentés. En effet, plus les individus sont diplômés, plus ils votent, un résultat qui se vérifiait encore en 2017. De même, les cadres et, dans une moindre mesure, les professions intermédiaires participent bien plus que les employées et les ouvrières. À cela s’ajoute une surmobilisation des salariées du public par rapport aux salariées du privé, mais aussi une moindre mobilisation des salariées les moins qualifiées, notamment parmi les employées et les ouvrières comme l’a très bien montré Camille Peugny[4], ou encore des plus précaires.
Le contenu même du travail semble avoir un rôle : comme l’économiste Thomas Coutrot[5] et moi[6] le démontrons à partir de données différentes, le travail à la chaîne, par définition répétitif, dans la mesure où il produit un apprentissage à la passivité, va aujourd’hui de pair avec une démobilisation électorale plus importante.
On dispose de moins de données sur les effets propres de l’origine nationale, mais il est clair que les électrices nées à l’étranger ou de parents nés à l’étranger, parce qu’elles cumulent davantage de facteurs peu propices à la participation (plus jeune âge, emplois moins qualifiés et plus précaires, niveau de diplôme plus faible…) sont sous-représentées dans les urnes. Et toutes ces inégalités sont d’autant plus fortes que les élections sont peu mobilisatrices : contenues aux élections présidentielles, les distorsions entre la part abstentionniste de la société française et qui se rend aux urnes sont particulièrement importantes aux élections législatives, européennes, départementales ou régionales[7].
Contretemps – La politique et la participation ne se réduisent pas au vote. Est-ce que ces tendances reflètent un éloignement seulement de la politique électorale ou plus généralement de la politique considérée dans un sens plus large ? Est-ce que la montée de l’abstention peut être assimilée à ce que certains appellent une grève des urnes, et donc un phénomène porteur d’un certain type de politisation ? Quels types de politisation as-tu identifié ?
Tristan Haute – Si l’abstention est associée à un moindre degré d’intérêt pour la politique au sens large, son intermittence, dépendante du contexte et des enjeux, conduit à nuancer une association trop caricaturale entre abstention et dépolitisation. Certes, aux citoyennes « déférentes », qui votent de manière constante et par « remise de soi » pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu[8], s’ajoutent des « citoyennes distantes » qui s’expriment très peu politiquement, que ce soit dans les urnes ou par d’autres moyens.
Mais, comme l’a montré Vincent Tiberj pour le cas de la France[9], on voit aussi émerger une citoyenneté plus critique dans laquelle le vote « ne suffit plus » : la participation électorale, le plus souvent intermittente, s’accompagne alors du recours à d’autres modes d’action, de la manifestation à la pétition en passant par des pratiques de consommation engagée. C’est parmi ces citoyennes critiques vis-à-vis du vote que l’hypothèse d’une « grève des urnes » est la plus plausible, mais elle est loin d’être systématique, le vote étant le plus souvent intermittent. À l’inverse, l’abstention plus constante des « citoyennes distantes » s’explique par une condition sociale particulièrement peu propice à la participation politique, quelle qu’en soit la forme.
Contretemps – Si, comme tu le dis, l’abstention n’est pas systématique et la participation électorale peut prendre un caractère intermittent, notamment dans les plus jeunes générations, l’abstention y est-elle compensée par d’autres formes de participation ou d’engagement ?
Tristan Haute – Oui, au sein des jeunes générations, l’abstention s’articule davantage que dans le reste de la population avec le recours à d’autres formes de participation politique plus « protestataires », qu’on pense aux marches pour le climat ou aux mobilisations contre le racisme et les violences policières. Pour autant, c’est aussi dans ces plus jeunes générations que la part des citoyennes ne participant pas politiquement, par le vote ou par d’autres moyens, est la plus importante.
Ces différences correspondent en réalité aux segmentations sociales de ces jeunes générations, d’où l’importance d’articuler une approche « générationnelle » avec une approche attentive aux rapports sociaux de classe, de genre et de race, ce qui permet d’éviter de tomber à la fois dans un mépris anti-jeunes médiatiquement très présent et considérant l’abstention et la non-participation politique comme révélatrices d’un jemenfoutisme individualiste et, à l’inverse, dans un jeunisme décontextualisé qui consisterait à attendre que le renouvellement générationnel fasse son œuvre sans se soucier de ce qui se joue, au sein des jeunes générations, en termes par exemple de confrontation (différenciée) à diverses formes de discriminations, d’accès à l’éducation ou encore de conditions de travail et d’emploi.
Contretemps – À l’approche des élections de 2022, les partis qui ont peu de chances de gagner voient dans les abstentionnistes l’enjeu majeur qui pourrait créer la surprise. Comment analyses-tu les tentatives politiques et militantes en direction des abstentionnistes ?
Tristan Haute – À l’approche de l’élection présidentielle de mars 2022, une vérité semble s’imposer médiatiquement : la « droitisation », attestée par les mauvais résultats de la gauche dans les urnes et par ses performances désastreuses dans les enquêtes d’opinion interrogeant les intentions de vote en vue du scrutin d’avril prochain. Attention à l’illusion d’optique car, si la gauche enregistre des défaites électorales et reste à la peine dans les sondages, c’est parce qu’elle a construit ses succès sur la mobilisation des classes populaires et des jeunes générations, celles qui aujourd’hui sont les plus promptes à s’abstenir. Certains partis ou candidats ont dès lors adopté une position de renoncement, préférant aller convaincre celles qui votent encore en adaptant leurs discours et leurs programmes.
Néanmoins, cette stratégie, si elle a pu leur permettre de garder le contrôle de certaines collectivités locales, s’est révélée pour l’heure, à l’échelle nationale, à la fois inefficace et destructrice pour la gauche. L’enjeu pour la gauche est bien de remobiliser dans les urnes les classes populaires et les jeunes générations et de très nombreuses militantes s’y emploient. Cependant, si cet exercice est peut-être moins ardu lors d’une élection présidentielle, il est peu probable que cette remobilisation puisse se faire sur le temps court d’une campagne. En effet, le problème fondamental n’est pas seulement un problème programmatique ou un problème de représentation.
Il relève, d’une part, d’un travail politique de terrain qui s’est affaibli, a fortiori avec la crise sanitaire, alors que la mobilisation électorale dépend fortement des interactions sociales D’autre part, le problème est moins lié à la matérialité du vote, les expériences du vote par procuration, par correspondance ou par Internet montrant que celles qui se l’approprient sont celles déjà les plus prédisposées à participer, qu’à sa nature elle-même. Le vote est un acte de plus en plus perçu dans l’ensemble comme inefficace, dont on peut tout à fait se dispenser et dont la réduction à une technologie de désignation et de remise de soi est de plus en plus contestée.
*
Propos recueillis par Vincent Gay et Séverine Chauvel.
Illustration : Wikimedia Commons.
Notes
[1] Nous utilisons ici le féminin neutre.
[2] Voir le chapitre 4 de notre ouvrage.
[3] Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention : aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire, Paris, Gallimard, 2007.
[4] Camille Peugny, « Pour une prise en compte des clivages au sein des classes populaires. La participation politique des ouvriers et des employés », Revue française de science politique, 2015, n°65.
[5] Thomas Coutrot, « Chapitre 9. De la démocratie au travail, et vice versa », in Libérer le travail, Paris, Seuil, 2018, p. 223-244.
[6] Voir le chapitre 4 de l’ouvrage
[7] Voir les chapitres 4 et 5 de notre ouvrage ainsi que Céline Braconnier, Baptiste Coulmont, Jean-Yves Dormagen, « Toujours pas de chrysanthèmes pour les variables lourdes de la participation électorale. Chute de la participation et augmentation des inégalités électorales au printemps 2017 », Revue française de science politique, 2017, n°67, p. 1023-1040.
[8] Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.
[9] Voir le chapitre 3 de notre ouvrage.