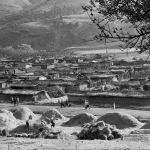Paris, capitale des parias
À propos de : Michael Goebel, Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism, New York, Cambridge University Press, 2015.

En 1945, la France régnait sur un vaste empire colonial, qui n’était devancé au niveau de son étendue – et de sa brutalité – que par les Britanniques. Cependant, alors que la Grande-Bretagne se débarrassa de son empire sans répercussion sérieuse pour sa politique intérieure, la France mena deux guerres coloniales féroces, en Indochine et en Algérie, avant de se retirer, vaincue, au début des années 1960. Entre 1946 et 1962, la France était constamment en guerre, mise-à-part un brève intervalle de quelques mois. Ces conflits ont dominé et finalement détruit la Quatrième République, donnant à la France la Constitution qu’elle a actuellement. Ce pays vit toujours dans l’ombre de ces luttes : le Front National serait incompréhensible sans le background algérien. Lorsque des démagogues ignorants accusent les « immigrés » de tous les maux de la France, ils oublient que beaucoup de Musulmans français descendent de ceux qui vinrent en Métropole alors que l’Algérie faisait encore partie de son territoire national. Un aspect important de cette histoire, que porte à notre attention l’étude fascinante de Michael Goebel, est que les révoltes qui aboutirent à la fin de l’empire français s’élaborèrent, en quelque sorte, au cœur même de l’impérialisme français : dans la ville de Paris. Goebel, qui enseigne à la Freie Universität de Berlin, est un spécialiste de l’histoire de l’Amérique latine : son premier livre, Argentina’s Partisan Past (2011), s’intéresse au rôle qu’a joué l’historiographie argentine dans la construction d’une identité nationale. Dans le livre qui nous intéresse ici, il avance l’idée que l’immigration vers la métropole française fut le « ciment social » de la formation d’une conscience anti-impérialiste qui allait transformer le monde après 1945. En effet, il va jusqu’à affirmer que le concept même de « Tiers-Monde » – un terme inventé dans les années 1950, qui eut une influence considérable sur la pensée politique des décennies suivantes – trouve son origine dans le militantisme des immigrés des années 1920 et 1930, avec l’« idée d’une solidarité anti-impérialiste traversant plusieurs continents ».
Au début des années 1920, Nguyễn Ái Quốc – qui se fera, par la suite, connaître sous le nom d’ Hồ Chí Minh, le leader communiste vietnamien et héros d’un nombre incalculable de chants de manifestations dans les années 1960 – était l’éditeur, basé en France, du journal Le Paria, un journal dirigé vers les victimes du colonialisme, qu’il s’agisse des immigrés en France ou de ceux restés dans leur pays d’origine. L’un de ces jeunes, radicalisés par une campagne électorale du Parti Communiste Français (PCF) durant cette même décennie était un jeune ouvrier algérien, Messali Hadj : il devint l’un des fondateurs de l’Étoile Nord-Africaine, de laquelle tous les mouvements conséquents luttant pour l’indépendance algérienne allaient découler – bien que dans les années 1950, Messali lui-même fut entraîné dans une tragique et meurtrière querelle avec les leaders du Front de Libération Nationale (FLN). Si ces deux hommes sont les plus connus, Goebel nous présente également une liste impressionnante de militants anti-impérialistes qui vivaient à Paris dans l’entre-deux guerres et qui y acquirent la majeure partie de leurs idées politiques. D’Algérie, il y avait Ferhat Abbas, qui devint plus tard une figure majeure du FLN. Du Vietnam, mise-à-part Hồ, on vit également arriver le militant trotskyste Ta Thu Thâu, qui eut de nombreux partisans dans les années 1930 et fut assassiné par le Viêt Minh en 1945. Lamine Senghor, du Sénégal, était l’un des organisateurs et écrivains noirs du PCF les plus remarquables, jusqu’à sa mort prématurée en 1927. D’autres venaient de pays non colonisés par la France. Zhou Enlai et Deng Xiaoping faisaient partie des « étudiants-ouvriers » de Paris à cette époque, tandis ce que l’Indonésie envoya Arnold Mononutu, qui joua par la suite un rôle important dans l’organisation de la conférence des nations afro-asiatiques nouvellement indépendantes de Bandung en 1955. L’Amérique latine fourni le marxiste péruvien José Carlos Mariátegui, sans mentionner deux de ses compatriotes, l’écrivain César Vallejo et le politicien Victor Raúl Haya de la Torre. En plus de telles figures majeures, Goebel a également identifié des personnages importants, relégués aux oubliettes de l’histoire, tel le grand militant Hadj Ali Abdelkader, contributeur régulier au Paria, qui, en tant que l’un des rares ouvriers nord-africains à posséder la nationalité française, fut candidat du PCF lors d’une élection et fonda l’Étoile Nord-Africaine avec Messali Hadj. Il resta un musulman pratiquant tout en faisant partie du comité central du PCF.
À la fin des années 1920, il y avait 100 000 non-Européens vivants à Paris, plus que dans n’importe quelle autre ville d’Europe. Pendant la Première Guerre Mondiale, environ trois-quarts de million d’indigènes (colonial subjects) furent amenés en France en tant que soldats ou ouvriers ; bien que cette nation ingrate fit de son mieux pour les rapatrier, certains restèrent sur place ou retournèrent en Métropole par la suite. Beaucoup d’autres étaient étudiants, mais il y avait également beaucoup d’ouvriers nord-africains dans l’usine automobile Renault : selon une source, en 1930, environ un quart de la force de travail de Renault-Billancourt venait d’outre-mer. La population immigrée contenait des étudiants-ouvriers comme Zhou et Deng qui combinaient leurs études avec des périodes de travail en usine, et étaient donc en contact direct avec des ouvriers français et immigrés. Évidemment, les immigrés de certains pays formaient leurs propres groupes. Cependant il y avait de nombreuses interactions entre les divers groupes nationaux qui apprirent les uns des autres en développant lentement des stratégies de lutte contre l’impérialisme.
Goebel dépeint une image saisissante et détaillée de ce qu’était la vie quotidienne de nombreuses communautés d’immigrés à Paris dans l’entre-deux guerres. Il y avait un riche tissu culturel. Les performances musicales permettaient aux immigrés de conserver un lien avec leurs cultures d’origine, mais encourageaient également les collaborations par-delà les frontières nationales. En 1936, un concert destiné à lever des fonds en soutient à l’Éthiopie qui devait faire face à l’agression italienne rassembla des musiciens antillais, créoles, italiens et arabes. L’auteur de ce livre s’intéresse également à la manière dont se sont développées des relations interpersonnelles. La grande majorité des immigrés étaient des hommes, des étudiants et des ouvriers, ce qui n’est guère surprenant pour l’époque. On vit ainsi l’émergence de bordels spécialisés dans les clients immigrés, mais également, et plus significativement, le développement de rapports étroits entre des immigrés et des femmes françaises. Cependant, le fort enracinement du racisme signifiait que, bien que la cohabitation fût assez largement étendue, les mariages étaient rares. Ceci-dit, un nombre surprenant de leaders anticoloniaux étaient mariés à des femmes françaises. Lamine Senghor aurait dit qu’il « ressentait encore plus fortement la condition des Noirs car il était marié à une femme blanche ».
Si Goebel perçoit, à juste titre, les complexités de la culture et de la vie quotidienne comme pourvoyant un contexte essentiel, il souligne également la centralité de la politique, mettant en lumière la manière dont la vie privée était politisée, et notant que « les questions sociales du quotidien des sujets-coloniaux en métropole » étaient « imbriqués aux politiques anticoloniales ». Pour la plupart, cela signifiait un ralliement au communisme. Il est vrai que certains militants anti-impérialistes furent attirés par le nationalisme de l’extrême droite européenne et montrèrent quelque sympathie pour la pensée fasciste, ignorant le racisme qui lui est inhérent. Mais pour de jeunes immigrés cherchant à comprendre le monde dans lequel ils vivaient ainsi que des moyens de le transformer, c’était surtout le Parti Communiste Français qui paraissait être un bon moyen d’aller de l’avant. Le PCF fut fondé en 1920 ; le jeune Hồ Chí Minh prit même la parole au cours de son congrès inaugural. Parmi les fameuses « 21 conditions » pour tout parti affilié à l’Internationale Communiste, on trouvait la suivante :
« (…) les Partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies ou opprime des nations, doivent avoir une ligne de conduite particulièrement claire et nette. Tout Parti appartenant à la IIIème Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de « ses » impérialistes aux colonies, de soutenir, non en paroles mais en fait, tout mouvement d’émancipation dans les colonies, d’exiger l’expulsion des colonies des impérialistes de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées et d’entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. »
L’attrait du communisme doit être compris à travers les contradictions de l’impérialisme français. Pour les jeunes immigrés, Paris offrait une expérience émancipatrice : il y avait des organisations politiques, des meetings, ainsi que des cafés maures servant de la nourriture nord-africaine, où les ouvriers algériens se réunissaient pour se plaindre de leurs conditions de travail et discuter politique. Les cafés offraient un terrain de recrutement particulièrement fertile pour l’Étoile Nord-Africaine. La capitale française permettait des contacts avec des intellectuels et des militants de gauche. La France était la patrie de la Révolution qui avait adopté la maxime « liberté, égalité, fraternité » et utilisait ces principes pour justifier sa « mission civilisatrice » à travers l’empire français. Pourtant, ce même empire était profondément et institutionnellement raciste. Les militants immigrés étaient sous constante surveillance, largement financée, et leurs organisations étaient fortement infiltrées, jusqu’à atteindre un tel point d’absurdité que des agents infiltrés faisaient des rapports sur d’autres agents – bien qu’il puisse y avoir un trafic à double-sens le long de cette route, telle était la force des idées radicales : Senghor commença en tant qu’informateur de la police mais fut tellement impressionné par ceux qu’il était censé espionner qu’il devint l’un des écrivains et organisateurs les plus efficaces du PCF.
Le racisme français était clairement visible dans le cas de l’Algérie. Constitutionnellement, ce n’était pas une colonie mais une partie de la France métropolitaine. Pourtant, la grande majorité des indigènes musulmans qui y vivaient n’étaient pas des citoyens français, uniquement des « sujets » qui ne jouissaient pas de droits politiques entiers. Il existait une procédure complexe pour acquérir la citoyenneté, comprenant une évaluation de la police et un rejet de l’applicabilité de la loi coranique. Il n’y eut guère que 6 000 Algériens musulmans ayant pleinement acquis la citoyenneté en 1939. Les autres étaient sujets au « code de l’indigénat », encore en vigueur après la Seconde Guerre mondiale, qui criminalisait toute forme d’insubordination ou de rébellion.
La première organisation à émerger fut l’Union Intercoloniale, formée par le PCF en 1921, qui publiait Le Paria ; d’autres groupes et journaux suivirent rapidement. Initialement, leurs revendications étaient plutôt modestes. Les militants immigrés travaillèrent en collaboration étroite avec le mouvement ouvrier français, qu’ils percevaient comme leur allié naturel. Nombreux sont ceux qui développèrent des rapports personnels avec des militants français ; ils pensaient souvent que les réformes étaient le moyen d’avancer, plutôt que de rompre complètement avec Paris. La revendication d’indépendance nationale se cristallisa graduellement face à l’entêtement français. En 1919, les militants vietnamiens demandaient l’amnistie pour les prisonniers politiques, la liberté de la presse et davantage d’éducation pour les indigènes, plutôt que la fin de l’empire. Peu après, le PCF dût faire pression sur Messali Hadj afin qu’il fasse de la liberté de l’Algérie l’une de ses revendications principales. Pour nombre d’immigrés, les questions économiques étaient plus importantes que la lointaine perspective de l’indépendance. Les ouvriers algériens en France ne pouvaient recevoir d’allocations familiales si leurs enfants vivaient en Algérie, puisque il était estimé qu’il s’agissait d’un « pays étranger », à rebours de l’orthodoxie constitutionnelle. Les anciens combattants indigènes recevaient également des pensions plus basses que leurs homologues français. Les immigrés attendaient de leurs organisations qu’elles se mobilisent sur de telles questions.
Peu de ces militants auraient pu imaginer les conflits sauvages qui allaient éclater en Indochine et en Algérie après 1945. Sans doute que si la France avait fait certaines concessions durant les années 1930, ces horribles guerres auraient-elles pu être prévenues. Mais l’impérialisme français était trop profondément ancré, et le courant politique dominant – comprenant la majorité de la gauche – était totalement résolu à maintenir l’Empire français en place. Les nationalistes constitutionnalistes vietnamiens arguaient en faveur d’une transition graduelle vers l’indépendance, en se basant sur le principe des droits universels qu’incarnait la République française. La réponse des autorités françaises fut de supprimer leur journal et de leur coller une étiquette d’« agitateurs anti-Français ». L’impérialisme français écarta ainsi les militants modérés et amena des éléments plus radicaux au premier plan. En rejetant et réprimant ceux qui prônaient des réformes modérées, Paris jetait les bases d’un futur plus sanguinaire.
Nous devons être reconnaissants à Goebel pour une étude qui met en lumière les racines de l’anti-impérialisme d’après-guerre et qui illumine ainsi notre compréhension de la période agitée pour la France de la décolonisation. Cependant, si l’auteur a ouvert certains champs importants de la recherche, il n’en a pas tiré l’analyse définitive. J’ai, en particulier, deux réserves majeures quant à son approche. Premièrement, ses sources principales sont les archives gouvernementales et de la police. Personne ne doute de la valeur de telles archives, et des historiens comme George Rudé en ont fait des utilisations valables. Or, comme le concède Goebel lui-même, ces documents posent également certains problèmes : notamment les préjugés et les perspectives de ceux qui étaient engagés dans ce travail de surveillance. Les policiers qui observaient les militants immigrés ne comprenaient que peu les activités réelles de leurs victimes et leurs perceptions étaient souvent distordues par une vision raciste et anticommuniste. Ils étaient également figés dans la mentalité impérialiste. Ni la police, ni ses dirigeants politiques, ne pouvaient se douter que l’Empire français allait s’effondrer dans les vingt années suivant la Seconde Guerre Mondiale. Bien que Goebel ne partage pas la myopie de ces sources, et fait attention quant à ses propres valeurs politiques, il fait souvent montre de bien moins d’empathie à l’égard de ses sujets – se référant, par exemple, à ces militants immigrés comme à des « entrepreneurs ethnopolitiques ». Le Paria et les journaux communistes et anti-impérialistes attiraient certains écrivains de talent. Il aurait été mieux, pour Goebel, de les laisser se défendre avec leurs propres mots, plutôt que de les présenter à travers les observations d’espions de la police. Une étude de la presse anti-impérialiste de l’entre-deux guerres offrirait une contribution de taille à notre compréhension de cette période.
Deuxièmement, Goebel n’est pas assez rigoureux dans son approche chronologique ainsi que dans sa périodisation, appréhendant les années s’écoulant de 1918 à 1939 comme un bloc homogène et sautant d’une date à l’autre. C’est d’autant plus regrettable que le principal protagoniste politique auquel il s’intéresse, le PCF, subit une évolution extrêmement marquée, tant d’un point de vue politique que d’un point de vue de sa composition, durant ces deux décennies. Le PCF, nouvellement formé, du début des années 1920, lorsque Le Paria fut lancé pour la première fois, était une organisation vivante, bien qu’erratique par moments, avec d’importantes divergences internes. Beaucoup de ceux qui jouèrent un rôle clé dans la fondation du parti ainsi que dans sa construction durant ses premières années, notamment ceux venant du syndicalisme, disparurent par la suite lorsque les influences de Zinoviev puis de Staline devinrent plus fortes ; le résultat en fut que ceux-ci furent très largement relégués aux oubliettes de l’histoire. Il en va de même pour plusieurs têtes de file du militantisme anti-impérialiste.
La période du Front Populaire, une décennie plus tard, était très différente. Le PCF était désormais solidement sous le contrôle de Moscou, et sa priorité absolue était l’anti-fascisme. Comme le montre Goebel, la communauté immigrée de Paris joua un rôle dans les grandes mobilisations contre le fascisme et dans le soutien au Front Populaire. Mais la subordination de toutes les autres tâches politiques à cet impératif compromit sérieusement l’anti-impérialisme du PCF : celui-ci cessa par exemple de demander l’indépendance de l’Algérie. Pour ceux venant des colonies, les choses étaient assez différentes. Les ouvriers français s’opposaient assez naturellement au fascisme, car ce-dernier signifierait la suppression de leurs droits et libertés durement gagnés. Mais, dans une large mesure, les indigènes ne jouissaient initialement pas de ces droits et libertés, et le focus total sur l’anti-fascisme ne reflétait pas leurs intérêts de la même façon. Si l’on ne prend pas en compte l’évolution du PCF, les arguments quant aux rapports entre le parti et les divers mouvements pour l’indépendance des colonies se transforment trop aisément en discussion sur le « nationalisme » et le « colonialisme » en tant que catégories abstraites. Néanmoins, Goebel a mis en évidence un matériau fascinant ; espérons que celui-ci serve de stimulus à de futures recherches.
*
La version originale de ce texte fut initialement publiée dans la New Left Review, n°98 (Mars-Avril 2016).
Traduit de l’anglais par Selim Nadi.
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.