
Femmes et genre en Irak. Un extrait du livre de Zahra Ali
Dans Femmes et genre en Irak (Ed. Syllepse, 2022), la sociologue Zahra Ali rend compte de la situation des femmes et du féminisme dans un pays blessé par des années de guerre. A partir d’une enquête au long cours menée dans la décennie 2010, elle s’appuie sur d’importantes données ethnographiques pour donner à voir la chute d’un pays qui était l’un des plus développés du Moyen Orient, et est désormais un territoire fragmenté, contrôlé par des hommes en armes, empreint d’une violence permanente.
Cette situation pèse particulièrement sur les femmes, mais ces dernières ne sont pas de simples victimes. Elles constituent en effet un acteur majeur de la survie de la société irakienne. Envisager la situation des femmes et les perspectives féministes irakiennes, c’est pour Zahra Ali s’éloigner de toute approche culturaliste qui ne verrait le réel qu’à travers le poids de l’Islam pesant sur les populations. A travers une analyse féministe postcoloniale et transnationale de l’histoire socio-politique contemporaine de l’Irak, Zahra Ali propose une contribution majeure aux débats féministes contemporains.
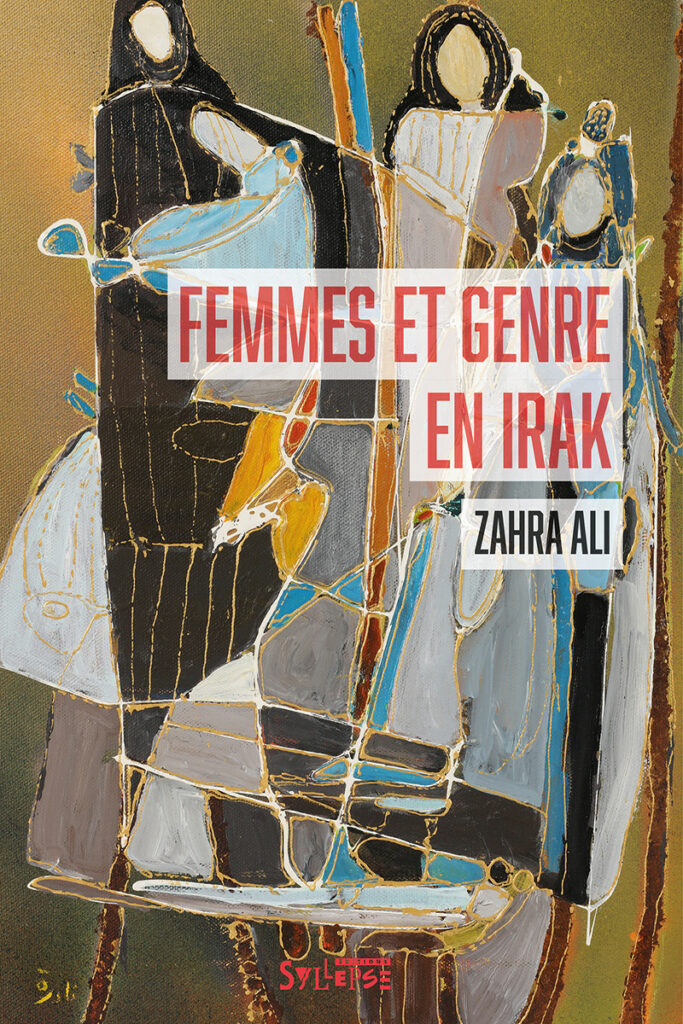
L’Irak post-invasion : violence confessionnelle, conservatisme et nouveau régime
Violence confessionnelle, conservatisme, faiblesse et dysfonctionnement du nouvel État
L’invasion a mis fin aux sanctions économiques des Nations unies ce qui a eu un impact considérable sur le revenu moyen des Irakien·nes. Pourtant, la poussée vers la libéralisation économique, la privatisation généralisée et les investissements étrangers (J. Ismael et T. Ismael, 2015), surtout en faveur des intérêts économiques américains, caractérise le contexte post-2003. Bremer estime que l’Irak reste un État rentier, mais la détérioration des gisements de pétrole pendant la guerre, en plus des politiques de l’OPEP, a fait qu’il a fallu un certain temps pour pouvoir tirer pleinement profit des recettes pétrolières (Bayt al-Hikma, 2009). Pour que l’Irak surmonte l’impact dramatique de l’embargo et des guerres sur ses infrastructures, son éducation, sa santé et ses services publics, un plan de reconstruction et de développement bien géré était nécessaire. Il n’avait cependant pas encore été lancé en raison des manques de l’administration et de la corruption institutionnalisée[1] de l’élite politique[2]. Considéré comme le plus grand scandale de corruption de l’histoire, l’argent pour la « reconstruction », octroyé par les États-Unis et les programmes des Nations unies pour le développement et l’habitat au cours des premières années d’occupation, s’était évaporé du pays (Lafourcade, 2007). L’argent versé n’est visible nulle part dans les rues, les bâtiments, les infrastructures, les secteurs de l’éducation et de la santé. Zaid Al-Ali (2014 : 103-124) attire l’attention sur le fait que la corruption sous sa forme institutionnelle et le népotisme sont les causes majeures de la violence politico-confessionnelle en Irak.
Je soutiens pour ma part, en accord avec Yousif (2016), que la situation économique depuis 2003 doit être vue comme une continuation de la période des sanctions. L’Irak post-invasion a suivi la voie entamée dans les années 1990, marquée par une dégradation continue des infrastructures et des services publics, malgré la fin des sanctions économiques en 2003. Yousif (2010) et Sassoon (2016) ont mis en évidence l’« économie politique » du confessionnalisme en Irak et son impact dévastateur sur le fonctionnement des services étatiques et des institutions vitales. La corruption profondément enracinée dans le système politique ethno-confessionnel crée de nouvelles formes de népotisme basées sur les appartenances ethno-confessionnelles. L’économie rentière de l’Irak repose sur ses ressources pétrolières gérées par l’État. Dans ce contexte, le système politique caractérisé par la corruption ethno-confessionnelle a prouvé son inefficacité. Aussi, au lieu de résoudre la crise socio-économique dans laquelle le pays était plongé depuis les années 1990, l’ère post-invasion l’a prolongée, lui donnant un caractère ethno-confessionnel.
Le nouveau régime semblait suivre les traces du précédent en matière de dépenses pour l’armement et la sécurité. Les conflits confessionnels et l’opération militaire contre l’organisation État islamique (ÉI) dans le Nord du pays expliquent les dépenses du nouveau régime dans ces domaines et aucun signe n’indique la fin du cycle de violence commencé en 2003. Depuis l’embargo, la pauvreté et l’analphabétisme caractérisent la société irakienne, et le chômage atteint 30 %. Il y a une crise du logement et un manque des services de base comme l’accès à l’eau courante et à l’électricité, surtout dans les campagnes. Telle est la situation plus d’une décennie après la chute du régime. En 2007, plus de la moitié de la population irakienne vivait avec moins d’un dollar par jour. La malnutrition aiguë a plus que doublé depuis 2003, affectant non moins de 43 % des enfants âgés de 6 mois à 5 ans à l’été 2007. La moitié des ménages sont privés d’installations sanitaires saines. Il y a un manque criant de médicaments et de matériel médical, et plus de 15 000 médecins ont été tués, kidnappés ou ont fui le pays. Même à Bagdad, l’État fournit au maximum cinq heures d’électricité par jour. La crise économique est généralisée avec l’absence de stabilité politique, à laquelle vient s’ajouter la privatisation agressive et généralisée de tous les aspects de la vie (eau, électricité, santé, éducation) et une libéralisation qui a provoqué une augmentation drastique des prix des denrées de base et des produits de première nécessité. Ainsi, la majorité des Irakien·nes sont pauvres alors qu’ils vivent dans un pays riche. Aucune politique réelle n’a été mise en œuvre par le nouveau régime pour faire face à cette réalité. L’État, déjà affaibli par plus d’une décennie d’embargo, manque à son rôle de pourvoyeur social et économique.
Entre 2006 et 2007, la guerre civile confessionnelle a fait en moyenne 1 000 morts par semaine, principalement des civils, et environ 2,5 millions de déplacé·es internes et externes selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Les explosions et assassinats hebdomadaires (sinon quotidiens) se perpétuent encore aujourd’hui. L’invasion de Mossoul par l’ÉI en juin 2014, et de certaines parties du nord de l’Irak, a exacerbé les tensions confessionnelles et replongé le pays dans un cycle de guerre et de militarisation.
Heba I. a été témoin de la montée du confessionnalisme, même parmi les intellectuel·les, lorsqu’elle est retournée en Irak en 2004. Elle raconte l’atmosphère de chaos dans le pays.
« À mon retour du Yémen, l’idée de voir des soldats américains marcher dans nos rues m’angoissait. Je me demandais comment j’allais réagir ; j’avais peur de trop en pâtir. Mais ce qui m’a fait le plus mal, ce n’était pas ça. À mon arrivée, j’ai trouvé un pays dont les frontières n’étaient contrôlées par personne, laissé à l’abandon. J’avais apporté beaucoup de livres du Yémen, mais il n’y avait personne pour inspecter ce qui était en ma possession. Le chauffeur a ri en voyant ma surprise car mon passeport n’avait même pas été contrôlé. Cela m’a brisée. Je n’aime pas parler de ça. Mais comme on dit, ce qui est personnel est politique. Tout ce que je viens de dire est politique. J’y crois. […] À mon retour, la première chose que j’ai faite a été de me rendre rue al-Mutannabi pour voir mes amis. J’ai été choquée par la mentalité là-bas. Ceux avec qui j’avais grandi sortaient des guerres et des sanctions. Tous ceux que je connaissais depuis tellement d’années commençaient à réfléchir différemment. Je me suis dit : « Avons-nous besoin d’une autre dictature pour tous nous sentir irakiens ? » Aujourd’hui, tout le monde s’accorde sur une façon de penser si éloignée d’avant. Nous parlons en termes identitaires, nous faisons des catégories : « Celui qui s’oppose à la guerre est un baasiste ; celui-ci est de telle communauté et celui-là de l’autre. » La façon de penser a tellement changé. Ça m’a beaucoup affectée quand je suis revenue. »
La violence confessionnelle a eu un impact sur la vie quotidienne des militantes. Parmi celles interrogées, la plupart avaient vécu directement la violence post-invasion, à travers la mort d’un conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’une cousine ou d’un voisin. Les explosifs sont la première cause de mortalité des femmes et de dégâts contre les infrastructures de santé (WILPF, 2014). La population fait en sorte de se frayer un chemin dans Bagdad. La stratégie la plus courante est d’éviter de franchir les frontières confessionnelles en restant dans son propre quartier. Dans ce contexte, une personnalité publique s’avère particulièrement exposée à la violence. Wafa F., par exemple, était mariée à un représentant du conseil provincial de Falloujah. Son mari, un islamiste chiite, a été tué devant elle et ses trois enfants à l’entrée de leur maison par des hommes armés qui tentait de vider le quartier de ses habitant·es chiites. À la suite de l’exécution de son mari, Wafa a été avertie qu’il fallait quitter la ville si elle voulait rester vivante. Elle est partie s’installer avec ses enfants dans un quartier populaire chiite de Bagdad. Femme au foyer pendant près d’une décennie, Wafa a dû ouvrir un nouveau chapitre et chercher un travail afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle s’est engagée dans Al-Fazila, un parti islamiste chiite, qui lui a offert soutien et protection. La plupart des militantes interrogées, en particulier des personnalités publiques et médiatiques, ont reçu des menaces de mort ou été visées directement par la violence, au moyen par exemple d’explosions à la voiture piégée devant leur bureau ou leur domicile. Certaines ont dû fuir le pays ou vivre dans la zone verte de Bagdad, mais beaucoup sont restées à Bagdad. D’autres se sont installées dans des zones contrôlées par leur confession, car leurs quartiers avaient été attaqués par les milices confessionnelles.
Militante des droits des femmes très active au sein de la Ligue de la femme irakienne, Ibtihal I., âgée de 39 ans, raconte comment un groupe d’hommes armés a placé des explosifs devant son domicile en 2007. L’événement s’est produit après qu’elle ait reçu plusieurs menaces de mort de la part de milices islamistes conservatrices, sous forme d’appels téléphoniques et de messages. Fort heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur de la maison à ce moment-là. Ibtihal parle de l’incompétence de la police et du manque de volonté pour l’aider à trouver les auteurs de l’agression et assurer sa protection. Elle évoque l’atmosphère de Bagdad en 2006-2007 et ce qu’elle ressent à cet égard.
« Tu sais, en 2006 et 2007, les rues étaient vides après 14 heures. Il n’y avait pas de vie à Bagdad. Le lendemain, tout était ouvert à 8 heures du matin. Mais les gens avaient peur de sortir très tôt ou après 14 heures. La violence était partout. Groupes armés, menaces de mort, milices, la réalité de tous les jours était terrible, effrayante. Jusqu’à aujourd’hui, tu sais, la vie a perdu sa valeur en Irak. Un désaccord entre les dirigeants politiques donne lieu à de la violence dans les rues. Nous sommes tous les jours confrontés à la mort ; tout Irakien qui sort de chez lui n’est pas sûr de revenir vivant. L’Irak s’est transformé en théâtre de la mort. Même quand nous avons des moments de joie, on a l’impression de les voler. Et on se retient de dire Allah yesterna [« Que Dieu nous protège »]. Le pire, c’est que nous n’avons même pas d’État, de gouvernement auprès duquel chercher protection ou nous plaindre. »
La nouvelle classe de politiciens, choisis selon des critères ethno-confessionnels, a construit sa base politique en s’appuyant sur la tribu ou la confession, non sur une vision positive et inclusive de la reconstruction nationale. La dimension confessionnelle de la re-tribalisation de la société, constatée par beaucoup et commencée sous le régime baasiste, a été exacerbée dans le chaos qui a suivi l’invasion. Si cette re-tribalisation revêt des dimensions conservatrices, surtout en ce qui concerne les questions de femmes et de genre, comme le notent à juste titre J. Ismael et S. Ismael (2008, 2007), elle a également été analysée comme une récupération par la société de son fonctionnement intrinsèque, dans un climat dominé par les milices islamistes armées. De récentes recherches, comme celles de Carroll (2011) et Hamoudi, Al-Sharaa, Al-Dahhan (2015), montrent que loin d’être hostiles au droit étatique, les tribus irakiennes l’ont souvent adopté, en coopération avec le droit tribal afin de maintenir l’ordre dans leurs domaines respectifs. Les chefs tribaux à Bagdad (Carroll, 2011) et dans le sud de l’Irak (Hamoudi et col., 2015) ont tous exprimé le souhait d’un système juridique étatique juste et fonctionnel, ainsi que le ressentiment d’avoir à assumer un grand nombre de rôles revenant à l’État. Ces récentes études soulignent en outre que, dans le climat actuel de non-droit et d’absence d’un système judiciaire fonctionnel, éloigné de la corruption et des conflits armés, les modes de réconciliation tribaux transsectaires dans leur nature même, dès lors que les tribus sont composées de deux confessions, se sont avérés plus efficaces dans le traitement de conflits confessionnels extrêmement violents. Les chefs tribaux sont inquiets de la répartition de leurs territoires selon des axes communautaires, résultant des conflits entre les nouvelles forces en concurrence, représentées par les milices armées. Ces milices étant liées au gouvernement, les individus sans aucune connexion avec la nouvelle élite politique se sont tournés vers leurs chefs locaux pour résoudre les conflits. Carroll (2011) rappelle à juste titre que, lors des terribles violences politico-confessionnelles de 2006-2007 et au-delà, il était difficile de résoudre les conflits dans un contexte de violence généralisée souvent anonyme. Seul le système tribal a été capable d’engendrer le pardon et la réconciliation interconfessionnelle.
En plus de l’insécurité généralisée ayant conduit à la mort de nombreuses militantes, la plupart des femmes interrogées ont remarqué combien la montée de normes de genre conservatrices a affecté leur tenue vestimentaire et leur capacité à se déplacer librement dans des quartiers spécifiques de Bagdad. Comme beaucoup de quartiers sont contrôlés par des milices et des groupes armés soutenus par des partis islamistes conservateurs, un grand nombre de femmes ont été témoins ou subi des incidents dus à leurs vêtements ou leur comportement lors du passage aux checkpoints. Même les militantes chrétiennes préfèrent porter un châle ample sur leur tête lorsqu’elles se déplacent entre les différents quartiers de la capitale. Généralement, dans les villes dominées par les sunnites, les femmes portent la jubba (hijab et long pardessus) et dans les villes dominées par les chiites, comme le Sud, elles portent une abaya noire par-dessus leur foulard et se couvrent les pieds avec des chaussettes noires. Plusieurs femmes interviewées ont mentionné des incidents tels que la fermeture de salons de coiffure ou des attentats à la voiture piégée visant à interdire aux femmes de conduire.
En plus des violences commises par les milices islamistes conservatrices, des militantes politiques ont été sujettes à la violence parce qu’elles appartenaient à l’opposition au nouveau régime. L’infiltration d’hommes armés cagoulés et de saboteurs dans les manifestations contre le gouvernement fait désormais partie de la scène politique. Plus généralement, un sentiment accablant de tension a été instauré par la violence, les postes de contrôle, les T-walls, la fragmentation ethnique, religieuse et confessionnelle de Bagdad et la domination de milices armées en compétition dans les rues. Cette impression m’a été communiquée à plusieurs reprises : « Avant il y avait un Saddam ; aujourd’hui, il y a un Saddam à chaque coin de rue. »
Diverses formes de violations des droits humains, arrestations arbitraires et emprisonnements de militants de la société civile par les forces gouvernementales, ont été signalées. Au cours de mes entretiens, beaucoup de militantes des droits des femmes m’ont expliqué que la répression des mobilisations politiques contre le nouveau régime exposait les femmes à une double peine, car la torture et l’emprisonnement étaient souvent synonymes de violences sexuelles pour elle. Les cas d’hommes et de femmes victimes de viols et de multiples modes de torture dans les prisons irakiennes montrent l’échec du nouveau régime à garantir les droits fondamentaux des citoyens. Les expériences de violence et de répression par les forces gouvernementales ont un impact sur les mobilisations de la société civile dans l’Irak post-invasion.
Comme mentionné dans l’introduction de ce chapitre à propos de Medinat Al-Sadr, la violence généralisée dans laquelle l’Irak a été plongé depuis 2003 va au-delà des violences entre milices sunnites et chiites. Comme le souligne Harling (2012), le conflit intra-chiite a des dimensions de classe opposant les exclus de la société, représentés par le courant sadriste et d’autres coalitions de conservateurs composées de la classe moyenne, de l’élite commerciale vivant de l’industrie du pèlerinage et de tribus ayant des liens historiques étroits avec les sanctuaires de Najaf, Karbala et Kazimiyya. À cette violence politico-classiste s’ajoute une forme très singulière de criminalité par des groupes armés qui tirent profit de l’extrême faiblesse de l’État et de la situation de non-droit, surtout les premières années après l’invasion, pour commettre des assassinats et des enlèvements contre rançon. Les groupes armés sunnites et chiites ont ciblé des représentants de la classe moyenne cosmopolite, tels que les médecins, les professeurs, les ingénieurs ou les avocat·es vivant dans des zones mixtes de Bagdad et incarnant ce qui restait d’une population mixte et techniquement qualifiée. Par exemple, l’Association des avocats irakiens a déclaré en 2007 que, depuis 2003, le nombre d’avocat·es avait diminué de 40 % car 210 avocat·es et juges avaient été assassinés depuis l’automne (Sassoon, 2012b).
La faiblesse structurelle du nouvel État, son incapacité à garantir la sécurité et à répondre aux besoins fondamentaux, comme l’accès à l’eau courante, à l’électricité, au logement et à l’emploi, mais aussi la mauvaise gestion et la corruption, ont poussé les Irakien·nes à s’appuyer sur des sources alternatives de protection et de services (Dodge, 2005). Selon de nombreux militants interrogés, et conformément aux rapports sur les violations des droits humains en Irak établis par Amnesty International en 2011 et 2013 relatifs aux abus et à la négligence envers les détenus, le non-respect des droits humains fondamentaux par l’armée et les forces de sécurité est courant. La répression violente du mouvement sunnite dans la province d’al-Anbar, et plus généralement de tous les mouvements de protestation contre le nouveau régime, est monnaie courante[3]. Les récents travaux d’Ala Ali (2014) au sujet de l’implication des femmes d’al-Anbar dans le conflit montrent que celles-ci ont exprimé leur attachement à l’« État » à l’extérieur de toute appartenance confessionnelle. Elles ont par exemple demandé à l’État d’intervenir contre les groupes d’al-Qaïda plutôt que de s’appuyer sur les chefs tribaux locaux. Comme l’observe Ali, dans les provinces dominées par les sunnites, les femmes restent attachées à un « État unifié », protecteur de leurs vies et de leurs intérêts.
Dans un contexte marqué par la violence et un État faible, où les individus sont amenés à compter sur des sources alternatives de protection et de sécurité, le leadership tribal a gagné du terrain. Il n’est donc pas surprenant qu’un grand nombre de chefs tribaux et dirigeants politiques aient choisi de rejoindre l’ÉI en juin 2014, lors de sa prise de Mossoul. Après cet événement choquant, le Grand Ayatollah Sistani, le plus important leader religieux d’Irak, a appelé au « jihad pour préserver l’Irak », incitant des milliers de civils à se joindre aux opérations militaires contre l’ÉI. La fragmentation de l’Irak selon des axes communautaires – Kurdes au nord, sunnites à l’ouest, chiites au sud – semble ainsi irréversible.
Notes
[1] En 2014, l’Irak figurait parmi les dix pays les plus corrompus au monde.
[2] Al-Ali (2014), Ismael et Ismael (2015 : 13-39).
[3] International Crisis Group (2013), Dodg (2013).









