
La gauche et la « question noire ». Entretien avec Pap Ndiaye
Pap Ndiaye est l’auteur de La Condition noire. Essai sur une minorité française, Calmann Lévy. Il est maître de conférences d’Histoire à l’EHESS. Ses travaux en cours portent sur les discours et pratiques de discrimination raciale aux Etats-Unis, ainsi que sur diverses questions relatives aux populations noires des Etats-Unis et de France. Il est aussi membre du Conseil scientifique du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN).
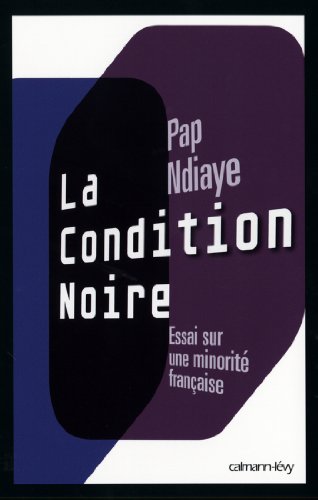
Vous vous présentez dans votre livre comme un chercheur engagé, pourquoi avez-vous voulu écrire sur la population noire en France alors que vous êtes plutôt spécialiste des Etats-Unis ?
Depuis quelques années, on observe en histoire et en sciences sociales un renouvellement de l’engagement politique et civique, après les années 1980 et 1990 qui avaient été plutôt marquées par une prise de distance du monde universitaire par rapport à la chose politique. A l’exception notable, bien sûr, de Bourdieu, très présent sur le terrain des luttes. On observe aujourd’hui un regain d’engagement, selon des modalités différentes du passé, avec une nouvelle génération de chercheurs. Je m’inscris dans ce mouvement, et le programme Frontières>[1] auquel je participe en est un exemple typique : il consiste à travailler sur les frontières dites intérieures et extérieures, et rassemble des chercheurs qui conçoivent leur travail intellectuel en relation avec des enjeux politiques contemporains.
Ces formes d’engagement me semblent bienvenues, pour peu qu’elles soient explicitées. Dans l’introduction de mon livre, je dis « d’où je parle », pour reprendre la vieille interpellation. En ce qui me concerne, je suis engagé du côté de l’organisation politique des minorités, et singulièrement la minorité noire en France, via le conseil scientifique du CRAN. Il s’agit d’une instance qui rassemble des universitaires non membres du CRAN, mais qui souhaitent manifester leur sympathie pour le CRAN, et lui donner un coup de main. Ce n’est pas un engagement associatif, mais une manière d’être dedans tout en gardant une distance critique. Autrement dit, je ne suis pas le représentant du CRAN.
En écrivant ce livre, j’ai le sentiment d’être resté américaniste. Il me semble que les sciences sociales états-uniennes sont indispensables à la compréhension des situations minoritaires en France, compte tenu du retard que nous avons. L’exercice de la comparaison l’est également. J’écris donc en américaniste, même si mon objet n’est pas américain. Je ne peux pas nier qu’il constitue un déplacement par rapport à mon objet principal d’études, mais je pense que c’est un sujet important et je ne voyais personne d’autre le faire. On a vu apparaître de façon évidente ce qu’on a coutume d’appeler « la question noire » dans les médias, de façon plus ou moins virulente, par exemple à travers des questions mémorielles ou sociales liées aux discriminations. Mais ces questions-là n’étaient pas sous-tendues par des ouvrages suffisamment solides et posés.
Dans votre livre, vous montrez à la fois en quoi les catégories raciales sont des constructions sociales, et les effets bien réels de ces construits sociaux, en rendant compte d’expériences subjectives communes de discriminations. Comment distinguez-vous et articulez vous les notions de minorité noire et d’identités ?
J’utilise le terme de minorité au sens où il circonscrit un groupe de personnes unies par l’expérience sociale d’être considéré comme noir. Cela permet de mettre de côté des notions plus « épaisses » culturellement parlant, comme la notion de « communauté », qui induit des liens culturels étroits entre ses membres, et qui, de surcroît, bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle dans les pays où elle a cours. Cette reconnaissance n’existe pas en France. J’ai donc préféré la notion de minorité, plus fine culturellement et identitairement parlant. Appartenir à la minorité noire, c’est être considéré comme noir dans une société qui majoritairement ne l’est pas, avec des stigmates attachés à cette condition. Je distingue deux formes d’identité : les identités épaisses, familiales, de filiation, les origines. Et puis les identités fines, comme l’expérience d’être considéré par les autres comme noir. Les personnes que j’ai pu interroger font état, en situation de confiance, de leurs identités épaisses, de leur pays d’origine ou celui de leur parent, de leur filiation, ou encore de leur groupe « ethnique ». Elles peuvent inclure, ou pas, leur identité noire dans ce portefeuille identitaire. Certains disent « je ne suis pas noir », notamment les Antillais, qui répugnent à l’identification noire, tant celle-ci est lestée négativement dans le monde caribéen. Mais beaucoup ne répugnent pas à cette identification pour peu qu’elle n’élimine pas d’autres aspects de leur identité. Elles disent « je suis noir » mais aussi « lillois » par exemple, et font état de différentes attaches. Indépendamment de cette richesse identitaire, ces personnes sont considérées comme noires dans une partie de leur expérience sociale. Voilà ce qui fonde leur expérience minoritaire.
Etes-vous favorable à une politique de reconnaissance pour les minorités ?
Parler de « minorité », en France, suscite moins de rejet que parler de « communauté ». Cette notion est plus compatible avec l’idéologie républicaine. Surtout, elle oblige à réfléchir politiquement sur les discriminations. Le terme de minorité visible s’est désormais imposé dans le vocabulaire, dans le discours politique. Il est relativement admis, par la Halde[2] par exemple, ce qui n’était pas le cas il y a quinze ans. Il faut noter d’ailleurs que ce terme est importé du Canada. Je pense que cette émergence est en lien avec l’apparition de la notion de « discrimination ». Le terme de minorité fait donc l’objet d’une forme de reconnaissance institutionnelle, ce qui est une première étape.
La condition noire est imbriquée avec d’autres questions : esclavage, colonialisme, migrations. Quels liens faites-vous entre ces différents aspects ? Comment percevez-vous une dénomination comme celle d’Indigènes de la République ?
J’ai pris le parti pris de me concentrer sur la France métropolitaine. De ce fait, le système de l’esclavage, au sens institutionnel du terme, n’est pas central dans mon livre. Cette remarque me semble importante en ce que la place de l’esclavage a pris une telle importance, légitime au demeurant, que pour beaucoup de Noirs, leur histoire se confond avec elle. Or il est possible d’écrire sur les populations noires sans que l’esclavage soit central, parce que l’institution de l’esclavage n’existait pas en France métropolitaine. Les esclaves qui arrivaient sur le sol français pouvaient demander leur affranchissement. C’est une différence avec l’Espagne par exemple.
La question de la colonisation est tout aussi intéressante, car aujourd’hui les historiens de la colonisation réfutent la vieille distinction entre histoire de la métropole et histoire coloniale. Les historiens du national s’occupaient peu des questions relatives au fait colonial. Cette distinction a perdu de sa pertinence, les deux historiographies sont beaucoup plus imbriquées aujourd’hui. Il y a une France coloniale dans la France nationale. Il y a donc beaucoup de colonial dans mon livre alors qu’il concerne le territoire métropolitain. C’est à partir de la Première Guerre mondiale que le nombre de personnes noires en France a été multiplié par 10, dès l’automne 1914. Le gouvernement s’est soucié de cette présence de soldats et d’ouvriers noirs, il a essayé de réguler des relations jugées trop proches entre la population française et ces soldats et ouvriers. Le « mélange des sangs » était un sujet d’inquiétude pour les pouvoirs publics. En 1918, ils se sont d’ailleurs empressés de rapatrier ces colonisés alors qu’il y avait de gros besoins de main-d’œuvre en métropole. Les questions de ligne de couleur, de « color line », sont devenues importantes en métropole, alors qu’elles comptaient peu auparavant. Je suis en train de me pencher sur la question des mariages dits mixtes, sur leur gestion par les maires. Ces préoccupations sont liées, il faut le dire, à la pureté de la race, et elles sont aussi un sujet d’inquiétude dans les colonies qui craignent de voir des filières migratoires raréfier la main d’œuvre. Les questions de colonisation sont donc bien présentes dans la réflexion sur la condition noire pour peu qu’on abandonne la distinction classique entre le colonial et le national.
Pour autant, il ne faut pas mélanger le » colonial » et le « racial », pour deux raisons. D’une part, le statut de l’indigénat était bien particulier, réglé par le droit, et son application ne peut avoir dans la France d’aujourd’hui qu’une valeur métaphorique, tout au plus. Nous ne sommes pas dans une situation d’indigénat, même si les descendants d’indigènes sont placés dans une situation de domination. Toute situation de domination n’est pas une situation coloniale. D’autre part, les personnes minoritaires elles-mêmes rechignent à la qualification d’indigène, à l’exception de quelques-unes politiquement plus aguerries C’est une notion fortement stigmatisante, surtout pour des gens qui insistent sur l’égalité des droits. Ce facteur a été sous-estimé par un mouvement comme celui des Indigènes de la République, même s’il a eu le mérite de jeter un pavé dans la mare. Les effets ont été relativement incertains. Le terme renvoie à des expériences trop humiliantes, qui n’ont pas permis un processus d’inversion du stigmate, par lequel un sujet de honte devient un sujet de fierté et un point d’appui à la revendication politique. Pour ces deux raisons, le terme d’indigène ne me semble pas convenir à l’analyse des situations actuelles.
Vous évoquez l’imbrication de la question sociale et de la question raciale. Comment articulez-vous ces deux questions ? Les discriminations raciales jouent-elles comme un redoublement de la domination sociale ?
La question de la discrimination raciale est souvent trop prestement rabattue sur la domination de classe. On dit : « un bourgeois noir du 16e vit mieux qu’un prolo blanc d’Hénin Beaumont ». La discrimination raciale est vue comme une « fausse conscience », selon la formule d’Engels, qui masque la réalité des rapports de classe. Les sciences sociales françaises ont longtemps été réductionnistes de ce point de vue. Certes, l’analyse des situations sociales ne saurait méconnaître les positions de classe mais elles ne peuvent s’y dissoudre entièrement non plus. Les rapports sociaux de sexe et ethno-raciaux sont des rapports de domination marqués par la classe mais qui ont aussi des logiques propres. L’émergence de la question des femmes dans les années 1970 a été difficile à accepter dans les champs universitaire et politique. Aujourd’hui, il faut prendre au sérieux les rapports de domination ethno-raciale en France. L’histoire de l’immigration existe depuis vingt ans, Le Creuset français de Gérard Noiriel est paru à la fin des années 1980. Mais cette histoire a été fortement marquée par son point de vue de départ : l’histoire ouvrière. Ce faisant, la perspective de classe a souvent conduit à négliger ou sous-estimer la réalité des rapports de domination ethno-raciale. Or les organisations du mouvement ouvrier ont à la fois été des instruments d’intégration, mais ont aussi fait preuve de racisme et de discrimination De ce point de vue-là, l’histoire de l’immigration est passée à côté de la « race ». De plus, l’histoire de l’immigration ne s’est pas intéressée, elle n’avait d’ailleurs pas à le faire, aux descendants d’immigrés, qui ne relèvent pas d’une expérience directe de la migration, mais peuvent être sujets à des formes de discrimination raciale. Ce constat de rendez-vous raté vaut aussi pour la sociologie. Sayad n’a pas sensibilisé Bourdieu aux questions discriminatoires et racistes. Bourdieu compare toujours l’expérience du migrant nord-africain en France à sa propre expérience de béarnais issu de milieu modeste, confronté à la bourgeoisie parisienne. Pour lui, c’est la même chose. Il a manqué ce qu’il y a de spécifique dans la domination raciale. Le stigmate a été sous-estimé. Il faut prendre au sérieux la part spécifique du racial dans les mécanismes de domination. Or cette part est généralement minorée, et même suspectée : en parler reviendrait à participer à la désaffiliation de la classe ouvrière, car souligner les failles en son sein reviendrait à accroître ses difficultés. Ainsi, ceux qui évoquent la dimension raciale ont pu être accusés de faire le jeu de la droite.
Que pensez-vous de la phrase du footballeur Vikash Dhorassoo qui disait « L’argent m’a blanchi » ?
Il a raison dans le sens où un certain nombre de vedettes voient leur expérience raciale amoindrie, voire gommée. Un autre footballeur racontait une fois avoir été contrôlé par un policier peu amène. Quand il a présenté ses papiers et que le policier s’est rendu compte qu’il avait affaire à une célébrité, il s’est confondu en excuses. Le policier l’avait confondu avec un Noir ! Cela dit, encore une fois, il ne faut pas commettre l’erreur qui consisterait à rabattre l’ethno-racial sur la position de classe. De nombreux travaux américains ont montré que plus on monte dans l’échelle socio-professionnelle, ou plus on prétend le faire, plus l’expérience discriminatoire est forte. On ne peut pas dire que les caissières de Monoprix sont confrontées à un système de discrimination forcené à l’embauche. Elles sont noires et embauchées comme caissières, cela ne posent pas de problème particulier, en principe. Cela dit, elles peuvent être victimes de racisme de la part des clients, ou des patrons. Mais si on monte dans la hiérarchie et qu’on regarde les cadres de Monoprix, on s’aperçoit qu’il y a peu ou pas de Noirs ou de Maghrébins ! L’impôt à payer sur la couleur de peau, ou sur l’origine, est de plus en plus lourd quand on monte dans l’échelle sociale. Les expériences racistes sont amorties, mais la discrimination est plus forte. Plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on est confronté à des remarques racialisées. Dans les catégories supérieures, ces phénomènes se font plus rares, ils sont davantage euphémisés, mais la discrimination reste prégnante. Le traitement défavorable joue plus dans les échelons supérieurs que dans les échelons inférieurs. C’est ce qu’on appelle le plafond de verre. Il ne s’agit donc pas d’une forme de relation déterministe entre rapports sociaux de classe et rapports sociaux de race.
La question raciale constitue-t-elle une ressource en fonction de la position sociale ?
Revendiquer le fait d’être noir, individuellement ou collectivement, constitue un risque, car, dans la société française, remettre en cause l’indifférence supposée à la couleur de peau est mal vu. Grosso modo, pour la droite vous remettez en cause la nation, pour la gauche, la solidarité de classe. Il est plus facile pour une personne issue des classes moyennes de s’affirmer « noire », que pour d’autres issues du monde des ouvriers ou des employés. Les mouvements associatifs rassemblant des Noirs comptent plutôt des personnes placées dans les échelons moyens et supérieurs. Les pressions politiques et syndicales sont très fortes et agissent contre ces formes d’identification. Imaginez la tête d’un responsable syndical si un ouvrier noir venait lui dire qu’il veut s’organiser en tant que minoritaire ! Le discours syndical consisterait à dire : «nous, on lutte sur ces questions depuis longtemps », ce qui est vrai et faux à la fois : on sait bien que le monde syndical a accueilli le monde immigré, mais a fait preuve aussi de formes de racisme et de discrimination. Les immigrés n’ont jamais grimpé réellement les échelons internes. Ils restent dans des positions de militants.
Les Noirs et la gauche
Historiquement, quels ont été les rapports entre la gauche et la question noire, prise en charge un temps par le PC ? La droite est elle plus avancée que la gauche sur la question de la place des minorités ou est ce seulement de l’affichage ?
Des années 1920 aux années 1960, le PC a eu une action spécifique autour des questions noires. Pourquoi à cette époque et plus maintenant ? Cela se faisait sur la base d’une ligne anticolonialiste : il s’agissait d’organiser les colonisés pour favoriser la décomposition de l’empire français. A partir des années 1960, avec les indépendances, organiser les minorités a perdu de son intérêt politique. Marx disait en parlant de la Révolution de 1848 que l’organisation nationale pouvait constituer une première étape vers une perspective révolutionnaire. La même idée prévalait pour les Noirs. On ignore souvent qu’il a existé une section noire de la IIIe Internationale, qui proposait une réflexion sur la question noire dans les empires français et britannique, et aux Etats-Unis. Elle a d’abord eu son bureau à Hambourg, car des militants camerounais en étaient les fers de lance. Puis elle s’est établie à Paris en 1933. Le monde communiste était avancé sur ces questions, tout en étant méfiant à l’égard de formes d’organisation qui prendraient trop d’autonomie par rapport aux impératifs de classe et deviendraient « noiristes », pas assez prolétariennes. Cela rejoint l’accusation contemporaine de communautarisme… Au mieux, les luttes des Noirs, comme celles des femmes, étaient conçues comme un front secondaire, une « thèse mineure de la dialectique », disait Sartre à propos de la négritude.
Aujourd’hui, le PC n’est pas, et de loin, le parti le plus hostile à l’organisation politique des minorités, aussi bien les minorités ethno-raciales, que celles de genre, ou de comportement sexuel. La situation actuelle difficile du PC le conduit à une sorte de mouvementisme. Mais la gauche dans son ensemble a pris du retard depuis les années 1960, à l’exception des Verts, les plus sensibles par rapport à ces demandes sociales-là. Au PS, les choses sont plus compliquées et hétérogènes. Dans les années 1970, ce parti pouvait être en phase avec certaines demandes sociales. Il avait compris les revendications des femmes, par exemple. Mais c’est aujourd’hui au sein du PS qu’on trouve les personnes les plus hostiles à l’émergence de telles questions. Elles « sortent leur fusil » dès qu’elles entendent parler de minorités, au nom de la nation ou de la classe ouvrière. Le cas de Ségolène Royal est un peu particulier. Son intérêt pour les questions féministes la conduit à une certaine écoute. Mais quand on lui parle de discriminations, elle répond « métissage ». Un chapitre de son livre d’entretien avec Alain Touraine concerne cette « France métissée ». La France ne l’a pas attendue pour se métisser. En quoi dire qu’on est pour une France métisse constitue-t-il un programme politique ? Il y a des Noirs et d’autres, qui sont victimes de discriminations et il faut les réduire par des dispositions pratiques. Leur parler de métissage est une réponse dilatoire. Les scores de Royal ont été gigantesques auprès des minorités visibles : près de 90 % des jeunes Noirs ont voté pour elle selon un sondage de Jeune Afrique. Mais cela traduit sans doute plus un rejet de Sarkozy qu’une adhésion au projet socialiste.
La droite, en particulier du côté de Sarkozy, a vite compris qu’il y avait des possibilités électorales au sein de minorités visibles déçues par la gauche. Les figures minoritaires qui ont rejoint Sarkozy sont souvent allées voir du côté de la gauche. C’est le cas de Fadela Amara, par exemple. Accentuer la décomposition de l’adversaire et faire feu de tout bois électoral constitue une tactique typiquement sarkozyste. Il y a quelques années, Sarkozy a essayé de donner des signes de bonne volonté, avec la question de la double peine par exemple. Mais ce semblant d’ouverture a craqué lors des émeutes de novembre 2005. Il est apparu comme tel, brutal et répressif, d’où son score piteux dans les quartiers, chez les personnes concernées. L’exemple de Rama Yade est intéressant. Autant les gens peuvent l’apprécier, autant ils sont lucides sur la politique d’affichage, et gardent une position critique par rapport à l’action gouvernementale.
Que représente le militantisme noir, celui du CRAN par exemple ? Les militants n’appartiennent ils pas souvent aux classes moyennes et comment faire le lien entre ce militantisme et les milieux populaires ? N’y a t-il pas un risque, comme aux Etats-Unis, d’aboutir à un fossé entre élites, bourgeoisies noires et milieux populaires ?
Les mouvements associatifs noirs rassemblent en effet plutôt des classes moyennes et supérieures. Il y a des difficultés spécifiques au militantisme populaire qui ne valent pas que pour les Noirs : limites de temps, d’argent, et aussi pressions politiques et syndicales fortes en ce qui concerne cette question spécifique. Toutefois, une association comme la NAACP aux Etats-Unis compte trois millions de membres. A ce niveau là, on mord forcément dans les milieux populaires. L’intellectuel et militant Du Bois qui dirigeait cette association avait théorisé l’idée des « 10 % talentueux ». C’est pour moi une conception bien trop élitiste. La voie explorée par le CRAN pour faire la jonction avec les milieux populaires consiste à partir de ce qui existe, des associations existantes, pour tenter de les fédérer. Il ne s’agit pas de créer une organisation qui soit en concurrence avec un tissu associatif déjà très riche. Cela va des facteurs antillais de Marne-la-Vallée aux Unions de travailleurs africains. On peut imaginer en France une politique minoritaire et non identitaire, qui unirait ces forces. Il est dramatique que le Parti démocrate aux Etats-Unis ait abandonné dans les années 1960 les questions de classe pour les questions d’identité. Une politique minoritaire me paraît plus efficace, car elle repose sur un fondement politique. Ce n’est pas que les Noirs s’aiment parce qu’ils sont noirs, mais parce qu’ils ont un intérêt commun : lutter contre le racisme et les discriminations, de façon plus efficace que des associations généralistes aveugles à la couleur de peau. Pour lutter efficacement, il faut commencer par reconnaitre l’existence d’un fait racial en France plutôt que de s’aveugler derrière le paravent républicaniste. Ce n’est pas du tout en concurrence avec les questions de classe. La renaissance de la gauche passe aussi par ça. L’approche « minoritaire » permet d’éviter les dérives à la Dieudonné ou tribu Ka, des gens qui se retrouvent main dans la main avec l’extrême droite sur un terrain identitaire finalement commun.
Les Etats-Unis et l’élection présidentielle
Comment analysez-vous l’investiture de Barack Obama comme candidat démocrate ? Est-ce une preuve de l’intégration de la minorité noire dans la vie politique des Etats-Unis ? Ou simplement que le tabou racial est moins fort que celui lié au genre ?
Je pense qu’on sous-estime encore les effets de son élection possible, et même probable, sauf événement imprévu. Et cela indépendamment de son programme politique et économique, très modéré, guère différent de celui d’Hillary Clinton. Sa campagne et son élection éventuelle ne peuvent qu’accuser le retard français. Pour un Obama, il y a 10 000 élus noirs aux Etats-Unis. C’est un terreau très riche qui a permis l’investiture d’Obama, car il n’est pas une exception absolue. On est loin de 10 000 élus minorés en France ! Il n’y a qu’à voir le contraste entre les ambitions affichées et les résultats lors des dernières municipales … On en est très loin et Obama peut nous servir de marchepied, de point d’appui. C’est tactiquement utile de se demander : « Et maintenant, que va-t-il se passer en France ? ».
Lors de la campagne pour l’investiture du candidat démocrate, malheureusement, il y a eu une confrontation électorale directe entre une femme et un Noir. Y lire une concurrence entre les deux recoupe un débat historique récurrent depuis la guerre de sécession, et serait une erreur dommageable. Il est au contraire important de faire converger les intérêts de chacun pour lutter contre les discriminations. Les moments les plus progressistes ont été ceux où la question des femmes et la question noire ont avancé de concert.
Pour revenir à Obama, sa candidature ne doit pas cacher un constat terrible : la ségrégation s’est accentuée aux Etats-Unis depuis les années 1960. Une classe moyenne noire s’en sort mieux qu’avant, grâce aux programmes d’ « affirmative action » notamment. Mais, en même temps, le monde des ghettos persiste et se dégrade fortement. Les sociologues américains ont décrit la disparition des élites noires du ghetto, et parallèlement celle du travail et de l’Etat. Et si l’on ajoute l’arrivée massive de l’économie de la drogue, force est de constater que la situation est terrible. Le prolétariat noir est dans une situation très difficile aujourd’hui. 10% des jeunes Noirs sont en prison, contre 1% des jeunes Blancs. La ségrégation s’est accentuée dans les écoles publiques. Donc ça va mieux et ça va moins bien en même temps, ça dépend de quelle catégorie sociale on parle. Obama ne s’adresse pas au monde des prolétaires noirs, qui sont d’ailleurs nombreux à avoir perdu leurs droits civiques et à ne plus pouvoir voter. Ce sont autant de gens perdus pour les forces politiques qui auraient le plus intérêt au changement. Un des enjeux actuels consiste, pour les Démocrates, à inscrire les Noirs sur les listes électorales et à s’opposer à ceux qui veulent, d’une manière ou d’une autre, les en chasser.
*
Propos recueillis par S. Hauteville et Sylvain Pattieu
Illustration : photo Martin Noda / Hans Lucas / Photothèque rouge.
Notes
[1] « AU-DELA DE LA « QUESTION IMMIGREE » – Les nouvelles frontières de la société française. » Programme pluriannuel (2006-2008) de recherche collective financé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre d’un appel d’offre « blanc » (sans contrainte thématique) en sciences humaines et sociales. Le programme est dirigé par Didier Fassin, (Directeur d’Etude à l’EHESS, Professeur à Paris 13).
[2] La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004.








