
Les gilets jaunes, une répétition générale ?
Stephen Bouquin, professeur de sociologie à l’université d’Evry et directeur de la revue Les Mondes du Travail, discute le livre de Juan Chingo : Gilets jaunes. Le soulèvement (quand le trône a vacillé), Paris, Communard.e.s, 2019, 206 pages, 12€.
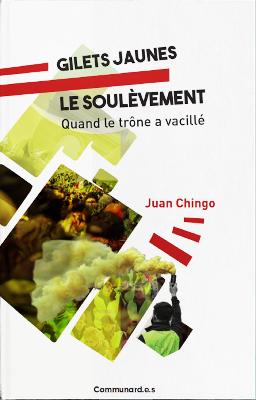
Gilets jaunes. Le soulèvement, propose un retour sur la révolte sociale des gilets jaunes. Cet ouvrage est écrit par un militant marxiste révolutionnaire, journaliste et animateur du courant CCR du NPA, et regroupe une série d’articles publié tout au long des évènements sociaux et politiques des années 2017-2019.
Dans une première partie « Macronisme et ses limites », Juan Chingo dresse le contexte politique et social qui a vu émerger ce mouvement de contestation. Si Emmanuel Macron a pris le leadership politique pour mener une politique au service de la classe dirigeante, il n’a pu le faire qu’en déstabilisant un système politique structuré autour d’une droite encore marquée par le sarkozysme et un centre gauche usé par l’exercice du pouvoir.
En effet, Macron fut élu au terme du cycle politique initié par l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, marqué par des mobilisations importantes autour de la question des retraites (2010) puis l’élection de François Hollande en 2012, qui quant à lui a mené une politique à rebours du mandat avec lequel il avait été élu, laissant les inégalités sociales s’approfondir et menant tambour battant une réforme d’inspiration néolibérale du code du travail.
Ancien ministre sous Hollande, Macron a fait une OPA sur le centre politique et ne disposait que d’une faible assise électorale de 24% (premier tour des élections présidentielles), dont l’élargissement au second tour doit beaucoup aux suffrages exprimés contre Marine le Pen. La première année d’exercice du pouvoir a été marquée par une volonté d’avancer vite dans des réformes répondant aux exigences de l’agenda néolibéral que sont la réduction des dépenses publiques, une fiscalité avantageuse pour le capital, la réduction de la protection sociale et l’ouverture à la concurrence de certains secteurs du service public.
Les chapitres de cette première partie ont été publié au cours de 2017 et 2018 et révèlent une compréhension judicieuse des raisons provoquant l’érosion rapide de la popularité de Macron, accélérée par un style de gouvernance qualifié de « jupitérien ». En somme, Emmanuel Macron incarnait dès le début de son mandat un bonapartisme sans base sociale solide. Après avoir été élu en surfant sur un sentiment de rejet de la « classe politique », disposant d’une écrasante majorité à l’Assemblée Nationale, il a d’emblée mené une politique se situant dans la continuité des gouvernements précédents, et dont certaines mesures, comme la suppression de l’ISF, incarnent parfaitement une politique au service de la « France d’en haut ».
En bouleversant le champ politique, Macron a pu se mettre au centre de l’échiquier mais devenait par la même occasion la première cible du mécontentement. Si le mouvement contre la loi El Khomry du printemps 2016 caressait encore l’illusion que l’action des « frondeurs » du PS à l’Assemblée Nationale pouvait permettre de limiter la casse, désormais, avec l’écrasante majorité de députés élus sous la bannière de LREM, plus aucun espoir était permis de ce côté-là.
Le baril de poudre débordait et il ne fallait qu’une étincelle pour y mettre le feu et faire advenir ce que certains à l’extrême gauche ont pour coutume d’appeler le « troisième tour social ».
L’irruption des gilets jaunes
Dans la deuxième partie, une série de chapitres abordent l’irruption du mouvement des Gilets jaunes. Le premier fait marquant ici, c’est bien l’incompréhension de cette révolte de la part d’une gauche bien pensante, y compris anticapitaliste et syndicale. Cette incapacité m’a laissé perplexe et c’est quelques semaines plus tard, en rédigeant une analyse publiée dans la revue Les Mondes du Travail[1] que je suis tombé sur cette citation de Lénine qui s’applique autant à des révoltes sociales qu’à des soulèvements révolutionnaires.
En substance, pour Lénine, croire qu’une révolution est possible sans le soulèvement de certains secteurs de la petite bourgeoisie, ramenant le cortège de tous ses préjugés réactionnaires, ou encore sans les masses prolétaires et semi prolétaires inconscientes politiquement, signifie en fait rejeter la révolution :
« Cela signifie que l’on s’attend à une situation où une armée va prendre position à un certain endroit à un moment certain en proclamant être en faveur du socialisme tandis qu’une autre armée va prendre une autre position déclarant ‘défendre l’impérialisme’ puis qu’une révolution va résulter de l’affrontement entre ces deux armées. Quiconque attend une révolution pure ne vivre jamais assez longtemps pour la voir ».
L’incompréhension de la gauche, y compris sa composante révolutionnaire, s’est traduite par une absence d’intervention politique, ce qui, la politique ayant horreur du vide, a laissé le champ libre aux courants réactionnaires et néofascistes qui tentèrent d’en faire une révolte poujadiste du peuple gaulois. Heureusement, les militants de courants d’inspiration anarchistes ou libertaires y participèrent aussi et bon nombre de militants syndicaux ont également investi les ronds-points,
Juan Chingo rappelle les ingrédients de la situation lorsque l’explosion sociale a lieu. Le pouvoir a eu peur, il était désemparé. Pendant trois semaines – du 17 novembre au 10 décembre – il a opté pour une criminalisation idéologique du mouvement (poujadiste, fascisant, etc.) s’appuyant également sur une certaine confusion à gauche. Pour Chingo, s’il ne s’agissait pas d’une crise de type prérévolutionnaire, elle contenait néanmoins des éléments qui allaient dans ce sens. L’occupation de près de trois mille rond points et les manifestations massives des samedis exprimaient une révolte massive dont on arrivait difficilement à identifier les contours sociaux.
C’était du jamais vu depuis au moins mai 1968 et personne ne savait où cela allait mener. Le fait que ce soulèvement ait lieu sans le soutien de forces syndicales ou de la gauche radicale rajoutait une dimension inconnue pour les cercles du pouvoir comme pour ces forces organisées. Mais fondamentalement, quand les masses font irruption sur la scène politique, c’est le signal que les gens se réapproprient leur devenir, leur sort. Juan Chingo rappelle à juste titre qu’il ne faut pas avoir peur de cette irruption des masses.
L’attaque des symboles du pouvoir, l’occupation de secteurs entiers de la capitale par des manifestants
« montre que nous n’assistons pas à un mouvement social classique mais à une agitation sociale qui a comme un avant-gout de révolution. (…). La tendance des masses à prendre directement les choses en main, à s’organiser par elles-mêmes, à refuser tout type de négociation – ces mêmes négociations émaillées de coups tordus auxquelles nous habituées les bureaucraties syndicales – et à ne pas hésiter à aller à l’affrontement. »
Pour l’auteur, c’est bien cela qui a fait peur à la classe dirigeante. Lorsqu’il se plaint du caractère protéiforme du mouvement, ou du fait qu’il n’y a pas leaders reconnus pour négocier ni d’acteurs capables de contenir les manifestations et de les encadrer, le pouvoir ne fait qu’exprimer l’embarras dans lequel il se trouve pour reprendre l’initiative. Citant Sophie Wahnich, qui souligne combien la violence produite par les mobilisations forme une sorte de violence retournée :
« Il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette manière de retourner la violence subie. Pour que la violence puisse paraître acceptable, voire légitime, aux yeux de beaucoup, il faut qu’il y ait eu beaucoup de retenue avant ».
En effet, ce sont bien des années de violence économique et sociale, acceptée ou supportée bon gré mal gré qui reviennent tel un boomerang, dans la figure du pouvoir.
Publié à la mi-janvier 2019, le chapitre à propos d’un « 1905 à la française » me paraît particulièrement intéressant mais également discutable à certains égards. L’auteur y revient sur les événements encore en cours, en les comparant à la révolution de 1905 en Russie. Certes, le soulèvement des Gilets jaunes ne mobilise pas les secteurs organisés du prolétariat des grandes villes et n’a pas donné lieu à des formes d’auto-organisation – les conseils ou soviets avaient vu le jour à Petrograd lors de cette crise révolutionnaire – mais en même temps, le soulèvement correspondait bien à un affrontement central avec le gouvernement.
Juan Chingo souligne qu’une nouvelle période de la lutte des classes s’est ouverte. Empruntant à Gramsci, il souligne combien le soulèvement social contient des éléments « orientaux » au sens où des pans entiers de la société sont désormais orphelins de médiations institutionnelles et d’une société civile par ailleurs délitée. En outre, les Gilets jaunes sont le produit d’un syndicalisme organiquement très faible, divisé et replié sur les secteurs organisés.
Suivant ici les analyses de Karel Yon, Sophie Béroud et Baptiste Giraud considérant le syndicalisme « à la française » à la fois de plus en plus institutionnalisé, inséré dans les dispositifs de concertation mais dépourvu d’une véritable assise sociale, le mouvement des Gilets jaunes représente une critique pratique des limites de l’action syndicale et du répertoire d’action centré sur les journées d’action. Les Gilets jaunes ont pris acte en quelque sorte de l’incapacité des forces syndicales à freiner les réformes néolibérales, comme l’a démontré les mobilisations contre la Loi El Khomry.
Pour Juan Chingo, les analyses de Rosa Luxembourg à propos du 1905 russe éclairent également la situation actuelle. En 1905, le déroulement chaotique et les grèves apparemment inorganisées étaient le point de départ d’une action révolutionnaire :
« L’histoire se moque des bureaucrates amoureux des schémas préfabriqués, gardiens jaloux du bonheur des syndicats. (…). Tandis que les gardiens jaloux des syndicats allemands craignent avant tout de voir se briser en mille morceaux ces organisations, comme de la porcelaine précieuse au milieu du tourbillon révolutionnaire, la révolution russe nous présente un tableau tout différent : ce qui émerge des tourbillons et de la tempête, ce sont des syndicats neufs et jeunes, vigoureux et ardents » (p. 100).
Par conséquent, tout comme en 1905, le mouvement ne s’oriente pas uniquement dans le sens d’un passage de l’économique au politique, mais aussi en sens inverse.
De fait, le mouvement des gilets jaunes se situe au-delà des limites de la protestation syndicale ritualisée. En même temps, parce qu’il est resté en dehors des ateliers et des bureaux, et qu’il a choisi de tourner le dos à la question du travail, ce mouvement ne s’est pas transformé en « néo-syndicalisme ».
Hormis dans certains endroits périphériques, la contestation des Gilets jaunes n’a pas obtenu le soutien de la part des secteurs organisés et combatifs du mouvement syndical même si à l’occasion du premier mai, des cortèges syndicaux et des Gilets jaunes se sont mélangés dans bon nombre d’endroits. Pour Chingo, citant ici Léon Trotsky, il est clair que le mouvement des Gilets jaunes montre la voie aux syndicalistes étant donné qu’il ne sert à rien d’escompter des résultats d’un affrontement qui respecte les règles artificielles et conventionnelles de la boxe française alors que l’ennemi ne les observe nullement.
Pour ma part, je pense qu’il faudrait chercher les limites des directions syndicales dans une analyse plus approfondie du mouvement syndical. Celui-ci organise des segments plus stables socialement, moins exposés à l’austérité et la paupérisation. En même temps, il est composé d’équipes militantes aguerries mais usées ou vieillissantes. Il est de surcroit très fragmenté et divisé entre un pôle qui tente de jouer la carte d’un compromis qui limite la casse et un pôle plus combatif mais qui n’arrive pas – et ne cherche pas toujours non plus – à entraîner la majorité des travailleurs/euses.
En dernier lieu, il faut aussi prendre en compte le fait que le patronat et la classe dirigeante radicalise sa lutte des classes à elle, qu’elle est peu encline à céder parce qu’elle lutte aussi pour la compétitivité du capitalisme français dans la concurrence mondiale. Le mouvement des Gilets jaunes forme la réponse concrète et spontanée d’une classe travailleuse « en soi » et qui se reconstitue tant bien que mal comme classe « pour soi ».
Dans les deux derniers chapitres de cette partie, l’auteur analyse la réponse du pouvoir, combinant une escalade répressive visant à intimider et terroriser les manifestants et un « Grand débat » pour noyer le poisson. Ce deuxième aspect me semble être trop minoré alors qu’il a joué un rôle central dans le dispositif visant à rétablir la légitimité du pouvoir.
Au fil des samedis de février-mars et avril, le nombre de blessés et mutilés n’a fait que grandir tandis que le « grand débat » mobilisait l’attention médiatique, sans convaincre les secteurs mobilisés des gilets jaunes. En même temps, cette stratégie a permis au pouvoir de « fatiguer » les mobilisations et de détacher les secteurs plus modérés, ceux qui ont pris peur devant la tournure des évènements.
Les affrontements violents ont servi d’épouvantail et permettaient de criminaliser les Gilets jaunes « actifs ». Progressivement, le nombre de ronds-points occupés a diminué et le soutien au sein de l’opinion publique a commencé à s’éroder, passant de 60-70% à 45-50%, ce qui demeure encore très élevé. Mais la crise politique était jugulée sans être résolue pour autant. Ceci signifie aussi qu’on peut assister à un retour de flamme de la révolte sociale et ce même dans un avenir assez proche.
La question de l’auto-organisation est mentionné mais au final peu développé dans l’ouvrage. Ce travail d’auto-organisation avait été initié par l’appel de Commercy de janvier 2019 en faveur d’une « Assemblée des Assemblées ». Il a donné lieu à quatre assemblées générales[2]rassemblant entre 500 et 700 délégués de plus de 250 collectifs locaux. Ce travail assez admirable mérite qu’on s’y attarde.
Il est extrêmement chronophage et il demande des efforts considérables sur le plan de la logistique (repas, logement) tout en étant très délicat sur le plan politique. La faible expérience organisationnelle et politique de bon nombre de gilets jaunes, la confusion idéologique et les aspirations parfois contradictoires font que la réalisation d’un tel travail de structuration et de coordination est une véritable prouesse qu’il faut saluer.
En même temps, il faut aussi en constater les limites quant à l’impact sur le cours des évènements. La responsabilité en incombe aussi aux figures de proue du mouvement (Priscillia Ludosky, Jérôme Rodriguez, Eric Drouet et Maxime Nicolle) qui ont continué, sur base de concertations informelles, à « animer » le mouvement sans participer au processus d’auto-organisation. Mais à partir du mois de mai, il devenait évident que vouloir reproduire indéfiniment les Actes et les manifestations ne serait pas suffisant pour imposer au pouvoir de nouveaux reculs.
C’est aussi au cours de cette séquence, de fin janvier à fin avril 2019, que l’action politique au sein des collectifs a permis de marginaliser l’ultra-droite qui tentait en vain d’identifier les Gilets jaunes à une « révolte du peuple gaulois réfractaire à la mondialisation néolibérale ». Le refus de se lancer dans une aventure électorale pour les européennes – piège tendu par la Macronie – reflétait une certaine intelligence stratégique « organique » au sein du mouvement. Mais l’absence d’une plateforme élaborée démocratiquement, exigeant des mesures d’urgence sur le plan social (SMIC, retraites, minimas sociaux), de justice fiscale et une démocratisation radicale d’un Etat manifestement au service d’une oligarchie financière, s’est traduit par une incapacité grandissante à maintenir le rapport de force.
La contestation continuait à mettre en évidence que le pouvoir restait sourd aux attentes des Gilets jaunes, mais l’absence de plateforme et le vide stratégique quant au devenir de la mobilisation réduisait sa capacité d’imposer des reculs et d’ouvrir la perspective d’un débouché politique. Pendant que les affrontements avec des forces de l’ordre se poursuivaient de samedi en samedi, Macron a repris l’initiative. Certes, la férocité de la répression a radicalisé des franges significatives du mouvement, en témoigne la solidarisation avec les Black blocs et l’écho des thèses « insurrectionnalistes » du Comité invisible au sein des Gilets jaunes.
Mais là aussi, le refus de penser « l’insurrection » au-delà de l’avènement de celle-ci transforme les tags sur les banques, des barricades de poubelles, en un théâtre d’affrontement sans réelle menace pour l’ordre établi. Le seul résultat politique de ce type d’anti-stratégie, c’est plus de 5000 martyrs blessés (dont certains mutilés) et plus de 800 peines d’emprisonnement…
Construire un bloc cotre-hégémonique
Dans la troisième partie, Juan Chingo aborde la question des forces en présence et des orientations pouvant constituer un « bloc contre-hégémonique ». Premier constat, la crise de l’hégémonie néolibérale, tant sur le plan idéologique que politique. Deuxième constat, l’opposition parlementaire est fragmentée entre une social-démocratie miniaturisée en pleine crise d’orientation et d’autre part un pôle plus radical mais divisé entre LFI et les députés communistes. En outre, les forces de la gauche révolutionnaire comme LO et le NPA s’avéraient bien incapables de s’adresser aux Gilets jaunes.
Pour Juan Chingo, c’est d’abord du côté de la LFI que le bât blesse. Si celle-ci était encore perçue après l’élection présidentielle comme la première opposition à Macron, un an plus tard (automne 2018), c’est le RN de Marine Le Pen qui apparaît comme la première force oppositionnelle au régime. Pourquoi LFI a-t-elle raté le coche dans un contexte qui pouvait paraître favorable ?
Il serait trop long d’analyser en détail cette question ici, mais globalement, il est évident que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est identifiée à l’ancien système politique. Il a été ministre sous Jospin, sénateur et député du PS pendant longtemps, et s’il n’a jamais été complice du social-libéralisme (ayant été un des fers de lance en 2005 de la compagne du « Non » lors du référendum sur le traité constitutionnel européen), il a du mal à incarner de façon crédible le propre populisme de gauche.
Qui plus est, cette orientation, élaborée par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe et « validée » par les victoires de Evo Morales, Rafael Correia et Hugo Chavez, éprouve quelques difficultés à s’appliquer en Europe. La France Insoumise a très vite vu son audience plafonner autour de 15-20% – c’est aussi le problème de Podemos qui cherché également une inspiration dans ce populisme de gauche –, ce qui est loin de faire une majorité. Que faire dans ce cas-là ? Camper sur une position tribunicienne oppositionnelle qui correspond au manuel de la révolution citoyenne par les urnes… Faire des alliances ? Certes, mais avec qui ?
En Europe, même dix ans après la crise financière et autant d’années d’austérité, les forces politiques traditionnelles ont perdu entre un quart et un tiers de leur électorat, pendant que le champ politique se balkanisait sous l’effet de l’arrivée de nouvelles formations « populistes », surtout de droite. En même temps, le clivage gauche/droite demeure présent. On peut même voir l’extrême droite gagner en audience en se situant sur le clivage « peuple versus caste politique », mais avec un contenu réactionnaire, raciste et anti-musulman.
Construire un bloc contre-hégémonique sur base du seul clivage « peuple versus élite » représente l’axe stratégique majeur défendu par le Laclau et Mouffe. Or, en Amérique Latine, si « le peuple » a pris une consistance politique, c’est aussi parce que la classe dirigeante demeure exclusivement blanche alors que le peuple est bigarré, multiculturel par le métissage et la question indigène. Cela facilite en quelque sorte une mobilisation de ce vocable performatif (qui participe à faire exister la réalité) pour un projet de gauche, anti-libéral et radical-démocratique.
À l’inverse, en France, étant donné les limites de la « décolonisation » du « peuple français », et sachant la prégnance du racisme d’état, ce terme entre facilement en résonance avec une identité arc-boutée sur les prétendus « Français de souche ». L’orientation populiste de LFI pouvait donc facilement être récupérée par Marine le Pen, dont le « souverainisme » cache une profonde complicité avec l’ordre établi, ce que l’option fasciste a toujours été au demeurant.
La publication d’un échange entre Stefano Palombarini et Juan Chingo vaut la peine d’être relue. Pour Palombarini, co-auteur avec Bruno Amable d’un petit livre intitulé L’illusion d’un bloc bourgeois, les Gilets jaunes représentent un mouvement qu’il fallait saluer et soutenir ne serait-ce que parce qu’il a remis la question sociale au devant de la scène. En même temps, Palombarini souligne aussi – à l’instar de bien d’autres sociologues – que ce mouvement était hétérogène socialement, qu’il mobilisait des secteurs ouvriers mais aussi des petits entrepreneurs, des artisans, des agriculteurs et qu’il a déserté la question du travail pour se focaliser sur la fiscalité et la démocratie.
Stefano Palombarini n’attendait pas de ce mouvement qu’il développe un projet politique propre à lui, mais estime semble-t-il qu’un « bloc contre-hégémonique » devrait résulter du travail d’élaboration en lien avec les secteurs de la population qui se révoltent et d’une politique d’alliance s’adressant aux forces et courants politiques existants et désirant sortir des ornières du néolibéralisme.
Juan Chingo développe de son côté une approche marxiste-révolutionnaire, qui, sans déconsidérer les élections, prend d’abord appui sur la lutte des classes et cherche à construire un outil politique à même d’influer sur le cours des évènements. Dit autrement, Juan Chingo pose la question du parti révolutionnaire, qui, soufflant sur les braises de la contestation et lui procurant une direction politique, fasse en sorte qu’émerge un « bloc contre-hégémonique ». Or, au moment des élections européennes, le mouvement des Gilets jaunes, n’ayant pas soutenu le dépôt d’une liste du mouvement, était tiraillé par l’abstentionnisme et un « vote sanction » contre Macron, ce qui légitimait de fait un vote possible pour le Rassemblement National de Marine Le Pen…
L’ouvrage se termine par deux chapitres courts portant sur la situation de la LFI et sur le contexte politique à l’issue des européennes. Marine Le Pen a obtenu un meilleur résultat que LREM aux européennes ; LFI a fait un très mauvais score tout comme le PCF, sans parler du score ridicule de LO. Bref, le « soulèvement » social de grande ampleur n’a pas trouvé de traduction politique à gauche…
Le climat idéologique à l’automne 2019 le reflète d’ailleurs et traduit un certainement pourrissement de la situation. Si l’exaspération sociale est toujours là, on observe aussi une haine grandissante à l’égard des musulmans et un rejet largement répandu des migrants, qu’ils soient refugiés ou non. Ces tendances réactionnaires s’affirment sans qu’il y ait beaucoup de ripostes à gauche. Déterminer les perspectives et la ligne politique à défendre dans une telle situation est devenu somme toute un exercice assez compliqué…
Mais avant de revenir sur cette question, je tiens à évoquer quelques observations critiques. La première concerne la question écologique, en particulier la question de la crise climatique, qui me semblent quelque peu négligées. Or, il s’agit-là d’un enjeu central. À plusieurs reprises, notamment en décembre 2018, les mobilisations des Gilets jaunes et les marches pour le climat pouvaient converger. Sachant que la révolte contre le prix du carburant a été le déclencheur des mobilisations, le pouvoir a tout fait pour opposer les Gilets jaunes et les revendications écologistes. Or, malgré la contre-offensive idéologique du régime, l’idée que les fins de mois et la fin du monde sont un seul et même combat a gagné du terrain parmi les Gilets jaunes.
Je regrette aussi que les questions revendicatives soient peu traitées. Que l’on se réclame de la révolution ou non, il est difficile d’ « intervenir » politiquement sans apporter des réponses ou défendre des propositions concrètes. Le fait qu’une partie des Gilets jaunes se soit orientée vers la démocratie locale, le RIC ou le municipalisme libertaire, tient au fait qu’ils et elles pensent pouvoir influer localement sur l’ordre des choses. Ce qui n’est pas faux… Mais en même temps, cela signifie aussi que l’on abandonne les questions centrales telles que le partage des richesses, la reconstruction de services publics de qualité ou la résolution urgente de la crise sociale (en réalité une paupérisation massive de secteurs entiers de la classe laborieuse et de la petite bourgeoisie).
Les Gilets jaunes ont exprimé des exigences sociales fortes tout en délaissant la question du travail, alors que c’est justement ce qui a nourri l’exaspération et la révolte. Ne faut-il pas saisir chaque occasion pour faire de l’agitation en faveur d’un SMIC à 13 euros/heure, mensuel de 1820 euros ; une échelle mobile des salaires (surtout en lien avec la hausse des prix du logement !), une hausse des minimas sociaux (retraites et allocations) au dessus du seuil de pauvreté (60% du salaire médian, à savoir 1200 euros net au minimum) et bien sûr, une réforme de la fiscalité ?
Pour Juan Chingo, le soulèvement des Gilets jaunes est objectivement une révolte de la classe prolétaire, même si subjectivement elle s’est identifiée à une révolte populaire. Ce hiatus ou cette tension a été sa faiblesse principale. Mais on peut difficilement le reprocher aux Gilets jaunes, sachant combien le mouvement ouvrier « réellement existant » est resté à l’écart… Pour combler ce hiatus, il est justement crucial de défendre des revendications autour du travail, de l’emploi et de la protection sociale, tout en articulant celles-ci à une transformation sociale et politique d’ensemble.
Une transformation qui vise à démocratiser en profondeur la société, à démanteler une 5ème République qui représente non seulement, comme le disait François Mitterrand (avant son élection en 1981), un « coup d’état permanent », mais aussi une machine de guerre « ordolibérale ». En même temps, on ne peut pas nier l’existence d’un « État social » et de services publics qui, même délabrés, représentent une conquête et un « bouclier social » contre la précarisation de la condition salariale.
Une troisième observation critique me semble tout aussi importante. Il faut certes prendre acte des limites politiques de la LFI, du sectarisme de LO ou de l’activisme apolitique du NPA, mais ne faut-il pas également formuler une critique des courants politiques actifs dans les mobilisations des Gilets jaunes ?
Je pense aux amis du Comité invisible, qui, grâce à un usage intelligent des médias et des réseaux sociaux, et un langage exprimant avec justesse la révolte et la volonté de changement, ont accompagné et amplifié l’action des Gilets jaunes. Ce fait, positif en soi, ne doit pas conduire à taire les critiques d’une approche qui nourrit l’illusion que l’insurrection suffit pour mettre à bas le système et que, dans l’intervalle, il suffira de casser les vitres d’une agence bancaire ou de mettre le feu au Fouquet’s.
Certes, beaucoup d’entre nous ont pu sourire en lisant les jeux de mots tagués sur les murs de Paris (« demain est annulé »). Bien sûr que l’on peut admirer la « beauté » d’une émeute, mais il faut aussi se demander si c’est de cette manière qu’on réussira à approfondir et à élargir les mobilisations. À la violence contre des objectifs matériels, le pouvoir répond par la répression en cherchant à isoler les secteurs radicalisés des secteurs plus modérés qui doutent et hésitent. Certes, certains se radicalisent et prennent conscience de la nature de l’État, mais cela ne répond pas à la question de savoir comment la révolution se fera. En fait, contre l’apologie apolitique de la violence comme équivalent de l’insurrection, il faut opposer une intelligence stratégique et tactique qui ne peut être le fruit que d’une délibération démocratique, et donc de l’auto-organisation.
L’orientation quelque peu « basiste », communaliste ou municipaliste-libertaire de l’appel de Commercy défend la construction d’un contre-pouvoir citoyen, qui pourrait s’amplifier et devenir réel dans beaucoup de communes et villes. Faut-il la soutenir et l’appliquer partout où c’est possible ? J’ai quelques doutes. D’une part, je pense qu’il est possible de faire de la politique autrement et qu’on peut agir en faveur de la démocratisation du jeu politique, ne serait-ce que municipal. Je pense aussi que ceci peut produire des avancées réelles et peut contribuer à reconstruire une identité politique s’appuyant sur la solidarité et la démocratie réelle.
Mais en même temps, je pense qu’une telle approche ne peut se faire avec succès que si les rapports de force changent à l’échelle de la société, faute de quoi, beaucoup d’énergie sera absorbée par une démultiplication de micro-conflits autour de questions tels que l’aménagement du territoire, les services publiques, le logement, etc. Certes, c’est autour de ces questions que peuvent se tisser des liens entre jeunes et plus anciens, inorganisés et réseaux militants, par-delà les origines et les convictions religieuses et ce n’est pas rien. Mais cela ne répond pas à la nécessité de renverser le cours des choses et de mettre un coup d’arrêt aux réformes néolibérales qui sont en train de détruire ce qui rend ce monde encore quelque peu vivable.
Cela étant, comme Emmanuel Macron revient à la charge – son travail de destruction n’est pas terminé… –, la question de l’affrontement central va se reposer, peut-être plus vite que l’on ne pense. À la réforme des retraites, l’ouverture à la concurrence de la SNCF, la crise du travail enseignant et des services de soin, se rajoute une érosion continue du pouvoir d’achat, poussant dans la pauvreté et la précarité des secteurs entiers de la classe laborieuse. Si les secteurs combatifs du mouvement syndical avaient opté pour des journées de grève avec des débrayages les vendredis précédent les Actes des Gilets jaunes, on aurait certainement connu autre chose. Mais ce qui ne s’est pas réalisé peut encore advenir et nous pourrions connaître à brève échéance une giletjaunisation des luttes sociales.
Hier, aujourd’hui comme demain, l’urgence n’est pas seulement de négocier le nombre de points pour la retraite en lien avec les pénibilités du travail mais d’impulser un mouvement de lutte pour des mesures concrètes contrecarrant la précarisation et la paupérisation des mondes du travail. Tout syndicaliste qui se respecte devrait le comprendre et dépasser l’esprit boutiquier et le jeu de positionnement de type réalisme versus radicalisme qu’adoptent les directions syndicales.
Un désaccord qui n’en est peut-être pas un
Le sous-titre de l’ouvrage mentionne « Quand le trône a vacillé ». Je ne suis pas certain que cela ait été le cas. L’irruption de la colère sociale a fait peur à la classe dirigeante et les patrons ont téléphoné à l’Elysée en disant qu’il fallait faire quelque chose et vite. Mais à aucun moment, la bourgeoisie a envisagé de pousser Macron vers la sortie.
Avant de faire sauter ce fusible, la classe dirigeante avait encore d’autres cartes à jouer. Elle a commencé par désamorcer la conflictualité en concédant quelques reculs, doublé d’un discours sur le registre « je vous ai compris », en promouvant un grand débat national, tout en appliquant une terreur répressive féroce. Au cas où cela ne suffisait pas, il restait la possibilité d’un changement ministériel, des mesures supplémentaires ou encore la dissolution de l’Assemblée nationales avec des élections anticipées comme paratonnerre. N’oublions pas que depuis une dizaine d’années, les gouvernements ne cèdent que très difficilement à la rue tant il est important pour la bourgeoisie que sa « révolution passive » néolibérale soit appliquée.
Pour l’instant, la révolte sociale des Gilets jaunes a redressé le rapport de force ; Macron n’a pas voulu céder mais le mouvement des GJ non plus. Le résultat, c’est un match nul avec avantage du côté de Macron (puisqu’il a le pouvoir et que les GJ se sont fatigués et sont bien moins nombreux). Macron tente de reprendre l’initiative dans un climat qui n’est pas celui d’une défaite du mouvement non plus.
Il ne s’agissait pas d’une « insurrection » mais d’un soulèvement, ou d’une révolte sociale, là dessus nous sommes d’accord. Une insurrection, à condition qu’elle soit massive et authentique, débouche potentiellement sur une crise révolutionnaire, où les uns ne savent plus comment gouverner et les autres ne se laissent plus gouverner. On n’en était pas là, même si on a bien pu voir qu’une telle situation pouvait et peut encore advenir.
Dans le cas présent, même si le rejet de Macron est largement répandu, la mobilisation exprimait d’abord un ras-le-bol absolu des conditions de vie. Dans une enquête menée au mois de janvier auprès de 4000 répondants, 70% soutenait les Gilets jaunes et près de 35% se déclaraient eux-mêmes « Gilets jaunes », tandis que près d’un quart des répondants avaient participé au minimum à une des formes d’action (occupation de rond points, manifestation de samedi et interventions sur les médias sociaux). Cela témoigne du caractère massif de cette révolte. L’enquête montre aussi que la démission de Macron, y compris parmi les Gilets jaunes mobilisés, représentait un souhait moins important que la hausse du pouvoir d’achat. Il y avait donc un « boulevard » pour réaliser une unité avec les secteurs combatifs du mouvement syndical…
Ceci ne signifie pas que les revendications politiques seraient négligeables. Sur ce plan, c’est d’abord le RIC qui a connu un certain écho. On peut douter de l’efficacité d’un tel outil mais en même temps, le terrain était fertile pour un plaidoyer en faveur d’une « révolution démocratique ». À l’évidence pour beaucoup de Gilets jaunes, l’État n’est plus un État servant l’intérêt général mais au service des seuls nantis et d’une caste politique. Des revendications comme la révocabilité des élus et l’obligation de soumettre chaque loi à un débat à mener au sein d’assemblées citoyennes auraient pu avoir un écho réel.
Plus globalement, si l’idée d’une 6ème République a toujours été assez lunaire pour le commun des mortels, trop empêtrés dans les ennuis de la vie quotidienne, l’idée d’un changement de régime était partagée par beaucoup de Gilets jaunes. Mais que mettre à la place ? Un gouvernement de Salut Public ? Un Comité National de la Résistance au néolibéralisme ? Il y avait beaucoup d’idées en circulation mais peu de stratégie pour y arriver. Et surtout, un grand silence sur ce point de la part des organisations révolutionnaires.
Pour ma part, au moment où une nouvelle épreuve de force se présente autour de la réforme des retraites, je pense qu’il est urgent de constituer un front social et politique unitaire, en convoquant des États généraux de la « France d’en bas » qui lutte. Il me semble en tout cas indispensable d’agir sur ce terrain, en rassemblant les Gilets jaunes, le monde syndical en lutte, des collectifs de quartiers populaires ainsi que les forces politiques de gauche (avec ou sans représentation à l’Assemblée nationale). Ce serait une manière de mettre les directions syndicales et les appareils politiques au pied du mur, en leur demandant de prendre leurs responsabilités.
Quelles leçons stratégiques retenir ?
Beaucoup de pays connaissent en ce moment des mouvements de contestation massifs et radicaux : Chili, Equateur, Liban, Algérie, Hong Kong, Catalogne. Par-delà les différences, toutes ces mobilisations se développent aussi autour de la question sociale. Imaginons-nous que nous n’en sommes qu’au début et que le spectre de la révolution réapparaisse vraiment. Quelle stratégie adopter ? Le scenario d’un changement par les urnes façon Unidad Popular conduisant Salvador Allende au pouvoir ? Ou encore celle du Front populaire en France de 1936, avec un gouvernement poussé dans le dos par une grève générale ?
Si les partis traditionnels de la gauche ont perdu leur hégémonie politique sur le mouvement ouvrier, d’autres partis ont vu (ou peuvent voir) le jour. Je veux dire par là que la forme-parti n’est pas forcément devenue obsolète même si la constitution d’un bloc contre-hégémonique exige de repenser cette forme et d’actualiser l’arsenal programmatique. Par ailleurs, même la démocratie représentative est en crise, elle a perdu de sa légitimité ; il ne faut pas prendre ses souhaits pour la réalité et croire que pour ceux qui se révoltent, le choix se situerait désormais entre la démocratie directe/participative d’une part et une régime autoritaire d’autre part.
On le sait, la classe dirigeante et ses représentants au pouvoir utiliseront tout ce qu’ils peuvent (y compris le fascisme) pour affaiblir ou écraser les révoltes sociales. Ils utiliseront aussi les élections pour ramener la dynamique de mobilisation dans le giron des institutions. Une stratégie révolutionnaire doit intégrer ces données et ne pas se cantonner aux simples luttes qu’il faudrait faire converger mais oser investir le terrain d’un changement de régime. Un mouvement de contestation, réellement auto-organisé et enraciné dans les entreprises comme dans les quartiers populaires, aura à suivre une stratégie de double pouvoir, permettant de se donner les moyens de dicter, au nom de la majorité sociale et du salut public, les mesures d’urgence en faveur de la majorité sociale qui s’imposent.
Dans cette perspective, il faudrait commencer à travailler les questions revendicatives et élaborer un programme de rupture, de « transition » qui correspond à la période dans laquelle nous sommes entrés. Sur ce plan, les références idéologiques en isme (le trotskysme dans toutes ces variantes, mais aussi l’anarchisme, le communisme et le socialisme) ont moins d’importance que la capacité à renouer avec une stratégie révolutionnaire et ces fondements programmatiques, dont la dimension internationale ne doit pas être sous-estimée.
Notes
[1] Bouquin, S, « Un retour en force de la question sociale. Quelques notes à propos de la révolte en gilet jaune », in Les Mondes du Travail, janvier 2019, pp. 121-132.
[2] – La première à Commercy en février 2019, la seconde à Saint Nazaire début avril 2019, puis à Monceau-les-Mines en juin et enfin à Montpellier (2-3 novembre 2019),









