
La Commune de Paris et son histoire. Quelques remarques à propos du livre de Q. Deluermoz
À propos de : Quentin Deluermoz, Commune(s) 1870-1871, une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 2020.
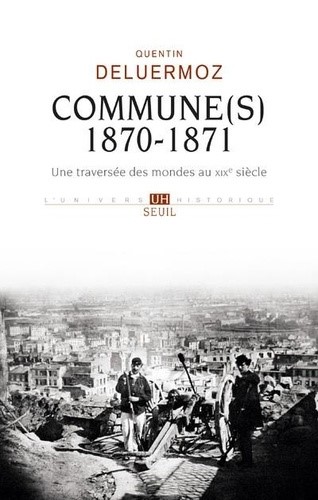
Paru en 2020, le livre de Quentin Deluermoz sur la Commune de Paris a bénéficié d’une réception critique unanimement élogieuse. L’auteur a d’ailleurs été l’un des historiens les plus sollicités par les médias à l’occasion du 150ème anniversaire de l’événement. Sa relecture de la Commune est cependant très contestable. Comme le montre ici Emmanuel Brandely, il énonce en effet, en passant et souvent sans prendre la peine de les justifier, des affirmations assez étonnantes pour un historien présenté comme « marqué à gauche »[1].
***
Thiers, boucher malgré lui ?
C’est d’abord la présentation qu’il fait du rôle joué par Adolphe Thiers, le chef des Versaillais, qui interpelle. Ainsi écrit-il, à propos du 18 mars 1871, que
« l’insurrection parisienne menace l’État républicain au moment où il tente de se stabiliser après les élections de février »[2].
L’affirmation est pour le moins surprenante. D’abord parce que le caractère « républicain » de l’État en question, de son Assemblée ultra-monarchiste et de son « chef du pouvoir exécutif », Thiers, « le fossoyeur de la République de 48 » (Lissagaray), est largement sujet à caution. Ensuite parce que, comme le rappelle Michel Cordillot, il est « généralement admis que ceux qui prirent les armes pour soutenir la Commune le firent pour défendre la République qu’ils estimaient menacée par le résultat des élections du 4 février 1871, et parce qu’ils avaient instinctivement perçu dans la tentative militaire du 18 mars la volonté de rééditer le coup d’Etat du 2 décembre 1851 »[3].
C’est en effet la crainte d’une restauration monarchiste perçue comme imminente, qui conduit les bataillons de la garde nationale à se fédérer et à créer un Comité central, avant même que les Parisiens ne s’insurgent le 18 mars. La tentative de s’emparer des canons est alors interprétée comme l’amorce du coup d’État monarchiste redouté depuis la décapitalisation de Paris et l’installation de l’Assemblée à Versailles. Bref, si la question de savoir si la Commune a ou non « sauvé la République » est depuis longtemps débattue par les historiens, rares sont ceux qui ont sérieusement suggéré qu’elle l’avait « menacée ». C’est par contre très exactement la thèse défendue par Macron : « Versailles, c’est là où la République s’était retranchée quand elle était menacée »[4].
Autre affirmation très discutable, à propos de « la semaine de l’incertitude » qui sépare l’insurrection du 18 mars de l’élection de la Commune le 26 mars :
« tous les protagonistes s’entendent à ce moment sur deux points : la nécessité de procéder à des élections et le refus de la guerre civile, chacun ayant à l’esprit le spectre de juin 1848. (…) chacun veut éviter la guerre civile »[5].
Précisons que les « protagonistes » ici évoqués sont d’une part le gouvernement de Thiers et l’Assemblée versaillaise, de l’autre le Comité central de la garde nationale, et, dans le rôle de conciliateurs, les députés et maires de Paris. Que chacun ait alors à l’esprit le « spectre » des journées de juin 1848 est une certitude. Tout comme il est avéré que l’ensemble des acteurs évoqués agissent à ce moment en prétendant vouloir éviter le bain de sang. Mais l’historien peut-il prendre pour argent comptant les déclarations de principe de Thiers, ce « virtuose du parjure et de la trahison » (Marx) ?
L’échec des élus de Paris, qui ont passé la semaine à tenter d’arracher à Thiers et à l’Assemblée, inflexibles, la simple reconnaissance des « franchises municipales » de la capitale, le droit d’élire une municipalité et pour la garde nationale celui d’élire ses chefs, n’en dit-il pas bien davantage sur leurs véritables intentions ? Lissagaray rappelle que « vainement, un des députés-maires supplia l’Assemblée de ne pas les laisser rentrer à Paris les mains vides. Cette haute bourgeoisie (…) tremblait de fureur à la seule pensée de céder quelque chose à Paris ». Quentin Deluermoz reconnait d’ailleurs plus loin que dès le 22 mars (avant en réalité) « le choix » de la répression sanglante est fait et « le retour en arrière impossible ». Jules Favre, à la tribune de l’Assemblée le 21 mars, est tout à fait explicite :
« Dans l’attentat du 18 mars, toute la garde nationale est complice ou coupable. (…) Il n’y a pas à pactiser avec l’émeute. Il faut la dompter, il faut châtier Paris ! ».
Voilà qui cadre mal avec une prétendue volonté d’« éviter la guerre civile »…
A propos de la Semaine sanglante, Deluermoz écrit :
« il est acquis aujourd’hui que le chef de l’exécutif avait initialement donné des ordres de clémence, non respectés, avant de couvrir sciemment la férocité de la répression. »[6]
Peut-être est-ce là pour l’auteur un fait « acquis », mais le lecteur ne peut que regretter que dans un livre contenant pas moins de 55 pages de notes il n’ait pas jugé utile de préciser sa source. Et, encore une fois, il semble ne pas envisager que l’on puisse déclarer une chose et en préparer une autre. Lissagaray, écœuré par le cynisme de Thiers promettant dans une même phrase une « expiation complète » à la majorité réactionnaire de l’Assemblée et le respect scrupuleux de « la loi » à sa minorité républicaine, n’a-t-il pas raison quand il écrit : « en juin 1848, Cavaignac avait promis le pardon et il massacra ; M. Thiers avait juré par les lois, il laissa carte blanche à l’armée » ?
Avant même la Semaine sanglante l’armée versaillaise ne s’est-elle pas illustrée par l’assassinat de nombreux fédérés prisonniers ? Thiers ne jurait-il pas à la province qu’il ne bombardait pas Paris alors même que les obus pleuvaient sur la capitale ? Ne s’est-il pas, enfin, félicité de voir « le sol jonché de cadavres » et de la « leçon » administrée au prolétariat parisien ?
L’auteur avance enfin une explication politico-psychologique assez stupéfiante de l’attitude de Thiers lors la Semaine sanglante :
« La raison d’Etat pour ces libéraux, en quelque sorte, impose le maintien à tout prix des libertés politiques et en leur nom, dans une situation exceptionnelle, il est paradoxalement possible, pour les préserver, de les mettre temporairement entre parenthèses. La répression de la Semaine sanglante est en ce sens une étape importante dans la constitution d’un État libéral. »
Si c’est assurément au nom de la « légalité » et de la défense des « libertés politiques », mises en péril par la « tyrannie » de la Commune, que le « libéral » Thiers a laissé les généraux bonapartistes et leur armée de ruraux massacrer les communards, l’historien peut-il s’en tenir là et reprendre à son compte les justifications données par Thiers ? En l’occurrence, la défense de la « légalité » et des « libertés politiques » a-t-elle été autre chose que le paravent de la défense de l’ordre social ? Jules Favre ne déclare-t-il pas à l’Assemblée le 21 mars, avant même l’élection et le moindre décret de la Commune, « est-ce que nous ne savons pas que les réquisitions commencent, que les propriétés privées seront violées » ? Dans le télégramme qu’il adresse au même Jules Favre le 21 mai, Thiers n’écrit-il pas crûment : « Que M. de Bismarck soit bien tranquille. (…) l’Ordre social sera vengé dans le courant de la semaine » ?
S’il ne s’était agi que de respect de la « légalité » croit-on vraiment qu’aucun compromis n’aurait été trouvé entre la Commune, qui voulait les élections municipales parisiennes en mars, et Versailles qui les promettait pour avril ? Jacques Rougerie note malicieusement à ce propos que « souvent, ce sont ses adversaires qui comprennent le mieux, le plus vite, le sens d’une révolution »[7]. On ne saurait mieux dire. Quant à faire de la Semaine sanglante « une étape importante dans la constitution d’un État libéral », c’est effectivement, pour le moins, « paradoxal ». Jusqu’à preuve du contraire, la Semaine sanglante a surtout été une effroyable boucherie et une « étape importante » dans l’établissement d’une République conservatrice ouvrant la voie à la franche réaction de l’Ordre moral du maréchal Mac-Mahon.
Deluermoz a-t-il lu Marx ?
L’auteur se montre très soucieux de se démarquer des « analyses marxistes »[8], mais il n’est visiblement pas très familier de la pensée de Marx. Comment expliquer sinon qu’il écrive à son propos :
« Dans sa vision hégélienne de l’histoire, la Commune inaugurerait un moment essentiel, celui où les masses travailleuses deviennent actrices de leur propre histoire »[9] ?
Attribuer au Marx de 1871 – c’est-à-dire à celui qui a théorisé « la conception matérialiste de l’histoire » dès 1845 dans l’Idéologie allemande – une « vision hégélienne de l’histoire » fait tout de même un peu désordre pour un professeur d’histoire contemporaine à l’Université. Cette méconnaissance se retrouve tout au long de l’ouvrage dès qu’il s’agit de l’auteur du Capital. Par exemple lorsqu’il assure que
« La Commune (…) n’est pas sans effet sur Marx : elle intervient dans sa réflexion sur la forme politique à instituer dans le futur – pas forcément dans le sens d’un État fort puisqu’il discute aussi des idéaux fédéralistes des leaders communards. »[10]
« Pas forcément », c’est le moins que l’on puisse dire… Dans une lettre adressée à Kugelmann datée du 12 avril 1871, Marx dit au contraire :
« si tu relis le dernier chapitre de mon Dix-huit Brumaire, tu verras que j’y exprime l’idée suivante : la prochaine tentative révolutionnaire en France ne devra pas, comme cela s’est produit jusqu’ici, faire changer la machinerie bureaucratico-militaire de main, mais la briser. Et c’est la condition préalable de toute véritable révolution populaire sur le continent. C’est bien là d’ailleurs ce que tentent nos héroïques camarades parisiens ».
« Briser » la « machine » d’État écrit Marx dès 1852 dans le Dix-huit Brumaire. Il le répète, et le précise, en 1871 à la lumière de l’expérience communarde dont il dit que « ce ne fut pas une révolution contre telle ou telle forme de pouvoir d’État, légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale » mais « une révolution contre l’État lui-même, cet avorton surnaturel de la société »[11]. Comment Quentin Deluermoz peut-il assurer, en 2020, que Marx en était encore en 1871 à se questionner sur l’opportunité d’un « État fort » ?
Toujours sur le rapport de la Commune à l’État, l’auteur assure :
« Dans sa célèbre analyse de la Commune La guerre civile en France, Karl Marx (…) reprochait à la Commune de s’être coulée dans l’appareil d’État bourgeois et de ne pas l’avoir remplacé »[12].
Marx a en effet écrit que « la classe ouvrière ne peut pas se contenter de s’emparer telle qu’elle de la machinerie de l’État et de la faire fonctionner pour son propre compte »[13]. Mais y lire un « reproche » ou une critique, même implicite, contre la Commune relève du contresens pur et simple. La suite du texte ne laisse aucune équivoque à ce sujet. Marx met au contraire au crédit de la Commune d’avoir engagé le processus de destruction de l’État :
« Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l’armée permanente, et son remplacement par le peuple en armes. La Commune fut composée des conseillers municipaux (…) responsables et révocables à court terme. (…) la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l’administration ».
Plus loin il parle de « l’antagonisme entre la Commune et le pouvoir d’État ». C’est bien sûr le droit de tout historien de critiquer et remettre en cause l’analyse de Marx. Mais pourquoi lui faire dire le contraire de ce qu’il dit ?
Un problème de méthode historique
Enfin et surtout, la méthode historique utilisée par Quentin Deluermoz pose sérieusement problème. Ainsi écrit-il à propos de l’œuvre sociale de la Commune :
« Le bilan général paraît mince au point que les élus eux-mêmes s’en sont moqués, à l’instar de Frankel, amer, soulignant que le décret sur le travail de nuit des boulangers était au fond la seule mesure véritablement socialiste de la Commune »[14].
Mais dans quel contexte Leo Frankel – militant hongrois de l’Internationale et élu de la Commune dirigeant la commission du Travail qui propose le décret du 20 avril supprimant le travail de nuit pour les ouvriers boulangers – a-t-il déclaré que cette interdiction était « le seul décret véritablement socialiste qui ait été rendu par la Commune » ? Il fait cette déclaration lors de la séance de la Commune du 28 avril alors que certains élus, se faisant le relais des patrons boulangers mécontents, remettent en cause le décret du 20 avril au motif que la Commune n’avait « pas à intervenir dans une question entre patrons et employés »[15]. Frankel intervient donc pour défendre le décret car, poursuit-il,
« nous sommes ici (…) pour faire des réformes sociales. Et pour faire ces réformes sociales, devons-nous d’abord consulter les patrons ? Non. (…) Je n’ai accepté d’autre mandat ici que celui de défendre le prolétariat, et, quand une mesure est juste, je l’accepte et je l’exécute sans m’occuper de consulter les patrons. »
Contrairement à ce que dit Deluermoz, ce n’est, on le voit, ni par « amertume », ni pour « se moquer » de l’œuvre sociale de la Commune que Frankel fait cette déclaration. Et l’heure n’était d’ailleurs certainement pas pour lui, le 28 avril, à un quelconque « bilan général » de l’œuvre de la Commune. Décontextualiser une citation pour lui faire dire autre chose que ce qu’elle dit n’est pas une manière sérieuse et honnête d’écrire l’histoire. Quant au bilan de sa charge de délégué à la commission du Travail, Frankel le fera plus tard :
« la Commission du travail avait déjà bien entamé des travaux préliminaires concernant la mise en place de boulangeries et d’ateliers de tailleurs coopératifs (…) et plus largement en vue d’un passage progressif du mode de production capitaliste à un mode de production coopératif »[16].
Ce bilan là, il est vrai, ne cadre pas vraiment avec ce que Quentin Deluermoz veut lui faire dire.
*
Qu’un tel livre ait bénéficié de l’accueil enthousiaste des médias institutionnels n’a, on le voit, rien pour surprendre. Qu’il se soit trouvé dans le mouvement ouvrier, et jusque parmi les « amis de la Commune », des gens pour le célébrer, voilà qui est bien moins compréhensible.
Notes
[1] « Quentin Deluermoz fait partie de cette génération originale d’historienEs de moins de 50 ans, plutôt marqués à gauche », l’Anticapitaliste (n°123, février 2020). Il est en effet l’un des signataires de l’appel « Faisons vivre la Commune ! », paru à l’occasion du 150ème anniversaire, dans lequel on peut lire : « les soussigné.e.s se revendiquent défenseurs du souvenir de La Commune comme expérience et moment unique d’émancipation sociale et politique (…)».
[2] Page 60
[3] Dans son article « La République fut-elle sauvée par la Commune ? » (La Commune de Paris, 1871, les acteurs, l’événement, les lieux, Les éditions de l’atelier, 2021).
[4] Cf. l’article de Michel Becquembois, « Macron, une certaine idée de Versailles », Libération, 10 mai 2018.
[5] Pages 147 et 148.
[6] Page 245.
[7] Paris libre, 1871, Le Seuil, 1971 réédité en 2004, page 123.
[8] Il évoque de manière récurrente dans son livre et ses articles « la fin des grands paradigmes » et le « reflux des analyses marxistes ». Et reproche à Marx « une vision parfois abstraite » de la Commune au motif qu’il ne cite pas… les noms des rues de Paris dans La Guerre civile en France !
[9] Page 301.
[10] Page 275.
[11] Premier essai de rédaction de La Guerre civile en France, publié dans Sur la Commune de Paris (éditions sociales, p. 209)
[12] Page 216.
[13] La Guerre civile en France, dans Sur la Commune de Paris (éditions sociales, p.174).
[14] Page 172.
[15] Voir Julien Chuzeville, Léo Frankel, communard sans frontières, Libertalia, 2021, p. 59 et 60.
[16] Texte de 1889 cité dans Julien Chuzeville, Léo Frankel, communard sans frontières, Libertalia, 2021, p. 56.

![La Commune vivante. Entretien avec Ludivine Bantigny [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Spectre-Commune-150x150.jpg)






