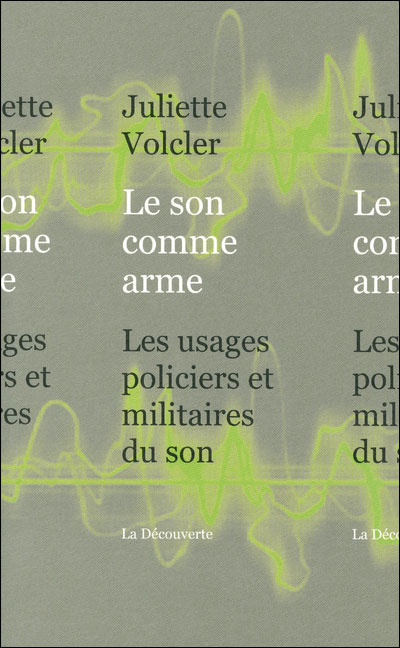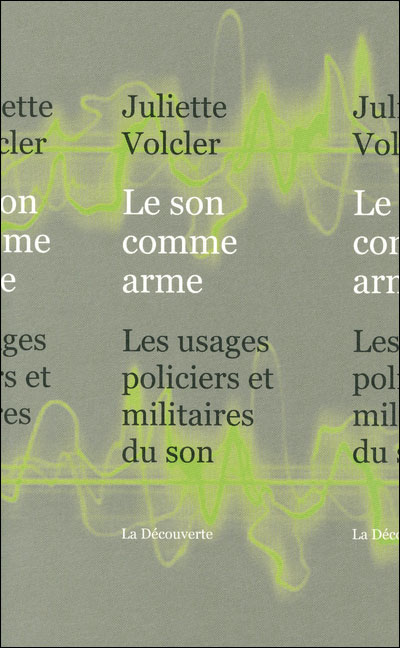
Juliette Volcler, Le son comme arme. Rencontre et bonnes feuilles
Rencontre avec Juliette VOLCLER autour de son ouvrage Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son (éditions La Découverte, 2011), dont vous pouvez lire un chapitre en ligne ici : lundi 28 novembre à 19h au Lieu-dit, 6 rue Sorbier 75020 Paris (M° Ménilmontant).
« Lalafalloujah », tel est le surnom donné par les GI’s à la ville irakienne de Falloujah en 2004, alors qu’ils bombardaient ses rues de hard rock à plein volume. « C’était comme envoyer un fumigène », dira un porte-parole de l’armée états-unienne. Les années 2000 ont en effet vu se développer un usage répressif du son, symptomatique de la porosité entre l’industrie militaire et celle du divertissement, sur les champs de bataille et bien au-delà. Rap, metal et même chansons pour enfants deviennent des instruments de torture contre des terroristes présumés. Des alarmes directionnelles servent de technologies « non létales » de contrôle des foules dans la bande de Gaza comme lors des contre-sommets du G20, à Toronto et à Pittsburgh. Des répulsifs sonores éloignent des centres-villes et des zones marchandes les indésirables, adolescents ou clochards. L’enrôlement du son dans la guerre et le maintien de l’ordre s’appuie sur plus d’un demi-siècle de recherches militaires et scientifiques. La généalogie des armes acoustiques, proposée ici pour la première fois en français, est tout autant celle des échecs, des fantasmes et des projets avortés, que celle des dispositifs bien réels qui en ont émergé. Aujourd’hui, l’espace sonore est sommé de se plier à la raison sécuritaire et commerciale. Souvent relégué au second plan au cours du XXe siècle, celui de l’image, il est devenu l’un des terrains d’expérimentation privilégiés de nouvelles formes de domination et d’exclusion. Et appelle donc de nouvelles résistances.
Plus d’informations : http://www.lelieudit.com/Le-son-comme-arme-Les-usages.html.
L’éditeur vous propose de découvrir ici un chapitre du livre :
Chapitre 6
« Peu importent vos raisons d’être ici, veuillez quitter les lieux[1] » : le son du pouvoir
Que signifie le développement, dans la période contemporaine, de l’usage du son comme moyen de contrôle et de répression ? L’inventaire achevé, on voit que la recherche est déjà vieille de plus d’un demi-siècle, qu’elle a été laborieuse et qu’elle n’a accouché, au bout de longues années et de ronflants espoirs, que de quelques dispositifs et pratiques bien précis. Mais on n’en assiste pas moins aujourd’hui à une présence de plus en plus marquée de technologies sonores dissuasives dans l’espace public. Le phénomène est récent et le débat qu’il occasionne reste pour l’instant cantonné à quelques milieux restreints – on ne saurait donc ici qu’en esquisser une première analyse.
Nous verrons d’abord que le son employé par les militaires, les policiers et certains particuliers éclaire de manière singulière la genèse, la prolifération et l’art du camouflage des technologies « non létales ». Mais peut-être est-ce déjà du passé : au-delà de leur « non-létalité », les armes deviennent ludiques, pour reprendre l’analyse du philosophe Olivier Razac. Nous nous intéresserons à l’interaction croissante entre l’industrie du divertissement et celle de l’armement : le son est ici employé pour brouiller les frontières entre la guerre, la culture et le jeu, et pour nettoyer le débat public de toute portée politique. Quant à l’avenir, il semble aller au-delà du militaro-spectaculaire, ou plutôt l’incruster dans la matière même des lieux que nous habitons : nous observerons que l’espace acoustique, terra incognita lentement conquise, devient le lieu d’un tri social omniprésent et dessine progressivement les contours d’un nouvel urbanisme sonore.
« Un mégaphone puissant doté d’une mitraillette auditive[2] » : la « non-létalité »
Un membre du Congrès états-unien, James Scheur, s’enthousiasmait en 1970 : « Nous pouvons tranquilliser, bloquer, immobiliser, harceler, choquer, irriter, stupéfier, donner des nausées, donner froid, temporairement aveugler et rendre sourd, ou juste faire mourir de peur toute personne que la police a légitimement besoin de contrôler[i]. » C’est, en termes moins réjouis, la définition que donne le philosophe Michel Foucault de la biopolitique : « Cette grande technologie à double face – anatomique et biologique, individualisante et spécifiante, tournée vers les performances du corps et regardant vers les processus de la vie – caractérise un pouvoir dont la plus haute fonction désormais n’est peut-être plus de tuer mais d’investir la vie de part en part[ii]. » Il ne s’agit plus d’éliminer le corps ennemi, mais de le rendre docile ou inopérant, de provoquer sa paralysie globale.
Genèse
Si la « non-létalité » ne commence à être formulée comme telle qu’à partir des années 1960, « dans un contexte marqué par l’émergence des masses contestataires et des mouvements de défense des droits civiques[iii] », et si elle ne devient un concept stratégique central qu’au cours des années 1990, l’archéologie de l’usage du son comme arme met en évidence des strates plus anciennes de la même idée. Avant que le colonel Applegate ne préconise l’emploi de grenades chargées à blanc dans le maintien de l’ordre, avant que chercheurs et militaires ne s’échinent à trouver l’infrason magnifique qui produirait « incontinences » et « états léthargiques », avant que les « sons dissonants » ne soient employés pour désarmer tireurs vietcongs ou manifestants occidentaux, le son servait déjà dans des expérimentations « non létales ». Les armes actuelles et l’idéologie qui les sous-tend sont au croisement de plusieurs histoires qui s’entremêlent.
Première lignée : les opérations psychologiques de l’armée. C’est là peut-être où se formalise le plus tôt une certaine pensée de la « non-létalité », envisagée comme complément, accompagnement et parfois intensification de l’action létale. Il s’agit, suivant le précepte de Sun Tzu, général chinois du vie siècle avant notre ère abondamment cité dans la littérature des Psyop, de « soumettre sans combattre[iv] » – et, selon les termes d’un officier des États-Unis en 1947, de pouvoir évoquer ces opérations « en temps de paix, sans heurter la sensibilité d’un citoyen vivant en démocratie[v] ». Ce sont là, précisément, trois caractéristiques de la « non-létalité » : l’objectif de neutraliser plutôt que de tuer, la porosité entre opérations de guerre et opérations de maintien de l’ordre ou humanitaires et la prise en compte des médias et de l’opinion publique dans la gestion du conflit.
Deuxième lignée : la privation sensorielle. Dès la Seconde Guerre mondiale, les recherches dans ce domaine et l’essor des opérations psychologiques vont lentement instituer, de manière non concertée puis avec des interactions croissantes, une science du comportement et de son conditionnement possible. Médecins et psychiatres sont introduits dans des opérations militaires, non pour soigner mais pour rendre lesdites opérations plus efficaces et plus difficilement critiquables. La collaboration, amorcée dans le secret au sein du projet MKUltra, est aujourd’hui officiellement instituée : pour la branche « interrogatoire renforcé », par la présence des équipes de consultants en sciences comportementales (les Behavorial Science Consultation Teams ou BSTC) dans les prisons de la CIA ; pour la branche « action psychologique », par les laboratoires comportementalistes de l’ARDEC, comme le TBRL, engagé dans la « défense nationale[vi] », ou le SMBI, spécialisé dans la neurobiologie et qui réunit « une équipe multidisciplinaire de chercheurs et de théoriciens pour affronter de manière collégiale les problèmes liés au stress et à la résistance au stress, en vue de défendre les intérêts de notre pays[vii] ».
Troisième lignée : la gestion sanitaire du vivant. Bon nombre de dispositifs « non létaux » ont initialement été développés pour contrôler insectes et animaux. C’est le cas des « barrières infrasoniques » anti-poissons, des « canons effaroucheurs » anti-oiseaux, des « dispositifs acoustiques répulsifs » anti-mammifères marins, des « générateurs d’ultrasons » anti-insectes, anti-rongeurs ou anti-chiens – et aussi bien, dans d’autres domaines que le son, des barrières ou bâtons électriques contre le bétail, dont sont issus les Tasers[viii]. Une rhétorique spécifique se met en place par la même occasion, qui opère un renversement logique : la version du LRAD visant à éloigner les oiseaux des avions ou des champs est notamment présentée comme assurant la « protection de la faune[ix] ».
Les dispositifs « non létaux », plus banalement, ne protègent pas tant leurs cibles que leurs détenteurs : on sauve sans doute quelques volatiles des turbines, mais l’objectif est assurément de veiller sur l’industrie et le transport plutôt que sur la nature. Lorsque les pratiques « non létales » commencent à être employées contre des êtres humains et à organiser leur gestion hygiénisée, elles ne visent pas davantage à les épargner – bien plutôt à les domestiquer ou à les briser. Elles sont d’abord testées sur des cobayes parfois non volontaires. Elles sont ensuite dirigées contre des populations que le pouvoir considère non pas comme les plus vulnérables, mais au contraire comme les plus nuisibles, les plus dangereuses ou les moins « civilisées » : militants révolutionnaires armés et dissidents sur le territoire national, habitants des colonies, combattants anti-impérialistes et suspects de terrorisme à l’étranger. Le chercheur et pacifiste britannique Steve Wright a par ailleurs relevé que les armes « non létales » avaient « régulièrement contribué à des crimes contre les droits de l’homme depuis leur première utilisation à l’époque coloniale dans des opérations de contrôle des foules[x] ».
Quatrième lignée : la prospective institutionnelle. Dans « L’arme non létale dans la stratégie militaire des États-Unis : imaginaire stratégique et genèse de l’armement », le chercheur Georges-Henri Bricet des Vallons reprend la généalogie à la fois judiciaire, énergétique, policière et militaire de la « non-létalité » : le National Institute of Justice (NIJ) et l’ARDEC s’intéressent au « développement d’armes incapacitantes destinées au contrôle des populations civiles, carcérales notamment[xi] », le ministère de l’Énergie souhaitant quant à lui trouver des dispositifs capables de protéger ses sites nucléaires. Bientôt, l’American Correctionnal Association (association des prisons états-uniennes) et la National Association of Sheriffs (association nationale des shérifs) y voient le moyen d’améliorer le maintien de l’ordre. En 1994, « suite notamment aux émeutes de Los Angeles en 1992 et à la tragédie du siège de Waco », le ministère de la Justice et celui de la Défense signent un accord « sur le partage de technologies susceptibles de renforcer les opérations non directement guerrières (operations other than war) et les opérations de maintien de l’ordre[xii] » – l’agence de recherche de la Défense, DARPA, est chargée de la supervision globale. Le maintien de l’ordre se militarise et l’action militaire prend des allures d’opération de police. À la fin des années 1990, le NIJ conclut des accords de coopération sur l’armement « non létal » avec la Grande-Bretagne, Israël et le Canada, puis l’OTAN et l’Europe s’engagent dans la voie ouverte par les États-Unis. L’usage des armes « non létales », au départ pensé comme circonscrit, s’étend ensuite, jusqu’à devenir une norme du maintien de l’ordre et de l’action militaire[xiii].
Prolifération
La « non-létalité » est ainsi devenue « centrale dans la réflexion militaire sur les conflits asymétriques et la guerre urbaine[xiv] ». Les conflits asymétriques, qui opposent des forces dont l’organisation, les objectifs, les moyens et les stratégies diffèrent, répondent à différents critères : « Présence permanente du média dans le conflit, multiplication des conflits urbains prolongés […], dilution de la distinction sémiologique entre militaire et civil, combattants et non-combattants, militaires et paramilitaires (sociétés militaires privées) ». La guerre devient « système de contrôle transversal et continuum de force » et l’armée répond à cette mutation en déclarant une très officielle « révolution dans les affaires militaires », qui vise notamment à « développer une panoplie d’armes tous azimuts […] : lasers, ondes acoustiques, électromagnétiques, matériaux superadhésifs, supercaustiques, etc. » Un champ de possibilités « si large qu’il concerne toutes les filières technoscientifiques imaginables et offre donc au complexe militaro-industriel un marché particulièrement lucratif ». Initialement conçus sous l’impulsion et avec le financement des militaires, les produits « non létaux » seront ensuite spontanément proposés et librement vendus par les industriels.
Deux mouvements se produisent simultanément : le territoire de la guerre s’étend et il devient moins visible. Cela se manifeste notamment par l’apparition dans la vie quotidienne d’armes initialement conçues pour le champ de bataille : la « dualité civile-militaire […] siège au cœur du concept de non-létalité[xv] ». L’évolution des haut-parleurs employés dans les zones de conflit en témoigne. D’abord utilisés sur le champ de bataille comme outils de communication, ils le sont ensuite dans des opérations de leurre, puis dans des actions de harcèlement visant à déloger l’ennemi, voire à le tuer. À mesure que la figure de l’« ennemi intérieur » évolue, ces mêmes haut-parleurs intègrent progressivement les missions policières – c’est le cas du LRAD. Dans une seconde phase d’extension du domaine de la guerre, les armes employées par les forces de l’ordre se voient dupliquées dans le civil par des dispositifs de moindre ampleur, conçus hors de tout programme de développement étatique – le Mosquito, employé par des commerçants, des syndics ou des particuliers, en est le meilleur exemple. Les inventions les plus récentes, comme les haut-parleurs ultrasoniques, sont directement pensées pour les deux usages, militaire et civil, et ils offrent, à l’intérieur de ces deux champs, une fonction de communication ou de coercition – ils sont simultanément dispositifs publicitaires, de divertissement, de transmission, de répression.
Les armes « non létales », avant que cette figure de style ne gagne la bataille des médias, étaient qualifiées de « rhéostatiques », le rhéostat étant un appareil qui permet de moduler l’intensité du courant électrique passant à l’intérieur d’un circuit. Le terme, employé dans la terminologie officielle des États-Unis au cours des années 1990, caractérise plus précisément la finalité de ces armes : offrir des effets réglables allant de la « non-létalité » à la létalité. Dans le domaine sonore, les multiples tentatives de la société SARA témoignent de cette recherche. Les technologies acoustiques actuellement déployées, si elles ne sont a priori pas mortelles – conséquence d’un échec de la recherche plus que d’une restriction volontaire – répondent néanmoins à cette définition puisqu’elles permettent de passer d’un usage « sûr » (symbolisé par une zone verte sur le curseur de volume du LRAD) à un usage dangereux (symbolisé par une zone rouge). Dangereux pour l’audition, dangereux aussi parce qu’il prive un individu de ses moyens de défense et rend possible son élimination, comme cela s’est passé pour les tireurs embusqués en Irak : l’arme « non létale » sert dans ce cas à augmenter la capacité létale de l’armement classique.
Rhéostatiques, ces dispositifs le sont aussi en ce qui concerne leur domaine d’application, qui s’étend du champ de bataille à l’autodéfense individuelle. Leur statut hybride, entre arme et technologie civile, favorise le commerce : leur vente est libre et, comme nous l’avons vu avec le LRAD, on se passe aisément d’autorisation officielle pour les employer. Cela permet à des activistes de lutter, sur le plan acoustique du moins, à armes égales contre le pouvoir ou contre des escouades de sécurité privée : c’est ainsi que les écologistes de Sea Shepherd se sont équipés d’un LRAD pour répondre aux baleiniers qu’ils prennent en chasse. Mais l’« innocuité » revendiquée de ces technologies permet aussi aux forces armées de s’affranchir des clauses de « proportionnalité » et de « discrimination[xvi] » qui contraignent l’usage de l’armement. Divers observateurs indépendants évoquent un « risque de prolifération[xvii] » : ils notent qu’un usage criminel de ces armes se développe et craignent qu’elles ne servent également comme nouveaux instruments de torture, notamment dans les pays autoritaires – le risque étant d’autant plus grand que les fabricants minimisent les blessures qu’elles occasionnent[xviii]. Les technologies « non létales » relèvent donc non seulement le seuil de la violence autorisée, celle légalement exercée par le bras armé du pouvoir, mais aussi le seuil de la violence sociale plus générale.
Camouflage
La guerre, plus diffuse, devient moins visible – elle s’intériorise. Le champ de bataille se déplace progressivement à l’intérieur de l’individu et les traces extérieures se font plus discrètes. Dans un article de 1998 intitulé « Le cerveau n’a pas de pare-feu », le lieutenant-colonel états-unien Timothy L. Thomas conseille ainsi de considérer, dans la « guerre de l’information », l’organisme humain comme un « système d’information parmi d’autres », dont il serait possible d’« altérer les capacités psychologiques et de traitement de données » afin de « brouiller ou détruire les signaux qui maintiennent en temps normal l’équilibre du corps[xix] ». Une conception hygiénisée de la guerre se met en place : elle se veut « propre », dématérialisée et totale. Le corps de l’ennemi, qui portait la trace des agressions subies et qui en témoignait, est dorénavant employé comme une enveloppe qui masque les blessures, comme la façade laissée intacte d’un intérieur que l’on s’attache à dominer ou à détruire.
En 1975, des chercheurs militaires états-uniens annonçaient : « Il est préférable que les passants n’aient pas l’impression que la police emploie une force disproportionnée ou que l’arme a un impact particulièrement violent sur les individus cibles. Les flots de sang et ce genre d’effets spectaculaires sont à éviter[xx]. » L’énergie employée est invisible et ses effets également : nul besoin de nettoyer les rues de la ville après une bataille acoustique, ni de trop s’inquiéter de protestations de la part des victimes. On peut éventuellement prouver une lésion causée par une matraque ou un flashball, bien plus difficilement celle produite par un LRAD ou un Mosquito. On peut démontrer une nuisance visible, beaucoup moins celle que seule une partie de la population perçoit[3]. La difficulté est d’autant plus grande que les recherches médicales indépendantes sur les armes acoustiques restent rares, les publications plus encore, et que les effets psychologiques ne sont que très peu pris en compte, si ce n’est du point de vue stratégique. Comme le résume Steve Wright, « ces technologies ont été faites pour avoir l’air et non pour être inoffensives[xxi] ».
Mais pour n’être la plupart du temps ni visibles ni mortelles, les blessures occasionnées par ces armes n’en sont pas moins réelles et l’obligation de respecter les conventions internationales sur l’armement pas moins effective. Quatre mises en garde peuvent ainsi être rappelées. Une recommandation technique est apportée par Jürgen Altmann, qui préconise des limitations plus strictes de l’amplitude sonore autorisée dans le maintien de l’ordre : le seuil de 120 dB lui semble tenir compte des sensibilités individuelles aussi bien que de la diversité des situations sur le terrain[xxii]. Cent vingt décibels, nous pourrions considérer que c’est encore trop, et étudier la recommandation médicale émanant du médecin britannique Robin Coupland, rédacteur du projet Sirus de la Croix-Rouge. Cette étude publiée en 1997 vise à « identifier les armes qui causent “des blessures inutiles ou des souffrances superflues”[xxiii] » : lesdites armes, en effet, sont bannies par le droit international, mais leur définition reste si vague qu’elle perd de son efficacité. Plus précis, le projet Sirus propose de bannir toute arme qui causerait notamment des « maladies spécifiques, un état physiologique spécifiquement anormal, un état psychologique spécifiquement anormal, une déficience spécifique et permanente ou une mutilation spécifique[xxiv] ». Soit des critères qui, s’ils étaient appliqués, tempéreraient grandement la prolifération actuelle de technologies acoustiques, biochimiques, kinétiques ou à énergie dirigée.
Un problème subsiste néanmoins, celui de l’autorité qui a le pouvoir de retenir – ou, en l’occurrence, de ne pas retenir – ce critère : le sociologue Brian Rappert, dans un article intitulé « A framework for the assessment of non-lethal weapons » (encadrer l’évaluation des armes non létales), préconise notamment de « ne pas laisser l’évaluation des armes non létales aux forces de sécurité », de « ne pas prendre pour argent comptant les déclarations des fabricants sur l’efficacité, l’objectif et la sûreté de ces armes » et plus largement « de rechercher des mesures autres que l’introduction d’un nouvel armement[xxv] ». Si l’on ne se satisfait pas, pour finir, d’un simple encadrement de la violence autorisée, reste à méditer la mise en garde politique : elle est formulée par Steve Wright, qui dénonce le fait que l’armement « non létal » prétend « apporter une apparence de solution technique à des problèmes sociaux et politiques plus larges[xxvi] ». La question n’est alors plus tant celle de la réglementation de ces armes, que celle de leur existence et de leur prolifération en dehors de tout débat public – et même, pourrait-on dire, en lieu et place de tout débat public.
« Estocade sonique[4] » : des armes ludiques
Le débat public ne disparaît pas : il se gonfle d’une absence de contenu soigneusement entretenue, il est métamorphosé de l’intérieur pour occuper l’espace de la manière la plus inoffensive qui soit. La seconde guerre du Golfe – ou plutôt sa représentation télévisée – jouera un rôle décisif dans l’émergence de la « non-létalité ». Les images de soldats irakiens tués diffusées par les chaînes états-uniennes choqueront l’opinion publique au point que le lieutenant-colonel de la marine Duane Schattle parlera de la nécessité de prendre en compte, dorénavant, le « facteur CNN », c’est-à-dire la médiatisation, dans la conduite de la guerre[xxvii]. Les armes « non létales », media-friendly, ont répondu à ce nouvel impératif. Elles passent bien à la télévision et multiplient ainsi les possibilités militaires : « L’avantage d’un tel système d’armes est évident : d’un point de vue politico-militaire, il fournit un argument pour légitimer des opérations qui n’auraient pu l’être avec des armes conventionnelles, tandis que d’un point de vue tactique, il offre aux décideurs sur le terrain une option supplémentaire d’intervention[xxviii]. » Il y a plus : la représentation et le divertissement se mêlent aujourd’hui de manière inextricable à la « non-létalité », ils s’y agrègent, ils la transmuent. Ils en font une idée presque ancienne, déjà admise, le présupposé à partir duquel la guerre – et le quotidien – du futur s’invente.
La torture en playlist
La résurgence de la privation sensorielle au cours de la « guerre contre le terrorisme » est un exemple flagrant de cette évolution. Suzanne Cusick conteste l’euphémisme de « no-touch torture » (torture « blanche ») habituellement employé pour la qualifier, parce qu’il en masque toute la violence. Elle constate le même type de minimisation dans la manière dont cette torture est représentée dans la « blogosphère » au moment où les premières informations sur Guantánamo sont rendues publiques. « Est-ce que c’est vraiment de la torture ? » et « C’est quoi la playlist ? » : voilà pour elle autour de quoi tourne l’essentiel des commentaires en ligne. Et les uns et les autres de blaguer, de proposer des playlists alternatives, de parler de leurs querelles de voisinage ou de leurs goûts musicaux[xxix]. Autrement dit, la musique présente l’avantage, pour le pouvoir qui l’utilise comme arme, de brouiller le débat : la torture en devient risible, socialement acceptable et télégénique.
James Hetfield, du groupe Metallica, affirme en 2004 : « Depuis le début, on punit nos parents, nos femmes, nos proches avec cette musique. Pourquoi pas les Irakiens ? […] Pour moi ces morceaux sont une forme d’expression, une liberté d’exprimer ma folie. Si les Irakiens ne sont pas habitués à la liberté, alors je suis content de contribuer à les y confronter[xxx]. » Et en 2008, Bob Singleton, compositeur du thème de Barney the Purple Dinosaur, se fend d’une tribune dans le Los Angeles Times : « C’est totalement ridicule. Une chanson dont l’objectif était de rassurer les petits enfants et de les entourer d’amour serait capable de menacer l’équilibre mental d’adultes et les amènerait à un point de rupture ? […] C’est faire de la musique un acte de vaudou, ce qu’elle n’est pas[xxxi]. » Comme nous l’avons vu, il n’y a nulle magie, mais beaucoup de science, dans le fait de briser quelqu’un au moyen de la privation sensorielle, quels qu’en soient les contenus spécifiques. L’exploit réside plutôt dans le fait d’escamoter ainsi la torture et de la rendre soluble dans un produit de divertissement.
Cette forme de torture est pour Cusick très représentative du pouvoir totalisant tel qu’il s’exerce aujourd’hui. Quand la musique est employée comme arme, elle donne le sentiment de « toucher sans toucher » : c’est l’expérience d’une « dystopie[5] postfoucaldienne, où l’on est incapable de donner un nom, et encore moins de résister, au Pouvoir diffus et englobant qui est à l’extérieur de soi, mais également à l’intérieur de soi, et qui force la personne à obéir contre son gré, contre son intérêt, parce qu’il n’y a aucun moyen – pas même le retrait dans l’intériorité – d’échapper à la douleur[xxxii] ». La musique devient ici l’instrument d’une domination totale du corps et de l’esprit, elle est chargée de proclamer la toute-puissance et l’omniscience de l’autorité, et l’inutilité de toute résistance. La psychologue Françoise Sironi synthétise : « En fait, si l’on torture c’est pour faire taire. La torture réduit bourreaux et victimes au même silence[xxxiii]. » Et elle fait taire les spectateurs, aussi – ou les rend bavards sur tout ce qui les divertira d’elle.
L’imaginaire comme instrument de domination
Non seulement le son permet de créer des bulles de silence et d’oubli, mais son usage militaire ou policier rend manifeste une instrumentalisation de l’imaginaire. La difficulté à appréhender les armes acoustiques, leur fonctionnement et leurs effets, ainsi que la masse de rumeurs conspirationnistes et de constructions paranormales qu’elles suscitent, sont autant d’atouts en leur faveur : les informations à leur sujet en deviennent confuses, alimentant ainsi l’effet psychologique dont elles bénéficient. L’invisibilité de l’énergie « incapacitante » qu’elles envoient et la difficulté parfois à prendre conscience de leur usage les rendent insaisissables, immatérielles et mystérieuses. Si les infrasons restent pour l’instant inexistants dans le maintien de l’ordre et si les ultrasons ne sont que très peu employés, ils participent pleinement de cet imaginaire – ce sont même eux qui lui donnent forme, plus que les dispositifs majoritairement employés. Armes de haute technologie, qui comme la torture blanche « touchent sans toucher », transpercent les obstacles et agissent sans en avoir l’air, les dispositifs acoustiques sont aussi chargés d’une illusion de magie savamment entretenue, qui permet de tenir l’autre à distance et de manifester la puissance. Ils fascinent et ils soumettent.
Parmi les premiers promoteurs de la « non-létalité » figurait une singulière équipe : « Dans les années 1990, les auteurs de science-fiction et quakers Janet et Chris Morris se sont joints aux futurologues Alvin et Heidi Toffler pour se faire les avocats d’une nouvelle forme de guerre sans morts[xxxiv]. » Loin d’être méprisés par les hautes sphères militaires, ils seront associés, en compagnie du colonel John Alexander, « mercenaire sans foi ni loi devenu thanatologue[xxxv] », à la réflexion menée par le think tank conservateur Strategy Global Council, alors sous la houlette d’un ancien directeur de la CIA, Ray Cline[xxxvi]. En 1980, dans un article intitulé « Le nouveau champ de bataille mental », le colonel Alexander exposait sa fascination, comme aux premiers temps du programme MKUltra, pour les avancées soviétiques dans les « applications paranormales » et faisait de la prospective militaro-littéraire :
« Avec le temps, les armes [psychotroniques] seront capables de tuer ou de blesser avec peu de risques, voire aucun, pour l’opérateur. La portée reste sans doute un problème à l’heure actuelle, mais cela sera bientôt résolu, si ce n’est déjà fait. […] Aucune compétence psychique particulière n’est requise pour charger le générateur. L’arme psychotronique sera silencieuse, difficile à détecter et ne nécessitera qu’un opérateur humain comme source d’énergie[xxxvii]. »
La présence, dans le club très fermé des inventeurs de la « non-létalité », d’amateurs du fantastique – aux ordres – n’est pas anodine : elle est révélatrice de l’imaginaire du pouvoir, elle marque l’intérêt grandissant de l’armée et de la police pour la communication autour de leurs opérations et elle caractérise l’émergence de ce qui se substituera progressivement au complexe militaro-industriel : le complexe militaro-spectaculaire.
Les rumeurs, on s’en sera rendu compte en lisant les déclarations des promoteurs des dispositifs sonores au fil des années, sont d’abord le fait des fabricants ou des militaires, pressés de survendre leurs produits et de se faire les pionniers des armes du futur. Ces mêmes rumeurs sont ensuite reprises, délestées de leurs origines officielles, par une partie de la presse ou de l’opinion publique. Jürgen Altmann indiquait en 1999 :
« Des analyses étayées sur le fonctionnement des armes non létales, le transport et la propagation vers la cible, et les effets produits, sont requises de toute urgence. Et ce d’autant plus que les ressources publiées sont remarquablement silencieuses sur les détails scientifiques et techniques. Les autorités militaires ou les entreprises officiellement engagées dans la recherche et le développement ne fournissent pas d’information technique[xxxviii]. »
Nul hasard ici : lors des premières conférences militaires d’ampleur sur l’armement « non létal », les membres de l’état-major états-unien avaient estimé que « la préservation du secret est d’une importance capitale pour s’assurer d’une efficacité maximale[xxxix] ».
La réalité n’a guère évolué depuis concernant les technologies acoustiques. Dans les premiers temps, les inventeurs enthousiastes de l’armement nouveau dotent leurs spécimens de qualités aussi extraordinaires que terrifiantes. Dans une seconde phase, d’aucuns, notamment aux États-Unis, adaptent leur communication, tempèrent leurs assertions et insistent davantage sur l’innocuité des dispositifs et leur adaptation aux conflits asymétriques ou à la vie quotidienne. Les nouveaux venus dans l’industrie de la « non-létalité », comme la Chine ou Israël, continuent à préférer les métaphores imagées aux euphémismes. Dans un cas comme dans l’autre, l’arme est protégée par un système de propagande militaro-commerciale, par une image d’elle-même qui se substitue à elle : une manière, en la rendant visible, de la garder secrète – et ainsi de « légitimer ou masquer l’usage institutionnalisé de la force[xl] ».
La guerre comme divertissement
« Hache sonique », « lance sonique », « arme sonique et de foudre intense », « fendoir sonique », « érupteur sonique », « tempête sonique », « estocade sonique » : le son fait une arme merveilleuse dans les jeux vidéos – rien de tel pour « dévaster » et « faire exploser l’ennemi ». Via les « grenade sonique » et « grenade sonique pro », des applications de téléphonie mobile, on pourrait tout bonnement « obtenir un contrôle immédiat de la foule[xli] ». Moins drastiquement, les plus jeunes ont le moyen de se faire appeler sans en aviser les oreilles adultes : peu après l’apparition des Mosquitos était ainsi mise en circulation une sonnerie éponyme pour téléphone portable, employant les mêmes fréquences mais à un niveau sonore très bas et pour de brèves périodes[xlii]. À parcourir certains forums sur les « grenades spéciales » et autres « résonateurs », on ne sait pas de prime abord s’il s’agit d’armes réelles ou de leurs ersatz virtuels. Si le doute est vite dissipé, il est symptomatique des liens étroits qu’entretiennent l’industrie de l’armement et celle du divertissement. Le théoricien des médias Friedrich Kittler assène : « L’industrie du divertissement abuse, dans tous les sens du terme, de matériel militaire[xliii]. »
Une figure comme celle de l’ingénieur Harold Burris-Meyer est particulièrement représentative de l’interaction croissante entre les deux, lui qui fut tour à tour concepteur d’un système stéréo sur lequel s’appuiera le Fantasound de Disney, des leurres soniques de l’« armée fantôme », de l’environnement sonore de la société Muzak, de haut-parleurs plus performants pour l’aviation militaire, d’effets sonores pour le cinéma, d’un projet de « torpille acoustique » – et même d’un « psychogalvanomètre » visant à mesurer l’impact émotionnel du son sur le public[xliv].
La compagnie britannique Decca a, quant à elle, fait d’une pierre deux coups : mandatée en 1940 par l’armée de l’air de sa Majesté pour affiner la captation des sons de sous-marins et permettre la distinction entre les navires britanniques et allemands, elle en profite pour améliorer ses techniques d’enregistrement. Dans l’immédiat après-guerre, c’est la société EMI (Electric & Musical Industries) qui a tiré parti des recherches militaires allemandes dans les technologies d’analyse de code Morse et d’enregistrement : des informations fournies par la saisie de matériel allemand de décodage lui permettent de fabriquer cassettes et magnétophones et de doter ainsi pour un quart de siècle son studio d’Abbey Road[xlv]. Kittler rapporte enfin que lorsque « Karlheinz Stockhausen mixait sa première composition électronique, Kontakte, dans le studio de Cologne de la Westdeutscher Rundfunk [WDR, radio de l’Allemagne de l’Ouest] entre le mois de février 1958 et l’automne 1959, le générateur d’impulsions, l’amplificateur, le filtre de bande passante ainsi que les oscillateurs […] provenaient d’équipements délaissés par l’armée états-unienne[xlvi] ».
De la même manière, la recherche militaire sur les vortex pendant la Seconde Guerre mondiale alimentera l’industrie du jeu. Comme nous l’avons vu, l’invention par Thomas Shelton d’un lanceur de vortex pouvant transporter des gaz nocifs n’a jamais été utilisée sur les champs de bataille. En revanche, Shelton « mit au point un pistolet en plastique qui éjectait un anneau de vortex capable de faire tomber une cible en papier à quelques mètres de distance. C’était l’âge d’or de la science-fiction et des pistolets à laser, et le jouet, qui fut baptisé le Flash Gordon air ray gun [pistolet à rayon d’air Flash Gordon], aura un immense succès. [Le magazine scientifique et technologique] Popular Mechanics le consacrera Jouet de l’année en 1949[xlvii] ». Les pistolets à air comprimé seront ensuite fabriqués en masse, des whammo air blasters de 1965 aux airzookas contemporains.
Le rapport s’est plus récemment inversé, l’industrie du jeu reprenant l’initiative et ne se contentant plus de recycler le matériel militaire. Un chercheur de l’université de Stanford, Timothy Lenoir, a fait paraître en 2003 une étude intitulée « Programming theaters of war. Gamemakers as soldiers » (programmer les théâtres d’opération, les fabricants de jeux comme soldats), dans laquelle il évoque les liens anciens entre l’armée et l’industrie du divertissement, et leur évolution récente :
« Nous pourrions dire avec cynisme que si le complexe militaro-industriel était relativement visible et identifiable pendant la Guerre froide, il est aujourd’hui présent partout de manière invisible et diffuse dans la vie quotidienne. Le complexe militaro-industriel est devenu le complexe militaro-spectaculaire. L’industrie du divertissement est à la fois une source majeure d’innovations et de technologies, et un terrain d’entraînement pour ce que nous pourrions appeler la guerre posthumaine[xlviii]. »
La transition s’est notamment faite, à partir de la fin des années 1980, à travers des programmes de simulation de combat mis en place par DARPA – soucieuse d’éviter des dépenses superflues, l’agence de la recherche militaire états-unienne s’appuie alors sur des « technologies développées en dehors du ministère de la Défense, comme les jeux vidéos de l’industrie du divertissement[xlix] ». Pilotes et soldats ont ainsi pu commencer à s’entraîner au vol et au combat « en conditions réelles » via des plates-formes de simulation. En retour, les militaires ont apporté leur expertise aux fabricants de jeux afin d’améliorer le réalisme des scènes de guerre. Des échanges de personnel, des militaires vers le divertissement et inversement, ont achevé de formaliser les liens[l].
En 2009, le laboratoire de l’armée états-unienne, l’ARL, a ouvert son « environnement pour la recherche auditive » (Environment for Auditory Research ou EAR), un complexe de haute technologie acoustique construit avec force partenaires industriels, qui vise à étudier la « capacité des soldats à détecter, identifier et localiser les sons dans des théâtres d’opérations acoustiques réalistes[li] ». Courant 2011, l’université scientifique et technologique du Missouri a quant à elle achevé de transformer un ancien entrepôt en champ de bataille sonore : soixante-quatre haut-parleurs et quatre caissons de basses diffusent des enregistrements de fusils d’assault M-16, de kalachnikovs, d’explosions, de tanks ou d’hélicoptères pour préparer les soldats à l’ambiance sonore de la vraie guerre. L’armée n’a pas encore validé l’usage de ce simulateur acoustique, mais s’y intéresse de près[lii]. Il faut dire que Steven Grant, concepteur de cet « environnement en immersion acoustique » (immersive audio environment, IAE), offre toutes les garanties :
« Dans la configuration actuelle des séquences de combat, vous pouvez vous maintenir dans l’IAE sans aucune perte d’audition pendant deux heures par jour sans protections auditives. Nous diffusons à un maximum d’environ 100 dB pour le moment. Bien sûr, les vrais bruits de la bataille sont beaucoup plus forts, mais nous nous conformons aux réglementations professionnelles[liii]. »
Une thèse a par ailleurs été publiée en 2005 par un doctorant de l’école navale de Monterey, en Californie – elle s’intitule « Modeling sound as a non-lethal weapon in the COMBATXXI simulation model » (modéliser le son comme arme non létale dans le modèle de simulation COMBATXXI). Son auteur, Joseph Grimes, explique que « la modélisation des armes non létales a été identifiée par le Training and Doctrine Command Analysis Center [centre d’analyse et de prospective militaire] de Monterey comme nécessaire pour mieux représenter le combat réel. Cette thèse a utilisé COMBATXXI, une simulation de combat de haute résolution […], pour reproduire les armes non létales et étudier leurs effets sur les combattants. Le code source initial a été modifié pour modéliser le Long range acoustic device (LRAD), l’arme non létale choisie pour cette recherche. […] Une fois la modélisation du LRAD effectuée, un scénario a été développé pour tester les effets simulés du dispositif. […] Il a été conclu que l’introduction de cette nouvelle technologie non létale dans COMBATXXI a amélioré le modèle et créé une représentation plus réaliste des conditions réelles de combat[liv] ». Grâce au LRAD, le champ de bataille virtuel a donc gagné en réalisme et la vraie guerre, en scénarisation.
Cette porosité entre la guerre et le jeu n’est pas sans effet sur l’acceptabilité et sur l’usage même des dispositifs « non létaux ». L’imbrication entre leurs applications guerrières et leurs applications divertissantes permet d’abord de les rendre socialement acceptables : les haut-parleurs ultrasoniques, par exemple, pourront être employés de manière intrusive dans les rues de ville et « prélétale » sur le champ de bataille, mais seront certainement très appréciés dans la vie quotidienne pour leurs qualités d’isolation ou de relief acoustique. Inversement, l’apparence de jouets qu’offrent nombre d’armes « non létales » est susceptible d’influer sur leur maniement policier ou militaire. En 2008, Olivier Razac publie les résultats de son enquête sur « L’utilisation des armes de neutralisation momentanée en prison ». Il y évoque notamment les grenades de désencerclement DMP et met en garde sur des « risques de glissement vers une utilisation abusive, voire ludique du matériel de neutralisation dus à une ambiguïté intrinsèque de ce type de matériel[lv] ». Il revient dans un entretien sur cette « ambiguïté » : « D’un côté, il faut bien que cela reste des armes – qu’elles continuent d’être dissuasives, de faire peur. Mais de l’autre, il s’agit de les banaliser. […] Voilà, je pense, le secret de ces armes de neutralisation : elles font peur et elles “font rire” […]. En cela, elles sont aussi désarmantes pour la critique[lvi]. »
« Une architecture sonique de contrôle[lvii] » : vers un urbanisme sonore
À l’issue de son étude sur les armes « non létales », Neil Davison conclut :
« Les efforts pour développer des armes acoustiques “non létales” ayant des effets incapacitants n’ont pas abouti. […] Étant donné que les évaluations passées ont jugé impossible d’obtenir des effets extra-auditifs sans entraîner une atteinte permanente à l’audition, les “dispositifs d’alerte” semblent ne pouvoir produire que des effets psychologiques ou gênants et la poursuite des recherches dans le développement d’armes acoustiques “non létales” paraît vouée à l’échec[lviii]. »
Que les LRAD soient physiquement moins dangereux que les pistolets à impulsions électriques, flashballs et autres lasers, c’est certain. Mais c’est passer un peu vite sur les « effets psychologiques ou gênants » qui ne sont, nous l’avons vu, pas anodins. Surtout, les dispositifs acoustiques, loin d’être insignifiants dans l’évolution du maintien de l’ordre, instituent un nouveau rapport à l’espace public, à l’écoute et à l’autre. Ils dessinent les premiers contours d’une cartographie hygiénisée des villes et des frontières. Ils établissent une nouvelle forme de violence, plus diffuse et plus globale.
Dans « Alarmes et sirènes : sonotopies de la commotion quotidienne », le chercheur Noel García López, de l’université autonome de Barcelone, affirme que « si la vue se caractérise par sa distance d’avec l’objet et son usage de la raison, l’écoute est collective et passe pour être toujours le sens des émotions et de l’affect[lix] ». Aujourd’hui comme il y a dix siècles, l’environnement sonore est partagé : la nature des sons a changé, mais notre manière de les recevoir est identique. Ce que les dispositifs acoustiques de contrôle inaugurent, c’est une conception fragmentée et fonctionnaliste de l’espace sonore : chaque son à sa place, chaque personne dans sa zone. Cela en fait des technologies totalisantes, qui administrent des ordres impossibles à contester : sur le moment, il ne s’agit que d’obéir à l’interdiction d’accès à une zone ou à la dispersion exigée. Non seulement aucune espèce de discussion n’est envisageable, puisque la frontière sonore demeure infranchissable, mais aucune contestation n’est possible sur le moment : elle ne peut être que différée ou se situer sur un autre terrain. Totalisantes, ces technologies le sont également parce qu’elles brisent le collectif et renvoient chacun à son individualité : se protéger, fuir. « Pourquoi les gens se rassemblent-ils ? », « qu’est-ce qui détermine l’intensité ou l’énergie d’un rassemblement ? », s’interrogeait en 2001 le très officiel INLDT, l’Institut pour les technologies « non létales » de Défense de l’université de Penn State[lx] : le collectif surprend, inquiète, pose problème, il est une menace à circonscrire.
Le chercheur indépendant Mike Davis, analysant dans les années 1990 l’émergence d’un urbanisme sécuritaire, écrit :
« Quant à la syntaxe néomilitaire de l’architecture contemporaine, elle a intégré l’idée d’une violence latente et cherche à conjurer des dangers imaginaires. […] La “sécurité” est moins une question de protection personnelle que de degrés d’isolement par rapport à des groupes ou des individus “indésirables”, et, d’une manière générale, d’évitement des foules, que ce soit dans l’habitat, le travail, la consommation ou les déplacements[lxi]. »
Les technologies sonores de contrôle jouent, de manière plus violente, le même rôle que les mobiliers urbains dits « de prévention situationnelle[6] » qui visent à individualiser, endiguer et orienter les flux rendus obligatoires : la machine ne tolère aucun blocage, aucun arrêt, aucune gratuité.
L’espace se plie, de manière invisible, en une succession d’aires tour à tour interdites et autorisées, en un empilement de lieux où sont prescrits des comportements spécifiques et changeants. La frontière n’est plus fixe, elle se déplace en fonction de celles et ceux qu’elle veut exclure – et ceux-là ne peuvent ni l’anticiper, puisqu’elle est furtive, ni s’en protéger, puisque les oreilles ne choisissent pas ce qu’elles entendent. Ce que García López dit de l’alarme vaut pour l’ensemble des dispositifs sonores, du haut-parleur ultrasonique au LRAD : la frontière sonore « crée un espace de commotion », « un espace entre parenthèses, dans l’attente du geste qui dissoudra le point d’inflexion[lxii] ». Une parenthèse sanitaire et fluctuante surgit là où se pose l’organisme indésirable, là où se manifeste le « trouble à l’ordre public » – et elle ne disparaîtra que par le geste de l’autorité décidant d’interrompre l’alarme ou par celui de l’indésirable contraint de s’extraire de la zone interdite. Le son crée là un non-lieu d’exclusion qui s’adapte à la géographie et à ses habitants, il fait surgir une ville virtuelle qui se superpose à la première pour en façonner une épure débarrassée de toutes ses scories.
Cette frontière sonore mouvante agit de part et d’autre d’elle-même : sur celles et ceux qu’elle refoule, mais aussi sur celles et ceux qu’elle valide ? elle « établit, dans les espaces qu’elle recompose, certaines manières de s’exprimer, de se mouvoir et d’observer les mouvements, d’écouter et d’être écouté, de regarder et d’être regardé : elle établit un régime de sonorité[lxiii] ». Ainsi, « chaque fois que sonne une sirène, une barrière sonore ou une alarme quelconque, elle crée une composition sonotopique qui reproduit le discours du danger, de l’insécurité et du trouble de la vie urbaine en sonorisant et en rendant visible l’infraction à la norme et en remplissant nos mouvements quotidiens de dénonciations publiques, de regards et de soupçons[lxiv]. » Chaque fois, aussi, qu’un haut-parleur directionnel diffuse une publicité ou donne un ordre, il reproduit le discours de la consommation, de la domestication et de la conformité.
Les Infernos interdisent de franchir certaines portes, les Mosquitos ordonnent de ne pas stagner, les Audio spotlights font parler les produits en rayon – tout cela sonne comme la « capitale du futur » qu’évoque Mike Davis :
« Les indésirables sont exclus par des barrières architecturales et sémiotiques, et la circulation du public est canalisée sur des itinéraires d’un automatisme férocement pavlovien. Excité par toute sorte de stimuli visuels, bercé par un fond sonore doucereux, parfois même grisé par des diffuseurs aromatiques, cet essaim de monades consommatrices vole de caisse en caisse au rythme d’un dressage qui, s’il est bien orchestré, ressemble à la partition d’une véritable symphonie commerciale[lxv]. »
Et si certains tentent de contrevenir à ce régime de sonorité quotidien, « les images des intrus sont conservées sur disque dur pour servir de preuve et les gardiens du parc de la ville sont alertés. Ensuite, des haut-parleurs annoncent aux contrevenants qu’ils sont observés et que les autorités sont en chemin[lxvi] ». Les bâtiments qui composent la ville se transforment en remparts fugaces, organismes mi-mécaniques mi-biologiques qui surveillent et trient les organismes humains : « Les systèmes de détection d’une grande part des nouvelles tours de bureaux de Los Angeles comprennent déjà dans leur éventail panoptique la vision, l’odorat, la sensibilité à la température et à l’humidité, les capteurs de mouvements et, dans certains cas, l’ouïe[lxvii]. » Steve Goodman conclut : « Une architecture sonique de contrôle émerge […]. Le contrôle sécuritaire n’est plus seulement panoptique mais pansensoriel[lxviii]. »
Ce contrôle pansensoriel se manifeste non seulement aux frontières intérieures des villes, mais aussi aux frontières des États. Les fabricants de technologies acoustiques sont là encore aux avant-postes : EORD, qui a conçu le Shophar israélien, a par exemple développé un système de « frontière virtuelle » permettant « l’identification acoustique de cibles[lxix] » et utilisable pour clôturer aussi bien les prisons que les bases militaires ou le pays. La société CETC International, constructrice de l’équivalent chinois du LRAD, a de son côté mis au point des « systèmes de surveillance de jungle et de frontière[lxx] ». Quant à l’Europe, elle travaille ardemment à mettre sur pied, « à l’échelle du continent[lxxi] », des systèmes de haute technologie pour se protéger des invasions extérieures comme des foules intérieures : dans son « Septième programme-cadre de recherche », courant de 2007 à 2013, la Commission européenne a ainsi alloué 1,4 milliard d’euros à la prospective en matière de sécurité. Parmi les quarante-cinq projets soutenus à ce titre, cinq font du son un outil de contrôle, comme le « système de détection de comportements anormaux et de menaces dans des espaces peuplés », le « système de surveillance maritime autonome », ou le « kit intégré de sécurité mobile ». Nul doute que les « dispositifs d’alerte » trouveront rapidement leur place dans cette vaste muraille virtuelle.
Steve Wright et l’universitaire Brian Martin analysent ce développement des dispositifs « non létaux » aux frontières à mesure que croît la grande crainte des États face aux catastrophes climatiques, nucléaires ou sociales à venir et à l’afflux de réfugiés qu’elles occasionneraient : « La question des réfugiés n’est plus traitée comme un problème d’assistance humanitaire mais comme une nouvelle technopolitique de l’exclusion[lxxii]. » Ils énumèrent, dans l’arsenal envisagé, des mines anti-personnel Taser, des lasers déclenchant une douleur intense, des vortex ou des armes acoustiques, des répulsifs nauséabonds, des calmants et autres « bio-régulateurs », qui auraient tous pour effet d’empêcher purement et simplement l’accès à la frontière – et la possibilité de faire valoir son droit d’asile ou de circulation. Mais les poseurs de murs ne s’embarrassent pas de ces détails :
« Si des armes à énergie dirigée sont déployées aux frontières, comment les réfugiés pourront-ils chercher protection ? Un représentant des États-Unis a fourni une réponse simple en parlant du dispositif de micro-ondes monté sur véhicule [l’Active Denial System (ADS)], qui emploie des micro-ondes pour chauffer la peau humaine à des intensités insupportables : “Il n’y a que deux types de personnes : les touristes et les terroristes. Les touristes ne cherchent pas à contourner le contrôle et nous tirons sur les terroristes[lxxiii].” »
Le régime de sonorité, parenthèse temporelle et géographique dans l’espace de la ville, se multiplie, se ramifie, s’insère dans tous les interstices de la cartographie urbaine ou géopolitique, jusqu’à constituer, pour reprendre les termes de Steve Goodman, une « politique de la fréquence[lxxiv] ». Une politique qui administre selon ses propres lois sécuritaires-publicitaires des sons attractifs aux « touristes » ou aux « consommateurs » et des sons répulsifs aux « terroristes » ou aux « indésirables ». Une politique qui instaure de facto, sans débat, une gestion sanitaire et privée des lieux publics. Un « réenchantement » discipliné du territoire sonore est en cours, qui participe à la « disneylandisation de l’espace public » dont parle le sociologue Jean-Pierre Garnier : « L’impératif de HQE (haute qualité environnementale) dont font grand cas les croisés du développement urbain durable s’applique […] aussi à l’environnement humain : seuls des gens “de qualité” seront en droit de fréquenter les espaces urbains requalifiés[lxxv]. » L’espace sonore est le terrain d’un déploiement discret de frontières dématérialisées, arbitraires et furtives. Il devient une ressource inépuisable qu’il s’agit pour le libéralisme sécuritaire de rendre efficace et rentable, privatisé, hygiénisé.
[1] « No matter what your purpose is, you must leave » : déclaration diffusée en boucle, via un LRAD, par la police de Pittsburgh aux manifestants anti-G20 en août 2009, en alternance avec l’alarme du dispositif.
[2] La chroniqueuse Catherine Porter à propos de l’usage par la police canadienne de LRAD, censément comme « outils de communication » : « Si vous avez besoin d’un mégaphone puissant, équipez-vous d’un mégaphone puissant. Mais n’en prenez pas un qui soit doté d’une mitraillette auditive. » Catherine Porter « A loud and clear lesson in police power », The Star, 4 février 2011.
[3] On pourra à cet égard écouter le documentaire sonore Mosquito d’Olivier Toulemonde, où l’on entend un échange kafkaïen entre des personnes gênées par les fréquences du boîtier illégalement, installé par une banque d’Ixelles, en Belgique, et des policiers qui ne les entendent pas et restent incrédules : <www.olivier-toutlemonde.com/mosquito_053.htm> (vu le 21 mars 2011).
[4] Arme du jeu vidéo Tales of Symphonia.
[5] Une dystopie est le contraire d’une utopie, le pire des mondes possibles.
[6] Bancs inclinés ou séparés par des accoudoirs pour rendre la position couchée ? voire assise ? difficile, poteaux, piques sur le rebord des fontaines, grilles, barrières de buissons, ou encore blocs de ciment où sont encastrés des galets.
[i] Cité dans Steve Wright, « The new technologies of political repression : a new case for arms control ? », Philosophy and Social Action, n° 17, juillet-déc. 1991.
[ii] Michel Foucault, Histoire de la sexualité, vol. 1 : La Volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976, p. 183.
[iii] Georges-Henri Bricet des Vallons, « L’arme non létale dans la stratégie militaire des États-Unis : imaginaire stratégique et genèse de l’armement », Cultures & Conflits, n° 67, aut. 2007.
[iv] Sun Tzu, L’Art de la guerre, Flammarion (trad. de l’anglais par Francis Wang), Paris, 1972, p. 110.
[v] Lettre du major-général W. C. Wyman au major-général Lauris Norsted, datée du 22 juillet 1947, citée par le colonel Alfred H. Paddock, « Psychological and unconventional warfare, 1941-1952 : origins of a “Special Warfare” capability for the United States Army », United States Army War College, nov. 1979, et reprise dans colonel Paul E. Valley et major Michael A. Aquino, « From Psyop to mindwar : the psychology of victory », Headquarters, 7th Psychological Operations Group, United States Army Reserve, 1980, mise à jour en nov. 2003, p. 5.
[vi] Neil Davison, « The contemporary development of “non-lethal” weapons », loc. cit., p. 24.
[vii] Présentation du laboratoire sur son site, <http://njms2.umdnj.edu/smbiweb/index.html> (vu le 22 avril 2011).
[viii] Neil Davison, « The early history of “non-lethal” weapons », loc. cit., p. 12.
[ix] Présentation des applications civiles du LRAD sur son site, <www.lradx.com/site/content/view/296/110> (vu le 5 mai 2011).
[x] Steve Wright, « Violent peacekeeping : the rise and rise of repressive techniques and technologies », Praxis Centre,LeedsMetropolitanUniversity, 28 janvier 2005.
[xi] Georges-Henri Bricet des Vallons, « L’arme non létale dans la stratégie militaire des États-Unis », loc. cit.
[xii] Ibid.
[xiii] Neil Davison, « Non-Lethal » Weapons, op. cit., p. 46 et p. 58 ; Steve Wright, « Merchants of repression », GSC Quarterly, n° 12, print. 2004.
[xiv] Georges-Henri Bricet des Vallons, « L’arme non létale dans la stratégie militaire des États-Unis », loc. cit. L’ensemble des citations de ce paragraphe provient de cet article.
[xv] Ibid.
[xvi] ONU, « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. », Genève, 10 oct. 1980.
[xvii] David A. Koplow, « Tangled up in khaki and blue », loc. cit., p. 796-799.
[xviii] Neil Davison, « The early history of “non-lethal” weapons », loc. cit. ; Steve Wright, « The new technologies of political repression », loc. cit. ; Steve Wright, « Civilising the torture trade », The Guardian, 13 mars 2003.
[xix] Timothy L. Thomas, « The mind has no firewall », Parameters, print. 1998, p. 84-92.
[xx] Cités dans Steve Wright, « The new technologies of political repression », loc. cit.
[xxi] Ibid.
[xxii] Jürgen Altmann, « Acoustic weapons », loc. cit., p. 58-59.
[xxiii] Robin Coupland, « The Sirus project », Comité international de la Croix-Rouge, 1997.
[xxiv] Ibid., p. 23.
[xxv] Brian Rappert, « A Framework for the assessment of non-lethal weapons », Medecine, Conflict and Survival, vol. 20, 2004, p. 41, p. 42 et p. 46.
[xxvi] Steve Wright, « Violent peacekeeping », loc. cit.
[xxvii] Major Mark R. Thomas, « Non-lethal weaponry : a framework for future integration », Air Command and Staff College, Air University, Maxwell Air Force Base, Alabama, avril 1998, p. 12-13.
[xxviii] Georges-Henri Bricet des Vallons, « L’arme non létale dans la stratégie militaire des États-Unis », loc. cit.
[xxix] Suzanne Cusick, « Music as torture », loc. cit.
[xxx] Cité dans Lane DeGregory, « Iraq’n’roll », loc. cit.
[xxxi] Cité dans Andy Worthington, « A history of music torture in the war on terror », loc. cit.
[xxxii] Suzanne Cusick, « Music as torture », loc. cit.
[xxxiii] Françoise Sironi, « Les mécanismes de destruction de l’autre », in Alain Berthoz et Gérard Jorland (dir.), L’Empathie, Odile Jacob, Paris, 2004, p. 228, citée dans Michel Terestchenko, Du bon usage de la torture, ou comment les démocraties justifient l’injustifiable, La Découverte, Paris, 2008, p. 159.
[xxxiv] Steve Wright, « Violent peacekeeping », loc. cit.
[xxxv] Définition du colonel Alexander par lui-même dans un livre coécrit avec le major Richard Groller et Janet Morris (et préfacé par l’auteur de romans d’espionnage Tom Clancy), The Warrior’s Edge : Front-line Strategies for Victory on the Corporate Battlefield, William Morrow & Co, New York, 1990, cité dans Steven Aftergood, « The “soft kill” fallacy », Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 50, n° 5, p. 40-45, sept.-oct. 1994.
[xxxvi] Georges-Henri Bricet des Vallons, « L’arme non létale dans la stratégie militaire des États-Unis », loc. cit.
[xxxvii] Lieutenant-colonel John B. Alexander, « The new mental battlefield : “Beam me up, Spock” », Military Review, vol. 60, n° 12, déc. 1980, p. 52.
[xxxviii] Jürgen Altmann, « Acoustic weapons », loc. cit., p. 2.
[xxxix] Nick Lewer et Steven Schofield, Non-Lethal Weapons. A Fatal Attraction ?, Zed Books, Londres, 1997, p. 36, cités dans Neil Davison, « The development of “non-lethal” weapons during the 1990’s », loc. cit., p. 13.
[xl] Steve Wright, « Violent peacekeeping », loc. cit.
[xli] Description de l’application Sound Grenade pour Ipod sur le site d’Itunes, <http://itunes.apple.com/us/app/sound-grenade/id301687625?mt=8> (vu le 13 mars 2011).
[xlii] Site du TeenBuzz, <www.teenbuzz.org> (vu le 25 avril 2011).
[xliii] Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter (trad. de l’allemand par Geoffrey Winthrop-Young et Michael Wutz), Stanford University Press, Stanford, 1999, p. 97, cité dans Steve Goodman, Sonic Warfare, op. cit., p. 32.
[xliv] James Tobias, « Composing for the media », loc. cit., p. 68.
[xlv] Geoffrey Winthrop-Young, « Drill and distraction in the yellow submarine : on the dominance of war in Friedrich Kittler’s media theory », Critical Inquiry, vol. 28, n° 4, été 2002, p. 830.
[xlvi] Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, op. cit., p. 97, cité dans Steve Goodman, Sonic Warfare, op. cit., p. 209-210.
[xlvii] David Hambling, Weapons Grade, op. cit., p. 250.
[xlviii] Timothy Lenoir, « Programming theaters of war. Gamemakers as soldiers. », in Robert Latham (dir.), Bombs and Bandwidth : The Emerging Relationship between IT and Security, New Press,New York, 2003.
[xlix] Ibid.
[l] Stephen Stockwell et Adam Muir, « The military-entertainment complex : a new facet of information warfare », Fibre Culture, n° 1, 2003.
[li] Paula P. Henry, Bruce E. Amrein, Mark A. Ericson, Army Research Laboratory, « The environment for auditory research », Acoustics Today, vol. 5, n° 3, juillet 2009, p. 9.
[lii] Associated Press, « Audio battlefield aims to help prepare new troops », 6 mai 2011.
[liii] Cité dans Duncan Geere, « Surround-sound “audio battlefield” reproduces cacophony of war », Wired, 11 mai 2011.
[liv] Joseph D. Grimes, « Modeling sound as a non-lethal weapon in the COMBATXXI simulation model » (thèse), Naval Postgraduate School, Monterey (Californie), juin 2005, p. I.
[lv] Olivier Razac, « L’utilisation des armes de neutralisation momentanée en prison : enquête auprès des formateurs de l’ENAP [École nationale d’administration pénitentiaire] », Dossiers Thématiques du CIRAP, n° 5, juillet 2008, p. 27.
[lvi] Jean-Baptiste Bernard, « Olivier Razac : “Penser les nouvelles formes de violence politique basées sur la neutralisation” », Article XI, 22 déc. 2010.
[lvii] Steve Goodman, Sonic Warfare, op. cit., p. 64.
[lviii] Neil Davison, « Non-Lethal » Weapons, op. cit., p. 205.
[lix] Noel García López, « Alarmas y sirenas : sonotopías de la conmoción cotidiana » in Orquesta del Caos, Espacios sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana, Institut Català d’Antropología, Barcelone, 2005, p. 18.
[lx] Docteur John M. Kenny, docteur Clark McPhail, docteur Peter Waddington et alii, « Crowd behavior, crowd control, and the use of non-lethal weapons », Human Effects Advisory Panel, INLDT, Penn State University, 1er janvier 2001.
[lxi] Mike Davis, City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur (trad. de l’anglais par Michel Dartevelle et Marc Saint-Upéry), La Découverte, Paris, 1997, p. 205.
[lxii] Noel García López, « Alarmas y sirenas », loc. cit., p. 20-21.
[lxiii] Ibid., p. 22.
[lxiv] Ibid., p. 24.
[lxv] Mike Davis, City of Quartz, op. cit., p. 232-233.
[lxvi] New Scientist, 24 août 1994, p. 18, cité dans Mike Davis, Au-delà de Blade Runner. Los Angeles et l’imagination du désastre (trad. de l’anglais par Arnaud Pouillot), Allia, Paris, 2007, p. 23-24.
[lxvii] Mike Davis, Au-delà de Blade Runner, ibid., p. 26.
[lxviii] Steve Goodman, Sonic Warfare, op. cit., p. 64.
[lxix] Site d’EORD, <www.eord.co.il> (vu le 29 janvier 2011).
[lxx] Site de CETC, <www.cetci.com.cn> (vu le 24 mai 2011).
[lxxi] Commission européenne, « Towards a more secure society and increased industrial competitiveness. Security research projects under the 7th framework program for research », mai 2009, p. 3.
[lxxii] Brian Martin et Steve Wright, « Looming struggles over technology for border control », Journal of Organisational Transformation and Social Change, vol. 3, n° 1, p. 95-107, 2006.
[lxxiii] Steve Wright, « Merchants of repression », loc. cit.
[lxxiv] Steve Goodman, Sonic Warfare, op. cit., p. XV.
[lxxv] Jean-Pierre Garnier, « L’espace public réenchanté », Le Monde libertaire, n° 1537, 11-17 déc. 2008.
Conclusion