
Comment a émergé un libertarianisme réactionnaire
Extrait de : Pablo Stefanoni, La rébellion est-elle passée à droite ? Dans le laboratoire mondial des contre-cultures néoréactionnaires, La Découverte, Paris, 2022
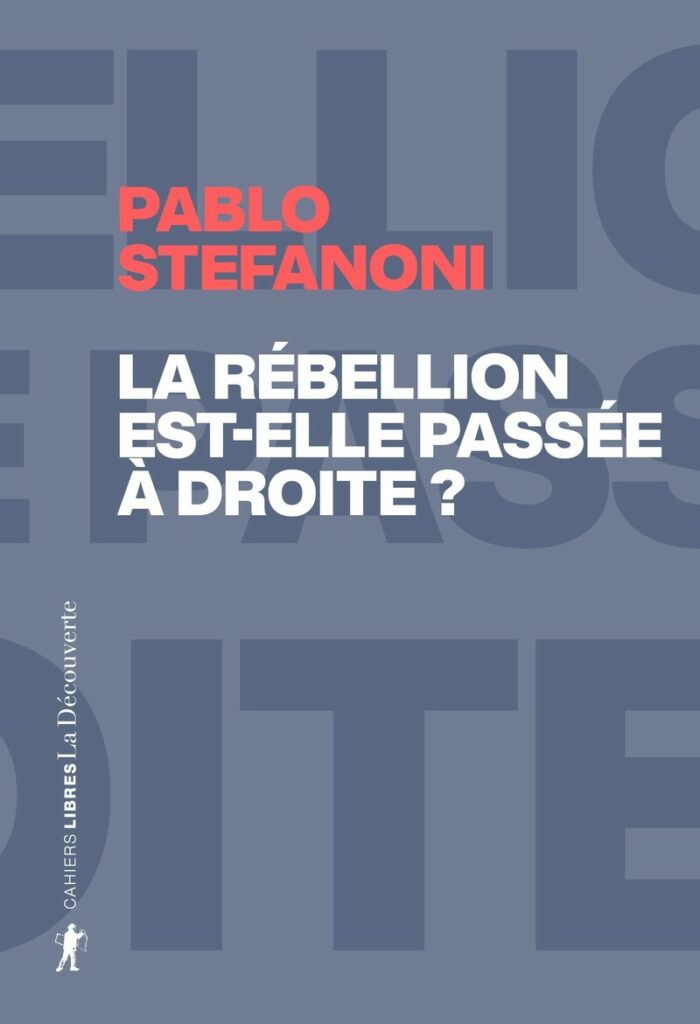
La synthèse paléolibertarienne : aller vers le peuple
À la fin des années 1970, Rothbard abandonna le Parti libertarien qu’il avait contribué à fonder et, dans un mouvement de retour au bercail de la old right, il entreprit d’élaborer une nouvelle articulation entre principes libertariens et idées conservatrices. Selon Miguel Anxo Bastos Boubeta, il s’agissait d’une synthèse des axiomes de l’école autrichienne d’économie, des postulats de la tradition libertarienne et des idées de la old right – quelque chose comme une pensée « réactionnaire radicale », selon la définition même de son auteur, qui n’hésitait pas, ce faisant, à s’approprier l’étiquette infamante dont l’affublaient certains de ses détracteurs. Il déclarait de fait préférer des termes tels que « réactionnaire », « droite radicale » ou même « droite dure » (hard right), à « conservateur ». Mais au-delà de son désir de délimiter clairement ce qui le séparait du (néo-) conservatisme officiel, lequel avait d’après lui capitulé face à l’étatisme, cette radicalité réactionnaire renvoyait à son aspiration à revenir à l’époque bénie des États-Unis d’avant 1910. Les fonctions et le domaine d’intervention de l’État étaient alors encore relativement réduits, les impôts faibles, le dollar robuste et le pays voué à un bienheureux isolement. Au-delà de ses éphémères esquisses de rapprochement avec la nouvelle gauche, Rothbard était au fond « un conservateur culturel qui se sentait à l’aise dans les milieux cultu rels de droite » (Bastos Boubeta, 2013). Dans son article « Why Paleo ? », publié à l’origine en 1990, il souligne que la liberté aura tendance à mieux s’épanouir au sein d’une culture bourgeoise et chrétienne. C’est dans ce texte qu’il introduit le terme « paléolibertarianisme » en tant que forme spécifique d’articulation entre idées libertariennes et valeurs conservatrices, voire autoritaires.
L’objectif d’abolition tendancielle de l’État demeure, mais il va désormais de pair avec le renforcement des institutions sociales traditionnelles. La liberté est une condition nécessaire mais non suffisante : les institutions de la société civile sont indispensables pour encourager la vertu publique et, surtout, protéger les individus contre l’État. Ces institutions sont la famille, les Églises et les entreprises. À l’objection qui souligne le caractère hiérarchique desdites institutions, voire leur mimétisme avec les formes « étatiques » de pouvoir et d’autorité, Rothbard répond qu’elles reposent en fait sur l’adhésion volontaire, contrairement aux États. On peut certes échapper au contrôle d’un État en s’exilant, mais on retombera forcément sous la souveraineté d’un autre – ce qui n’est pas le cas des familles, des Églises ni, du moins en théorie, des entreprises. Les paléolibertariens estiment qu’une forme quelconque d’autorité sociale sera toujours nécessaire et distinguent l’autorité « naturelle » (dérivée de structures sociales reposant sur l’adhésion volontaire) de l’autorité « non naturelle » (imposée par l’État). Il existe une divergence additionnelle entre libertariens et paléolibertariens : les premiers, suivant l’explication du disciple de Rothbard Lew Rockwell, confondent liberté face à l’oppression étatique et liberté par rapport aux normes culturelles (religion, morale bourgeoise et autorité sociale), alors que ces deux notions n’ont pas du tout la même signification. Autrement dit, la maxime des rothbardiens est « non à l’État, oui à l’autorité sociale ».
Il ne faut pas confondre idéal libertarien et libertinage, expliquent les paléolibertariens. Plus question de fricoter avec les hippies antisystème qui ont longtemps peuplé le Parti libertarien à l’époque où Rothbard en était adhérent. Par conséquent, les libertariens authentiques doivent rompre avec le « style Woodstock » et ne plus se présenter comme une secte antiautoritaire hostile aux « normes de la civilisation occidentale ». Prôner la dépénalisation des drogues ou de la prostitution, comme le fait le Parti libertarien, c’est s’inscrire dans le champ de la contre-culture et s’éloigner du sentiment des Américains « normaux », et donc réduire les chances de faire triompher les idéaux libertariens. En outre, l’athéisme militant de nombreux libertariens (comme les promoteurs du magazine New Atheism ou les disciples d’Ayn Rand) va lui aussi à l’encontre des convictions de la majorité du peuple des États-Unis ; pour les paléolibertariens, la question n’est pas de croire ou de ne pas croire en Dieu, mais de défendre la « culture occidentale » comme fondement éthique du nouvel ordre postétatique. « Permettre aux syndicats d’exercer une violence criminelle subvertit l’autorité des employeurs. La législation sur les drogues, la couverture maladie, l’assurance vieillesse et l’école publique sapent l’autorité de la famille. Bannir la religion du débat public sape l’autorité de l’Église », écrit Rockwell (1990). Quant à Rothbard, il explique que :
« si le LM [le libertarien modal[1]] déteste l’État, ce n’est malheureusement pas parce qu’il le percevrait comme l’unique instrument social d’agression organisée contre les personnes et les biens. Non, le LM est un adolescent en rébellion contre tous ceux qui l’entourent : d’abord contre ses parents, ensuite contre sa famille, puis contre ses voisins et enfin contre la bourgeoisie dont il est issu, contre les normes et conventions bourgeoises et contre les institutions exerçant une autorité sociale, telles les Églises. Ainsi, pour le LM, l’État n’est pas un problème unique, il n’est que la plus visible et la plus odieuse des nombreuses institutions bourgeoises qui méritent sa haine, d’où le plaisir avec lequel le LM arbore un badge qui proclame “Question Authority” [“Conteste l’autorité”] » (Rothbard, 2016).
Le paléolibertarianisme n’est donc pas une idée nouvelle, mais le véhicule d’un retour aux racines de la vieille droite. Autrement dit, un libertarianisme sans libertinage, mais aussi sans concession au néoconservatisme « étatiste ». On peut résumer cette sensibilité en quelques idées fortes : l’État est la source institutionnelle du mal tout au long de l’histoire ; le libre marché est un impératif à la fois moral et pratique ; l’État-providence est un vol organisé ; l’éthique égalitaire est moralement condamnable car elle détruit la propriété et l’autorité sociale ; l’autorité sociale est seule capable de faire contrepoids à l’autorité étatique ; les valeurs judéo-chrétiennes sont indispensables à un ordre libre et civilisé. Le paléolibertarianisme vise ainsi à rétablir l’ancienne convergence entre libertariens et conservateurs, aujourd’hui divisés par l’émergence d’un néoconservatisme qui, d’après Rockwell, « applaudit le capitalisme » mais « applaudit encore plus fort l’État-providence conservateur » (Rockwell, 2016).
Selon Rockwell, le libertarianisme « de gauche » déteste la culture occidentale, alors que lui entend « réconcilier » les libertariens et le peuple états-unien. Mais il est un point plus sensible encore : les paléolibertariens tendent à considérer que si la notion de « droits civiques » équivalait jadis à celle des droits des citoyens face à l’État, elle a fini par être détournée pour signifier un traitement spécial en faveur des Noirs et d’autres minorités au détriment des majorités. « La ségrégation imposée par l’État, qui violait elle aussi les droits de propriété, était regrettable, mais non moins regrettable est l’intégration imposée par l’État », explique Rockwell, ajoutant à cela que la séparation (entre les races) n’est pas mauvaise en soi : elle peut même être un phénomène positif si elle est « volontaire ». Il faut éviter de céder le terrain aux arguments égalitaires, comme le font certains libertariens :
« Il est parfaitement naturel et normal de vouloir s’associer avec des membres de sa propre race, de sa propre nationalité, de sa propre religion, de sa propre classe, de son propre sexe, voire du même parti politique », car cela fait partie du droit à la libre association. Mais « trop de libertariens se joignent aux progressistes en accusant de racisme les non-conformistes ».
Ainsi, par exemple, les paléolibertariens ne sauraient approuver les hommages officiels (financés par l’impôt) rendus chaque année à Martin Luther King, « un socialiste hostile à la propriété privée et partisan de l’intégration forcée ». Il s’agit là d’un point absolument central de l’argumentaire rothbardien : ce qui est immoral, ce ne sont pas les croyances racistes (ou anti-racistes) en soi, qu’elles soient fausses ou justifiées, mais l’exigence que ces croyances soient officiellement reconnues et promues par l’État.
En 1992, Rothbard écrivit un article qui, à la lumière des événements de ces dernières années, est d’une étonnante actualité et s’avère même prophétique. Il y proposait d’adopter le populisme de droite comme stratégie politique des paléolibertariens. Son texte commençait par une défense de David Duke, ancien leader du Ku Klux Klan, candidat au poste de gouverneur de Louisiane et deux fois précandidat à la présidence, sous l’étiquette démocrate aux primaires de 1988 puis républicaine à celles de 1992. (En 2016, Duke – qui met en doute l’existence de la Shoah – a soutenu Trump comme le moindre mal, tout en critiquant ses positions pro-israéliennes.) D’après Rothbard, l’adoption d’un discours populiste réactionnaire devait permettre à la mouvance libertarienne, qui avait beaucoup de mal à se déve lopper au-delà de cercles restreints, de conquérir des majo rités électorales :
« L’idée fondamentale de la droite populiste, c’est que nous vivons dans un pays étatiste et dans un monde étatiste dominés par une élite dirigeante reposant sur une coalition entre un État omniprésent, les grandes entre- prises [Big Government and Big Business] et divers groupes d’intérêts influents. Plus précisément, les États-Unis d’antan, royaume de la liberté individuelle et de l’État minimal, ont été remplacés par une coalition de politiciens et de bureaucrates alliés avec et dominés par de puissantes élites finan cières, qu’elles soient traditionnelles ou d’origine plus récente […] et par une Nouvelle Classe de technocrates et d’intellectuels dont font partie les universitaires de l’Ivy League et les élites médiatiques et qui sont les principaux formateurs de l’opinion publique dans notre société » (Rothbard, 1992).
Ces intellectuels jouent un rôle essentiel pour « tromper les masses » et les convaincre de « payer des impôts » et de « se plier aux desseins de l’État » (la pilule bleue ?). De ce fait, une stratégie qui viserait uniquement à convaincre les élites intellectuelles de la bonté des idées libertariennes ne peut que se heurter aux intérêts personnels de ces couches intellectuelles et de ces leaders d’opinion. La stratégie de promotion des idéaux de liberté doit être « plus active et plus agressive » ; il ne suffit pas d’être convaincu que ces idées sont justes et d’espérer que l’étatisme s’effondre de lui-même, tout comme le communisme s’est effondré sous le poids de ses propres échecs.
C’est ici que le pari populiste entre en jeu. Il s’agit, à proprement parler, d’une double approche : d’une part, maintenir la stratégie de diffusion des idées libertariennes et tenter de montrer leur supériorité ; de l’autre, « faire directement appel aux masses pour “court-circuiter” les médias dominants et les élites intellectuelles ; mobiliser les masses populaires contre les élites qui les spolient, les mystifient et les oppriment, tant au niveau social qu’au niveau économique » (Rothbard, 1992). Autrement dit, les libertariens doivent conquérir les grandes majorités exploitées par l’alliance impie du grand capital progressiste et des élites médiatiques, laquelle a engendré une couche parasitaire qui se nourrit des efforts des travailleurs et des classes moyennes. Les libertariens doivent abandonner leurs tentatives inutiles de séduire les yuppies – qui font stagner l’élec torat du Parti libertarien autour d’un maigre 1 % – et aller vers le peuple. À cette fin, Rothbard propose un programme en huit points :
Réduire drastiquement les impôts.
Démanteler l’État-providence.
Abolir les privilèges raciaux et de groupe.
Reconquérir la rue : éliminer les délinquants.
Reconquérir la rue : chasser les clochards et les vaga bonds.
Abolir la Réserve fédérale : s’en prendre aux banquiers criminels.
L’Amérique d’abord.
Défendre les valeurs familiales.
« It’s white people, stupid ! »
Pas besoin d’être grand clerc pour identifier dans ce programme les principaux axes du populisme réactionnaire et des extrêmes droites contemporaines. Il s’agit d’une sorte de « programme de transition » : les libertariens participe- raient à la gestion de l’État afin de créer les conditions d’une « privatisation définitive » et, simultanément, ils encourageraient la formation d’une alliance avec des secteurs conservateurs et traditionalistes non libertariens, voire autoritaires. C’est bien ce type de coalition populiste que l’on observe aujourd’hui lorsque l’on analyse des phénomènes comme le trumpisme ou certaines droites européennes. Mais qu’est-ce qui a facilité cette dérive du libertarianisme vers l’extrême droite ? Un des facteurs de cette évolution, souligne Gulliver-Needham, est la base socio-raciale et de genre de l’idéologie libertarienne qui, tout comme l’extrême droite, attire tout particulièrement les hommes blancs de classe moyenne. Parallèlement, il existe aussi des affinités idéologiques et émotionnelles, en termes de langage et d’attitudes.
Lorsqu’un libertarien et un néofasciste fustigent le féminisme, il est presque impossible de les distinguer. Il est rare de voir un partisan du « libéralisme classique »15 s’attaquer à l’alt-right ou aux racistes : en revanche, il est bien plus à l’aise s’il s’agit de s’en prendre à la gauche. Libertariens et néofascistes utilisent le même langage et les mêmes expressions à la mode et recourent constamment à des termes comme « SJWs » [social justice warriors] ou « valeurs occidentales ». Il est donc extrêmement facile pour les adhérents de l’alt-right de s’entendre avec les libertariens ; les uns et les autres parlent littéralement la même langue. Vous pensez que les socialistes contrôlent les médias ? Remplacez le terme « socialistes » par « marxistes culturels » et vous êtes en bonne voie pour devenir le nouveau Richard Spencer (Gulliver-Needham, 2018).
Un autre point commun est la question de l’immigration (alors même que le libertarianisme classique était censé être favorable à l’ouverture des frontières et à la libre circulation des personnes). Outre la dimension raciale et « culturelle » de la chose, le thème omniprésent de la redistribution revient ici sur le tapis : « C’est la même rhétorique sur les pauvres non méritants [undeserving poors] qui est utilisée à l’encontre des bénéficiaires de l’aide sociale et des immigrants, censé- ment venus [aux États-Unis] pour y vivre des prestations sociales. Cela est également dû à l’idée que les immigrants auront plus tendance à voter à gauche (ce qui est souvent le cas), ce qui entraînera le renforcement de l’État-providence. Bien souvent, les libertariens se sont montrés tout disposés à abandonner leurs prétendus principes fondamentaux afin de préserver un ordre social qui garantit leur place au sommet de la pyramide » (Gulliver-Needham, 2018).
Parallèlement, athées libertariens et droites religieuses sont aussi prêts à s’allier pour faire face ensemble aux dangers de l’islam et du « grand remplacement » de la population occidentale, de ses traditions et de ses valeurs. La différence avec les néoconservateurs, c’est que de leur point de vue, ce combat doit prendre la forme d’un blindage de la forteresse états-unienne et non de la croisade pour la démocratisation de la planète chère aux faucons liés aux complexe militaro- industriel. Les libertariens sont également de fervents partisans de l’accès sans restriction des citoyens aux armes à feu, une « gun culture » qui va de l’autodéfense personnelle à la formation de milices hostiles au gouvernement.
Et qu’en est-il de la question de la mondialisation ? D’après Gulliver-Needham, les libertariens n’ont jamais été aussi enthousiastes à l’égard de celle-ci que l’on pourrait le croire. Or, de nos jours, il n’est pas difficile de perce- voir l’internationalisation des échanges comme une menace majeure sur l’identité blanche, qu’il s’agisse de l’afflux de travailleurs immigrés ou du poids de la Chine sur le marché mondial (l’agressivité de Trump contre la Chine pendant ses deux campagnes électorales et sa rhétorique antichinoise permanente ne sont pas gratuites). On observe une dérive similaire de la sensibilité libertarienne en matière de discrimination positive et de réparation des injustices raciales : d’une part, comme nous l’avons souligné, les libertariens estiment que la liberté d’association doit permettre à chaque groupe de s’organiser librement, y compris en excluant les membres d’autres groupes ; de l’autre, les politiques publiques favorables aux minorités finissent selon eux par faire de ces dernières des populations privilégiées par rapport aux Blancs. « Dans la philosophie libertarienne, personne ne peut être contraint de s’associer avec qui que ce soit. Si les Noirs commettent des crimes ou si les juifs propagent le communisme, un propriétaire a le droit de les discriminer », résume Christopher Cantwell, le « nazi pleurnichard » croisé au chapitre précédent. La biographie de Cantwell est emblématique de cette évolution de la mouvance libertarienne vers une extrême droite qui, dans son cas, est ouvertement néonazie et antisémite (Weigel, 2017) : lui-même affirme que ce sont les idées de Rothbard qui lui ont permis de passer d’un antiétatisme abstrait à ses positions racistes actuelles, justifiées au nom du libre droit d’association.
L’idée de décadence est commune au courant libertarien et à l’extrême droite. Tout ce qui méritait d’être défendu dans l’ordre social occidental – le gouvernement limité des premières années de l’indépendance états-unienne pour les libertariens ; les hiérarchies de genre et de race pour l’extrême droite – est en train de partir à vau-l’eau, en grande partie à cause des progressistes. Enfin, les libertariens ne peuvent manquer de reconnaître à l’extrême droite le mérite d’avoir réhabilité une attitude « virile » vis-à-vis du danger communiste, soit une sensibilité qui s’était affaiblie après l’effondrement du socialisme réel et les fantaisies libérales sur la « fin de l’histoire ». Le progressisme contemporain n’est à leurs yeux qu’une version édulcorée de la « présomption fatale » qui cherche à transformer la société dans un sens égalitaire, avec ses milliers de social justice warriors menant leur combat depuis différentes tranchées, et en particulier sur le terrain de la culture, où la gauche aurait prétendument « gagné » la bataille.
*
Illustration : « Uragan vi stepi », Nikolay Dubovskoy, 1890
Notes
[1] Expression forgée par Rothbard pour désigner les libertariens contre-culturels hostiles à toute autorité sociale légitime
![Rebelles réactionnaires et extrémisation des droites [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_Delivers_Remarks_at_CPAC_49608880598-150x150.jpg)








