
À lire un extrait de Lyon en luttes dans les années 68, du Collectif de la Grande Côte
Collectif de la Grande Côte, Lyon en luttes dans les années 68. Lieux et trajectoires de la contestation, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Actions collectives », 424 p., 20 €, février 2018.
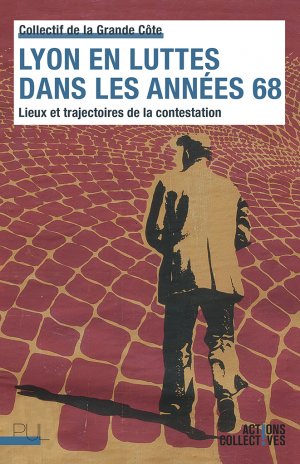
La recherche en sciences sociales sur Mai 68 et ses contrecoups politiques et sociaux se poursuit, réfutant systématiquement les lieux communs éculés sur les supposés reniements des soixante-huitard.e.s. Particulièrement ambitieuse et menée dans cinq villes françaises, l’enquête « Sombrero » commence à livrer ses résultats. L’ouvrage produit par l’équipe lyonnaise, réunie dans le Collectif de la Grande Côte[1], est le premier à paraître[2] ; nous présentons ci-dessous un extrait de son introduction.
Introduction (par Lilian Mathieu)
Le développement des recherches historiques et sociologiques a largement révoqué la caricature, longtemps dominante, d’un Mai 68 strictement estudiantin et parisien (Mouriaux et al., 1993 ; Vigna, 2007 ; Artières & Zancarini-Fournel, 2008 ; Gobille, 2008 b ; Porhel, 2008 ; Vigna & Vigreux, 2010 ; Benoit et al., 2011). Il est désormais acquis que l’événement a traversé et bousculé la France entière, qu’on l’envisage dans sa dimension territoriale ou sociale. Avec neuf millions de grévistes au plus fort de la mobilisation, c’est le pays dans son ensemble qui a vécu une crise politique et sociale majeure[3]. Cette extension de l’appréhension de l’événement est également temporelle. Pour solidement établie qu’elle soit, l’expression « Mai 68 » cède de plus en plus le pas à celle, plus exacte, de « mai-juin 68 » (Damamme et al., 2008). L’attention se déplace tant vers l’amont de la crise – notamment dans ce qui la relie à la guerre d’Algérie (Ross, 2005 – que vers son aval – marqué par une forte effervescence contestataire[4] –, dont rend bien compte l’expression de « moment 68 » suggérée par Zancarini-Fournel (2008) ou celle, antérieure et que nous privilégierons ici, d’« années 68 » proposée par Dreyfus-Armand et al. (2000). Ces années 68 sont ainsi celles d’une contestation durable, à la fois politique, sociale et culturelle, dont la diversité découle elle-même du foisonnement des mutations des années 1960[5].
Le présent ouvrage entend contribuer à cet élargissement de la compréhension des années 68 à partir du cas lyonnais. Le choix de cette ville – ou plus exactement de son agglomération – ne tient pas qu’à la localisation universitaire des auteur.e.s. Alors troisième ville de France après Paris et Marseille, Lyon a joué un rôle décisif dans le déroulement de la crise puisque c’est après les violences du 24 mai 1968, marquées par la mort du commissaire Lacroix à proximité de la préfecture du Rhône, que se dessine un retournement en faveur du camp gouvernemental. De fait, si le Mai lyonnais est incompréhensible sans référence à la dynamique nationale de l’événement, l’inverse est tout aussi vrai.
Souvent dévalorisée dans la hiérarchie des objets de recherche, l’étude au niveau local n’est en pas moins irremplaçable pour comprendre les relations d’interdépendance qui unissent le centre et ses périphéries. La situation économique, sociale, politique ou encore universitaire de la métropole lyonnaise en fait de ce point de vue un terrain d’étude révélateur de tensions et de recompositions plus larges, dans le même temps que les spécificités de son paysage contestataire – marqué par exemple par le poids du catholicisme social et l’ancrage de sa tradition libertaire – appellent une analyse au niveau le plus fin. En présentant une étude de la contestation lyonnaise post-soixante-huitarde, ce livre entend livrer plus qu’une monographie locale : une sociologie d’un univers militant composite et dynamique, façonné par des logiques complexes tenant, notamment, aux propriétés sociales de celles et ceux qui l’animent.
Aborder mai-juin 68 et ses suites au travers d’une sociologie de ses protagonistes n’est pas anodin s’agissant d’un événement aussi controversé. Une image dominante de l’ancien soixante-huitard s’est imposée au fil des commémorations décennales, frappée du sceau infamant de la trahison (Lacroix, 1986 ; Sommier, 1994 ; Zancarini-Fournel, 1995). Présente dès la fin des années 1970 dans les écrits d’essayistes attribuant au mouvement collectif de Mai la responsabilité d’un repli individualiste sur la défense d’intérêts égoïstes, cette thèse a connu pendant la campagne présidentielle de 2007 son expression la plus outrancière, le candidat Nicolas Sarkozy (ou plus exactement son porte-plume Henri Guaino) n’hésitant pas à stigmatiser « le culte de l’argent roi, du profit à court terme, de la spéculation […], les dérives du capitalisme financier […] portés par les valeurs de mai 68 ». Les recherches existantes (Fraser, 1988 ; Cultural & Social History, 2011 ; Gildea, Mark & Warring, 2013 ; Pagis, 2014 ; Johsua, 2015) infirment pourtant on ne peut plus clairement ce lieu commun voulant que les soixante-huitard.e.s aient renié leurs idéaux de jeunesse au profit de carrières aussi brillantes que lucratives dans ces lieux de pouvoir que sont les médias, la politique, l’économie ou encore la publicité. Ainsi que le montrera à son tour le présent ouvrage (et spécialement son chapitre 11), c’est au contraire une permanence (ce qui n’exclut ni les modulations ni les redéfinitions) des engagements qui se révèle dès qu’on interroge les protagonistes sur leur parcours post-68.
Si cet ouvrage accorde une importance décisive à la crise de mai-juin 68, son propos dépasse largement les bornes de l’événement en intégrant celui-ci dans une séquence temporelle plus ample, qui le déborde tant vers l’amont que vers l’aval. Dans ce qui reste l’une des analyses les plus ambitieuses de cette crise, Pierre Bourdieu a proposé de l’envisager comme le produit de la synchronisation d’une multiplicité de crises latentes dans différents univers sociaux, qui aurait eu « le pouvoir de faire coïncider des événements qui, étant donné le tempo différent que chaque champ doit à son autonomie relative, devaient normalement s’ouvrir ou se clore en ordre dispersé ou, si l’on veut, se succéder sans s’organiser nécessairement en une série causale unifiée » (1984, p. 226-227). L’analyse se doit par conséquent de reconstituer la multiplicité des logiques propres aux différents univers sociaux – ceux de l’enseignement supérieur, de la compétition politique, du travail et de la représentation syndicale, etc. – que les événements de mai et juin 1968 ont fait se rencontrer et se confondre dans une brève séquence de fluidité politique (Dobry, 1986 ; Gobille, 2008c).
De ce fait même, les bornes temporelles de l’ouvrage n’ont pas la netteté ou la précision des tentatives, souvent artificielles, de séquençage chronologique. La genèse de la crise universitaire se dessine sur deux décennies au moins, au fil d’une explosion des effectifs estudiantins favorisée par le baby boom et par l’infléchissement des barrières devant l’accès à l’enseignement supérieur. Le Mai ouvrier lyonnais débute en réalité dès l’automne 1967 avec la grève particulièrement dure et déterminée des salariés de la Rhodiacéta (Révoltes, 1999) qui, déjà, dessine une convergence des étudiants et des forces de la gauche non communiste vers ce qui est alors un bastion de la Confédération générale du travail (CGT). À l’inverse – ainsi que l’a démontré la thèse de Camille Masclet (2017a) –, si le développement du mouvement des femmes trouve une de ses principales sources d’inspiration dans l’humeur contestataire post-soixante-huitarde, c’est de manière décalée et différée en regard d’autres mobilisations et en se prolongeant bien au-delà de la victoire du candidat socialiste à l’élection présidentielle de 1981. Tous les mouvements, causes ou organisations traités dans cet ouvrage ne relèvent pas de la même temporalité sociale ; si les convergences ou les synchronisations qui les rassemblent méritent toute notre attention, tenter de les inclure dans un même calendrier analytique serait faire violence à la réalité historique. Par suite, toutes les personnes qui ont accepté de nous raconter leurs engagements n’appartiennent pas à la même cohorte générationnelle et n’ont pas vécu mai-juin 68 et ses suites au même âge ni de la même manière : certaines étaient insérées depuis le début des années 1960 dans le monde du travail et avaient préalablement connu d’autres épisodes de mobilisation, d’autres – encore étudiantes – ont vécu Mai de l’intérieur des universités tandis que parmi les plus jeunes, beaucoup ont suivi les événements au sein de leur famille, souvent par l’intermédiaire des médias audiovisuels, une expérience à distance qui n’allait pas moins rapidement impulser un engagement effectif dans diverses causes ou organisations.
Car ce sont aussi et surtout les engagements militants post-soixante-huitards qui constituent l’objet de cette recherche. Parfois décrite comme un « âge d’or des luttes », la séquence contestataire impulsée par Mai 68 est porteuse d’enjeux sociologiques et politiques non moins délicats que l’événement lui-même. Les luttes collectives des années 1970 ont été abordées au travers d’un cadre d’analyse, celui dit des « nouveaux mouvements sociaux », incarné notamment par Alain Touraine et son équipe et illustré par une série d’études consacrées à l’écologie, au régionalisme et aux luttes étudiantes (Touraine, 1978 ; 1982). Longtemps dominante en France, cette approche sociologique avance que la nouveauté de ces mouvements réside principalement dans la nature de leurs revendications et de leurs projets[6] : alors que le mouvement ouvrier, central dans la société industrielle, exprimait des exigences d’ordre matérialiste, les nouveaux mouvements sociaux se feraient porteurs d’attentes post-matérialistes, c’est-à-dire d’ordre plus identitaire ou moral, et seraient destinés à prendre la relève, au sein de la société post-industrielle, d’un combat ouvrier condamné à dépérir.
Les critiques adressées à ce cadre d’analyse sont nombreuses et anciennes (Mathieu, 2009b). La nouveauté prêtée à des mouvements comme le féminisme, l’écologie ou le régionalisme apparaît toute relative quand on découvre que leurs racines plongent en plein xixe siècle, tandis que l’étude des manifestations contemporaines infirme l’hypothèse d’un remplacement des revendications « matérialistes » par les enjeux « post-matérialistes » (Fillieule, 1997). Mais c’est plus encore cette césure entre ordres de revendications, de même que l’opposition entre mouvement ouvrier et « nouveaux mouvements sociaux », qu’entend réfuter notre ouvrage. À Lyon comme ailleurs en France, les luttes propres au monde ouvrier, et spécialement au travail industriel, ne faiblissent pas dans l’après-68. Les travaux de Xavier Vigna (2007) et de Vincent Porhel (2008) ont certes montré que les années 1970, marquées par la crise économique et sociale ouverte avec le premier choc pétrolier, assistent à une redéfinition majeure de ces luttes, qui deviennent progressivement plus défensives, spécialement axées sur la sauvegarde des emplois dans les secteurs les plus fragilisés. Elles n’en restent pas moins nombreuses, combatives et déterminées, ainsi qu’en attestent les chapitres 4 et 5 de notre ouvrage. Surtout, l’étude des parcours militants (à laquelle la troisième partie est consacrée) témoigne de l’étroite intrication entre les enjeux de luttes, les mouvances et les organisations. Être féministe, par exemple, va fréquemment de pair avec un engagement syndical, de même que militer dans un parti d’extrême gauche d’idéologie marxiste n’est pas incompatible avec un investissement dans les luttes homosexuelles.
Ici encore, l’inscription locale de l’objet d’étude doit conquérir sa légitimité devant la propension à sa dévalorisation au sein du monde académique. Inscrites dans un espace économique, social ou politique local, plusieurs des mobilisations surgies dans l’agglomération lyonnaise n’en ont pas moins eu un retentissement national, voire international. Citons-en quelques-unes parmi les plus emblématiques. Déjà évoquée, la grève de la Rhodiacéta de 1967 atteste une combativité ouvrière intacte alors que se font sentir les premiers signes de ralentissement de la croissance économique, tandis que celle des salariés de Pennaroya, cinq ans plus tard, révèle les effroyables conditions de travail (danger des installations vétustes, exposition au plomb, logements insalubres, etc.) imposées aux travailleurs immigrés (chapitre 5). La mobilisation des prostituées lyonnaises qui, avec le soutien des féministes, occupèrent en juin 1975 l’église Saint-Nizier pour protester contre la répression policière a marqué l’entrée en politique d’un groupe social pourtant parmi les plus stigmatisés et les plus démunis en ressources et traditions de lutte (Mathieu, 2001) ; elle est aujourd’hui célébrée mondialement comme l’événement fondateur du mouvement des « travailleur.se.s du sexe ». Mobilisant d’importants effectifs lyonnais, la manifestation organisée à Creys-Malville le 31 juillet 1977 pour protester contre la construction d’un surgénérateur nucléaire demeure un événement traumatique pour les mouvances écologiste et d’extrême gauche. Les affrontements extrêmement violents avec la police font un mort parmi les opposants au projet, Vital Michalon, ainsi que de nombreux blessés, et imposent une redéfinition des formes et des enjeux du mouvement écologiste naissant.
Attentif à la diversité des luttes qui ont marqué les années 68 dans Lyon et ses environs, cet ouvrage n’a cependant pas pour ambition de dresser un panorama exhaustif des mouvements sociaux de l’époque, ni d’en faire un récit chronologique circonstancié. L’exercice, quelque peu positiviste, aurait exigé des moyens matériels et humains dont nous ne disposions pas. Nous avons préféré centrer notre interrogation sociologique sur trois grandes familles militantes – détaillées ci-après – et surtout adresser à nos données des questionnements transversaux relatifs à la structuration des univers militants, à l’inscription spatiale des activités contestataires et aux dynamiques sociologiques des engagements. Le plan du livre découle directement de ces choix d’analyse. La première partie dresse, après un chapitre consacré à la déclinaison lyonnaise de la crise de mai-juin 1968, le portrait détaillé des structures et des évolutions des trois domaines de lutte privilégiés : l’extrême gauche (saisie dans ses composantes trotskistes, anarchistes, maoïstes ainsi que Parti socialiste unifié – PSU), le mouvement féministe (abordé à partir des principaux groupes et des principales mobilisations qui l’animent au fil de la période) et le champ syndical (envisagé au travers de ces deux composantes les plus importantes : la CGT et la Confédération française démocratique du travail – CFDT).
La deuxième partie aborde l’activité militante sous l’angle principal de son inscription dans l’espace : les établissements industriels ayant assisté aux conflits sociaux les plus importants, la territorialisation urbaine des pratiques et des sociabilités militantes, ainsi que l’étude d’un site singulier, l’hôpital psychiatrique du Vinatier, où se déploie une dynamique contestataire entrecroisant redéfinitions du service public hospitalier et recompositions syndicales.
La troisième partie adopte une approche plus microsociologique en traitant de plusieurs facettes des engagements et parcours des militants et militantes rencontré.e.s en entretien. L’influence des socialisations religieuses sur l’entrée en militantisme est étudiée en premier lieu, suivie d’une étude du cas particulier des couples militants, qui permet d’appréhender l’imbrication de la sphère intime et de la sphère politique. Les cas, extrêmement fréquents, de multiplication des engagements sont ensuite abordés dans leur dimension tant diachronique que synchronique. L’ouvrage s’achève sur l’étude des aboutissements des trajectoires individuelles d’engagement, restitués dans leurs dimensions professionnelle et militante, confirmant ainsi l’inconsistance de la figure démagogique du « soixante-huitard renégat ».
Bibliographie
Artières Philippe, Zancarini-Fournel Michelle (dir.) (2008), 68, une histoire collective, Paris, La Découverte.
Benoit Bruno, Chevandier Christian, Morin Gilles, Richard Gilles, Vergnon Gilles (dir.) (2011), À chacun son mai ? Le tour de France de mai-juin 68, Rennes, PUR.
Bourdieu Pierre (1984), Homo academicus, Paris, Minuit.
ContreTemps (2008), dossier « 1968 : un monde en révoltes », n° 22, mai.
Cultural and Social History (2011), « Voices of Europe’s 68 », 8 (4).
Damamme Dominique, Gobille Boris, Matonti Frédérique, Pudal Bernard (dir.) (2008), Mai-juin 68, Paris, éditions de l’Atelier.
Dobry Michel (1986), Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Sciences-Po.
Dreyfus-Armand Geneviève, Franck Robert, Lévy Marie-Françoise, Zancarini-Fournel Michelle (dir.) (2000), Les Années 68. Le temps de la contestation, Bruxelles, Complexe.
Fillieule Olivier (1997), Stratégies de la rue, Paris, Presses de Science-Po.
Fraser Ronald (dir.) (1988), 1968. A Student Generation in Revolt, New York, Pantheon.
Gildea Robert, Mark James, Warring Anette (dir.) (2013), Europe’s 1968: Voices of Revolt, Oxford, Oxford University Press.
Gobille Boris (2008b), Mai 68, Paris, La Découverte.
Gobille Boris (2008c), « L’événement Mai 68. Pour une sociohistoire du temps court », Annales HSS, n° 2, p. 321-349.
Johsua Florence (2015), Anticapitalistes. Une sociologie historique de l’engagement, Paris, La Découverte.
Lacroix Bernard (1986), « À contre-courant : le parti-pris du réalisme », Pouvoirs, n° 39, p. 117-127.
Mathieu Lilian (2001), Mobilisations de prostituées, Paris, Belin.
Mathieu Lilian (2009b), Les Années 70, un âge d’or des luttes ?, Paris, Textuel.
Mouriaux René, Percheron Annick, Prost Antoine, Tartakowsky Danielle (1993), 1968. Exploration du mai français, Paris, L’Harmattan.
Pagis Julie (2014), Mai 68, un pavé dans leur histoire, Paris, Presses de Sciences-Po.
Porhel Vincent (2008), Ouvriers bretons. Conflits d’usine, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968, Rennes, PUR.
Révoltes (1999), Histoires d’une usine en grève. Rhodiaceta 1967-1968 Lyon Vaise, Lyon, Révoltes.
Sommier Isabelle (1994), « Mai 68 : sous les pavés d’une page officielle », Sociétés contemporaine, n° 20, p. 63-82.
Touraine Alain (1978), La Voix et le regard, Paris, Seuil.
Touraine Alain (dir.) (1982), Mouvements sociaux d’aujourd’hui, Paris, Éditions ouvrières.
Vigna Xavier (2007), L’Insubordination ouvrière dans les années 68, Rennes, PUR.
Vigna Xavier, Vigreux Jean (dir.) (2010), Mai-juin 1968. Huit semaines qui ébranlèrent la France, Dijon, EUD.
Zancarini-Fournel Michelle (2008), Le Moment 68. Une histoire contestée, Paris, Seuil.
Notes
[1] Située dans le 1er arrondissement, la Grande Côte est un lieu emblématique de l’effervescence contestataire lyonnaise des années 1970. Le Collectif réunit François Alfandari, Sophie Béroud, Laure Fleury, Camille Masclet, Lilian Mathieu, Vincent Porhel et Lucia Valdivia.
[2] Un ouvrage synthétisant les résultats au plan national sortira en mars prochain aux éditions Actes Sud sous le titre Changer le monde, changer sa vie. Les ouvrages portant sur Lille, Marseille, Nantes et Rennes paraîtront au fil de l’année 2018.
[3] La dimension internationale du souffle contestataire de 1968 a davantage été prise en compte ; voir notamment Fraser (1988), Contretemps (2008) et Gildea, Mark & Warring (2013).
[4] Cette extension temporelle est également à l’œuvre dans les ouvrages collectifs de Dammame et al. (2008) et de Artières & Zancarini-Fournel (2008).
[5] Selon les auteur.e.s, « les soulèvements de la jeunesse, les occupations d’usine, les rites nouveaux de protestation, la “libération des mœurs”, la mise en question d’un certain nombre de règles, de codes et de conventions, l’essor des contre-cultures poussent à penser les “années 68”, en articulant la chronologie courte des “événements” avec la durée, en croisant l’étude du phénomène contestataire avec celle des transformations profondes de la société, des cultures politiques et des modes de vie » (Dreyfus-Armand et al., 2000, p. 15).
[6] Elle résiderait également dans la composition sociale des nouveaux mouvements sociaux, aux effectifs davantage éduqués et relevant des nouvelles classes moyennes.







