
À lire un extrait de « Paniques identitaires », de Laurence de Cock et Régis Meyran
Laurence De Cock et Régis Meyran, Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales, Bellecombe-en-Bauges, Le Croquant, 2017.
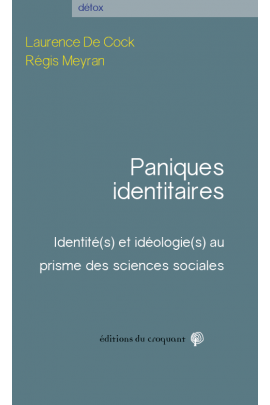
Résumé
Femmes en burkini suscitant des bagarres, cafés noyautés par des musulmans et « interdits aux femmes », viols effectués par cinquante individus musulmans à Francfort… Depuis quelques années, des informations inventées de toutes pièces ont pris de l’ampleur dans les grands médias, dans le but d’entretenir la peur d’un ennemi supposé menacer la nation et ses valeurs.
Ces paniques identitaires ne sont pas de simples rumeurs : elles apparaissent dans un contexte de défiance démocratique et sont relayées par des journalistes et des politiques, avant de s’évanouir du jour au lendemain. Mettant en scène le corps pur de la nation à protéger contre les Roms, les musulmans mais aussi l’héritage de Mai 68, la diversité, la « théorie du genre » et le communautarisme, ces récits révèlent en creux les formes actuelles de la domination et de la stigmatisation. Dans ce livre, une dizaine de spécialistes en sciences sociales (histoire, sociologie, anthropologie, science politique) montrent en quoi ces paniques identitaires viennent nourrir le renouveau du nationalisme français, en train de se reformuler et d’occuper presque tout l’espace médiatique.
Sommaire
Introduction, par Laurence De Cock et Régis Meyran
« Malaise identitaire » contre « affirmation identitaire » : les usages du mot « identité », par Régis Meyran
1968 ou le début de la fin. Catastrophisme anticontestataire et contre-sens identitaire, par Ludivine Bantigny
Le roman national au cœur des paniques identitaires, par Laurence de Cock
Le discours du « communautarisme », une logique de la guerre identitaire, par Fabrice Dhume
Le bon genre de l’identité nationale, par Fanny Gallot
L’insécurité culturelle : usages et ambivalences. Notes critiques à propos du livre de Laurent Bouvet, par Klaus-Gerd Giesen
Paniques identitaires, paniques territoriales : une spatialisation des crispations identitaires, par Cécile Gintrac
La diversité « à la française » ou la tentation d’une égalité sous conditions de performance identitaire pour les « non-frères », par Réjane Sénac
Panique sécuritaire et panique identitaire : quelques usages de « l’insécurité », par Laurent Mucchielli
L’ Algérie à Cologne, par Jocelyne Dakhlia
Introduction
Tout le monde s’en souvient, lors de l’été 2016, la polémique a fait rage en France autour du burkini, une tunique de bain utilisée par des personnes de confession musulmane, qui recouvre le corps et les cheveux à la manière du hijab. Tout avait commencé le 13 août avec une rixe entre deux bandes rivales sur la plage de Sisco, en Corse, causant plusieurs blessés et des véhicules incendiés. L’« information » circule alors rapidement dans les médias : il s’agirait d’un affrontement entre jeunes musulmans radicalisés et Corses racistes, qui aurait pour origine le fait que « plusieurs femmes qui se baignaient en burkini étaient prises en photo par des touristes »[1]. Or, on verra par la suite qu’il n’en était rien, et que cet incident relevait plutôt d’une logique de caïdat – deux bandes rivales s’étant battues pour s’approprier la plage en question[2]. L’affaire toutefois prend de l’ampleur, dans le contexte post-attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi après la récente interdiction du burkini dans plusieurs villes du Sud de la France. Des gens manifestent ainsi à Bastia aux cris de « on est chez nous ! ». Des hommes politiques, en particulier d’extrême droite, s’emparent de l’affaire pour affirmer que le pays est menacé dans son identité, à cause de ce vêtement et des violences qu’il engendre. Florian Phillippot (FN) réclame « l’ordre » contre la « violence islamiste ». Deux jours après, le maire PS de Sisco prend un arrêté pour interdire le burkini sur les plages de la commune. L’arrêté est soutenu par le Premier ministre en personne, Manuel Valls, estimant qu’avec ce vêtement la laïcité et les valeurs de la République sont bafouées. Les médias s’affolent, les réseaux sociaux aussi : c’est l’affaire la plus importante de l’été. Alors que les journalistes américains, anglais et allemands se moquent abondamment de cette histoire, tout s’interrompt brutalement à la suite de la décision du Conseil d’Etat, qui suspend l’exécution des arrêtés anti-burkini, au motif que les risques de trouble à l’ordre public invoqués par les municipalités ne sont pas établis par les faits présentés. Et, du jour au lendemain, l’affaire du burkini disparaît du paysage médiatique. Cette petite histoire est édifiante : elle constitue un parfait exemple de panique identitaire.
Paniques morales et paniques identitaires
L’objectif de cet ouvrage collectif est d’analyser les paniques identitaires, comme celle du burkini, qui agitent le pays depuis plusieurs années. Par « panique identitaire », nous désignons un cas particulier de panique morale. Ce concept a été inventé par le sociologue Stanley Cohen[3] à partir de l’analyse d’une bataille relativement anodine entre mods[4] et rockers sur la plage de Clacton (Angleterre, 1964) qui avait pris des proportions délirantes dans la presse – jusqu’à être présentée comme une « invasion » de hooligans menaçant le pays. Cohen définit la panique morale par la forte préoccupation de l’opinion publique (mesurable par des sondages) vis-à-vis d’un groupe dont le comportement est vu comme une menace pour les valeurs de la société ou pour l’existence même de cette société. Un tel groupe suscite l’hostilité : il est vu comme un ennemi, comme le Mal incarné, qu’il est nécessaire de combattre pour le bien de tous. Pour qu’il y ait panique morale, il faut un consensus assez large au sein de la société ou au sein de certains groupes sociaux quant à la réalité de cette menace. Mais la peur suscitée par la menace est complètement disproportionnée par rapport à sa réalité, et toutes les données sont exagérées : nombre de victimes ou d’agresseurs, coût des dégâts matériels, etc. Enfin, Cohen décrit ce phénomène comme volatile – pouvant apparaître et disparaître en un rien de temps. Il suppose en outre l’existence d’entrepreneurs de morale[5] qui contribuent à la diffusion de la panique morale (notamment dans le monde des médias ou chez les politiques).
Nous définissons quant à nous un type particulier de ces paniques morales : la panique identitaire, qui met en jeu à la fois les représentations de soi d’un groupe social – sa supposée identité, pensée de façon essentialiste et culturaliste[6] – et la perception que ce groupe a d’un autre groupe social – pensé lui aussi de façon essentialiste et culturaliste, présenté comme une menace et dès lors diabolisé. L’affaire du burkini, que nous avons évoquée, peut en ce sens être considérée comme une panique identitaire : le groupe perçu comme inquiétant étant « les musulmans », le groupe d’appartenance idéalisé étant « la vraie France » (sous-entendue blanche, chrétienne, « de souche », etc.), les entrepreneurs de morale se nommant Nicolas Dupont-Aignan, Manuel Valls ou Florian Philippot – ainsi qu’un certain nombre d’éditorialistes qui leur ont emboîté le pas.
Comment fonctionne une panique identitaire et comment l’analyser ? Le sociologue Lilian Mathieu[7] croit percevoir une ambiguïté profonde du concept de panique morale, car, selon lui, on ne sait jamais si les paniques morales sont le fait des dominés (agis par leurs émotions primaires) ou des dominants (manipulant machiavéliquement les faits). Or, selon nous, cette opposition ne tient pas, à moins de supposer qu’une panique peut apparaître spontanément chez un groupe dominé, c’est-à-dire à moins de considérer que certains groupes sociaux sont constitués d’êtres simples mus par leurs seules passions et incapables du moindre raisonnement rationnel – bref, de tomber dans la logique du raisonnement « participatif » caractéristique des peuples primitifs selon la logique désuète prônée jadis par le philosophe Lucien Lévy-Bruhl. Il est bien plus probable que tous les individus au sein de tous les groupes sociaux aient des idées, mais que certaines personnes, et certains groupes, disposent d’un réseau suffisant pour diffuser les leurs, alors que d’autres non. C’est d’ailleurs ce que montre la sociologie de la construction des problèmes publics depuis les travaux pionniers de Joseph Gusfield sur la construction de la catégorie des « conducteurs-buveurs »[8]. Ainsi, plutôt que cette fausse opposition, nous supposerons ici qu’une panique identitaire est causée par un groupe donné qui diffuse dans l’espace public un mélange de faits discutables et d’idéologies, avec l’objectif plus ou moins explicite de canaliser les peurs des individus, dans le but de convaincre le plus grand nombres de rejoindre leur groupe. Cette démarche est appuyée par des entrepreneurs identitaires qui entretiennent ainsi une croisade identitaire, à laquelle on peut supposer qu’ils croient à des degrés divers. L’objectif des entrepreneurs de morale a été analysé par Goode et Ben-Yehuda[9]. Pour ces auteurs, les paniques morales émergent non du haut (l’élite), ni du bas (le peuple), mais sont utilisées par des groupes spécifiques qui y voient leur propre intérêt. Ils invitent à se poser la question : « qui a intérêt à ce que tel ou tel enjeu soit considéré par tous comme une menace ? » Dans leur perspective théorique, le gain matériel et le gain moral ou idéologique se rejoignent complètement – la croyance dans la croisade morale fait partie de la vision du monde des entrepreneurs de morale, tout autant que l’intérêt matériel qu’ils en retirent, les deux choses s’exprimant à divers degrés chez chaque individu particulier. Une panique identitaire n’est donc pas une simple rumeur, car à la différence de la rumeur (comme la fameuse « rumeur d’Orléans » dans les années 1960), elle se diffuse par des canaux informels et populaires, mais aussi publics, dans la sphère médiatique et politique. Elle est formulée précisément par des entrepreneurs identitaires, c’est-à-dire des entrepreneurs de morale qui défendent ce qu’ils estiment être « l’identité » de leur propre groupe d’appartenance en menant une croisade identitaire contre le groupe supposé les menacer. Chez ces personnes, les intérêts idéologiques et matériels se combinent. Ainsi, pour reprendre notre exemple initial, tel maire d’une petite ville balnéaire peut être amené à faire passer un arrêté anti-burkini parce qu’il est convaincu du danger islamiste, mais aussi pour s’adjoindre le vote de la partie islamophobe de la population locale.
Paniques identitaires et nouveaux régimes de vérité
Mais, se demandera-t-on, pourquoi les paniques identitaires apparaissent-elles de manière si importante depuis les années 2000 ? Nous supposons que plusieurs éléments contextuels ont favorisé leur émergence et leur multiplication. Tout d’abord, il est patent que depuis les années 1970, la question sociale s’est effacée au profit de la question culturelle. Par ailleurs, lors de la décennie suivante, nous sommes entrés dans une ère de « post-idéologies », après l’effondrement des grands récits sur lesquels se fondaient les idéologies du 20e siècle, organisées notamment autour de l’affrontement structurel entre communisme et fascisme. Ce changement est consommé sur le plan symbolique après la Chute du Mur de Berlin (1989), qui discrédite le marxisme et les utopies révolutionnaires[10]. Dès lors, la base sociale des partis politiques a en grande partie disparu, et tous les partis produisent désormais des éléments de langage fabriqués par des « communicants ». Si l’on ajoute à cela le fait que de plus en plus de personnes se méfient des médias traditionnels et s’informent uniquement sur les réseaux sociaux (où les informations erronées et les sources peu vérifiables abondent), nous serions entrés dans un régime de « post-vérité », où la notion de vérité est discréditée : les faits n’ont plus d’importance, les idéologies sont mouvantes, seule compte l’émotion et le « ressenti » des individus. Les théories du complot se propagent dans ce nouveau contexte comme un virus (celles d’Alain Soral par exemple, qui justement est un entrepreneur identitaire), de même que le style populiste, non limité aux dirigeants d’extrême droite[11]. L’autre conséquence de la disparition des « faits bruts » et des idéologies est que les paniques identitaires sont favorisées et se multiplient. Elles prennent leur source dans l’angoisse réelle des populations précarisées par les crises économiques à répétition, le chômage, la pauvreté et le déclassement. Elles désignent un ennemi imaginaire, et sont utilisées par des politiques ou des personnages médiatiques qui se proposent de canaliser la peur suscitée par un groupe bouc émissaire (les musulmans, les Rroms), en fédérant les individus autour d’une appartenance identitaire figée, fermée, pure et fantasmatique (par exemple, la nation, vue comme ethniquement et culturellement homogène) et éventuellement d’un chef providentiel qui incarne le peuple et parle en son nom – ce dernier point étant commun avec la logique des vieux fascismes et systèmes autoritaires du XXe siècle. Il nous semble fondamental d’étudier en détail la mécanique et les éléments les plus saillants de ces paniques identitaires. En effet, celles-ci, tout comme l’essor du style populiste chez les politiques et celui des nouvelles extrêmes droites en Europe contribuent à l’érosion de la démocratie, et touchent la sphère publique dans son ensemble, c’est-à-dire autant la rue et le café du commerce que la sphère médiatique ou politique.
Paniques identitaires et nouvelles figures de l’altérité
Mais pour analyser la spécificité des paniques identitaires qui affectent aujourd’hui la France, et notamment le fait qu’elles ciblent une populations spécifique, les musulmans (voire les musulmanes), il est nécessaire de s’inscrire dans l’histoire longue des figures françaises de l’altérité. Ce qui revient à rappeler, qu’à côté de l’histoire des formes de racisme exercées sur différentes communautés (Juifs, Italiens, Polonais, Espagnols, Portugais, Maghrébins, Africains subsahariens…), un ensemble d’images stéréotypées s’est constitué dans l’espace public, sur lesquelles, à différentes périodes, vient s’appuyer le discours nationaliste. Ainsi, dans les dernières décennies du 19e siècle, la menace supposée sur laquelle se fonde le nationalisme est « le Juif ». La publication de La France juive (1886) d’Edouard Drumont, et son succès médiatique grâce à l’appui d’écrivains comme Alphonse Daudet et de quotidiens comme Le Figaro, constituent le point de départ de l’antisémitisme moderne en France[12]. Dans la presse catholique et nationaliste, le Juif est décrit comme un étranger cosmopolite et malfaisant, ou encore un espion prussien infiltré au cœur de l’Etat, au lendemain de la défaite de la guerre franco-allemande de 1870. Or, en diffusant de telles idées, Drumont fabrique l’opinion. Il occulte lui-même complètement le fait que les professionnels du discours public (les éditorialistes et les patrons des grands journaux parisiens) « s’accordent à penser qu’il existe un problème juif »[13] et utilisent les moyens dont ils disposent pour imposer cette idée dans l’espace public. Ainsi défini, ce nouvel antisémitisme va désormais imprégner le discours nationaliste de droite, et cristalliser au moment de l’Affaire Dreyfus. Avec l’essor du nazisme, des idéologues de l’entre-deux-guerres verront le Juif comme un corps étranger à la nation, sur les plan religieux et ethnique.
Après la Seconde Guerre mondiale et les génocides commis par les nazis et tout particulièrement celui des Juifs, un tel discours racial et antisémite n’est plus acceptable dans l’espace public et l’extrême droite est marginalisée. Les figures de l’ennemi fabriquées par le discours nationaliste se doivent de changer. En France, avec les décolonisations et l’indépendance de l’Algérie, et avec l’arrivée massive de travailleurs maghrébins célibataires, l’extrême droite va renaître en reconfigurant son discours raciste autour d’un nouvel ennemi prototypique et chimérique : l’homme arabe, voire spécifiquement l’ « homme algérien », perçu comme un envahisseur et une menace sexuelle. Jusqu’ici, l’ennemi, le Juif, était vu comme un ennemi « de l’intérieur », un représentant de l’ « anti-France » (pour parler comme Charles Maurras) niché à l’intérieur même de la machinerie étatique. Désormais, l’extrême-droite cible l’homme arabe, vu comme un élément étranger à la nation et incapable de s’assimiler, à cause de ses différences raciales ou culturelles. Ce rejet s’accompagne de peurs et de représentations sexualisées – l’homme arabe étant systématiquement décrit dans la culture populaire comme un « dégénéré hypersexué »[14]. Pour l’historien Todd Shepard, après 1968, les violences sexuelles sont présentés comme des attributs « naturels » des hommes arabes. Ce cliché envahit la sphère publique et se retrouve dans la presse régionale de l’époque, comme en témoignent les nombreuses accusations infondées de viols qu’on y trouve[15]. En cause : la « misère sexuelle » de l’homme immigré algérien, comme le souligne un rapport secret au Premier ministre Jacques Chirac (1976), qui précise : « l’immigré joue le rôle d’un support de projection de la peur, mais également des désirs »[16].
A partir des années 1990, les figures de l’altérité ont évolué. Aujourd’hui, l’antisémitisme renaît de ses cendres avec une série de massacres visant directement les Juifs. Mais, par ailleurs, l’extrême droite se reconfigure sur un nouveau socle idéologique : la haine du musulman. En France, la figure stéréotypique publique de l’Autre menaçant la nation n’est désormais plus le Juif, ni l’Algérien révolutionnaire, mais éventuellement le jeune à capuche ou le barbu islamiste (tous les deux potentiellement djihadistes). Surtout, une autre figure occupe désormais toute la place médiatique, celle de la femme musulmane. Pourquoi ? Jusqu’à ces dernières années, la femme musulmane était vue comme la bonne élève de la colonisation et de l’intégration, celle qu’on allait émanciper et qui se montrerait reconnaissante et méritante. Or, une opinion communément partagée dans l’espace public suppose désormais que les filles musulmanes ont trahi le processus assimilateur et les espoirs fondés sur elle, en portant le voile, voire en partant au Jihad ou en soutenant l’islamisme. Il faut dire que l’époque est au retour indéniable de formes d’islam littéralistes, et d’une visibilité plus grande des pratiques de l’islam, voire d’une affirmation identitaire musulmane (y compris sous les espèces d’un féminisme musulman).
En conséquence c’est désormais la femme voilée, depuis la première affaire du foulard à Créteil en 1989 jusqu’à la récente panique du burkini, qui est vue comme une menace pour la nation et l’ordre public, mettant en danger la laïcité selon ceux qui en ont une conception rigide voire intégriste. La femme musulmane serait aliénée à la fois par son appartenance à l’islam (souvent assimilé sans ambages à l’islamisme) et par sa soumission aux hommes musulmans, qui l’enfermeraient de force dans son habit et dans son appartement (dans une assimilation tout aussi hâtive du foulard ou du bandana, du hidjab, du jilbab, du niqab, du tchador et de la burqa…). Dans cette vision misérabiliste ou haineuse de la femme musulmane, on peut voir un retournement de sa figure orientaliste exotisée aux siècles précédents. Au 19e siècle, les écrivains développaient le stéréotype de la femme musulmane, attirante et oisive : songeons au Salammbô de Flaubert. Ces clichés étaient à l’œuvre également chez les peintres orientalistes, dans leurs représentations du harem (Intérieur de harem égyptien, d’Eugène Girard), du hammam, ou encore du bain (Le Bain turc d’Ingres). L’idée s’imposait, dans une imagerie occidentale, que, comme l’exprime Ali Wijdan, « les femmes orientales [sont] des objets sexuels, mauvais, débridés et débauchés, ayant pour seul but dans la vie de séduire et de satisfaire les désirs illicites des mâles orientaux, puis des mâles européens en voyage : chaque femme musulmane devait être une espèce de séductrice »[17]. Mais, après la séduction paisible de la « beurette » ou de la femme comme bonne candidate à l’intégration, aujourd’hui, un tel stéréotype se retourne en son contraire : la femme musulmane n’est plus vue comme encline à exprimer ses désirs, ni apte à s’assimiler, elle est désormais perçue comme une victime contrôlée et dominée, entravée dans son désir par les fanatiques religieux ; de ce fait, d’objet de désir auparavant, elle devient objet de rejet aux yeux de l’islamophobe, alors que l’homme musulman figure, plus que jamais, tout à la fois le fanatique puritain et l’agresseur sexuel menaçant.
Les paniques identitaires masquent la violence des rapports de classe, de genre et de « race »
Les paniques identitaires ne seraient donc qu’affaire d’idéologies ? On nous rétorquera sans doute que les identités existent, qu’il n’est qu’à palper les angoisses qui se révèlent dans le succès électoral croissant du Front National ; et qu’il faut être bien aveugle pour ne pas mesurer à quel point l’« insécurité culturelle » est devenue l’alpha et l’omega de l’engagement politique. C’est pour le moins la thèse d’une fraction de la gauche auto-proclamée « républicaine » et de ses porte-paroles intellectuels dont Laurent Bouvet est devenu la figure de proue à coups de tribunes continues dans le Figaro Vox. On nous renverra donc à notre aveuglement, notre « bien-pensance » nourrie par notre armature antiraciste, une cause que d’aucun.e.s affirment comme désormais désuètes, ou pire, détournées à des fins de cautionnement d’une dangereuse idéologie « multiculturaliste », voire de racisme… anti-blanc[18]. Comment en est-on arrivé à ce paroxysme de la confusion aboutissant à considérer chez certain.e.s qu’un combat pour une cause juste ne soit que le cache sexe de la promotion d’une idéologie différentialiste et antirépublicaine ? C’est ce processus que cet ouvrage s’apprête à détricoter quelque peu. Les identités existent et leur analyse est nécessaire, mais nous nous inquiétons lorsqu’elles se referment sur elles-mêmes, à travers l’idéologie « identitariste » (défendant une identité pure, figée et mythologique) ou via les paniques identitaires. D’ailleurs la récurrence de ces dernières mérite une véritable historicisation et scintigraphie. Certes il existe déjà de nombreux travaux sur le thème de l’identité devenu l’un des objets d’investigation privilégiés des sciences sociales[19], mais cet opus a pour vocation de fournir des outils intellectuels directement transposables dans l’engagement – qui nous semble urgent – contre le discrédit de justes causes et contre la banalisation des rhétoriques et pratiques du pouvoir autoritaires dont le contexte récent des dramatiques attentats terroristes semble masquer le danger pour la démocratie. Nous revenons donc aux sciences sociales et à leur potentiel de déminage des lieux communs, d’éclairage du réel et de légitimation de la critique. C’est à cette fin que nous avons convoqué des auteur.e.s tou.te.s convaincu.e.s de l’articulation nécessaire entre le travail scientifique et la fonction sociale des chercheurs/ses, tou.te.s animé.e.s par le souci de l’intérêt général, lequel ne peut passer par le soutien de pratiques discriminatoires et autoritaires.
Les articles de cet ouvrage s’attachent donc à « vendre la mèche » en dévoilant ce qui se joue en coulisses de ces paniques identitaires : le racisme (soit le système supposant l’inégalité naturelle des « races » humaines) et les discriminations de genre. Rappelons qu’on entend par « genre » la construction sociale des identités sexuées[20], et par « race » non une réalité biologique, mais un ensemble de constructions sociales et historiques qui a des effets réels sur le vécu des individus (en termes d’exclusions, de discrimination, de racisme) – alors qu’aujourd’hui, les critères de définition de la race, tout comme le racisme, se sont déplacés depuis le plan biologique vers le plan culturel et religieux[21]. L’articulation entre race et genre est visible dans les débats publics récurrents concernant les femmes voilées (stigmatisées parce que femmes, maghrébines, musulmanes) et la place de l’islam dans la société (décrit comme une religion nécessairement rétrograde, avilissant les femmes voire incompatible avec les « valeurs républicaines » et menant systématiquement à l’intégrisme et au terrorisme). Ces questions convoquent immanquablement les problématiques de l’immigration et de l’intégration républicaine, devenues quasi obsessionnelles dans l’espace politique et médiatique depuis plus de trente années désormais. Ainsi Sylvain Laurens a-t-il montré dans ses travaux la construction du « problème immigré » dans la haute administration à la fin des années 1970[22]. Amplifié par le contexte de crise économique, par la médiatisation galopante des « échauffourées » dans les banlieues et des mobilisations contre le racisme (la marche de 1983), par les premiers attentats islamistes des années 1980, le processus s’est poursuivi ; il s’est chargé d’une dimension confessionnelle et genrée avec les affaires dites « du voile » (1989, 1994, 2003) et s’est aggravé au point de provoquer d’incessants débats autour des immigrés et de leurs descendants. Le flou sémantique désignant ces populations discriminées n’en est devenu que plus important : « immigrés », « musulmans », « maghrébins », « Africains », parfois généreusement dotés de l’expression « d’origine » qui suffit à fossiliser leur statut d’exogènes. Depuis, le simple principe de nationalité s’efface devant les explications culturalistes aux fondements anthropologiques scabreux faisant de ces populations des êtres assignés à résidence identitaire. Les choses n’étant jamais si simples, la question identitaire est également brandie par les minorités en guise de demande de reconnaissance comme l’avait déjà analysé Axel Honneth[23]. Ces demandes s’inscrivent dans une politique de lutte contre les discriminations, elles aussi amplement démontrées par des travaux scientifiques : aux guichets, à l’école, à l’emploi, au logement, au faciès… Elles recoupent désormais des enjeux mémoriels autour d’un passé colonial qui peine à s’imposer dans le récit national-républicain. C’est pourquoi les mémoires des traites, de l’esclavage, ou de la guerre d’Algérie irriguent aussi les paniques identitaires : que ne découvrirait-on pas des turpitudes républicaines en ouvrant le vase de Pandore… A la vérité historique, d’aucun.e.s préfèrent le maintien d’une mythologie nationale au service du patriotisme, d’autres voient dans le passé colonial l’unique matrice des discriminations qu’ils subissent au présent. Sur ces enjeux aussi, le contexte est saturé d’affects et peu propice à l’intelligence de la complexité que révèle toute approche objective de l’histoire et des faits sociaux. Les questions identitaires servent des causes et des desseins politiques qu’il nous faut mettre à jour, mais que les emballements inhérents aux paniques rendent parfois opaques.
Identité : un concept délicat à manier
Précisons enfin que l’usage du mot identité est délicat et prête à de multiples confusions et usages idéologiques. C’est pourquoi nous proposons de distinguer trois problèmes concernant ces usages. Tout d’abord, les dominés revendiquent une identité parce qu’ils sont dominés, stigmatisés, victimes du racisme, et c’est ce qui les distingue des groupuscules d’extrême droite, qui ont certes le droit de se définir comme ils veulent (tant qu’ils respectent autrui) mais ne sont pas discriminés parce que Blancs ou chrétiens. Par ailleurs, les membres de la majorité (notamment, si on prend un extrême, les « cumulards » : vieux hommes blancs, hétérosexuels, chrétiens), aveuglés par la « color blindness », refusent d’admettre que la domination ne se réduit pas à des rapports de classe sociale. Or, si une personne est noire ou arabe, et musulmane, et femme, et homosexuelle, et pauvre (pour prendre un autre extrême), celle-ci a toutes les chances de subir un nombre plus important de discriminations que si elle était un homme blanc, chrétien, hétérosexuel et pauvre, par exemple. Il ne s’agit pas pour autant de « calculer » un quelconque degré de discrimination, ce qui nous ferait entrer dans un régime de « concurrence des victimes » dangereux, mais de prendre la mesure de ce cumul possible des discriminations. Enfin, pour compliquer le débat, il faut prendre en compte la parole des dominé(e)s, sans pour autant considérer que cette parole est nécessairement la Vérité. Mais quand certaines personnes veulent décider de l’aliénation d’autrui au lieu de laisser les dominé.e.s s’exprimer, cela devient problématique. Contrairement aux propos de Caroline Fourest ou d’Elisabeth Badinter, les femmes voilées lambda ont bien le droit de s’habiller comme elles veulent sans que cela fasse d’elle systématiquement des aliénées (et ce, même s’il existe une minorité d’intégristes et un petit nombre de femmes portant la burqa, par exemple, où la religion devient aliénante, comme cela existe aussi chez les catholiques ou juifs intégristes, mais c’est un autre problème, que nous ne traiterons pas ici).
Choix des textes
En raison de la difficulté à manier le terme d’identité, nous avons choisi de consacrer un chapitre à l’histoire de ce concept dans les sciences humaines et sociales, et sur ces possibilités d’usage dans la France d’aujourd’hui (texte de R. Meyran). Nous avons ensuite sélectionné un ensemble de thèmes affectionnés par les entrepreneurs identitaires, qui dévoilent chacun à leur tour un des éléments de la nouvelle mythologie sur laquelle s’appuient les paniques identitaires. Ainsi Mai 68 est-il présenté comme une révolte individualiste et libérale-libertaire qui aurait sonné le glas de la hiérarchie, de la tradition voire de la nation, pour les nouveaux réactionnaires, qu’ils soient politiques ou intellectuels, comme Marcel Gauchet (texte de Ludivine Bantigny). L’enseignement de l’histoire est également au cœur des paniques identitaires : pour les entrepreneurs identitaires, il y aurait nécessité de réintroduire le roman national et l’amour de la patrie, alors que les thématiques de l’islam et de l’enseignement du passé colonial présenteraient un risque de dénaturation du récit national intégrateur au profit d’une vision « repentante » (texte de Laurence De Cock). Le « communautarisme », mot-valise et mot-écran à la mode chez les entrepreneurs identitaires, contient l’idée que les identités menacent le « vivre ensemble » et la République : l’histoire de ce concept récent, né dans la sphère publique avec l’affaire Kelkal en 1993, est retracée. Puisque le communautarisme dans les quartiers défavorisés mènerait directement au terrorisme, il constitue une nouvelle « guerre des races », qui sert à justifier l’état d’urgence (texte de Fabrice Dhume). L’ « insécurité culturelle », soit la peur que leur culture disparaisse, que ressentiraient les « petits Blancs » français face à la mondialisation et aux musulmans trop présents dans les quartiers populaires expliquerait, selon certains entrepreneurs identitaires, leur vote pour le Front national : cette thèse très problématique est celle du géographe Christophe Guilluy (texte de Cécile Gintrac), reprise par le politologue Laurent Bouvet (texte de Klaus-Gerd Giesen). Les théories sociologiques du genre enseignées à l’école, la loi dite du « mariage pour tous », sont diabolisées par des groupes d’extrême droite (notamment des catholiques traditionalistes) qui voient en elles une menace sur l’identité nationale et la civilisation. La laïcité et le féminisme sont également réquisitionnés et détournés pour servir d’armes idéologiques contre la menace musulmane, par le Printemps républicain notamment (texte de Fanny Gallot). Le nouveau discours sécuritaire et xénophobe se justifie par la nécessité de lutter contre un prétendu « laxisme » des juges et par la présence d’un ennemi à combattre : le Musulman-terroriste, être prototypique réalisant la fusion de la menace extérieure et de l’ennemi de l’intérieur. (texte de Laurent Mucchielli). La médiatisation récente du terme de diversité, depuis les ministres dits « issus de la diversité » jusqu’au business de la diversité, essentialise les différences et occulte la réalité des discriminations vécues par les minorités : elle est donc une réponse inadéquate aux paniques identitaires. Enfin, ce livre se clôt sur une analyse de cas, le fameux Nouvel an tragique de Cologne. Il s’agit d’un cas-limite. Les agressions sexuelles de Frankfurt du Nouvel an 2017 relevaient bel et bien de la panique identitaire : quatre personnes travaillant dans un restaurant témoignèrent de l’irruption dans les rues de la ville d’un groupe de 50 hommes arabes ivres qui auraient commis de multiples agressions sexuelles – témoignages aussitôt relayés dans les grands médias allemands, notamment le quotidien Bild. Or, les témoignages étaient faux et l’affaire, qui a fait grand bruit, a été complètement inventée – un des témoins, par ailleurs, défendait des opinions xénophobes et était sympathisant du parti nationaliste AfD (Alternative pour l’Allemagne). Le cas des événements du Nouvel an à Cologne en 2016, est différent : des agressions sexuelles et des vols ont été commis en masse, plus de 1000 plaintes (dont 500 pour agression sexuelle) ont été enregistrées, mais finalement une seule personne a été condamnée. Cette affaire reste mystérieuse, dans la mesure où les responsables de ces violences et agressions réelles courent toujours, alors que par ailleurs les médias allemands et du monde entier ont affirmé dès le départ qu’elles étaient le fait de migrants, pour rétropédaler ensuite et affirmer qu’elles venaient de personnes d’origine maghrébine non migrantes. Dans ce contexte tendu, l’écrivain algérien Kamel Daoud a publié une tribune où il mettait en cause la « culture du viol » caractéristique selon lui des musulmans. Il lui a alors été reproché, au nom de la critique de l’islamisme, de retomber dans les stéréotypes orientalistes les plus éculés. Retour sur cette affaire, qui sans relever complètement de la panique identitaire, en porte pour autant certains traits (texte de Jocelyne Dakhlia).
Notes
[1] « Corse : 4 blessés dans une rixe entre communautés, un appael au calme », Le Parisien, 13 août 2016.
[2] Vincent Manilève, « Comment une rixe de plage est devenue ‘l’affaire du burkini de Sisco’ », Slate, 18 août 2016.
[3] Stanley Cohen, Folk devils and moral panics, London, Mac Gibbon and Kee, 1972
[4] « Mods » : abr. de « modernist », désigne les jeunes Anglais de bonne famille, représentant une sous-culture urbaine opposée et s’affrontant aux « rockers », autre sous-culture d’origine plus populaire.
[5] Entrepreneur de morale : personne qui mène une croisade morale (un combat moral contre un groupe supposé menacer la nation et ses valeurs), à des fins idéologiques mais aussi de carrière personnelle.
[6] Essentialiste : le groupe est défini comme une essence, il est ontologiquement séparé des autres groupes. Culturaliste : les comportements des membres de ce groupe sont définis complètement et exclusivement par le biais de la culture ou la sous-culture inhérente à ce groupe.
[7] Lilian Mathieu, « L’ambiguïté sociale des paniques morales », Sens-Dessous, n°15, 2015.
[8] Joseph Gusfield, La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Economica, 2009 [1981]
[9] Erich Goode & Nachman Ben-Yehuda, Moral panics : culture, politics and social construction, Annual Review of Sociology, Vol. 20 (1994), pp. 149-171.
[10] Enzo Traverso, Où sont passés les intellectuels ?, conversations avec Régis Meyran, Ed. Textuel, 2013.
[11] De ce point de vue, l’investiture du président Donald Trump (janvier 2017) a été exemplaire de la force de ce nouveau régime de post-vérité. Selon les médias américains, très peu de personnes étaient présentes dans les rues lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump. Pourtant, le porte-parole de la Maison blanche a affirmé que s’y trouvait « la plus grande foule jamais vue lors d’une investiture ». Une conseillère de Donald Trump a enfoncé le clou : selon elle, le porte-parole n’a pas menti, il a simplement donné de « faits alternatifs »…
[12] Gérard Noiriel, Immigration racisme et antisémitisme en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Fayard, 2007, p. 208.
[13] Noiriel, op. cit., p. 229.
[14] Edward W. Saïd, L’Orientalisme, Le Seuil, 1994 [ed. originale : 1978], p. 320.
[15] Pour l’année 1978, l’analyse de 5 grands journaux régionaux montre que les hommes immigrés (en particulier Algériens) étaient présentés comme responsables de 38% des agressions sexuelles ; or Shepard note que ce chiffre représente plus de deux fois celui des immigrés emprisonnés pour crimes sexuels et, en outre, qu’il est démenti par les rapports de police de l’époque – selon ces rapports, la proportion des crimes sexuels chez les jeunes hommes algériens est la même que celle des jeunes Français nationaux. Todd Shepard, Mâle décolonisation. L’ « homme arabe » et la France, de l’indépendance et à la révolution iranienne, Paris, Payot & Rivages, 2017, pp. 264-265.
[16] Todd Shepard, op. cit., 277
[17] Ali Wijdan, « Les femmes musulmanes : entre cliché et réalité », Diogène, 3/2002 (n°199), p. 92-105.
[18] Laurent Bouvet, http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/13/31003-20170113ARTFIG00340-decoloniser-la-philosophie-betise-et-totalitarisme-de-la-pensee-ont-encore-frappe.php
[19] Citons ici le dernier ouvrage Roger Martelli, L’identité, c’est la guerre, Les liens qui libèrent, 2016. Les lecteurs trouveront d’autres références au fil des articles de cet ouvrage
[20] Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas une unique « théorie du genre », et rares sont celles qui n’acceptent pas la réalité biologique du sexe. Nous considérons quant à nous que l’individu sexué est le résultat d’un emboîtement en poupées russes faisant intervenir à différents niveaux le biologique et le social. Cf. Anne Fausto-Sterling, Corps en tous genres, La dualité des sexes à l’épreuve de la science, La Découverte, 2012.
[21] Didier Fassin & Eric Fassin (dir), De la question sociale à la question raciale ? représenter la société française, La Découverte, 2006 ; Régis Meyran (avec V. Rasplus), Les Pièges de l’identité culturelle, Berg International, 2012.
[22] Sylvain Laurens, Une politisation feutrée, les hauts fonctionnaires et l’immigration en France, Belin, 2009.
[23] Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Folio histoire, 2013.









