
Contre le particularisme des dominants, pour l’universalité insurgée
Dans son livre Le Malentendu. Race, classe et identité, Asad Haider propose une critique des politiques de l’identité et avance des perspectives pour penser un antiracisme politique et radical. Avec l’aimable autorisation des éditions Amsterdam, nous mettons à disposition un extrait du chapitre 6, où il discute le problème de l’universalisme, réfutant la fausse alternative entre un universalisme d’en haut, uniformisant et paternaliste d’un côté, et un particularisme de l’identité qui enferme les subalternes dans un statut de victime. Se réclamant de l’héritage de la Révolution haïtienne et de la Déclaration des droits de l’homme de 1793, il défend ainsi la piste de l’universalité insurgée, partant des combats singuliers mais visant la libération de tou-tes.
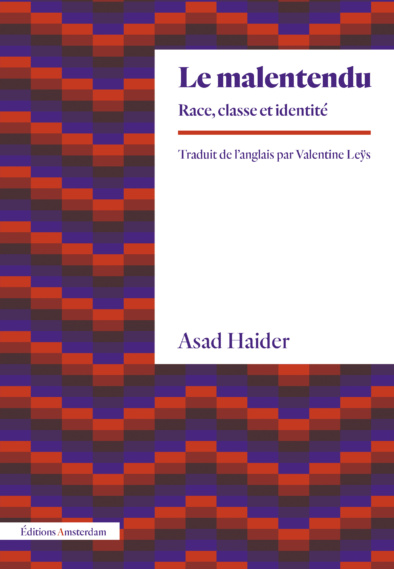
Chapitre 6 – L’universalité
Au moment où Ronald Reagan inaugurait l’ère néolibérale, mes parents ont émigré aux États–Unis depuis Karachi, au Pakistan. Espérant poursuivre leurs carrières universitaires dans un climat de liberté intellectuelle et d’abondance matérielle, ils se sont établis en plein cœur de la Pennsylvanie rurale, où l’on ne trouvait pas de mangues dans les supermarchés.
En janvier 2017, alors que je me trouvais au milieu d’une foule de manifestants à l’aéroport international de San Francisco, j’ai imaginé leur arrivée. Comme c’est souvent le cas dans les aéroports, il y avait là des gens de nationalités, d’âges et de dispositions variées. Mais au lieu de la fatigue et de -l’anxiété habituelles, la foule vibrait d’énergie et de colère. Venus pour protester contre l’interdiction -d’entrée des musulmans sur le territoire américain que Donald Trump venait de prononcer dès les premières semaines de son mandat, les manifestants scandaient : « Bienvenue à tous les réfugiés ! » Ils étaient tellement nombreux qu’ils avaient réussi à bloquer tous les vols au départ. En voyant un jeune garçon qui s’était confectionné une pancarte où était inscrit « Fils de réfugié », j’ai songé au rôle déterminant qu’a joué pour moi l’avion qui a transporté mes parents jusqu’à ce pays. Ce moment m’a rappelé tout ce que cette loi menaçait de détruire – non seulement des familles, mais aussi les vies et les rêves de tous ceux qui avaient traversé l’océan en quête d’une vie nouvelle.
Les désirs qui poussent les migrants à partir peuvent être divers, mais ils ont tous en commun ce que Sandro Mezzadra appelle « le droit de s’échapper[1] » : le droit de fuir la pauvreté et les persécutions, de découvrir de nouveaux espaces et de parler de nouvelles langues. Le migrant désire un monde sans frontières, un monde sans prisons, un monde dans lequel les humains peuvent se déplacer librement et où les étrangers sont accueillis. Il désire que soit reconnue la possibilité de penser, de parler et de vivre autrement.
C’est peut-être justement ce qui explique que le migrant pose un problème central pour la pensée politique – non pas celui qui a été échafaudé par Trump et ses complices, mais un problème aussi vieux que l’État-nation lui-même. La contradiction fondamentale de l’État-nation, comme l’a souligné Étienne Balibar, réside dans la confrontation et l’interaction entre deux manières de définir le « peuple ». Premièrement, l’ethnos, ou « le “peuple” comme communauté imaginaire d’appartenance et de filiation » ; et deuxièmement, le demos, ou « le “peuple” comme sujet collectif de la représentation, de la décision et des droits ».
Le premier sens du mot « peuple » internalise la frontière nationale : il est le mur que Trump cherche à ériger dans nos esprits. Il désigne un sentiment d’appartenance à une « ethnicité fictive », à une communauté imaginaire définie par les frontières nationales mais composée en réalité d’un agrégat de populations hétérogènes rassemblées par les migrations et les déplacements – pluralité éliminée par le fantasme d’une essence raciale et spirituelle unique.
Le second sens est le sens politique, celui que semble exprimer notre Déclaration des droits. Il est supposé s’appliquer indépendamment de l’identité : il est le chant de la statue de la Liberté qui offre ses libertés aux masses exténuées qui, « en rangs serrés, aspirent à vivre libres », indifféremment de leurs particularités.
C’est dans la contradiction entre ces deux sens que réside le péché originel de l’État-nation américain. Cette contradiction apparaît dès la première phrase de son tout premier document officiel, une constitution rédigée par des propriétaires d’esclaves dont le préambule s’ouvre par les mots « We, the People » (« Nous, le Peuple »). Comme l’écrit Balibar :
[C’]est aussi cette construction qui associe étroitement l’universalité démocratique des droits du citoyen […] avec l’appartenance nationale particulière. C’est pourquoi la constitution démocratique du peuple dans la forme de la nation a eu inévitablement pour conséquence des systèmes d’exclusion : le clivage entre les « majorités » et les « minorités », et plus profondément encore le clivage entre les populations considérées comme autochtones et les populations considérées comme étrangères, hétérogènes, qui sont racialement ou culturellement stigmatisées[2].
Cette contradiction démocratique fait clairement surface au moment de la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En 1843, le jeune Karl Marx soumet cette déclaration à un examen critique. Dans Sur la Question juive, l’auteur répond avant tout à la critique énoncée par Bruno Bauer des revendications d’émancipation des Juifs. Selon cet auteur, toute identité, religieuse ou autre, est nécessairement excluante, et donc incompatible avec l’émancipation universelle. Réclamer l’émancipation pour l’identité juive en particulier, suggère Bauer, ne fait que reproduire l’exclusion qui a été pratiquée jusqu’à l’extrême par l’État chrétien : l’émancipation politique doit être universelle, et implique à ce titre une forme de désidentification[3].
Cependant, Marx remarque que l’émancipation politique laïque, la séparation de l’Église et de l’État au nom des droits universels, n’a pas permis dans la pratique de se défaire de la superstition religieuse. Dans des pages prophétiques restées célèbres, il cite l’exemple des États-Unis. Dans ce pays, observe Marx, les droits sont conférés à des individus : ils sont les droits de « l’homme égoïste séparé de ses congénères et de la chose publique[4] ». En protégeant les droits de l’individu dans la sphère politique, on ne met pas fin à l’oppression des autorités religieuses et des possédants. Pour cette raison, l’universalisme abstrait et aristocratique de Bauer ne peut, pas plus que le particularisme d’une minorité, conduire à une réelle émancipation de l’humanité. Pour vaincre l’exploitation du marché, il est nécessaire d’aller au-delà de l’émancipation politique.
Dans son essai consacré à la pertinence de la pensée marxienne pour analyser les politiques de l’identité contemporaines, Wendy Brown résume ainsi le raisonnement complexe de cet auteur :
Historiquement, les droits ont émergé dans la modernité à la fois comme un véhicule d’émancipation à l’égard de la privation de droits politiques ou de la servitude institutionnalisée, et comme un moyen de privilégier une classe bourgeoise émergente à l’intérieur d’un discours d’égalitarisme formel et de citoyenneté universelle. Ainsi émergèrent–ils à la fois comme un moyen de protection contre l’us et l’abus arbitraire par le souverain et le pouvoir social, et comme une manière d’assurer et de naturaliser des puissances sociales dominantes[5].
Cette situation implique pour le libéralisme un « paradoxe » qui subsiste à ce jour. Quand les droits sont accordés à des individus « vides » et abstraits, ils ne prennent pas en compte les inégalités et les oppressions sociales réelles, considérées comme extérieures à la sphère politique. Cependant, souligne Brown, quand les particularités des identités blessées sont intégrées au contenu des droits, ceux–ci sont « plus susceptibles de devenir des sites de la production et de la régulation de l’identité comme lésion, que d’être les véhicules de l’émancipation[6] ». Autrement dit, quand le langage libéral des droits est utilisé pour défendre un groupe identitaire particulier contre des attaques physiques ou verbales, ce groupe finit par être défini à partir de son statut de victime, et les individus se trouvent réduits à leur appartenance victimaire.
Brown montre que cette logique fragilise par exemple la pensée à l’origine d’un courant féministe majeur, bien que controversé : la tentative de Catherine MacKinnon de rectifier le biais masculiniste de la loi. Le féminisme antipornographie de MacKinnon part de l’idée que la liberté d’expression entre en conflit avec les droits des femmes à vivre libres de toute subordination sexuelle. Cependant, demande Brown, « la définition de la condition des femmes comme subordination sexuelle et l’encodage de cette définition dans la loi travaillent-ils à libérer les femmes de la subordination sexuelle ou réinscrivent-ils paradoxalement la féminité en tant que violabilité sexuelle[7] ? »
Cette critique suggère que, lorsque des droits sont revendiqués par un groupe identitaire particulier et que l’horizon politique que l’on se donne se trouve restreint à la défense de cette catégorie, alors les membres de ce groupe se voient assignés le statut fixe de victimes. Les droits eux-mêmes se résument alors à une réponse à la blessure infligée à cette victime. Leur contenu émancipateur disparaît. C’est ainsi qu’en présentant une argumentation juridique qui cherche à donner aux droits un contenu concret, attaché à des identités particulières, MacKinnon aboutit à produire une catégorie figée de « femme » qui les assigne à une identité donnée. Le discours juridique neutralise ainsi toute possibilité pour les femmes de s’organiser contre l’oppression sexuelle, en recourant à un type d’organisation qui passe par l’action de masse autonome.
C’est exactement le même problème qui se trouve projeté sur le devant de la scène dans le débat contemporain sur la « question musulmane ». En France, cette question a été débattue en 2004 lorsque le voile musulman a été interdit dans les écoles publiques. La question est alors devenue la suivante : le voile doit-il être défendu parce que les musulmans sont définis par le fait de le porter ? La liberté de la population immigrée de France se joue-t-elle dans le fait d’apporter une réponse défensive à la blessure infligée par l’interdiction du voile ? De toute évidence, le racisme qui sous-tend l’interdiction d’un accessoire vestimentaire musulman doit être condamné et combattu. Mais dès lors que cette opposition est présentée comme une défense des droits des musulmans, la position de gauche qui consiste à prôner la tolérance enferme les musulmans qu’elle prétend défendre dans une identité victimaire, plutôt que de se ranger à leurs côtés dans un projet d’émancipation collective.
Comme le souligne Alain Badiou dans L’Éthique, ce paradigme de la gauche qui associe les droits à la défense des victimes est un fondement de l’impérialisme et de la soi-disant « intervention humanitaire ». L’impérialisme proclame que sa mission civilisatrice, le « fardeau de l’homme blanc », vise à défendre l’intégrité physique d’un peuple. L’homme est ainsi réduit au statut d’animal et exclu de la politique ; parce qu’il est incapable d’agir politiquement par lui-même, il a besoin de la protection de l’État. « Qui ne sent, demande Badiou, que cette éthique penchée sur la misère du monde cache, derrière son Homme-victime, l’Homme-bon, l’Homme-blanc ? » Toute intervention menée « au nom de la civilisation exige un mépris premier de la situation tout entière, victimes comprises ».
Aujourd’hui, les discours pleins de suffisance sur la responsabilité morale et l’éthique de l’intervention militaire – qui s’expriment, remarque Badiou, « après des décennies de courageuses critiques du colonialisme et de l’impérialisme » – témoignent avant tout « d’une sordide autosatisfaction des “Occidentaux”, de la thèse martelée selon laquelle la misère du tiers–monde est le résultat de son impéritie, de sa propre inanité, bref : de sa sous–humanité[8]. »
Est-il possible de dépasser le paradigme libéral de la victimisation et le paradoxe des droits ? Nous disposons de solides bases historiques pour y parvenir si nous pensons ce paradoxe comme l’expression d’un antagonisme politique concret : c’est ce que fait Massimiliano Tomba lorsqu’il compare les deux versions de la Déclaration des droits de l’homme. La première Déclaration de 1789, note Tomba, ancre les droits dans un universalisme juridique : « un universalisme venu d’en haut, impliquant un sujet de droit qui est soit passif, soit une victime réclamant protection ». Qu’il s’agisse de protéger une femme contre les discours pornographiques ou un musulman contre les préjugés religieux, l’universalisme juridique ne prête à ces sujets aucune capacité d’agir – leur seule existence politique réside dans la protection que leur accorde l’État.
La Déclaration de 1793, elle, définit une universalité insurgée, propulsée sur la scène de l’Histoire par les révoltes d’esclaves de la Révolution haïtienne, par l’intervention des femmes dans le processus politique dont elles avaient été exclues et par les revendications par les sans-culottes d’un droit au pain et à la vie. Cette Déclaration « ne présuppose pas un porteur abstrait des droits », note Tomba, mais « fait référence à des individus particuliers et concrets – les femmes, les pauvres et les esclaves – et à leur agentivité politique et sociale ». Nous nous trouvons ici face à un nouveau paradoxe :
« L’action de ces individus particuliers et concrets dans leur situation spécifique a une portée plus universelle que ne pourrait l’avoir un universalisme juridique portant sur des sujets de droits abstraits[9]. »
En 1799, le leader révolutionnaire haïtien Toussaint Louverture reçut la demande de la France d’inscrire sur les drapeaux de son armée : « Braves Noirs, souvenez-vous que le peuple français seul reconnaît votre liberté et l’égalité de vos droits. » Il refusa, arguant que l’esclavage persistait dans les autres colonies françaises, et répondit dans une lettre à Bonaparte :
« Ce n’est pas une liberté de circonstance concédée à nous seuls que nous voulons ; c’est l’adoption du principe que tout homme né rouge, noir ou blanc, ne peut être la propriété de son semblable[10]. »
Nous pouvons aujourd’hui encore nous réclamer de l’héritage de cette universalité insurgée, qui ne nous définit pas comme des victimes passives mais comme les agents actifs d’une pensée politique qui réclame la liberté pour tous. C’est cela qui m’a paru le plus beau dans la foule des manifestants à l’aéroport de San Francisco : la détermination de tous ces gens, sans aucun enjeu personnel, à défendre les droits de chaque immigrant. Des personnes qui n’avaient rien à perdre sinon leur confort et leur sécurité étaient là, aux côtés des enfants de réfugiés, et ils criaient tout aussi fort qu’eux. Ils incarnaient ce que Badiou appelle la « maxime égalitaire, propre à toute politique d’émancipation[11] ». C’est une maxime qui réclame de manière inconditionnelle la liberté de ceux qui ne sont pas comme nous. Or, comme le sait tout immigrant, tout le monde est différent de nous – à commencer par nous-mêmes.
De nos jours, nous avons coutume d’utiliser un langage qui désigne les groupes considérés comme étrangers ou différents sous le terme d’« Autres » – un rapport dans lequel l’auteur voit un réductionnisme dégradant. Mais comme le souligne Badiou dans son Éthique, l’Autre est déjà partout, y compris en nous :
L’altérité infinie est tout simplement ce qu’il y a. N’importe quelle expérience est déploiement à l’infini de différences infinies. Même la prétendue expérience réflexive de moi-même est, non pas du tout l’intuition d’une unité, mais un labyrinthe de différenciations, et Rimbaud n’avait certes pas tort de déclarer : « Je est un autre ». Il y a autant de différence entre, disons, un paysan chinois et un jeune cadre norvégien qu’entre moi–même et n’importe qui – y compris moi–même[12].
Ce paradoxe apparent s’incarne dans une pancarte que brandissait un des manifestants à l’aéroport, et qui disait : « Les juifs avec les musulmans ». Ce slogan puisait dans ce que Judith Butler décrit comme « des ressources juives susceptibles d’être mobilisées pour une critique de la violence d’État, une critique de l’assujettissement colonial des populations, de l’expulsion et de la dépossession », ou encore « des valeurs juives de cohabitation avec le non–Juif, valeurs qui font partie de la substance éthique même de la judéité diasporique ». On peut trouver les fondements de ce soutien aux réfugiés musulmans dans une tradition éthique qui joue un rôle central dans l’histoire juive. Toutefois, poursuit Butler, formuler une critique du colonialisme israélien nécessite de rejeter « la valeur d’exception des ressources éthiques de la judéité ».
Il y a ici une ambivalence fondamentale. C’est dans « une tradition juive éminente défendant des formes de justice et d’égalité » que Butler ancre sa critique du sionisme. Cependant, sa démarche met en question l’idée de l’exceptionnalité d’une tradition quelle qu’elle soit. Pour critiquer le sionisme et affirmer l’importance de la justice et de l’égalité, il est nécessaire de dépasser toutes les formes d’exceptionnalisme : cette démarche « requiert de se départir de la judéité comme cadre exclusif pour penser à la fois l’éthique et la politique[13] ».
Pour ceux d’entre nous qui sont comme moi d’origine musulmane, il nous faut aussi revendiquer notre propre ambivalence. Nous pourrions commencer par nous souvenir du poète marxiste pakistanais Faiz Ahmad Faiz, qui a écrit son célèbre poème « Hum Dekhenge » (« On verra ») en 1979 pour protester contre la dictature islamique de Muhammad Zia–ul–Haq. Conformément à la tradition de la poésie de langue urdu, Faiz adopte le langage de l’Islam pour accuser Zia d’idolâtrie et livrer une prophétie révolutionnaire :
Quand résonnera le cri
« Je suis la Vérité »
La vérité que je suis
Et que tu es aussi
Alors règneront toutes les créatures de Dieu
Dont je suis
Et dont tu es aussi.
Tout en utilisant le langage de l’Islam, Faiz fait signe vers une politique qui dépasse l’exceptionnalisme, perspective rendue possible par ses convictions marxistes. Ce sont ces idées que nous mettons en pratique toutes les fois que nous agissons aux côtés des autres et conformément à la maxime égalitaire. Si je lutte pour ma propre libération, c’est précisément parce que je lutte pour celle de l’autre.
D’ailleurs, ceux que la pensée libérale réduit au statut de victimes passives ont toujours été des agents actifs dans le champ politique : ils sont la source même de l’universalité insurgée. Pour citer C. L. R. James : « Le combat des masses pour l’universalité ne date pas d’hier[14]. » Dans son livre précurseur, L’Atlantique noir, Paul Gilroy montre que les intellectuels radicaux noirs qui ont adopté l’héritage des Lumières tel que le préfigurait la Révolution haïtienne sont parvenus à élaborer une « contre–culture de la modernité ». Ce moment représente précisément un exemple de cette altérité fondatrice condensée dans le mot diaspora, qui fait le pont entre l’expérience juive et africaine. La diaspora, affirme Gilroy, va à l’encontre de « l’idée de nationalisme culturel et des conceptions surintégrées [overintegrated] de la culture » selon lesquelles « les différences ethniques, immuables, constituent un fossé infranchissable entre les histoires et les expériences des “Noirs” et des “Blancs” ». Cette notion nous force à affronter une réalité beaucoup plus difficile et complexe : « la créolisation, [le] métissage, [le] mestizaje et [l’]hybridité » qui, « du point de vue de l’absolutisme ethnique », ne sont qu’« une litanie de souillures et d’impuretés ». Cependant, comme le démontre Gilroy, un tel absolutisme ethnique occulte le riche patrimoine culturel né des « processus permanents de mutation culturelle et de (dis)continuité qui débordent le discours racial et échappent à ses agents[15] ». C’est ce même débordement des contours de l’identité qu’invoquait Demita Frazier à propos de la formulation pionnière d’une « politique de l’identité » par le Combahee River Collective :
Pour ce que j’en sais, nous n’avons jamais vraiment, si l’on s’en tient à la définition classique, réellement pratiqué ce que les gens appellent aujourd’hui la politique de l’identité. Parce que l’élément central, le point de focalisation n’était pas un aspect de notre identité, mais plutôt la totalité de ce que signifiait le fait d’être une femme noire dans la diaspora[16].
Cependant, souscrire à la contre–culture radicale de la modernité ne signifie pas adhérer sans réserve aux Lumières européennes. Gilroy dénonce la glorification de l’histoire intellectuelle européenne comme une manifestation de la « complaisance conservatrice » actuelle, qui idéalise le passé de l’Europe et « cherche discrètement à réhabiliter des universalismes naïfs et dépourvus de réflexivité, qu’ils soient libéraux, religieux ou ethnocentriques[17] ». Le projet d’une universalité insurgée n’a rien à attendre des prétendus marxistes qui se joignent à des commémorations du siècle des Lumières dépourvues de perspective historique et d’esprit critique, adoptant une position éculée et dépassée. Gilroy souligne que cette approche paresseuse « est à peine affectée par la longue histoire de barbarie qui joue un rôle si considérable dans l’écart grandissant entre l’expérience de la modernité et les attentes qu’elle a fait naître » :
Ils ne semblent ainsi pas voir, par exemple, que l’universalité et la rationalité de l’Europe et de l’Amérique éclairées ont été utilisées pour préserver et déplacer – plutôt que pour abolir – une hiérarchie des différences raciales héritée de l’ère prémoderne. La figure de Christophe Colomb n’apparaît pas chez eux pour compléter celles de Luther et de Copernic, qui servent implicitement à marquer les limites de cette compréhension particulière du moderne. Les intérêts coloniaux de Locke et l’effet de la conquête de l’Amérique sur Descartes et Rousseau ne sont tout simplement pas des questions qui se posent[18].
Une telle lecture de la modernité passe sous silence non seulement les crimes de l’Europe des Lumières, mais aussi la centralité de l’Atlantique noir :
Il n’est donc pas étonnant, dans ces conditions, que l’histoire de l’esclavage, si tant est qu’elle soit perçue comme pertinente, soit pour ainsi dire assignée aux Noirs. Au lieu de faire partie de l’héritage éthique et intellectuel de l’Occident dans son ensemble, l’esclavage devient ainsi la propriété exclusive des Noirs. Cette conception est à peine préférable à l’idée alternative, et tout aussi classique, selon laquelle l’esclavage dans les plantations n’est qu’un résidu prémoderne appelé à disparaître une fois révélée son incompatibilité fondamentale avec la rationalité des Lumières et la production industrielle capitaliste[19].
Nous ne pouvons accéder à une position universelle que si nous entreprenons sérieusement de « regarder en face la modernité coloniale », si nous puisons dans la contre–culture de l’Atlantique noir pour formuler ce que Gilroy appelle un « universalisme stratégique » dont la portée s’étend au–delà de l’Europe[20]. L’universalité n’a pas d’existence abstraite, comme un principe prescripteur qui s’appliquerait mécaniquement en toutes circonstances. Elle se produit et se reproduit dans le geste insurrectionnel, qui exige l’émancipation non seulement pour ceux qui partagent mon identité mais pour tous ; qui réclame que nul humain ne soit réduit en esclavage ; qui refuse de figer l’opprimé dans un statut de victime réclamant une protection venue d’en haut ; qui soutient que toute émancipation doit être une auto–émancipation.
Depuis les révoltes des plantations jusqu’au Combahee River Collective, cette sorte d’universalité doit nécessairement se confronter au capitalisme et le combattre. L’anticapitalisme est une étape nécessaire et indispensable sur cette voie. Comme l’écrit Barbara Smith, invoquant un versant de l’héritage du CRC qui mérite d’être revitalisé et préservé :
Si le féminisme noir du Combahee est si puissant, c’est parce qu’il est anticapitaliste. On attend forcément d’un féminisme noir qu’il soit antiraciste et opposé au sexisme. Mais c’est l’anti-capitalisme qui lui donne sa précision, son tranchant, son exhaustivité, son potentiel révolutionnaire[21].
C. L. R. James a montré que tout compromis sur cette forme précise d’universalité, tout renoncement à la primauté de l’insurrection et au potentiel révolutionnaire de la lutte anti-capitaliste conduit à retomber dans le particularisme de l’ordre établi. Cette régression peut toucher n’importe quelle identité : ainsi, les leaders de la Révolution haïtienne ont fini par imposer une forme salariée d’esclavage à la population récemment émancipée. Comme l’écrit James dans Les Jacobins noirs :
La race blanche n’a pas le monopole de la trahison politique, et cette abominable trahison, suivant de si près l’insurrection, montre que le leadership politique est une question de programme, de stratégie et de tactique, et n’a rien à voir avec la couleur de peau de ceux qui l’exercent, avec l’origine commune qu’ils ont avec leur peuple, ni même avec les services qu’ils ont rendus[22].
En 1957, James rencontre à Londres Martin Luther King Jr. et Coretta Scott King qui reviennent du Ghana. James, qui est alors en train d’écrire son livre Nkrumah and the Ghana Revolution, écoute avec le plus grand intérêt le récit du boycott des bus de Montgomery dans l’Alabama. Il écrira plus tard une lettre à King, expliquant qu’il a envoyé un exemplaire des Jacobins noirs à Louis Armstrong et à son épouse Lucille avec l’instruction de le faire passer à King une fois qu’ils l’auraient lu. Il ajoute : « Vous aurez compris que mon cadre de référence politique n’est pas la “non–coopération”, mais que j’examine chaque activité, stratégie et tactique politique à l’aune de son succès ou de son échec[23]. » Commentant cette rencontre dans une lettre à ses camarades aux États–Unis, il résume ce qu’ont en commun tous les événements politiques victorieux : « le pouvoir toujours inattendu du mouvement de masse[24] ». C’est un tel mouvement de masse qui mettra fin à la ségrégation légale dans les années 1960, initiant un nouveau champ de lutte politique dans lequel nous cherchons aujourd’hui encore notre voie.
Un programme, une stratégie et une tactique. Notre monde a le besoin urgent d’une nouvelle universalité insurgée. Nous sommes capables de la produire ; nous en sommes tous capables, par définition. Reste à élaborer un programme, une stratégie et une tactique. À condition de laisser de côté la consolation de l’identité, nous pouvons entamer cette conversation.
*
Illustration : Portrait libre de Toussaint Louverture.
Notes
[1]. Sandro Mezzadra, « The Right to Escape », Ephemera, vol. 4, no 3, 2004.
[2]. Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001, p. 24. Pour une analyse complémentaire consacrée au cas étatsunien, voir Nikhil Pal Singh, Black Is a Country, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2004.
[3]. Voir Massimiliano Tomba, « Exclusiveness and Political Universalism in Bruno Bauer » in D. Moggach (dir.), The New Hegelians: Politics and Philosophy in the Hegelian School, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; et du même auteur, « Emancipation as Therapy : Bauer and Marx on the Jewish Question » in M. Quante et A. Mohseni (dir.), Die linken Hegelianer, Paderborn, Wilhelm Fink, 2015.
[4]. Karl Marx, Sur la Question juive, trad. fr. J.-F. Poirier, Paris, La Fabrique, 2006, p.58.
[5]. Wendy Brown, States of Injury, Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 99.
[6]. Ibid., p. 134.
[7]. Ibid., p. 131.
[8]. Alain Badiou, L’Éthique. Essai sur la conscience du mal, Paris, Nous, 2003, p. 34.
[9]. Massimiliano Tomba, « 1793: The Neglected Legacy of Insurgent Universality », History of the Present. A Journal of Critical History, vol. 5, no 2, 2015, p. 111.
[10]. Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Paris, Karthala, 1982, p. 264.
[11]. Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris, Le Seuil, 1998, p. 163.
[12]. Alain Badiou, Petit manuel d’inesthétique, Paris, Le Seuil, 1998, p. 27-28.
[13]. Judith Butler, Vers la cohabitation. Judéité et critique du sionisme (2012), trad. fr. G. Le Dem, Paris, Fayard, 2013, p. 7-9.
[14]. C. L. R. James, « Dialectical Materialism and the Fate of Humanity », Spheres of Existence, Londres, Allison & Busby, 1980, p. 91.
[15]. Paul Gilroy, L’Atlantique noir, trad. fr. C. Nordmann, Paris, Amsterdam, 2017, p. 30-33.
[16]. K.–Y. Taylor (dir.), How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective, op. cit., p. 119-120.
[17]. Paul Gibson, Against Race, Cambridge, Harvard University Press, 2000.
[18]. Paul Gibson, L’Atlantique noir, op. cit., p. 103.
[19]. Ibid.
[20]. Paul Gilroy, Against Race, op. cit., p. 71 et 96.
[21]. K.–Y. Taylor (dir.), How We Get Free, op. cit., p. 67.
[22]. C. L. R. James, Les Jacobins noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint–Domingue, trad. fr. P. Naville, Paris, Amsterdam, 2017, p. 148.
[23]. Martin Luther King Jr., The Papers of Martin Luther King Jr., Volume IV, C. Carson, S. Carson, A. Clay, V. Shadron et K. Taylor (éd.), Berkeley, University of California Press, 2000, p. 150.
[24]. Sojourner Truth Organization, Urgent Tasks, no 12, été 1981.

![Pour une sociologie de la race (2e partie) [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/t6-ico-038-00164191_0-150x150.jpg)







