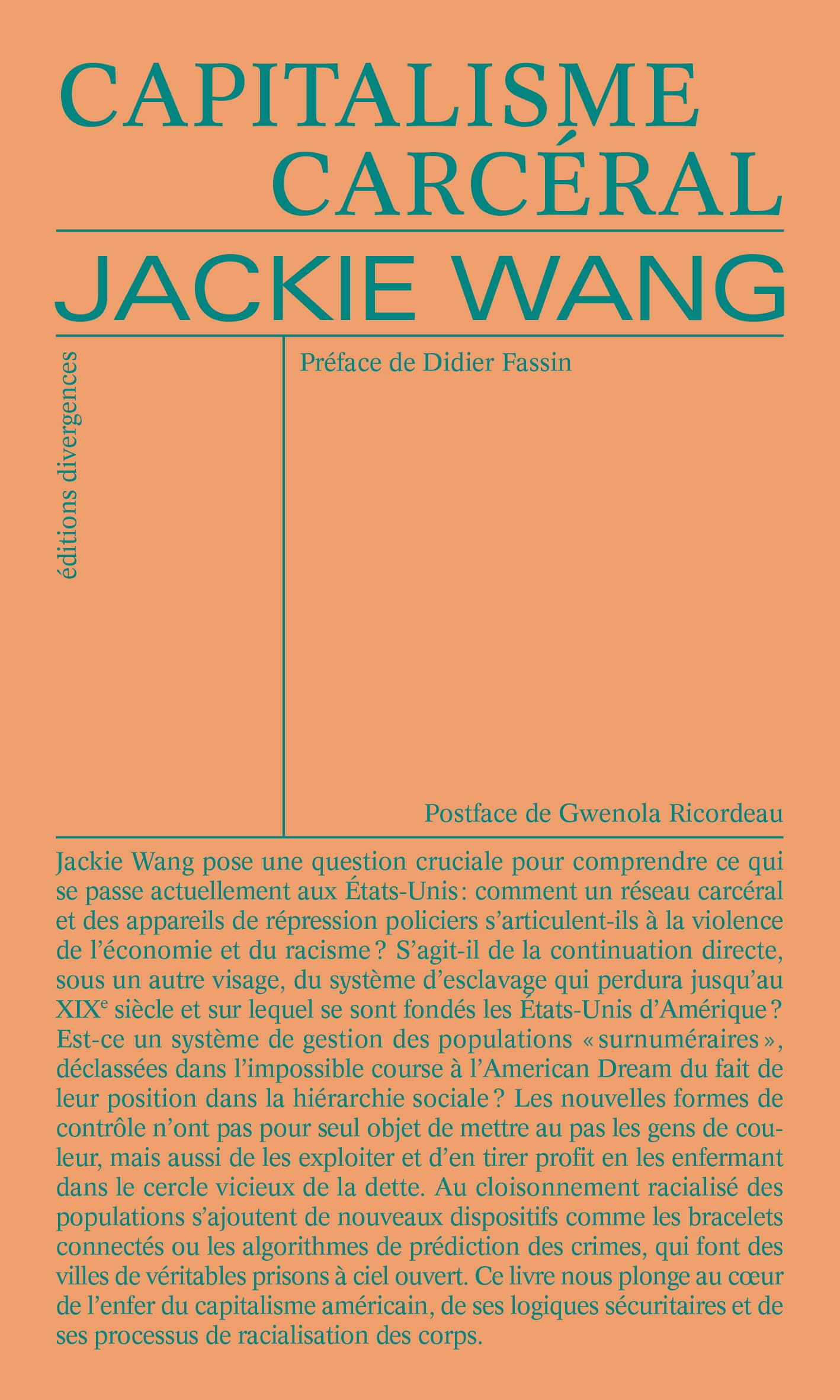
À propos de : Jackie Wang, Capitalisme carcéral, Paris, Éditions divergences, 2019. Préface de Didier Fassin. Postface de Gwenola Ricordeau.
On pourra lire ici un extrait du livre.
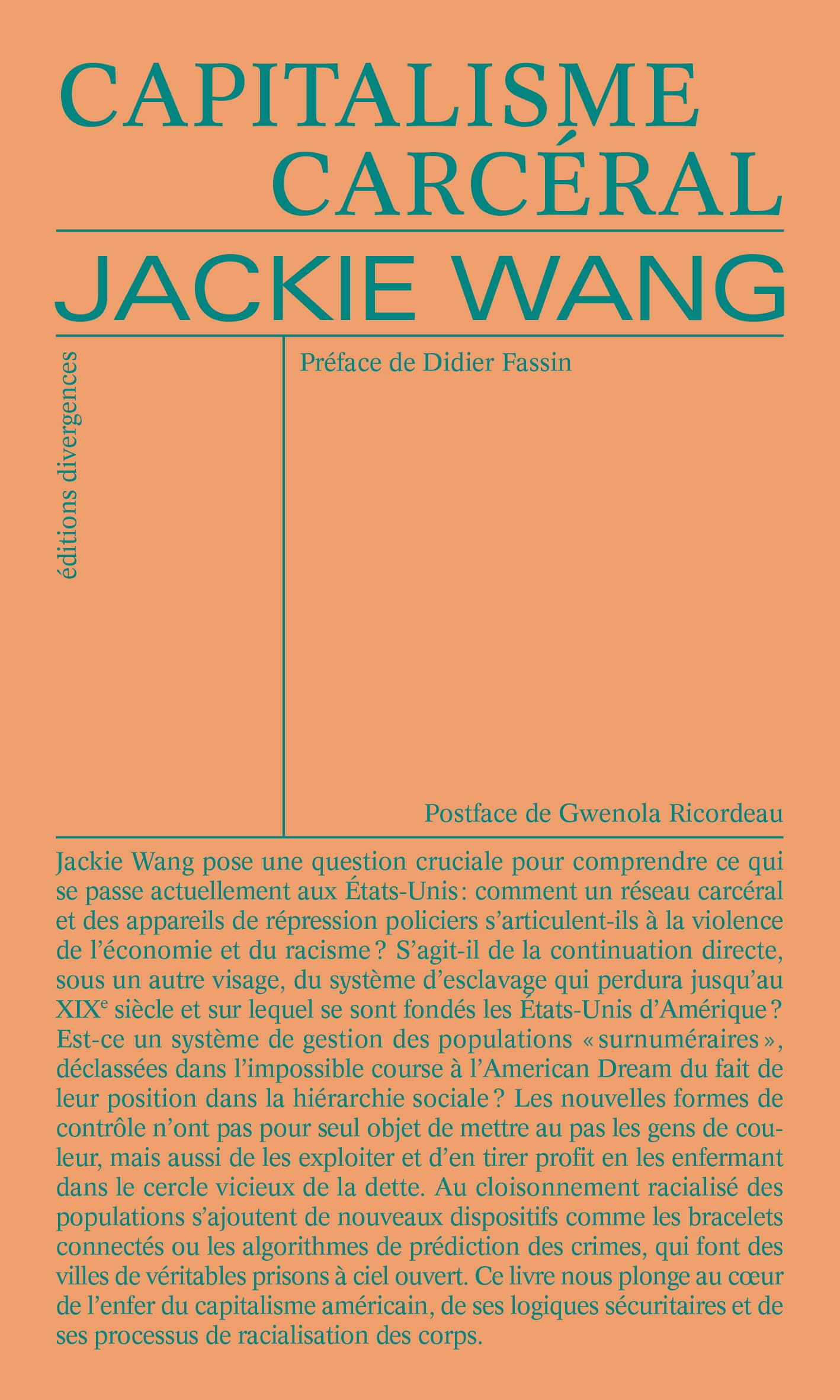
Capitalisme carcéral est le premier livre de Jackie Wang, publié en 2018 et traduit par les éditions Divergences en 2019. Cet ouvrage propose une analyse complexe et assez complète de l’économie politique de l’État carcéral étasunien. Dans un contexte de soulèvement généralisé contre les meurtres policiers racistes, aux États-Unis comme en France, (re)lire ce livre est essentiel afin de saisir ce qui, dans le contexte étasunien, lie l’économie de la dette, les crimes policiers et l’incarcération de masse des Noirs – une analyse des conditions économiques de l’évolution de l’appareil policier et judiciaire étasunien en somme. Convoquant et faisant discuter la littérature afro-pessimiste, encore peu connue en France, avec celle sur le capitalisme racialisé ainsi que la littérature marxiste et postmarxiste, le livre de Wang est essentiel pour saisir l’aspect structurant de la race – et ne pas la réduire à une perception, voire à un racisme d’État dont on ignorerait les rouages.
Dès l’introduction, on apprend qu’alors que Jackie Wang était reçue à Harvard pour y entamer un doctorat, son frère purgeait une peine de prison à vie – pour un crime commis alors qu’il avait 17 ans – en Floride, peine commuée en 40 ans de prison. Si Wang part donc de son expérience, et de celle de son frère, pour expliquer son intérêt pour le capitalisme carcéral, elle ne tombe jamais dans le simple récit personnel – évoquant son histoire par moments, mais uniquement pour appuyer son analyse. Si de nombreux livres existent sur la persistance de la négrophobie (traduit par « racisme anti-noir » dans la version française du livre) aux États-Unis, sur le rôle de l’esclavage et de la spoliation des terres autochtones dans le développement du capitalisme, cet ouvrage se propose d’analyser tout un pan de l’économie raciale contemporaine aux États-Unis.
Le livre revient ainsi sur l’économie de la dette et sur sa racialisation ; sur les crises budgétaires des municipalités et la manière dont elles frappent de plein fouet non seulement les plus démunis, mais surtout les Noirs ; sur la construction de la figure du « superprédateur » ; sur l’évolution des formes policières (« le flic cybernétique ») ; sur la critique de la « politique du safe » ; et enfin sur l’imaginaire abolitionniste, surtout sous la forme poétique. L’important nombre de questions soulevées par ce livre ne nous permet pas de toutes les discuter en détail ici. Nous ne reviendrons donc que sur certains points, qui nous semblent essentiels pour analyser la situation actuelle.
L’un des principaux objectifs de Wang est de souligner l’enchevêtrement entre l’économie, les finances municipales et le « maintien de l’ordre ». La première question traitée par l’autrice concerne le fait que l’économie de la dette est profondément racialisée et joue le rôle de « dispositif disciplinaire » (p. 36) aux États-Unis. Ce qui intéresse principalement Jackie Wang est la manière dont le capital financier ainsi que l’État créent de nouvelles formes d’expropriation racialisée. En effet, comme le rappelle l’autrice, mobilisant un article de Brandon Terry, entre 1980 et 2006 la dette des ménages a augmenté de 72,1 % à 139,7 % — une immense partie de cette dette reposant sur les épaules des Afro-Américains vivant en ville.
Ce régime de la dette passe non seulement par des prêts, « qui sont essentiellement des arnaques » (p. 75), ciblant principalement des Noirs ou Latinos, mais repose également sur la ségrégation spatiale – pour reprendre les termes de Wang, les personnes noires sont « spatialement exposées à la prédation » (p. 76). Si l’expropriation ne concerne bien évidemment pas que les Noirs aux États-Unis, le premier chapitre de Wang est entièrement consacré à l’expropriation racialisée – et c’est l’un des mérites de ce livre, dont la traduction vient combler un manque dans les travaux sur la race en France.
En effet, alors que les discussions concernant la finance, et ses conséquences sur les classes les plus pauvres de la société animent une partie importante de la gauche, les effets de la finance sur les non-blancs restent à peu près absents de celles-ci. Si l’économie étasunienne et l’économie française sont structurées différemment, une analyse des conséquences raciales de la financiarisation aux États-Unis permet de ne plus ignorer la question raciale lorsqu’il est question de discussions autour de la financiarisation de nos vies.
En 2012, l’économiste Gary A. Dymski écrivait un texte dans lequel il défendait l’idée selon laquelle un élément clé dans la crise des subprimes de 2007-2009 était l’évolution de l’exclusion raciale du marché hypothécaire étasunien. Selon Dymski, jusqu’au début des années 1990, les minorités raciales étaient systématiquement exclues de la participation à la finance hypothécaire, notamment à cause des pratiques bancaires de redlining. Pourtant, ces mêmes minorités raciales n’ont par la suite plus été exclues, mais ont eu accès à des crédits immobiliers à des conditions bien plus défavorables que les Blancs1. C’est ce que Jackie Wang nomme « l’expropriation par l’inclusion financière » (p. 125) :
Tout indique que les banques ont commis une vaste fraude à caractère racial au cours de la période qui a précédé la crise de 2008. (p. 125). Jackie Wang explique ainsi la manière dont les banques ont pu inciter les emprunteurs noirs ou latinos à contracter des emprunts risqués – les employés de la banque Wells Fargo nommant ces prêts les « prêts du ghetto. » En prenant l’exemple de l’expropriation racialisée par la finance, Jackie Wang insiste sur la persistance de l’ordre racial post-Jim Crow – où cet ordre a perdu sa base légale, mais se traduit par d’autres mécanismes, en empêchant les non-Blancs d’accéder à la propriété privée. Selon Wang, dans le régime actuel de l’accumulation capitaliste, expropriation et exploitation s’enchevêtrent.
Wang replace bien évidemment la question de l’expropriation et de l’exploitation raciale dans le débat autour du fait de savoir « quelle sorte de dépossession a été la condition de possibilité du capitalisme : l’expropriation des terres autochtones ou l’esclavage ? » (p. 109) En fait, séparer les deux, comme le rappelle Iyko Day – qui associe l’expropriation des terres autochtones à l’expropriation des corps noirs2 – est assez réducteur, l’une étant la condition de possibilité de l’autre. Si Wang rappelle que l’objet de son livre est d’abord la négrophobie et sa traduction carcérale et policière, elle évoque assez justement le fait que l’analyse du colonialisme de peuplement est tout aussi vitale pour saisir les mécanismes du capitalisme racial.
Bien évidemment, cette expropriation s’inscrit surtout dans une racialisation de la dette, qui a joué le rôle de contrôle racialisé dès l’abolition de l’esclavage. On pourrait alors se demander quel est le rapport entre l’économie de la dette et le régime carcéral qui vise en priorité les non-Blancs aux États-Unis. L’un des meilleurs exemples que prend Jackie Wang est sans aucun doute la nouvelle forme de prison pour dettes – pourtant abolie en 1833 aux États-Unis – qui prend forme via la collecte d’amendes, l’emprisonnement pour défaut de payement, etc.
Dans le 2e chapitre, dans lequel Wang s’intéresse au rôle que jouent les amendes dans les finances municipales, l’autrice prend un exemple tiré d’un article de la Harvard Law Review, celui de Tom Barrett, vivant à Augusta en Géorgie, verbalisé en 2012 pour avoir volé une cannette de bière. Lorsque Barrett a dû comparaître, il lui a été offert la présence d’un avocat commis d’office, moyennant 80 $ (ce qu’il a refusé), puis il a été condamné à payer 200 $ assortis d’un an de liberté conditionnelle.
Cette probation incluait le port d’un bracelet contrôlant sa consommation d’alcool (alors que sa sentence n’impliquait aucunement une baisse de sa consommation, Barrett a pourtant dû choisir entre le bracelet et la prison) – bracelet ayant un montant de base de 50 $ ainsi que des frais de service de 39 $ par mois et des frais d’utilisation de 12 $ par jour. Pour pouvoir payer tout cela, Barrett a dû vendre son plasma sanguin tout en sautant des repas et donc, à terme, n’a plus été en mesure de donner son plasma. Lorsque la dette de Barrett a atteint 1000 $, l’entreprise privée (Sentinel Offender Services) auprès de qui celle-ci avait été contractée a obtenu un mandat d’arrêt contre lui et il a été mis en prison pour dettes impayées.
L’idée de Jackie Wang selon laquelle la racialisation des Noirs repose sur une double logique d’exploitation et d’expropriation est assez convaincante et permet de réellement traiter des structures de la négrophobie outre-Atlantique. Celle-ci repose en grande partie sur l’économie de la dette, que ce soit par la prédation financière ciblant prioritairement les noirs et les non-blancs, de manière générale, ou par le financement municipal reposant en grande partie sur les amendes – l’autrice s’appuie en grande partie sur le cas de Ferguson et lie explicitement la « pression que la ville de Ferguson exerçait sur son service de police pour générer des revenus » au meurtre de Michael Brown..
On pourrait toutefois regretter que le rapport entre la question raciale et le management du travail aux États-Unis ne soit pas vraiment discuté. La question raciale est en effet centrale dans la place qu’occupent les Noirs dans les rapports de production, tout comme dans leur exclusion de ceux-ci – Wang discute d’ailleurs l’importance du concept de Lumpenprolétariat pour les Black Panthers en introduction. Dans The Production of Difference, David Roediger et Elizabeth Esch montrent que la racialisation des noirs a en grande partie reposé sur le management du travail.
Lier l’expropriation et exploitation des noirs aux États-Unis par la finance à leur exploitation en tant que force de travail et à l’aspect racial de leur place dans les rapports de production aurait sans doute pu souligner la force des arguments de Jackie Wang – d’autant plus que le capital financier est intimement imbriqué au capital industriel.
Dans le troisième chapitre de Capitalisme carcéral, Jackie Wang revient sur une problématique majeure de la négrophobie contemporaine : la construction de la figure du superprédateur. Selon Wang, cette image du superprédateur a participé à la transformation du statut juridique de la jeunesse noire dans les années 1990 – via la modification, à la fin des années 1990, dans la plupart des États américains, de la loi sur les mineurs, « de manière à brouiller la distinction entre les tribunaux pour mineurs et les tribunaux pour adultes » (p. 180).
Ce « brouillage » de la distinction entre mineurs et adultes a coïncidé avec « le renversement de la manière dont la population conçoit les mineurs en général » (p. 180), et notamment les garçons noirs, qui se voient donc assimilés à des superprédateurs. Dans The Man-Not, le philosophe Tommy J. Curry, figure des « Black male studies », retrace cette différence de racialisation entre les hommes et les femmes noirs à partir des années 1970 et 1980 – une époque de précarisation accélérée des hommes noirs en particulier – lors de laquelle le statut de « travailleurs indésirables » a été de plus en plus accolé aux hommes noirs. Selon Tommy Curry, cette période est intimement liée au mythe de l’homme noir comme superprédateur3.
Cette problématique n’est bien sûr pas spécifiquement étasunienne. À la fin des années 1970, Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke et Brian Roberts publiaient Policing the Crisis, livre dans lequel ils revenaient sur la manière dont la catégorie d’agression (mugging) – « condensation des catégories de race, de crime et de jeunesse4 » – habituellement utilisée dans un contexte étasunien, a commencé à éclater en Grande-Bretagne, participant de la criminalisation grandissante des non-blancs britanniques et servant d’instrument de contrôle social.
En France, il n’est que de penser à la figure du « garçon arabe » qui nourrit toute sorte de fantasmes républicains et participe de la criminalisation des indigènes de l’hexagone. Il est d’ailleurs dommage que l’aspect genré de cette catégorie raciale ne soit pas plus analysé par Jackie Wang – même si elle mentionne cet aspect. Il ne s’agit bien évidemment pas de nier la spécificité de l’oppression raciale des femmes noires, mais de rappeler que les oppressions ne s’articulent pas mathématiquement.
C’est d’ailleurs l’un des points faibles de certaines théories de l’intersectionnalité qui tentent de totaliser l’articulation des oppressions en les additionnant. Or, une telle totalisation ne nous semble guère possible – l’oppression et l’exploitation des non-blancs étant toujours genrée, elle se traduit différemment selon les situations (ce qui se reflète d’ailleurs dans la définition initiale du concept d’intersectionnalité). Le chapitre de Wang consacré à la racialisation du mythe du superprédateur est essentiel pour saisir cette forme de criminalisation comme une forme de biopouvoir.
Toutefois, la criminalisation grandissante des noirs aux États-Unis ne se traduit pas nécessairement par des contrôles policiers « aléatoires », mais repose bien plutôt sur des algorithmes visant à cibler la criminalité raciale. C’est l’objet du quatrième chapitre de Capitalisme carcéral, notamment consacré à la prédiction policière. À travers l’exemple de l’entreprise PredPol (predictive policing), Jackie Wang s’intéresse aux outils d’analyse prédictive et, surtout, à leur utilisation par la police. Alors que ces outils sont omniprésents dans nos vies (le meilleur exemple étant celui des achats en ligne), l’autrice de Capitalisme carcéral s’intéresse à l’utilisation de ces outils par la police.
Si l’image de la police se détériore dans l’opinion publique – et notamment chez les personnes non-blanches – l’utilisation de ce type d’outils vise à associer l’image de la police à « l’objectivité scientifique » – ce qui occulte totalement le fait que ces outils sont aussi construits racialement. Lorsque la police met l’accent sur la prédiction des crimes, elle présente le crime comme une catégorie neutre, mesurable objectivement sans s’en remettre aux catégories raciales. L’utilisation de la recherche universitaire pour renforcer la police est centrale, un point essentiel à comprendre afin de ne pas réduire les policiers à des idiots racistes dont le comportement serait dirigé par une bêtise individuelle :
L’histoire de la police au XXIe siècle, ne peut pas être réduite au stéréotype des policiers bêtes et méchants [meathead officers] qui se cherchent des occasions pour mettre le grappin sur les voyous et abuser du pouvoir qui leur a été confié. […] [L]’histoire de la police algorithmique – et de PredPol en particulier – est celle d’une collaboration rapprochée entre les forces de l’ordre, l’université, l’armée, la Silicon Valley et les médias. C’est l’histoire d’une forme de technogouvernance qui opère aux confluents du savoir et du pouvoir. (p. 227)
Si le livre de Jackie Wang est extrêmement stimulant et gagnerait à être discuté dans les cercles militants et universitaires, l’utilisation de la poésie au milieu ou en fin de chapitre n’apporte cependant pas grand-chose – et réduit la force de la démonstration. À une époque où nombre de militants ou d’universitaires s’inventent une vocation de poète, on ne peut qu’espérer que le livre de Wang n’encourage pas ce phénomène. Quitte à vouloir utiliser une forme artistique, autant puiser dans l’immense source que constitue le rap étasunien, bien qu’avec un langage sans doute moins « safe » – de Ol’ Dirty Bastard à Bobby Shmurda[1], l’incarcération des noirs est un thème inépuisable pour les rappeurs.
Néanmoins, cet ouvrage de Jackie Wang ne pourra qu’être précieux aux militants antiracistes en France. Si la structure raciale de la France diffère de celle des États-Unis, Wang propose des pistes méthodologiques permettant de ne pas réduire les Noirs – et les non-blancs en général – à des « images » ou à des stéréotypes mentaux. Étudier les racines raciales de notre système économique est donc une étape nécessaire pour comprendre l’existence des indigènes en métropoles – par-là, il s’agit de « dépasser » la seule discrimination à l’emploi pour comprendre la manière dont la racialisation du capitalisme tardif organise nos vies dans ses moindres détails.
Alors qu’un vaste mouvement de lutte contre les crimes racistes de la police française est en cours, s’intéresser à l’économie de la race ne revient aucunement à noyer celle-ci dans un économicisme color-blind, mais bien plutôt à mettre à jour les raisons structurelles des meurtres de Noirs et d’Arabes par la police.
[1] « Yeah, youknowhatI’msayin, to you ?
I was in Riker’s Island, youknowhatI’msayin ?
High impact, youknowhatI’msayin ?
They they had me pickin cigarettes (SLAM !)
A thousand cigarettes up off the floor
Doin push-ups, all that bullshhhh
Yo I’m tryin to (SLAM !)
I just wanna give a shout, to all the jails everywhere
Cause you know, I know it’s a game (Just SLAM !)
YaknowhatI’msayin ? The government got a game
Get all the brothers locked down »
(Extrait de The Park de Ol’Dirty Bastard ft. Coolio)
« Free Greezy though, let all of my dogs out
Momma said no pussy cats inside my doghouse
That’s what got my daddy locked up in the dog pound
Free Phantom though, let all of my dogs out »
(Extrait de Hot Nigga, de Bobby Shmurda.)
références
| ⇧1 | Gary A. Dymski, « Racial Exclusion and the Political Economy of the Subprime Crisis », In Costas Lapavitsas (dir.), Financialisation in Crisis, Brill, Leiden-Boston, 2012, p. 52. |
|---|---|
| ⇧2 | Iyko Day, « Being or Nothingness : Indigeneity, Antiblackness, and Settler Colonial Critique », Critical Ethnic Studies, vol. 1, n°2, 2015. |
| ⇧3 | Tommy J. Curry, The Man Not. Race, Class and the Dilemmas of Black Manhood, Temple University Press, Philadelphia, 2017. Voir en particulier le chapitre 3 : « The Political Economy of Niggerdom : Racist Misandry, Class, Warfare, and the Disciplinary Propagation of the Super-predator Mythology. » |
| ⇧4 | Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke et Brian Roberts, Policing the Crisis. Mugging, the State, and Law and Order, MacMillan Press, Londres-Basingstoke, 1982, p. viii. |