
Capitalisme carcéral. Un extrait du livre de Jackie Wang
Jackie Wang, Capitalisme carcéral, Paris, Éditions Divergences, 2019, 350 p., 18€ (préface de Didier Fassin, postface de Gwenola Ricordeau).
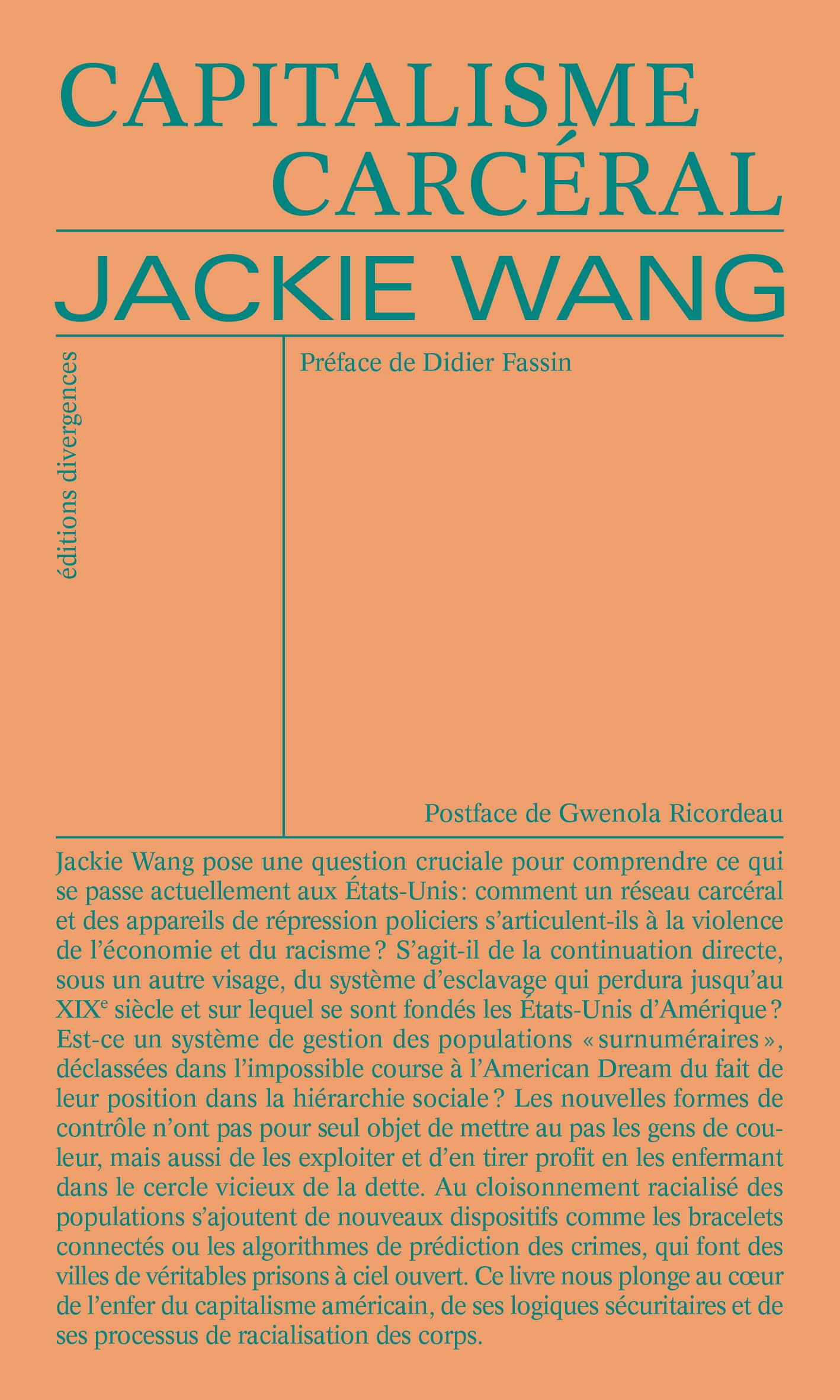
Introduction
Ce projet est né lorsque j’ai écrit « Contre l’innocence », il y a plus de cinq ans. C’était avant le mouvement Black Lives Matter, à une époque où il était souvent considéré comme scandaleux de critiquer la police, même dans certains cercles de gauche. C’était une période d’effervescence dans la pensée et l’action politiques. Inspirés par Occupy Wall Street, le « mouvement des places » et la vague de contestation mondiale, plusieurs d’entre nous se sont engagés dans d’intenses expérimentations collectives. Que cela soit par des cuisines collectives, le partage de nourriture, des groupes de soutien en santé mentale, des collectifs d’artistes, des caisses de soutien aux prisonniers, des groupes affinitaires de personnes queer ou de personnes racisées, des projets d’édition pirate, des cercles de lecture de textes inspirants, l’occupation d’édifices et de places publiques, la politisation des amitiés et une panoplie d’autres formes de solidarité collective, nous insufflions nos gestes d’un désir commun de briser le règne de l’organisation militante compartimentée et de transporter la politique à même la vie quotidienne. Ces expérimentations étaient certes politiques, mais elles cherchaient également à créer de nouvelles temporalités et façons d’être, des liens sociaux matériels, enracinés dans la reproduction de la vie quotidienne.
Cette vague de contestation globale qui a politisé tant de personnes de ma génération a débuté avec le Printemps arabe, bientôt suivi par Occupy Wall Street. Mais peu à peu, ce qui avait commencé comme une vague révolutionnaire dans les pays arabes a fini par sombrer dans le chaos, fournissant le prosceniumsur lequel les grandes puissances allaient exhiber leur suprématie militaire, en y orchestrant une guerre par procuration. L’instant des possibles s’est refermé sur six ans de guerre civile en Syrie et sur l’implosion économique et politique de pays comme l’Égypte, la Libye, le Yémen et d’autres – alors que la Russie refaisait surface comme puissance militaire globale et qu’une soi-disant « crise des réfugiés » fournissait le prétexte de la réapparition de mouvements réactionnaires partout en Europe, galvanisant l’appui populaire de partis de droite fascistes, néofascistes, populistes ou ultraracistes.
À l’époque, il paraissait encore possible de faire vaciller le gouvernement en se rassemblant sur les places publiques, et de reprendre notre avenir collectif en main à travers des décisions au consensus et des messages colportés au porte-voix. Beaucoup pensaient que la révolution passerait par des appels à l’action sur Facebook et des débats sur Twitter. Au début du mouvement d’Occupy Wall Street, les analyses du rôle structurel de la police comme bras armé du capitalisme et du suprémacisme blanc avaient un écho assez marginal. Beaucoup disaient que la police était là pour aider les manifestants, que les policiers étaient aussi des travailleurs opprimés et ne devaient pas être traités avec suspicion ou hostilité. Quoi qu’il en soit, c’est la police qui a fini par expulser des places les manifestants d’Occupy, en menant des raids nocturnes contre les camps de fortune, ce qui fournit la preuve, une fois de plus, qu’au moment où le statu quo est menacé, la police n’a d’autre raison d’être que la répression politique.
Les choses ont beaucoup changé depuis cette époque – pour le mieux comme pour le pire, car le monde se déplace toujours dans plusieurs directions à la fois. Depuis que j’ai commencé à écrire ce livre, j’ai assisté à l’émergence du mouvement Black Lives Matter, qui a radicalement transformé notre manière de penser et de combattre le racisme. J’ai réalisé à quel point tout avait changé en moins de cinq ans lorsque j’ai participé à une conférence sur Ferguson et l’histoire du mouvement pour les droits civiques à l’Université Harvard. J’ai compris que le discours s’était complètement renouvelé lorsque j’ai vu les spectateurs de Harvard accueillir avec un tonnerre d’applaudissements le rappeur Tef Poe déclarant qu’il était légitime de renverser des voitures de police pour contester le pouvoir. Même les médias de masse et les magazines grand public comme Time, Rolling Stone, MTV News et The Nation se sont mis à publier des chroniques justifiant les émeutes comme moyen de protester contre les violences policières qui avaient eu lieu à Baltimore, Ferguson et Oakland en 2014 et 2015.
Avant les événements de Ferguson et l’émergence de Black Lives Matter, j’avais écrit « Contre l’innocence » en réponse à ce que je ressentais comme une impasse politique et théorique : c’est-à-dire la mainmise du libéralisme sur notre conception de la nature du racisme et des tactiques admissibles pour le confronter. Après avoir mené une enquête approfondie sur la question de l’incarcération de masse – qui m’affecte également sur le plan personnel –, j’ai réalisé à quel point le stéréotype qui associe le fait d’être noir à la criminalité et à la culpabilité est profondément enraciné dans l’imaginaire américain. Comme le rappelle Khalil Muhammad dans The Condemnation of Blackness, ce stéréotype existe depuis plus d’un siècle – mais, entre les années 1960 et 1990, les criminologues, politiciens et autres décideurs ont travaillé d’arrache-pied pour façonner l’image du criminel noir dans l’opinion publique. Il me semblait donc contreproductif de fonder la lutte antiraciste sur la notion d’innocence morale, où seuls les « sujets respectables » peuvent servir de symboles pour contester le racisme. Dans une telle perspective, la violence structurelle de l’État n’apparaît scandaleuse que lorsque ses victimes correspondent à l’image de la « bonne victime ». L’association a priori du fait d’être noir à la criminalité conforte l’Amérique blanche en l’autorisant à croire que les Noirs méritent leur sort et que la prospérité des Blancs n’a aucun lien avec la misère des Noirs. D’un autre côté, en fétichisant la passivité, l’accent mis sur l’innocence discrédite la révolte et la combativité – pourtant beaucoup plus efficaces pour lutter contre le racisme. Bien que le cadre antiraciste libéral n’ait pas encore été complètement démantelé, je crois que la nouvelle génération de jeunes activistes ne se laisse plus si facilement séduire par la classe politique et l’espoir d’obtenir la reconnaissance de l’État – à l’inverse de ceux et celles qui refusaient, il y a encore quelques années à peine, d’abandonner leur croyance chimérique en la possibilité que les révolutionnaires et les policiers puissent un jour faire bon ménage.
Le soulèvement de Ferguson a fourni la preuve indubitable que la police est intrinsèquement raciste, au point que le Département de la Justice des États-Unis a été obligé d’ouvrir une enquête sur la police de Ferguson. Cette enquête a fini par révéler l’existence d’un vaste système de pillage qui impliquait le service de police et le gestionnaire des finances municipales, John Shaw. Le Département de la Justice a découvert non seulement que la police harcelait et assassinait des citoyens, mais que la mairie utilisait sa police et ses tribunaux pour extorquer de l’argent aux citoyens et augmenter les recettes de la municipalité. Après avoir lu cette enquête, je me suis mise à éplucher tous les faits divers qui concernaient les finances des municipalités et des gouvernements locaux. J’ai fini par réaliser que partout aux États-Unis, les finances des municipalités et des États étaient de plus en plus dépendantes de mécanismes coercitifs visant à extorquer et à piller les populations démunies. Décidément, il y avait anguille sous roche.
À mon avis, ces méthodes d’extorsion marquent un tournant dans la fameuse ère néolibérale – qu’on a défini comme suit :
un ensemble de mesures et de préceptes idéologiques incluant entre autres : la privatisation de fonds publics, la déréglementation ou l’élimination des services publics, la stabilisation macroéconomique et l’abandon des politiques keynésiennes, la libéralisation du commerce et la déréglementation financière, l’insistance rhétorique sur les solutions efficaces, techniques et « neutres » aux problèmes sociaux, l’utilisation du vocabulaire du marché pour légitimer les nouvelles normes et neutraliser l’opposition[1].
Les mesures économiques des cinquante dernières années, qui ont érodé le pouvoir ouvrier au profit d’une mobilité accrue du capital, n’ont pas seulement provoqué un nivellement des finances par le bas en sapant au passage l’assiette fiscale de l’État : elles ont aussi transformé la nature même de la gouvernance.Si, pour reprendre la taxinomie de Wolfgang Streeck, l’État taxeur (l’État providence keynésien d’après-guerre) s’est transformé en État débiteur (vecteur d’austérité), alors nous assistons présentement à l’émergence de l’État prédateur, dont la fonction est de moduler les aspects dysfonctionnels du néolibéralisme et en particulier le problème de la réalisation du profit dans le secteur financier. Les théoriciens modernes de l’économie monétaire soutiennent que pour couvrir leurs dépenses, les gouvernements qui utilisent la monnaie fiduciaire (comme les États-Unis depuis que le président Richard Nixon s’est débarrassé de l’étalon-or en 1971) ne sont plus obligés d’augmenter leurs recettes, car ils ont le monopole de l’émission de leurs devises respectives. Or ce n’est pas le cas des États et des municipalités aux États-Unis, qui ne peuvent ni imprimer leur propre monnaie ni relever arbitrairement le plafond de leur dette. Tout ce que les États et les municipalités peuvent faire, c’est émettre des obligations (pour rembourser leur dette) ou se débrouiller pour augmenter leurs recettes. Si les États ne peuvent pas déclarer faillite, cela n’est pas le cas des municipalités, qui y ont droit en vertu du titre XI du chapitre IX du Code des États-Unis. Selon les lois de leurs États respectifs, certaines municipalités ont par exemple le droit de faire faillite pour se décharger de leurs obligations en matière de pensions de retraite. Lorsque Détroit a fait banqueroute, un avocat spécialiste des faillites, Timothy M. Wittebort, était intervenu à la télévision pour relayer la (fausse) croyance populaire selon laquelle la dette publique serait la propriété des gens ordinaires, et qu’il fallait donc traiter les investisseurs avec les mêmes égards que les retraités. En réalité, la proportion des obligations municipales détenues par les ménages a chuté de 4,6 % à 2,4 % entre 1989 et 2013, année où la fourchette supérieure des 0,5 % de ménages les plus riches détenait 42 % de toutes les obligations municipales[2]. La propriété de la dette publique est un enjeu politique, où le capital financier et les riches cherchent toujours à présenter leur intérêt privé comme s’il représentait l’intérêt général. Plus le capital financier s’approprie la dette publique et plus il fournit les liquidités nécessaires aux dépenses de l’État, plus les appareils de gouvernement deviennent redevables envers leurs créanciers privés plutôt qu’envers la société civile. À la longue, ce phénomène a des effets négatifs sur la démocratie.
En somme, le résultat du repli budgétaire et des mesures néolibérales du gouvernement fédéral n’a pas seulement été de multiplier les privatisations et l’austérité. Ces opérations ont fini par créer une structure de gouvernance prédatrice et parasitaire dans les États et les municipalités, cependant que l’endettement se généralisait dans la société. Les gouvernements locaux contractent des prêts de plus en plus risqués, et font des paris financiers à haut risque avec les deniers publics. Et quand ces affaires tournent au vinaigre – comme lors de la crise financière de 2008 – les administrations tentent d’éponger leurs pertes sur le dos des personnes démunies, des chômeurs et des gens à la peau noire ou marron. Les règles du jeu fiscal étant conçues de manière à faciliter l’évasion fiscale des entreprises et des plus riches, l’éclatement de la bulle immobilière en 2008 a provoqué la chute des taxes foncières, l’une des principales sources de revenus des gouvernements locaux. Récemment, la ville de Miami, en Floride, a intenté un procès à la Bank of America pour les dommages financiers indirects causés par ses pratiques discriminatoires dans l’octroi de prêts hypothécaires à risque. La banque avait conçu ces prêts à taux d’intérêt élevés ciblant les emprunteurs noirs et latinos de manière à ce qu’ils fussent immanquablement incapables de payer leurs échéances.
L’évolution politique récente révèle à quel point l’économie, les finances municipales et le maintien de l’ordre sont enchevêtrés. La crise économique mondiale issue de l’éclatement de la bulle immobilière a fait chuter les recettes des municipalités, qui ont répliqué en inventant des combines fiscales où la police était mobilisée pour extorquer de l’argent aux citoyens. Mais comme les forces de l’ordre sont payées par les municipalités, leur existence allait-elle être menacée par les réductions budgétaires ? Loin s’en est fallu : malgré les politiques néolibérales qui ont affaibli le pouvoir ouvrier autant dans le secteur privé que public, la police dispose toujours de budgets faramineux et bénéficie de généreuses pensions de retraite. En fait, les syndicats policiers (et parfois ceux des pompiers et des gardiens de prison) figurent parmi les très rares organisations qui sont sorties indemnes des récentes dépressions économiques. Lorsque le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a entrepris de réécrire le Code du travail de l’État pour démanteler le pouvoir de négociation des ouvriers, il a évidemment pris soin de ne pas toucher aux pensions de retraite des policiers et des pompiers.
Si le financement de l’appareil sécuritaire n’est jamais remis en question par les administrations locales, leurs services de police ont néanmoins fini par pâtir de leurs déboires financiers. Dans un article de la revue The Police Chief décrivant le recours à la police pour générer de nouvelles sources de revenu,l’officier du service de police de West Covina Paul LaCommare note que « les revenus des municipalités californiennes sont en chute libre depuis les cinq dernières années, lorsque la bulle immobilière avait provoqué une baisse de 40 % des recettes issues des impôts fonciers ». Il poursuit en indiquant que « face aux crises budgétaires, la réaction habituelle est de réduire le personnel et de couper les services. L’objectif de cet article est de fournir aux forces de l’ordre une solution de rechange aux réductions de personnel et de services »[3]. LaCommare relate que « des experts dans les domaines de la gouvernance municipale, les affaires, l’immobilier et l’entrepreneuriat » se seraient rencontrés en 2008 afin « d’identifier comment les forces de l’ordre pourraient introduire de nouvelles sources de revenus ». Les propositions incluaient :
des frais d’inscription pour les délinquants sexuels qui s’installent dans une région donnée ; la création d’entreprises de remorquage municipales ; 50 % d’augmentation des amendes ; la facturation à l’appel des services de police ; un service payant de surveillance des maisons pour touristes ; l’ouverture de plages horaires publiques payantes pour utiliser le champ de tir de la police ; la création d’une école de conduite gérée par le service de police pour redresser les responsables d’infractions mineures au Code de la route ; la création d’un service de sécurité incluant des rondes de vérification à domicile et la supervision policière de caméras de surveillance privées ; une entreprise consacrée au nettoyage de scènes de crime ; des frais juridiques et administratifs visant les criminels condamnés lors de leur retour dans la communauté ; permettre l’utilisation du nom du service de police à des fins publicitaires ; tripler les amendes judiciaires pour l’alcool au volant ; percevoir des frais relatifs au droit de résidence sur le modèle des taxes sur les services publics ; créer une taxe ou une redevance sur toutes les boissons alcoolisées vendues sur le territoire de la municipalité ; percevoir des frais de sécurité publique pour les nouveaux développements immobiliers ; percevoir des frais pour l’utilisation du 9-1-1 ; autoriser des publicités commerciales sur le site internet du service de police ; la vente d’un service de « co-patrouille » au grand public ; des cours de maniement d’armes à feu offerts par le service de police[4].
Une bonne partie de ces propositions – qui témoignent d’un basculement vers le financement par les contrevenants eux-mêmes du maintien de l’ordre et des mesures punitives – fait manifestement la promotion de l’hyper-exploitation des citoyens par la police, que ce soit en monnayant directement les services de police ou en multipliant les frais et les amendes pour siphonner de l’argent aux citoyens qui entrent en contact avec eux. Récemment, des comtés comme Ramsey County, au Minnesota, ont essuyé des critiques après avoir commencé à facturer une série de frais à chaque interpellation, sans égard à la culpabilité des suspects. À la lumière de ces pratiques, il apparaît clairement que le nouveau contexte budgétaire pousse la police à assumer graduellement le rôle d’un générateur de revenus, ce qui la met à l’abri des licenciements et des soudaines réductions budgétaires, lorsque les municipalités se retrouvent aux prises avec des difficultés financières. Autrement dit, la survie et la croissance des gouvernements locaux dépendent de plus en plus de leur capacité à utiliser la force policière et le système pénal pour extorquer de l’argent à leurs citoyens. De la même manière que la libéralisation des marchés dans la seconde moitié du XXe siècle s’était accompagnée d’une multiplication des prisons, la fameuse réduction de la taille de l’État ne semble en aucun cas mener à une réduction des effectifs policiers ou une remise en question du système carcéral, ni à plus forte raison des dépenses militaires. Bien au contraire, l’hégémonie idéologique de « l’État minimal » peut fort bien rimer avec une extension de l’appareil policier et carcéral, car cette idéologie considère le maintien de l’ordre comme une des prérogatives essentielles (et moralement légitimes) du gouvernement public. Selon Bernard E. Harcourt, la pénalité néolibérale s’ancre « d’une part, dans le postulat de la légitimité et de la compétence du gouvernement en matière pénale et, de l’autre, dans la présomption que le gouvernement ne devrait pas avoir d’autre rôle par ailleurs »[5]. Ceci dit, l’effondrement de l’État débiteur après le triomphe du néolibéralisme a créé une situation où les revenus des gouvernements locaux sont devenus largement tributaires de structures fiscales prédatrices qui reposent sur l’extorsion des citoyens.
Il est évidemment nécessaire d’analyser les conditions économiques qui suscitent ces transformations des pratiques policières. Mais il ne suffit pas de faire l’économie politique de la répression pour comprendre l’évolution de l’appareil policier et carcéral. Certaines formes de violence racialisée de la part de l’État, absolument gratuites, sont tout à fait « irrationnelles » d’un point de vue économique. Aux yeux du marché, le nouveau régime de condamnation qui a émergé parallèlement à la guerre contre la drogue – comme la loi des trois fautes[6] pour la possession de stupéfiants – n’a aucune justification rationnelle. Pourquoi gaspiller une quantité exorbitante de fonds publics pour incarcérer des prévenus non violents – parfois à vie ? Pour trouver une raison économique à un tel phénomène, il faudrait le considérer du point de vue des Blancs des milieux ruraux aux États-Unis, à qui l’expansion des pénitenciers fournit de nouveaux emplois. Mais cet argument n’est pas suffisant pour expliquer toutes les facettes de l’incarcération de masse, comme le régime de réclusion à perpétuité des jeunes délinquants sans libération conditionnelle, intégré dans la loi au milieu des années 1990. Dans mon chapitre « Les superprédateurs », j’analyserai en détail cette interaction entre la loi, la biopolitique et le discours criminologique.
J’avais à peine fini d’écrire ce chapitre sur la criminalisation des mineurs quand des activistes de Black Lives Matter ont perturbé un rassemblement de partisans de Hillary Clinton. Interrompant la collecte de fonds de la candidate qui se tenait à Charleston, en Caroline du Sud, la jeune militante Ashley Williams a demandé à Clinton pourquoi elle avait utilisé le terme « superprédateur » dans un discours de 1996, où elle appuyait le projet de loi anticriminalité lancé par Bill Clinton en 1994. Alors que dans les années 1980 et 1990, l’hégémonie du discours sur la-loi-et-l’ordre obligeait tous les politiciens à prôner la tolérance zéro pour se faire élire, le paysage politique a aujourd’hui subi une telle transformation que de rappeler à Clinton sa rhétorique passée sur les « superprédateurs » pendant la campagne présidentielle était devenu embarrassant. Pour un instant, on aurait pu croire que le vent avait tourné sur la question de la répression et des prisons. La guerre contre la drogue perdait des appuis, alors que la question de la drogue était reformulée comme une problématique de santé publique – sans doute en raison du fait que la dépendance aux opiacés avait fait irruption chez les Blancs. Étant donné les barrières structurelles qui empêchent les Blancs de ressentir de l’empathie vis-à-vis des Afro-Américains, il n’est pas surprenant que la criminalisation de la consommation de drogue se soit adoucie dès qu’elle s’est mise à affecter les Blancs. Avant l’élection de Donald Trump, les États-Unis semblaient être en voie d’adopter une approche moins punitive. En 2016, le Pew Research Center publiait un rapport stipulant que le soutien de la population à la peine de mort était à son plus bas depuis 45 ans : alors qu’il était de 80 % en 1994, il avait chuté à 49 % en 2016[7].
Puis, la campagne électorale de 2016 a soudainement fait tourner la vapeur en faveur de l’approche punitive. Trois États se sont prononcés par référendum en faveur de la peine capitale : la Californie et l’Oklahoma ont voté pour son maintien, alors que le Nebraska a choisi de la remettre en place. Rien de surprenant au vu du sondage Pew qui révélait également que les hommes blancs – la base électorale de Trump – appuient davantage la peine de mort. Avec l’élection de Trump et la nomination de Jeff Sessions comme Procureur général des États-Unis, l’horizon semble s’être refermé pour les activistes qui militent contre la prison et la police. Dans son discours d’investiture, Trump a ressorti la vieille rhétorique de la tolérance zéro contre le crime en dressant un portrait sordide des métropoles américaines : nos rues, disait-il, sont ravagées par le crime, le « carnage » et l’anarchie, ajoutant qu’il appuierait inconditionnellement les forces de l’ordre pour remettre l’Amérique sur ses pieds. Dans l’ensemble, son discours annonçait le retour à une guerre acharnée contre le crime et la drogue.
Le jour où j’ai publié mon essai sur l’emprisonnement à vie des délinquants mineurs sans possibilité de libération conditionnelle (juvenile life without parole, JLWOP) sur mon blog, la Cour suprême des États-Unis tranchait l’affaire Montgomery vs. Louisiana en ordonnant l’application rétroactive de la décision qui avait été rendue dans l’affaire Miller v. Alabama sur le caractère inconstitutionnel des JLWOP[8]. Ce faisant, la Cour suprême laissait ouverte la possibilité pour les juges de condamner les délinquants mineurs à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle ; elle se contentait de stipuler que les juges devraient tenir compte du fait qu’un prévenu est mineur dans leurs jugements. Ces annonces judiciaires ont néanmoins créé une zone grise juridique qui a obligé certains États à autoriser des procès en révision pour certains condamnés à une JLWOP, au nombre desquels se trouvait mon frère aîné. Il est encore trop tôt pour dire si ces jugements de la Cour suprême permettront de réduire les sentences des jeunes condamnés. En Floride, où mon grand frère croupit actuellement en prison, plusieurs révisions de peine ont débouché sur de nouvelles condamnations à perpétuité (mon frère a écopé d’une peine de quarante ans). Pendant un certain temps, on aurait pu croire que la Cour suprême allait abolir les peines discrétionnaires à une JLWOP ; mais il a fallu abandonner cet espoir lorsque les nouvelles nominations à la Cour suprême fédérale sont venues donner la majorité absolue à la droite conservatrice. Sans une révolution ou un mouvement de masse dans la rue, les modestes avancées juridiques qui avaient été réalisées pour contrer l’incarcération de masse risquent d’être définitivement perdues.
*
Illustration : Cell Block D at Alcatraz. Library of Congress.
Notes
[1]Michael C. Dawson et Megan Ming Francis, « Black Politics and the Neoliberal Racial Order », p. 27.
[2]Daniel Bergstresser et Randolph Cohen, « Changing Patterns in Household Ownership of Municipal Debt: Evidence from the 1989–2013 Surveys of Consumer Finances » (document de travail, Brookings Institute, 15 juillet 2015), https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Bergstresser-Cohen-with-tables.pdf.
[3]Paul LaCommare, « Generating New Revenue Streams », The Police Chief, no 77, 2010, p. 22-30.
[4]Ibid.
[5]Bernard E. Harcourt, The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order, p. 202-203.
[6]La « Three-strikes law », parfois traduite en « loi des trois coups », s’inspire des règles du baseball pour imposer des peines extrêmement sévères à la suite de la troisième « offense » [NdT].
[7]Baxter Oliphant, « Support for Death Penalty Lowest in More Than Four Decades », Pew Research Center, 29 septembre 2016, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/29/support-for-death-penalty-lowest-in-more-than-four-decades.
[8]Il est curieux qu’aux États-Unis une disposition jugée inconstitutionnelle par les tribunaux puisse encore être légale si elle a été instituée avant la décision.









