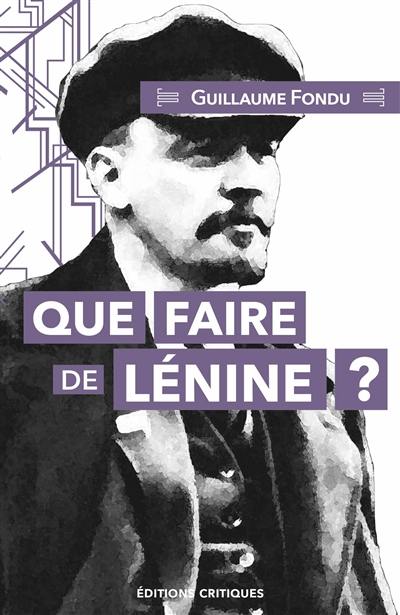
Dans son ouvrage paru récemment aux éditions Critiques, Guillaume Fondu resitue certaines des principales thèses de Lénine dans le contexte polémique de leur élaboration, en essayant de réfléchir à leur actualité.
Dans ce premier chapitre, consacré à la notion d’organisation, il est question d’un des premiers grands textes de Lénine, Que faire ? L’ouvrage propose une réflexion sur la manière de produire des collectifs politiques viables et susceptibles de peser sur les évolutions sociales. Dans une polémique contre les « économistes », que l’auteur donne à lire dans le texte, Lénine défend la nécessité de ne pas réduire la politique à la seule expression des intérêts communs de tel ou tel groupe social.
Pour exister politiquement, il importe, selon lui, de s’organiser autour d’un scénario politique dans lequel les groupes en question sont appelés à jouer un rôle décisif, en portant notamment des idées et un projet politique clairement exprimé.
Pour aller plus loin, on pourra lire ou relire notre dossier consacré à Lénine.
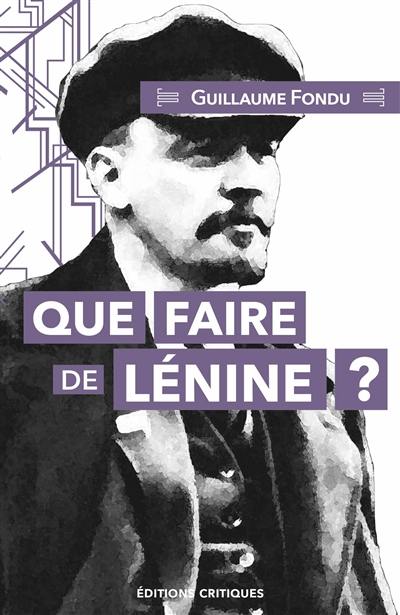
Lénine est avant tout passé à la postérité comme un dirigeant politique : dirigeant d’un parti, tout d’abord, dirigeant d’un État par la suite. On s’intéressera ici au Lénine militant, un chapitre ultérieur traitant de son activité en tant qu’homme d’État (cf. chap 4). Et l’on traitera de cette question à partir d’une séquence spécifique, celle qui entoure la fondation du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (désormais POSDR) et donne lieu à la rédaction, en 1902, de Que faire ? qui demeure l’un des ouvrages les plus connus de Lénine. Cette séquence est marquée par un important débat autour de la notion d’organisation. Même si l’on trouve par la suite, sous la plume de Lénine des considérations diverses à ce sujet, il est indéniable que les réflexions et les discussions menées à ce moment dessinent un cadre important pour tous les débats ultérieurs qui traverseront le socialisme russe et, au-delà, les partis communistes revendiquant l’héritage de Lénine.
La notion d’organisation est cruciale pour la politique, a fortiori la politique socialiste. En effet, si l’on cherche à la définir du point de vue militant, on peut dire que l’organisation est l’une des principales ressources politiques, surtout lorsqu’on s’adresse à des couches par ailleurs dénuées des ressources politiques habituelles : les ouvriers (et plus généralement les dominé-e-s) n’ont, par définition, ni richesse matérielle, ni relations sociales, etc. qui leur permettraient d’exister politiquement, c’est-à-dire de peser activement sur le fonctionnement de la société, que ce soit au niveau des lois officielles ou des pratiques plus informelles.
La politique consiste donc d’abord à créer des collectifs susceptibles de constituer une force réelle à partir de rien ou, plus exactement, si l’on se situe d’emblée dans une perspective marxiste, à convertir le nombre – seule ressource réelle des dominé-e-s – en force réelle. On définira donc la « politisation » comme le fait de rejoindre ce genre de collectif pour accéder à une influence réelle sur le cours des choses. Mais cela suppose de conférer une certaine consistance au collectif en question, consistance qui se décline selon deux dimensions, la dimension idéologique et la dimension pratique : une organisation doit à la fois exprimer certaines idées précises et pouvoir coordonner les actions de ses membres, de manière à être identifiée comme une option idéologique et agir comme un sujet collectif. C’était déjà l’ambition de Marx dans le Manifeste du parti communiste : conférer une identité politique à un communisme qui n’était encore qu’un « spectre » aux contours vagues.
L’histoire russe et soviétique sera riche en exemples des problèmes posés par ce collectif et son fonctionnement : on peut le centraliser de manière pathologique, le collectif ne servant alors plus des buts politiques réels mais ne travaillant qu’à se reproduire lui-même pour satisfaire les intérêts de ceux qui existent à travers lui (on parlera alors de bureaucratie) ; on peut, inversement, le diluer dans une pseudo-organisation aux contours flous incapable d’exister réellement sur le plan idéologique comme sur le plan pratique, ce qui arrivera au plus grand parti socialiste russe (en nombre d’adhérents), le parti socialiste-révolutionnaire (qui disparaîtra rapidement après la révolution de 1917). Ces deux écueils continuent à scander notre vie politique, comme en témoignent les tentatives contemporaines de dépasser la forme-parti pour trouver d’autres modalités d’organisation, tentatives soldées par des échecs puisqu’elles évacuent la plupart du temps la question de cette consistance pour réduire l’organisation à n’être que l’expression d’un programme politique auquel on ne peut faire qu’adhérer passivement, la seule implication militante véritable n’étant qu’électorale, et donc ponctuelle et rythmée par un calendrier imposé.
L’autre enjeu de la séquence que l’on va étudier tient à une tension constitutive de l’activité politique : cette dernière doit à la fois s’appuyer sur une base sociale déterminée, c’est-à-dire exprimer les intérêts de groupes sociaux définis par une certaine place dans les rapports de pouvoir, tout en proposant un projet universel devant s’appliquer à la société toute entière. Là encore, la tension en question est susceptible de mener à deux écueils symétriques : le refus d’appréhender la société en termes de groupes aux intérêts antagonistes menace de transformer la politique en pur prêche moral ou utopique, l’oubli de la dimension universelle du projet faisant dégénérer la politique en pure défense corporatiste d’intérêts partiels.
Le monde dans lequel Lénine fait son apprentissage politique est notamment marqué par une histoire proprement russe dont Lénine est conscient et dans laquelle il s’inscrit en connaissance de cause. Au seuil du XXe siècle, la situation politique de la Russie semble être totalement fermée pour les militants socialistes. Depuis 1825 et la tentative de révolte manquée des décabristes, jeunes aristocrates sensibles aux idéaux révolutionnaires, la Russie semble être condamnée au tsarisme. Divers mouvements socialistes se sont levés au cours du siècle, marqués par des doctrines diverses, mais ils sont tous demeurés marginaux et lorsque de jeunes intellectuels (étudiants, petits enseignants et fonctionnaires, etc.) ont essayé d’aller « au peuple » dans la décennie 1870 et de prêcher le socialisme au paysan russe, ce dernier les a accueilli avec, au mieux, des dénonciations à la police impériale.
Du point de vue des doctrines, la Russie a vu s’opposer deux thèses sur son avenir, celles des « occidentalistes », convaincus que la voie à suivre est celle de l’Europe occidentale (avec ses diverses révolutions, politiques, sociales et économiques) et celle des « slavophiles », considérant que la Russie peut et doit trouver une voie spécifique de développement. À l’intérieur du courant socialiste, cette opposition s’incarne notamment dans deux courants opposés, le populisme slavophile, attaché à démontrer le potentiel socialiste des anciennes institutions communautaires de la paysannerie russe, et le marxisme naissant, attentif à la formation progressive d’une classe ouvrière russe dans les grands centres urbains alors en plein développement. Face à leur échec dans la constitution d’un mouvement de masse, les populistes prennent la voie du terrorisme, défendant l’idée qu’un ébranlement soudain de l’autorité impériale est de nature à susciter des révoltes d’ampleur. Les marxistes, eux, sont partisans d’une voie plus lente, convaincus que le développement historique joue en leur faveur et que les tâches du moment sont principalement de nature organisationnelle.
Dès 1883, un groupe de marxistes revendiqués et adoptant le nom de « Libération du travail » diffuse à une échelle relativement importante les textes de Marx et commence à envisager la création d’un parti socialiste russe sur le modèle du parti social-démocrate allemand. On y retrouve de futurs grands noms du marxisme russe, notamment Plekhanov, qui, en 1889, surprend les participants du Congrès de fondation de la IIe Internationale en revendiquant pour la Russie une place au sein du socialisme européen alors même que la plupart des militants présents considèrent la Russie comme un pays arriéré, réactionnaire et très éloigné de toute perspective socialiste. Il parvient cependant à convaincre et se taille un succès d’estime.
Dans les années 1890, le mouvement s’accélère et les militants, éparpillés dans des groupes divers sur tout le territoire russe, décident de s’unifier. Ce sera tout d’abord le cas avec des journaux, qui confèrent une unité idéologique à la social-démocratie russe : la Rabotchaïa Gazeta [Journal ouvrier] d’abord, à partir de 1897, dont il ne paraîtra que deux numéros. Mais surtout, en 1898, les discussions aboutissent à la nécessité de former un parti. Le premier pas sera réalisé lors du Congrès de fondation du POSDR, organisé à Minsk[1]. Mais tous les délégués présents sont immédiatement arrêtés et emprisonnés et il faudra en réalité attendre encore cinq ans et le deuxième Congrès du POSDR, en 1903, pour que le parti commence à exister réellement, avec des statuts, des dirigeants, etc.
Cela étant, l’activité idéologique se poursuit et donne rapidement lieu au premier grand débat de la social-démocratie russe, celui qui va opposer les tenants d’une lutte principalement économique (les « économistes », attachés donc à l’activité qu’on appellerait aujourd’hui « syndicale ») aux défenseurs de la nécessité d’une lutte politique ouvrière contre le tsarisme, Lénine se rangeant très clairement dans le second camp. L’enjeu, on le verra, se trouve dans le rapport entre le monde ouvrier et les élites libérales, partisanes d’un État de droit et d’un capitalisme libéré de l’emprise étatique, élites elles-mêmes alors en lutte – larvée – contre le tsarisme.
Les économistes détiennent alors deux journaux[2] : le Rabotchoïe Delo [La Cause ouvrière], organe de l’Union des social-démocrates russes à l’étranger, considérée comme l’expression du POSDR chez les émigrés européens. Le journal paraît entre avril 1899 et février 1902, à une époque où l’Union est passée entre les mains des économistes. On trouve dans son comité de rédaction les grands noms de l’économisme, Kritchevski et Martynov notamment. Mais c’est surtout dans la Rabotchaïa Mysl’ [La Pensée ouvrière] que les économistes s’expriment puisque ce journal présente l’avantage de ne pas être lié à un groupe officiel quelconque, ce qui lui permet de bénéficier d’une liberté de ton absolue. Il paraîtra entre octobre 1897 et décembre 1902, sous la direction de militants moins célèbres (à l’exception peut-être d’Invanchine, présent également dans la rédaction du Rabotchoïe Delo). En face, les social-démocrates opposés à l’économisme tiennent l’Iskra (Décembre 1900-Octobre 1905[3]), qui deviendra l’organe officiel du POSDR et dont le comité de rédaction comporte des noms plus illustres : Axelrod, Zassoulitch, Lénine, Martov, Plekhanov et Potressov.
Le conflit autour de l’économisme cristallise en réalité de nombreux débats plus anciens et constitue en un sens l’acte de naissance de la social-démocratie russe. Les militants dressent en effet ici le bilan d’un siècle de socialisme (en un sens très large) en Russie, à l’occasion d’un événement historique important, les premières grandes grèves ouvrières en Russie, en 1896, et la formation de formes d’organisation massives, quoique embryonnaires (caisses de soutien, comités de grève, etc.).
Les économistes représentent pour ainsi dire l’aile la plus occidentaliste de la social-démocratie, défendant un marxisme à ses yeux tout à fait orthodoxe, tel qu’on en trouve la formulation dans les textes de Marx les plus déterministes, la préface du Livre I du Capital en constituant un exemple particulièrement significatif avec, entre autres, cette formule demeurée célèbre : « Le pays plus développé industriellement ne fait que montrer ici aux pays moins développés l’image de leur propre avenir[4]. »
Puisque la Russie se trouve à peu près au niveau de développement atteint par les États européens du début du XIXe siècle, elle doit, comme eux, laisser la bourgeoisie mener la lutte politique et adopter une perspective purement économique, encourageant les ouvriers à se battre pour leurs intérêts immédiats et à s’organiser sur leurs lieux de travail et directement contre le patronat. La thèse des économistes est donc d’abord une thèse historiographique, qui consiste à postuler un schéma de développement universel en deux temps : d’abord une certaine séquence politique, dont la bourgeoisie est l’acteur principal (d’où la nécessité pour le prolétariat de la soutenir, en ne faisant valoir que des revendications économiques) ; puis, dans un second temps, la lutte socialiste à proprement parler, c’est-à-dire la constitution de la classe ouvrière en sujet politique à proprement parler.
Mais en réalité, le modèle historique occidental est plus complexe chez les auteurs économistes. Le « Credo[5] » de 1899, l’un des principaux textes du courant, qui explicite et radicalise un certain nombre de leurs thèses au point de se voir répudié par de nombreux économistes, défend en effet une thèse historiographique plus subtile. Le socialisme européen se serait développé dans un cadre démocratique et ne peut donc offrir de véritable modèle au mouvement ouvrier russe, pris dans un monde où la notion de liberté politique est inexistante. Or, l’autrice du « Credo », Kouskova, défend la thèse historique du développement selon « la ligne de la moindre résistance » : une organisation politique serait appelée à se développer dans le ou les domaines où elle a le moins de risques d’être étouffée et peut donc se déployer relativement librement, toute autre activité entraînant une dispersion d’énergie inefficace et épuisante. Le socialisme occidental, face aux difficultés de la lutte anti-patronale et à la latitude offerte par la République, aurait principalement investi l’arène politique pour Kouskova, ce dont témoigne l’importance électorale du parti social-démocrate mais aussi le révisionnisme bersteinien, c’est-à-dire la volonté de faire du parti socialiste un parti comme les autres au sein du jeu parlementaire. Mais le contexte présent de la Russie est à l’opposé de ces coordonnées :
[Si], en Occident, les faibles forces ouvrières, entraînées dans la lutte politique, se sont renforcées par elle, s’y sont formées, chez nous, ces faibles forces, au contraire, font face au mur du joug politique et non seulement elles n’ont aucune voie pour lutter contre lui, donc aucune voie pour leur développement, mais elles étouffent sous ce joug, elles ne peuvent pas même commencer à exister. […] La lutte économique est elle aussi infiniment difficile mais est possible et elle est enfin dans la pratique des masses elles-mêmes. En se faisant à l’organisation, dans cette lutte, et en se heurtant à tout moment contre le régime politique, l’ouvrier russe finira par créer ce que l’on peut appeler une forme de mouvement ouvrier, par créer l’organisation, quelle qu’elle soit, correspondant aux conditions de l’activité russe. On peut dire avec certitude aujourd’hui que le mouvement ouvrier russe se trouve encore à l’état amiboïde et n’a créé aucune forme. Le mouvement de grève, qui existe quelles que soient les formes d’organisation, ne peut pas être considéré pour l’instant comme la cristallisation de la forme du mouvement russe et les organisations illégales, ne serait-ce que du point de vue quantitatif, ne méritent aucune attention (je ne parle pas de leur utilité dans les conditions actuelles). Voilà la situation.[6]
Selon Kouskova, le mouvement socialiste russe doit donc s’adapter à la spécificité de son terrain et ne pas entreprendre de tâches politiques susceptibles de l’épuiser et de le tuer dans l’œuf.
La thèse du « Credo » est particulièrement marquée, puisqu’elle consiste ni plus ni moins à défendre la nécessité d’un attentisme politique pur et simple de la part de la social-démocratie, face à un univers où les possibles sont inexistants et où l’organisation – même économique – n’est donc pas une tâche actuelle mais une perspective de long terme sur laquelle il n’est pas possible d’anticiper. Cependant, d’autres économistes, moins radicaux, proposent une analyse assez différente, et bien plus positive, des grèves de 1896. C’est notamment le cas de l’édito du premier numéro de la Rabotchaïa Mysl’, non signé et antérieur au « Credo » mais que l’on peut considérer davantage comme le manifeste d’un économisme raisonnable ou modéré. On y trouve l’analyse suivante des grandes grèves de 1896 :
On peut considérer les grèves de 1896 comme la première et pour l’instant unique manifestation d’une pensée ouvrière autonome, incarnée dans des formes solides, si on laisse de côté les grèves précédentes, nées de manière plus ou moins spontanée, à la manière d’une explosion et non comme une lutte menée selon un plan réfléchi. Dès lors que la question de savoir contre qui se battre est claire, dès lors que l’ennemi est sous ses yeux, l’ouvrier russe est capable de lutter et il en a fait la démonstration. La lutte pour les intérêts économiques est la lutte la plus acharnée, la plus puissante, de par le nombre d’âmes qui la comprennent et l’héroïsme avec lequel l’homme le plus ordinaire défend son droit à l’existence. C’est là une loi de nature. La politique suit toujours docilement l’économie et en fin de compte, le joug politique se brise en chemin. La lutte pour la situation économique, la lutte contre le capital sur le terrain des intérêts quotidiens vitaux, et les grèves comme moyen de cette lutte : voilà la devise du mouvement ouvrier.[7]
Le propos, ici, n’est plus de nature historiographique mais constitue une véritable thèse sur la genèse et le développement de la conscience de classe. Cette dernière naîtrait et se développerait avant tout sur le terrain de la lutte concrète pour l’existence, dans le vécu de la domination et le face-à-face direct avec les exploiteurs (ou les dominants en tous genres). Puisque la lutte est ici une réalité et une nécessité, elle est à la fois plus massive et plus intense. On retrouve donc là encore une forme de marxisme apparemment orthodoxe : la politisation est définie par la prise de conscience d’une situation sociale réelle (classe « en soi ») qui devient une identité vécue (classe « pour soi ») lorsqu’elle est appréhendée affectivement dans la domination et les résistances que cette dernière suscite sur le lieu même de l’exploitation (ici l’usine). Et c’est donc ce terrain que doit investir la social-démocratie, celui des intérêts matériels par opposition aux idéaux politiques, plus abstraits, plus discutables et présents avec bien moins d’intensité dans les consciences ouvrières.
La thèse proposée ici par l’édito de la Rabotchaïa Mysl’ trouve une traduction pratique immédiate, offerte par la suite du texte :
Les moyens [de la lutte] doivent être fournis par les combattants eux-mêmes et le moindre sou placé dans la cause vaudra mille fois plus que ceux issus d’autres sources. L’effort des travailleurs pour mettre en place des caisses [de grève] marque le passage à l’époque de la pleine conscience du mouvement. Ces caisses doivent à l’avenir offrir des moyens destinés avant tout non pas à des occupations diverses, à des ouvrages, mais au pain quotidien nécessaire lorsque la lutte explose, en période de grève. C’est autour des caisses que doivent se regrouper les ouvriers et chacune d’elles a plus de valeur pour le mouvement que cent autres organisations. […] Que les ouvriers mènent la lutte en sachant qu’ils ne luttent pas pour je ne sais quelles générations futures mais pour eux-mêmes et pour leurs enfants, qu’ils se rappellent que la moindre chose arrachée à l’ennemi est une avancée sur la voie qui mène à leur bien-être […].[8]
Là encore, on trouve ici une thèse forte sur la notion d’organisation : cette dernière ne doit pas être conçue d’abord dans sa dimension idéologique ou théorique, c’est-à-dire comme l’affirmation d’un ensemble d’idées auxquelles on adhérerait, mais dans sa dimension pratique, c’est-à-dire dans la solidarité réelle qu’elle suppose et suscite chez ses participants. C’est pourquoi la notion de « caisse » (de grève mais plus généralement de solidarité) est ici centrale. Elle constitue en un sens la traduction pratique, en contexte militant, du matérialisme historique de Marx et de la place centrale accordée à l’économie puisqu’elle donne un sens immédiat, et politique, à l’identité des intérêts de la classe ouvrière. Là encore, la définition d’une classe par un ensemble d’intérêt partagés devient une réalité consciente et ce d’autant plus fortement qu’elle se voit dotée d’un débouché pratique, c’est-à-dire d’un mot d’ordre concret : la contribution aux caisses de grève. À partir de là, les travailleurs existent comme collectif puisqu’ils sont pris dans des relations de solidarité réelle qui les associent les uns aux autres. Les caisses sont donc à la fois un moyen de lutte absolument nécessaire, pour tenir en période de grève, mais aussi le meilleur moyen de donner une réalité à l’organisation ouvrière.
Même si l’édito ne le dit pas explicitement, ces caisses s’opposent, comme forme d’organisation, aux « cercles » présents alors en Russie, institutions héritées du mouvement populiste principalement tournées vers la formation intellectuelle et la discussion politique. Souvent formés d’intellectuels[9] ayant réussi à attirer à eux quelques ouvriers qualifiés, ces cercles ont joué un rôle important dans la diffusion des idées socialistes en Russie mais semblent être une impasse à la fin du XIXe siècle puisqu’ils peinent à la fois à se massifier et à proposer autre chose que le seul débat d’idées. C’est donc avant tout contre cette forme d’organisation que polémique la Rabotchaïa Mysl’, voyant dans les grèves de 1896 et la formation des caisses d’assistance une étape supplémentaire bienvenue dans le mouvement ouvrier russe.
Face aux économistes, une aile « politique » existait au sein du futur parti social-démocrate, hétérogène[10] mais majoritaire et regroupée notamment autour du « Manifeste » du POSDR rédigé à l’occasion du Congrès de Minsk. On y retrouve aussi bien Lénine que ses futurs adversaires mencheviks et, plus à droite encore, les marxistes dits « légaux » passés à la bourgeoisie libérale après la révolution manquée de 1905. C’est notamment le cas de Strouvé, rédacteur du « Manifeste » en question. Le texte proclame l’apparition de la classe ouvrière sur la scène politique et se termine par ces mots :
En tant que mouvement mais également en tant que courant socialiste, le parti social-démocrate russe perpétue la cause et les traditions de tout le mouvement révolutionnaire qui l’a précédé en Russie ; en affirmant que la tâche la plus importante et la plus urgente du parti dans son ensemble est la conquête de la liberté politique, la social-démocratie poursuit les objectifs exprimés clairement par les glorieux militants de l’ancienne Narodnaïa Volia[11]. Mais les moyens et les voies que prend la social-démocratie sont différents. Leur choix est déterminé par le fait que, consciemment, elle entend être et rester le mouvement de classe des masses ouvrières organisées.
Elle est fermement convaincue que « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » et agira obstinément en conformité avec ce principe fondamental de la social-démocratie internationale.
Vive la social-démocratie russe, vive la social-démocratie internationale ![12]
On retrouve dans ce manifeste l’ambition partagée par les premiers social-démocrates russes lors de leur ralliement à la IIe Internationale : considérer le socialisme européen non comme un simple modèle, appréhendé principalement à travers son passé, mais comme une force existante au présent susceptible de modifier la situation européenne et dans laquelle la social-démocratie russe a toute sa place[13]. Cela suppose d’inscrire la mouvement ouvrier russe non dans un simple face-à-face local avec son propre patronat, mais de lui conférer une tâche autrement bien plus importante, à la fois en termes d’échelle et de contenu : l’émancipation politique de la classe ouvrière russe toute entière, voire internationale, du fait des valeurs dont elle est porteuse : la solidarité, l’égalité, la collectivité, etc.
Contre les économistes, l’aile politique de la social-démocratie considère donc que la politisation véritable de la classe ouvrière passe par la compréhension de sa mission historique et un élargissement de ses perspectives. Le mouvement ouvrier n’est pas simplement, en effet, un simple phénomène engendré par le capitalisme naissant mais aussi et surtout le protagoniste d’une histoire plus ancienne, le combattant d’un conflit plus général visant à l’émancipation du peuple contre ses exploiteurs, les patrons certes mais également l’autocratie tsariste qui l’empêche d’exister en tant que force politique. La notion d’organisation qui se dessine ici est donc plus abstraite, moins immédiate que celle des économistes puisqu’elle est ce qui doit permettre à la classe ouvrière de reconnaître son rôle historique, la conscience de classe étant ainsi inséparable d’un élargissement de son horizon pour s’élever à la dignité d’un sujet politique aux ambitions universelles.
Le Que faire ? de Lénine, rédigé entre la fin de l’année 1901 et le début de l’année 1902, intervient dans cette conjoncture idéologique. Il est avant tout une réaction au « Credo », aux articles de la Rabotchaïa Mysl’ mais également à une série d’articles polémiques échangées entre le Rabotchoïe Dielo et l’Iskra. Il reprend le débat décrit plus haut pour défendre la perspective « politique » social-démocrate contre l’hétérodoxie minoritaire que représente l’économisme et retirer à cette dernière le droit de s’exprimer au nom du parti. C’est ce qui explique le plan quelque peu étrange de l’ouvrage, qui comporte cinq parties :
De manière schématique, le raisonnement peut être résumé ainsi : puisque c’est l’unité idéologique qui constitue la base véritable de l’organisation, la critique interne doit être maintenue dans certaines limites, que dépassent les économistes en refusant le travail de conscientisation des masses ouvrières. Car ce refus équivaut à abandonner le prolétariat aux influences idéologiques du temps et, au mieux, à la simple défense de ses intérêts immédiats, ce qui va de pair avec un manque d’ambition total en matière organisationnelle. Contre cela, il faut doter immédiatement la social-démocratie russe d’un journal national, afin qu’elle puisse exister comme force politique à l’échelle et avec les perspectives qui sont les siennes. Contrairement à la légende noire d’un Lénine chef de secte, la théorie du parti proposée dans Que faire ? consiste en grande partie à reprendre les bases de la conception social-démocrate européenne de l’organisation, tout en l’adaptant évidemment à un contexte politique où toute liberté publique est proscrite.
On ne peut revenir ici, faute de place, sur le détail des débats conjoncturels qui structurent la brochure de Lénine, et le lecteur pressé pourrait être surpris par le titre et le contenu du premier chapitre. La question posée par Lénine est celle de la tolérance envers les critiques internes à toute organisation, en l’occurrence celles des économistes à l’égard du POSDR. Lénine semble le tenant d’une ligne dure, considérant qu’il faut fortement restreindre cette liberté afin de maintenir l’unité idéologique de l’organisation.
Cette thèse, qui peut sembler problématique, est en réalité la contrepartie de l’importance accordée au facteur idéologique : puisqu’une organisation se définit en premier lieu comme un ensemble d’idée permettant à certains groupes sociaux – ici le prolétariat – de prendre conscience de sa tâche historique, tout discours qui contesterait cette tâche situe d’emblée ses tenants à l’extérieur de l’organisation. Il existe en effet, d’après Lénine, une alternative structurant l’espace politique russe : le projet consistant à conférer un véritable rôle historique au prolétariat et celui consistant à abandonner (même temporairement) ce rôle à la bourgeoisie libérale. Or, cette idée de rôle historique constitue le cœur de l’analyse et du programme social-démocrate, puisqu’elle fonde la légitimité de la classe ouvrière à élaborer un projet autonome et rival de celui de la bourgeoisie. Condition de possibilité même de l’existence d’une organisation social-démocrate, elle n’est pas négociable. L’idée de Lénine n’est pas d’interdire toute autre ligne que celle de la direction du parti – condamnant par là toute minorité au silence – mais simplement de mettre des bornes à l’espace du dicible au sein d’une organisation afin de la maintenir en tant que telle.
Cette thèse ne se voit justifiée que lorsqu’on saisit le rôle important assigné à Lénine à la théorie, non comme simple instrument de connaissance, mais comme moteur de la conscience historique de soi. C’est là l’enjeu des chapitres 2 et 3, qui s’opposent à la « spontanéité » défendue par les économistes. Le mot ne doit pas induire en erreur : contrairement au terme français, le terme russe – stikhiïnost’ – est négativement connoté puisque l’adjectif construit sur la même racine sert par exemple à qualifier les catastrophes naturelles. En outre, l’opposition entre spontanéité et conscience joue un rôle crucial dans toute l’histoire du socialisme russe puisqu’elle sert d’opérateur critique contre la routine, les traditions et la bêtise qui façonnent, selon les premiers auteurs critiques russe, la société russe, de la paysannerie à la bureaucratie[15]. La spontanéité n’est donc pas du tout à entendre comme apparentée à la liberté, comme c’est le cas en français, mais à l’obéissance aveugle à des lois inconscientes. La conscience, au contraire, est constitutive de l’histoire et de la possibilité du changement puisqu’elle permet de sortir de ces mécanismes incorporés pour accéder à l’action, notamment politique.
Ce que Lénine reproche donc au « culte de la spontanéité », c’est de ne pouvoir s’accompagner que d’une posture attentiste. Enfermé dans une conception objectivante du réel, qui le pousse à considérer l’histoire comme un développement autonome, l’économisme n’est pas traductible en une quelconque pratique politique pour Lénine[16]. Contrairement là encore à une légende noire, Lénine n’est pas marqué par une méfiance maladive à l’égard de la spontanéité des masses russes. Parmi les socialistes de sa génération, il fait même partie des plus optimistes et des plus confiants en les capacités des masses. Simplement, la reconnaissance de ces capacités ne doit pas avoir pour conséquence le quiétisme politique puisqu’un dirigeant politique se définit précisément par sa capacité à déterminer les tâches appelées par une situation
Le chapitre central de Que faire ?, en proposant une théorie de la conscience de classe alternative à celle des économistes, constitue le cœur du propos de Lénine, qui le synthétise ainsi :
La formule de Martynov – « donner à la lutte économique un caractère politique » – nous est précieuse, pas du tout parce qu’elle illustre la capacité de Martynov à tout mélanger, mais parce qu’elle exprime de manière particulièrement claire l’erreur fondamentale de tous les « économistes », la conviction que l’on peut développer la conscience de classe politique de l’intérieur, pour ainsi dire, de la lutte économique, c’est-à-dire en partant exclusivement (ou principalement) de cette lutte, en se basant exclusivement (ou principalement) sur cette lutte. Une telle perspective est radicalement erronée – et c’est précisément parce que les « économistes », furieux contre nous à cause notre polémique contre eux, refusent de réfléchir sérieusement à la source des désaccords, que l’on en arrive à une situation où nous ne nous comprenons pas, littéralement, où nous parlons des langues différentes.
La conscience de classe politique ne peut être apportée à l’ouvrier que de l’extérieur, c’est-à-dire de l’extérieur de la lutte économique, de l’extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. Le seul domaine auquel on puisse puiser cette connaissance[17], c’est le domaine des rapports de toutes les classes et couches de la société à l’État et au gouvernement, le rapports de tous les rapports réciproques entre les classes. C’est pourquoi, à la question – que faire pour apporter aux ouvrier la connaissance politique ? – on ne peut, comme s’en contentent la plupart du temps les militants pratiques (sans même parler des militants qui sont enclins à l’ « économisme ») se borner à la réponse suivante : « Aller aux ouvriers ». Pour apporter aux ouvrier la connaissance politique, les sociaux-démocrates doivent aller dans toutes les classes de la population, ils doivent déployer de tous côtés les détachements de leur armée.[18]
La thèse de Lénine est donc très claire, et là encore assez éloignée de l’intellectualisme qu’on lui prête, selon lequel la conscience de classe serait le produit d’une réflexion théorique menée par des intellectuels spécialisés (et détenant le monopole de la réflexion). Il ne s’agit pas, pour Lénine, de considérer que la classe ouvrière est trop bête pour développer sa conscience politique et qu’il faudrait qu’une autre classe sociale, celle des intellectuels, la lui insuffle de l’extérieur. Intérieur et extérieur ne se rapportent pas ici à des identités sociologiques – l’ouvrier et son « extérieur », l’intellectuel bourgeois – mais à la lutte des classes elle-même. L’idée de Lénine est que la classe ouvrière, dans son conflit avec le patronat, peut être atteinte d’une forme de myopie politique qui la condamne à la défense d’intérêts immédiats et à l’inconscience de son rôle véritable d’autant que cela profite à la bourgeoisie, qui a tout intérêt à ce que la classe ouvrière se restreigne au combat « trade-unioniste », que l’on appellerait nous « syndical ».
C’est pourquoi le discours social-démocrate ne doit pas être exclusivement tourné vers les ouvriers. Il doit proclamer dans la société toute entière ce qu’est la classe ouvrière et ce à quoi elle prétend, le projet de société dont elle est porteuse. Et c’est en se confrontant politiquement, en défendant son projet contre celui des autres classes, que le prolétariat existera véritablement dans l’arène politique. Cette idée de la mission historique du prolétariat et de la nécessité de sa proclamation demeurera une constante dans le discours de Lénine, qui radicalise ici la perspective du Manifeste du parti communiste en lui conférant une dimension organisationnelle encore peu présente dans le discours marxien.
Bien évidemment, cette proclamation pose des problèmes infinis dans un univers où la liberté de réunion et la liberté de la presse sont inexistantes, et le chapitre 4, sur lequel on a trop tendance à s’appesantir, ne fait en réalité qu’adapter la forme d’organisation politique social-démocrate au contexte russe, en insistant sur la nécessité de disposer de révolutionnaires professionnels capables de déjouer la répression (on se rappellera que le premier congrès du POSDR s’était soldé, quatre ans plus tôt, par l’arrestation de tous ses participants). Le chapitre 5 jette enfin les bases d’une des tâches urgentes de la social-démocratie, la fondation d’un journal pour exister définitivement comme une voix politique identifiable dans l’espace russe.
Indéniablement, de nombreuses pages de Que faire ? ont vieilli. Mais les débats contemporains issus de la multiplication des fronts de lutte demeurent en partie traductibles dans les termes de ce débat mené il y a plus d’un siècle. La force du marxisme, selon Lénine, est d’avoir associé à une lutte « identitaire », c’est-à-dire menée au nom d’une identité sociale précise (le prolétariat, la classe ouvrière, les travailleurs, etc.), un projet politique universel. L’identité ouvrière ne doit donc pas être conçue comme une simple réalité sociologique mais comme associée à certain nombre d’idées et de valeurs générales, ce qui permet de ne pas restreindre le débat à la question de savoir comment « exprimer » au mieux des revendications qui seraient consubstantielles à telle ou telle frange de la population. On a pu assister à plusieurs reprises aux problèmes que pose cette réduction de la politique à l’expression d’intérêts considérés comme spontanément partagés par un ensemble social donné : très souvent, il existe des rivalités entre les différents porte-paroles spontanés et autoproclamés (du peuple, des quartiers populaires, des femmes, etc.) et le débat politique s’enlise dans la question de la légitimité des un-e-s et des autres à prendre la parole pour simplement « exprimer » une colère, une souffrance, etc.
Mais il ne s’agit pas pour autant de considérer qu’une organisation politique ne se définirait que par un programme, par une simple option idéologique dans le champ des possibles politiques. Ce programme doit faire l’objet d’une réelle élaboration collective et d’une discussion permanente susceptible de l’actualiser face aux événements et de le diffuser au sein de la société, par l’intermédiaire des militants. Pour qu’une organisation appartienne en effet réellement à ses membres, une forme de démocratie collective est requise (ce que défend Lénine même dans ses passages les plus centralisateurs). Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette dernière n’est pas d’abord à concevoir comme tournée vers les libertés individuelles, au contraire. Dans la mesure où les militants participent à la construction d’une organisation, ils doivent avoir leur mot à dire sur la manière dont elle fonctionne, bien évidemment mais, en retour, les décisions prises les engagent et les contraignent, sans quoi la décision collective resterait purement fictive et les efforts des un-e-s et des autres réduits à néant.
C’est là aussi ce que nous rappelle Lénine, et au-delà de lui tous les partisans de ce qu’on a plus tard nommé le « centralisme démocratique ». Avant de devenir risible du fait des pratiques pour le moins anti-démocratiques des grandes institutions staliniennes, la formule ne fait que décrire la condition de tout engagement politique : la certitude pour chacun que le travail bénévole fourni servira effectivement et que la voix des militants sera effectivement portée par le collectif, ce qui suppose, en cas de désaccord, qu’on accepte la sanction majoritaire, quitte à poursuivre les débats à l’intérieur de l’organisation. Tout cela suppose des modalités contraignantes de prise de décision collective, et le siècle ouvert par la publication de Que faire ? offre de nombreux exemples sans doute plus divers et plus intéressants que les récentes tentatives de dépasser la « forme-parti », la plupart du temps pour construire des usines à gaz électoralistes structurées autour de leurs seuls élus et ne vivant collectivement qu’au rythme des campagnes électorales.
*
Photo : Lénine jouant aux échecs avec Bodganov sur l’île de Capri.
[1]Faute de place, on ne peut revenir ici sur les divers groupes présents lors de ce congrès, notamment sur l’un d’entre eux qui jouera un rôle important et complexe par la suite, le Bund, union des travailleurs juifs, organisation de masse aux rapports complexes avec le POSDR.
[2]On simplifie ici volontairement la situation. Les luttes de fraction s’accompagnent en effet très souvent d’un pullulement d’institutions diverses – publications et organisations – dont il est laborieux et inutile de retracer la genèse exacte (et les subdivisions multiples).
[3]Les dates de fin des différents journaux ne sont pas anodines. Si les publications des économistes s’arrêtent un peu avant le second Congrès du POSDR, qui signe la fin de leur courant, c’est la révolution de 1905 qui mettra un terme à la publication de l’Iskra. Les militants seront pris par d’autres tâches et feront ensuite face à la répression.
[4]Marx, Le Capital, Livre I [1867], trad. J.-P. Lefebvre, Paris, Les éditions sociales, 2016, p. 4. Marx est revenu sur son propos dans les éditions ultérieures, et il commencera à douter fortement de la possibilité de dresser un schéma d’évolution à portée universelle. C’est, entre autres choses, la discussion avec certains populistes russes qui le poussera à relativiser sa première perspective. Cf. le chapitre 2 du présent volume
[5]Le texte, rédigée par Koustova l’une des rares dirigeantes social-démocrates de l’époque (avec Zassoulich) a circulé de manière informelle sans vraiment faire l’objet d’une publication en bonne et due forme. Nous nous sommes appuyés sur l’ouvrage suivant, qui le donne en annexe : V. Astrov, Les Économistes, précurseurs des mencheviks (L’économisme et le mouvement ouvrier en Russie au seuil du XXe siècle), Moscou, éditions Krassnaïa Nov’, 1923, p. 132-136.
[6]V. Astrov, op. cit., p. 134-135.
[7]Le texte est lui aussi donné dans le volume mentionné : V. Astrov, op. cit., p. 130-131.
[8]Ibid., p. 131.
[9]On prend ici le terme au sens russe du terme, c’est-à-dire en tant qu’il désigne une couche sociale formée de gens scolairement instruits par opposition à la fois à la classe ouvrière et à la paysannerie, mais également à la bourgeoisie définie par son capital économique. Il s’agit le plus souvent de petits fonctionnaires ou d’enseignants politisés sur les bancs de l’université.
[10]On y retrouve en effet aussi bien Lénine que ses futurs adversaires mencheviks et, plus à droite encore, les marxistes dits « légaux » passés à la bourgeoisie libérale après la révolution manquée de 1905. C’est notamment le cas de Strouvé, rédacteur du « Manifeste » dont il va être question.
[11]Il s’agit de la principale organisation populiste, passée à la postérité par ses attentats spectaculaires et dont la mémoire était particulièrement cultivée dans les organisations socialistes russes.
[12]Nous avons traduit le texte du manifeste à partir du fac-similé (et de sa transcription) disponible à cette adresse : http://www.agitclub.ru/center/comm/zin/1898pr.htm .
[13]On retrouve ici, en un sens, une traduction militante de la célèbre notion de « développement inégal et combiné » proposée par Trotski dans son histoire de la révolution russe : la Russie industrielle n’est pas simplement l’Angleterre industrielle avec cinquante ans de retard puisqu’elle s’inscrit dans des échanges internationaux qui lui permettent de bénéficier de certains transferts technologiques, avec leurs conséquences sociales, tout en la rivant à une position dominée au sein du capitalisme international. De même, la social-démocratie russe se voit modifiée par l’existence d’une social-démocratie européenne plus « avancée ».
[14]Le terme russe « koustarnitchestvo » vient du terme qui signifie « artisan » mais revêt déjà à l’époque une connotation péjorative, ce qui nous amène à traduire par « bricolage » (un autre terme possible étant « dilettantisme »).
[15]On la retrouve notamment dans le grand roman qui a donné son titre à la brochure de Lénine, le Que faire ? de Tchernychevski.
[16]On traite de cette idée plus en détail dans le chapitre suivant.
[17]Lénine fait ici une sorte de jeu de mots puisque la conscience (soznanié) devient connaissance (znanié). Le terme russe est bâti comme le nôtre, mais le fait de traduire znanié par « science » (pour rendre la parenté avec « conscience ») aurait forcé le russe.
[18]Par souci d’accessibilité, nous donnons les textes de Lénine dans leur édition la plus disponible : l’édition française des Œuvres, réalisée à partir de la 4e édition soviétique et publiée conjointement, dans les années 1960, par les Éditions du Progrès et les Éditions sociales. On abrège ainsi : Lénine, Oeuvres, tome 5, p. 431.