
Femmes au travail, femmes syndicalistes
À propos de : Cécile Guillaume, Syndiquées. Défendre les intérêts des femmes au travail, Paris, Presses de SciencesPo, 2018.
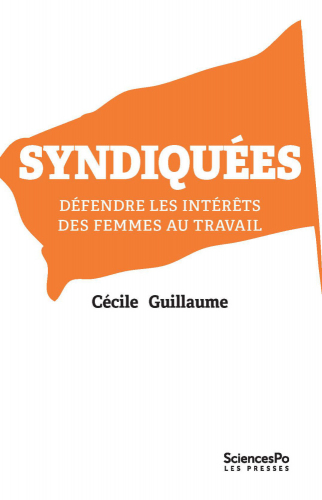
Céline Guillaume s’intéresse dans cet ouvrage à un objet encore sous exploité dans la recherche académique : la représentation syndicale des femmes et de leurs intérêts dans le monde du travail. Le taux actuel de syndicalisation des salariées atteint, voire dépasse dans certains syndicats, celui des hommes. Toutefois cette féminisation ne se traduit pas mécaniquement par une amélioration des conditions de travail des femmes qui continuent à subir de nombreuses discriminations (inégalités de salaire, moindre chance de promotion professionnelle, etc.) Partant de ce constat, l’auteure soulève une série d’interrogations qui structurent l’argumentation de l’ouvrage :
« comment expliquer cette sous-représentation de leur intérêt dans le monde du travail ? Quel lien peut-on faire entre la présence accrue, mais sélective, des femmes dans les syndicats et leur capacité à défendre la cause des femmes dans les entreprises ? Si elles sont encore peu présentes dans les fonctions dirigeantes et de négociation, comment peuvent-elles peser, en interne, pour faire valoir leurs intérêts professionnels ? Suffit-il d’avoir des femmes (et quelles femmes ?) pour améliorer la défense de leurs conditions salariées ? » (p.8).
Synthétisant ses travaux sur la question, l’auteure mobilise les données de plusieurs enquêtes, réalisées entre 2003 et 2015. Ces données combinent des « récits de carrière » de militant.es dans plusieurs syndicats britanniques (UNISON et GMB) et français (CFDT et Solidaires), des observations participantes (notamment quand l’auteure a été elle-même salariée pour la CFDT), des archives variées (celles produites par les syndicats étudiés, mais aussi par exemple par les employment tribunals chargés de traiter les plaintes pour discrimination salariale liée, ici, au genre) et enfin l’exploitation de questionnaires passés lors de différents congrès syndicaux. La méthodologie doublement comparative, entre le Royaume-Uni et la France, et entre quatre syndicats, permet de mettre en perspective l’analyse des processus de sous-représentations des femmes dans des contextes nationaux et locaux « contrastés » et ainsi de « faire émerger ce qui serait commun au monde syndical dans sa difficulté à représenter les femmes, mais aussi ce qui est spécifique à chaque contexte institutionnel, selon les périodes » (p. 52). Les récits de carrière, qui viennent ponctuer l’argumentation sous la forme de portraits, resituent les engagements militants dans leurs contextes institutionnels larges, mais aussi dans des parcours biographiques et professionnels singuliers, et permettent in fine de poser la question de l’exceptionnalité des femmes qui ont réussi à atteindre les postes prestigieux de la hiérarchie syndicale.
Le chapitre premier, qui synthétise les principaux travaux sur le genre et le syndicalisme, permet de prendre la mesure de l’évolution de la prise en compte du genre dans le monde du travail. A travers l’analyse de « fabrication des carrières syndicales », le deuxième chapitre met au jour la façon dont les quatre syndicats étudiés tendent à produire et légitimer les inégalités de genre, limitant ainsi les effets des politiques d’égalité développées par ailleurs. Enfin le dernier chapitre se focalise sur les syndicats britanniques qui ont pour particularité d’avoir développé des politiques d’égalité salariale plus précoces et plus volontaristes que les syndicats français.
Dans le chapitre premier, Cécile Guillaume revient donc sur les principales recherches sur le genre et le syndicalisme, notamment anglo-saxonnes, et analyse les dynamiques de la double sous-représentation des femmes dans le monde syndical. Double, car si les femmes ont longtemps été exclues des syndicats, elles sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à être syndiquées, certaines accédant même à des postes à responsabilités. Les intérêts des femmes continuent néanmoins à apparaitre marginaux dans le champ des luttes. Cet état de l’art éclaire ainsi les freins et les leviers de la féminisation des syndicats depuis les années 1970.
Elle insiste notamment sur la façon dont politiques de syndicalisation – dans un contexte de désertion du syndicalisme – et politiques d’égalité ont agi en tandem, dans la mouvance plus globale de politiques nationales et européennes en faveur de la lutte contre les discriminations. Ce contexte éclaire la syndicalisation massive de femmes. Les progrès en matière de représentation descriptive des salariées cachent cependant des effets de seuil, les syndiquées se confrontant toujours à un plafond de verre qui contraint leurs carrières syndicales.
L’auteure souligne, ce faisant, la pertinence d’une appréhension des mondes syndicaux sous l’angle des « régimes d’inégalité » (Joan Acker) pour mettre au jour les mécanismes internes aux syndicats qui, s’ils ne sont plus réfractaires à l’entrée des femmes dans leur rang voire mettent en œuvre des politiques volontaristes de mixité et de parité, coururent à reproduire les inégalités de genre. Suffit-il par exemple que des femmes accèdent aux responsabilités syndicales pour transformer les cultures syndicales ?
Si certains travaux pointent les effets positifs d’un leadership au féminin, plus inclusif et démocratique, d’autres soulignent la façon dont la présence de femmes ne suffit pas pour défendre la cause des femmes, les femmes leaders ayant tendance à s’aligner sur le style dominant (masculin) pour assoir leur légitimité. C’est d’ailleurs à l’écart des syndicats que certains groupes professionnels de femmes se mobilisent, à l’instar des aides à domicile étudiées par Christelle Avril.
Le deuxième chapitre, le plus dense, se focalise sur la fabrication des carrières militantes. C’est ici que les données de terrain sont particulièrement mobilisées et notamment les entretiens biographiques avec des militant.es « figures typiques du syndicalisme à la française ou à l’anglaise » (p. 66). L’auteure propose de mettre au jour les leviers et contraintes qui fondent les carrières syndicales, de la simple adhésion, en passant par la prise d’un mandat local et jusqu’à l’obtention d’un mandat national. Il apparait que « l’engagement […] s’appuie, peu importe le sexe, sur une intégration sociale et professionnelle forte » (p. 81).
Les caractéristiques de l’emploi féminin, plus instable et précaire, constituent ainsi le principal frein à l’engament syndical des femmes. Cet engagement ne saurait par ailleurs se passer du rôle de « passeurs » ou de « mentors » – le plus souvent des hommes – qui, dans des contextes de pénurie de candidats, sollicitent des femmes chez lesquels ils identifient des compétences, souvent naturalisées, susceptibles de répondre aux exigences des mandats de représentation. Les femmes accèdent ainsi à des petits mandats locaux (par exemple aux comités d’entreprise en France ou shop steward en Grande Bretagne) ou à des fonctions de représentation spécialisées (Comité Femmes, equality officer, etc.)
La montée en grade implique cependant l’acquisition de compétences plus techniques, dans un contexte de professionnalisation des carrières syndicales. La qualification apparait comme un levier essentiel pour les femmes, mais la production des inégalités résiste dans les processus formels et informels de l’activité professionnelle et syndicale. Ce sont finalement quelques rares femmes, le plus souvent blanches et déjà qualifiées, qui réussissent à faire une carrière syndicale durable. Cécile Guillaume pointe alors les effets limités de ce qu’elle nomme les « politiques d’égalité », qui n’empêchent pas la reproduction d’une forme « d’oligarchie syndicale ».
Le troisième et dernier chapitre se focalise sur les syndicats britanniques et revient sur l’histoire de la bataille pour l’égalité salariale au Royaume-Uni depuis les années 70 dans laquelle le recours à la justice s’est imposé comme un répertoire d’action légitime. Cette histoire révèle le rôle prépondérant d’« acteurs critiques », et notamment des « féministes de l’intérieur », mais aussi des hommes, qui se sont engagés dans la lutte pour l’égalité salariale au sein d’institutions pourtant parfois très réfractaires (et notamment les syndicats).
L’auteure analyse les conditions d’engagement de ces différents acteurs de la cause de l’égalité salariale, mais pose également la question de l’effectivité du droit en montrant par exemple comment l’avancée des législations ne se suffit pas à elle-même. Si le concept d’equal value marque un tournant dans les années 1980, sa mobilisation par les salarié.es et les syndicats n’aurait su se passer des actions stratégiques d’avocat.es, d’expert.es ou de responsables syndicales féministes susceptibles de soutenir les plaignantes. Au total, l’importation de catégories juridiques dans le monde syndical est venue mettre au jour les pratiques de négociation discriminantes dans les syndicats et bousculer un cadrage traditionnellement collectif des problèmes.
Pour conclure, l’approche sociohistorique développée par l’auteure permet de « saisir les effets de l’institutionnalisation du thème de l’égalité hommes/femmes dans les politiques publiques et de la législation sur les pratiques formelles des syndicats » et d’« analyser les dynamiques internes propres aux différents syndicats selon les contextes professionnels et les périodes » (p. 233)
Son analyse pointe la façon dont les rapports sociaux de genre tendent encore aujourd’hui à être invisibilisés dans le monde syndical. Si les politiques d’égalité traversent l’ensemble des syndicats, « l’efficacité des mesures repose en grande partie sur l’action de militant.es spécialisé.es ou sur la conviction de dirigeants locaux ». Face à la permanence de mécanismes informels qui produisent les carrières syndicales et reproduisent les inégalités, les recherches de Cécile Guillaume « invitent à nuancer la thèse d’une masse critique de femmes nécessaires pour réussir à changer les cultures organisationnelles » et soulignent la façon dont « la question de la portée transformatrice des politiques adoptées [reste] posée, dans le champ syndical comme ailleurs » (p. 236).
*
Mélodie Renvoisé est doctorante au Centre nantais de sociologie (UMR 6025).
Illustration : une manif des Lip de 1973, au centre-ville de Besançon, reconstituée pour le tournage du téléfilm, en juin 2010 (Arch. ER).









