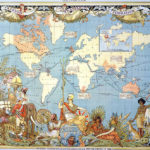Trump veut-il annexer la Suisse ?
Depuis le 2 avril dernier (Liberation Day), le président Donald Trump a fait appel à des dispositions légales d’exception pour manipuler les tarifs douaniers qu’il impose aux principaux pays qui exportent des marchandises aux États-Unis, sans passer par le Congrès. Son objectif déclaré vise d’abord à accroître les rentrées fiscales sans toucher aux bénéfices des grandes entreprises et aux intérêts des grosses fortunes américaines. Il attend entre 2 000 et 5 000 milliards de dollars de recettes supplémentaires dans les dix prochaines années. Par ce moyen, il prétend aussi contribuer à la réindustrialisation du pays. On le sait, ces prétentions sont contestées, mais le président des États-Unis croit dur comme fer à son programme néo-mercantiliste. Aujourd’hui, il aimerait voir figurer la Suisse sur son tableau de chasse.
Le Conseil fédéral incrédule
Le 1er août, jour de la fête nationale suisse, alors que les négociations sur la taxe de 31 %, annoncée le 2 avril, semblaient pouvoir aboutir à un « compromis raisonnable », Trump a surpris ses interlocuteurs en annonçant un taux de 39 %, applicable dès le 7 août, supérieur de 8 points à celui annoncé initialement. Les produits pharmaceutiques et l’or (que la Suisse se contente de fondre, de raffiner et d’estampiller) ne sont pas touchés pour le moment par ces mesures. L’industrie pharmaceutique, qui est pourtant la principale pomme de discorde entre les deux pays — ses ventes représentaient 48 % des exportations suisses aux États-Unis, en 2024 — ne l’est pas non plus.
Pourquoi cela ? Parce que les États-Unis ne peuvent sans doute pas se passer, dans l’immédiat, des importations pharmaceutiques suisses dans des domaines sensibles, notamment les médicaments brevetés contre le cancer. Comme au jeu de billard, la pharmacie est dans le collimateur, mais le locataire de la Maison-Blanche ajuste d’abord son tir sur les montres (7 % des exportations), les instruments de précision (6 %) et les machines (5 %), qui ensemble ne pèsent pas 40 % du poids des exportations pharmaceutiques. La manœuvre est destinée à faire pression sur le gouvernement helvétique, qui s’est toujours assigné la tâche essentielle de défendre les intérêts de « la place économique suisse », pour qu’il compense d’une façon ou d’une autre le déficit commercial qu’accuse Washington à l’égard de Berne (38,5 milliards de dollars, soit 3,2 % du déficit total du commerce des États-Unis en 2024).
Jouer sur les contradictions entre grandes puissances
Contrairement à une idée reçue, la Suisse est une grande puissance économique, même si elle manie habilement la rhétorique de la petitesse. Bien sûr, elle ne peut se comparer aux États-Unis, à la Chine, à l’Union européenne ou au Japon, raison pour laquelle sa stratégie a toujours consisté à entretenir de bons rapports avec les grands de ce monde en tentant de tirer profit de leurs conflits. Ainsi, les deux guerres mondiales ont-elles permis à la Confédération de développer sa place bancaire et son industrie d’exportation en conservant des relations économiques lucratives, tant avec l’Allemagne, qu’avec l’Angleterre et les États-Unis.
Après le Second conflit mondial, elle a réussi à régler son différend avec les Alliés, lié à ses relations économiques soutenues avec les puissances de l’Axe. Il avait conduit au blocage de ses avoirs aux États-Unis, au boycott de certaines de ses entreprises, à l’exigence de la restitution intégrale de l’or volé par les nazis et acquis par la Suisse, ainsi que celle des fonds allemands placés dans ses banques. Pour solde de tous comptes, elle a finalement pu ne verser que 250 millions de francs suisses – beaucoup moins que ce qui avait été exigé au départ –, compte tenu du commencement de la guerre froide et de son adhésion inconditionnelle au camp occidental (Accords de Washington, 1946).
En janvier 1950, la Suisse a été l’un des premiers pays occidentaux à reconnaître la Chine populaire, en qui elle voyait déjà, en dépit de son régime communiste, une puissance économique d’avenir. En 1960, elle a choisi de s’intégrer à l’Association européenne de libre-échange (AELE, avec le Royaume-Uni, l’Autriche et les pays scandinaves), aux structures beaucoup plus lâches, qui lui garantissaient la possibilité de poursuivre une politique d’indépendance par rapport aux principaux blocs. En 1982, elle a signé un premier accord bilatéral avec la Chine populaire. Dans les années 1990, elle a refusé l’Espace économique européen (EEE) et la perspective d’une adhésion à l’UE pour se placer à l’interface entre l’UE, les États-Unis et les économies émergentes d’Asie, en particulier la Chine. Comme l’écrit l’historien suisse, Sébastien Guex, « la grande bourgeoisie bancaire et industrielle helvétique est devenue virtuose dans l’art de jouer sur les contradictions entre grandes puissances impérialistes afin d’avancer ses propres pions »[1].
Fin de la lune de miel entre la Suisse et les États-Unis ?
Après la disparition de l’Union soviétique, en 1991, la Suisse n’a plus bénéficié de son statut de représentant discret des intérêts des États-Unis à Cuba (depuis 1961), en Égypte (de 1967 à 1974) — période durant laquelle la Confédération a accueilli à bras ouverts les représentants des Frères musulmans, soutenus par Washington pour contrer le nationalisme arabe de Nasser —, en Iran (de 1980 à 1981) ou au Vietnam (de 1975 au début des années 1990). Elle était devenue une puissance économique rivale, notamment dans le domaine bancaire, mais aussi dans certains secteurs industriels.
Sous pression des États-Unis, auxquels ne déplaisait pas de faire de l’ombre à la place financière suisse, l’UBS et le Crédit Suisse n’ont pu échapper au scandale des fonds juifs en déshérence, entre 1995 et 1998, qu’en versant la somme de 1,25 milliard de francs suisses (2 milliards d’euros actuels) à un fonds de compensation destiné à indemniser les héritiers des titulaires de ces comptes, les travailleurs forcés qui ont eu affaire à des entreprises suisses, les réfugiés refoulés à la frontière suisse et les survivants de la Shoah lésés dans leurs relations avec la Suisse. Cette affaire a forcé le Conseil fédéral à nommer une commission, dirigée par l’historien Jean-François Bergier, pour faire la lumière sur les relations de la Suisse avec l’Allemagne nazie[2].
En 2008, accusée d’aider des contribuables américains à dissimuler des avoirs non déclarés, l’UBS a dû verser une amende de près de 780 millions de dollars aux États-Unis et leur fournir la liste de plusieurs milliers de clients soupçonnés de fraude fiscale, forçant la Suisse à abandonner progressivement le secret bancaire. Dès 2010, la loi américaine a contraint les banques étrangères à déclarer les avoirs détenus par des citoyens des États-Unis — La Suisse a été contrainte de signer un accord spécifique pour la mise en œuvre de ces dispositions. Depuis lors, plusieurs banques suisses ont été sanctionnées ou ont dû négocier des conventions pour éviter des poursuites pénales.
Pourquoi Washington cible-t-il l’industrie pharmaceutique suisse ?
Depuis les années 1970, les États-Unis dénoncent l’industrie pharmaceutique suisse comme un concurrent déloyal, notamment Roche, Ciba-Geigy et Sandoz, qui dominaient certains segments du marché mondial. Dans les années 1980, sous la pression de Pfizer et Merck, ils accusent la Suisse de profiter d’un système de brevets plus souple. Au cours des années 1990, par le biais de l’OMC et des accords TRIPS, ils imposent une protection accrue de la propriété intellectuelle. Les tensions croissent alors avec l’industrie suisse, accusée de fausser la concurrence et de pratiquer des prix trop élevés aux États-Unis pour financer sa R&D – et pour servir de copieux dividendes à ses actionnaires, ajouterais-je –. Le coup de Trafalgar de Trump est donc l’aboutissement d’un long processus.
Dans le domaine pharmaceutique comme dans le domaine financier, la Suisse constitue une concurrence pour le capitalisme américain. La Suisse représente 5 à 7 % du marché mondial des médicaments et se place au 5e rang des exportateurs mondiaux. Elle concentre deux sièges sociaux de Big Pharma — Roche et Novartis — parmi les plus innovantes au monde. Chacun de ses employés en Suisse génère plusieurs centaines de milliers de francs de valeur ajoutée. Elle dispose de positions de quasi-monopole dans certains traitements du cancer, de maladies dégénératives ou d’affections rares.
Au Livre 3 du Capital, Marx écrivait : « les capitalistes, se conduisent en faux frères lorsqu’ils se font la concurrence [et] s’entendent comme des francs-maçons lorsqu’il s’agit d’exploiter la classe ouvrière ». Ici, ils rentrent en conflit sur un marché mondial dominé par de grands monopoles, soutenus fermement par leurs États. En tournant le dos à la « mondialisation heureuse », depuis la crise systémique de 2008, les intérêts économiques majeurs, représentés généralement par des États, se heurtent de plus en plus directement sur le marché mondial et sur la scène internationale. Si les États-Unis mènent aujourd’hui le bal, c’est qu’ils ont perdu l’assurance d’une « suprématie naturelle ».
Céder sur toute la ligne pour sauver l’essentiel ?
Pour les entreprises suisses, le choc paraît particulièrement rude, alors qu’en 2024, leurs exportations aux USA représentaient 18,6 % du total de leurs ventes à l’étranger. Selon différents instituts de prévisions conjoncturelles, l’application de ces mesures pourrait réduire la croissance de la Suisse en 2025 et 2026, de 1 à 0,7, voire à 0,3 %. Le camouflet est d’autant plus sévère, que le Royaume-Uni (avec des taxes de 10 %, moyennant certaines restrictions) et l’Union européenne (15 %) ont obtenu des conditions plus avantageuses, même si plusieurs questions restent encore à régler. Il est possible que l’attaque portée contre la Suisse vise aussi l’Allemagne et l’UE, que les États-Unis souhaitent ainsi avertir qu’ils sont prêts à une escalade.
Les partis gouvernementaux suisses affichent évidemment des divisions quant à la réponse à apporter à ce défi, auquel il leur faut réagir dans l’urgence. C’est d’autant plus vrai que la Big Pharma est aujourd’hui le vaisseau amiral de l’industrie suisse. Ainsi, l’ancien diplomate, Tomas Borer, qui dirige une agence de conseil prestigieuse, a conseillé aux autorités de céder sur toute la ligne, lors d’une entrevue accordée, le 3 août, à la très conservatrice Neue Zürcher Zeitung. Le 11 juillet 1997, il y a près de 30 ans, alors qu’il était négociateur dans le dossier des fonds juifs en déshérence (1996-1998) et ambassadeur de Suisse en Allemagne, il avait justifié ainsi au quotidien belge, Le Soir, l’attitude du gouvernement suisse pendant la Seconde Guerre mondiale : « Nous n’étions qu’un îlot dans l’océan allemand ». Aujourd’hui, il suggère d’accorder à Donald Trump les compensations nécessaires à la protection des intérêts vitaux des grands groupes helvétiques.
Il propose d’augmenter les investissements suisses aux États-Unis — 500 entreprises suisses y sont déjà actives, où elles emploient 400 000 personnes —, d’acheter du gaz liquéfié et d’augmenter les acquisitions d’armements américains, mais aussi de lever les protections tarifaires et non tarifaires (sanitaires) qui protègent l’agriculture suisse. Accessoirement, il recommande de dépêcher Guy Parmelin à Washington, ministre de l’UDC (le parti de droite nationaliste proche des républicains américains), « un vieil homme blanc parlant avec l’accent français » (sic). Certains conseillers recommandaient même de rencontrer Trump sur un terrain de golf où il est de meilleure humeur. Il insiste sur le fait que les États-Unis sont une superpuissance et que la Suisse ne doit pas tenter de leur résister frontalement.
Imaginons un instant que Trump songe à transformer la Suisse en un État américain à part entière, après le Canada et le Groenland. Il pourrait faire office de paradis fiscal états-unien au cœur de l’Europe, à portée des stations de ski déjà détenues par des capitaux américains, comme Crans-Montana, et du siège du Forum économique mondial de Davos, mais aussi à quelques heures d’avion des colonies balnéaires méditerranéennes qui occupent les rêves du président : l’île albanaise de Sazan, dans laquelle son gendre va investir 1,4 milliard de dollars pour développer une villégiature pour super-riches, ou la bande de Gaza, dont il a annoncé vouloir prendre le contrôle, en février dernier, pour en faire la future « Riviera du Moyen-Orient » ? Après tout, le PDG de Novartis est déjà américain et une telle annexion éviterait à la Big Pharma helvétique de déplacer une partie supplémentaire de ses investissements aux États-Unis… Le 1er avril dernier, un humoriste américain n’avait-il pas conçu un scénario dans ce sens ?
La Big Pharma helvétique a plus d’une corde à son arc
Des droits de douane de 39% sur le marché américain pourraient certes réduire sensiblement les bénéfices des Big Pharma helvétiques. Toutefois, au cours de ces cinq dernières années, on relèvera que Roche a réalisé un bénéfice net annuel moyen de 12,3 milliards de francs par an (ses dividendes ont crû de 6,3%), et Novartis, de 13,2 milliards de francs (ses dividendes ont crû de 16,6%). Ces entreprises et leurs actionnaires disposent donc de marges de manœuvre considérables.
De plus, l’industrie pharmaceutique n’a pas attendu le dernier coup de sang de Trump pour prendre certaines dispositions. En 2024, le troisième pays importateur de produits suisses (le premier pour les produits pharmaceutiques, légèrement devant les États-Unis) est un petit État de 2 millions d’habitants, membre de l’UE : la Slovénie. La société suisse Sandoz y avait acquis l’entreprise Lek, en 2002, spécialisée dans les biosimilaires (analogues aux génériques, parce que moins chers, mais pour les médicaments biologiques utilisés dans le traitement du diabète, des maladies cancéreuses, des anticorps monoclonaux, etc.). Depuis, la Suisse en a fait sa principale « succursale pharmaceutique ».
Pour les droits de douane, il suffit que la dernière phase de production d’un médicament soit effectuée en Slovénie pour qu’il soit compté dans les exportations de ce pays et s’acquitte des droits de douane de l’UE aux États-Unis. Faisons confiance à Sandoz et à Novartis, qui y sont déjà bien implantés, pour déplacer, si nécessaire, une part plus importante de leur production dans ce pays. Le transporteur suisse Kuehne+Nagel a d’ailleurs déjà bâti un entrepôt géant de 38 000 m2, spécialisé dans le stockage des médicaments (avec contrôle de températures), à portée de l’aéroport de Ljubljana. Bien sûr, il ne suffit pas d’exporter des médicaments suisses en Slovénie pour les réexporter aux États-Unis à l’enseigne de l’UE, mais ce détour peut offrir des possibilités, moyennant un peu d’imagination.
Faire payer la note à la population suisse, à moins que…
Depuis l’an 2000, le franc suisse a été réévalué de 48 % par rapport au dollar et de 66 % par rapport à l’euro. Cette hausse continue du franc sur le marché des changes a été absorbée par les gains de productivité de l’industrie d’exportation et par une politique des salaires et des dépenses publiques extrêmement restrictive : en termes réels, les salaires de 2024 n’ont pas encore rattrapé ceux de 2021 ; la dette nette du pays se monte à 17,2 % seulement de son PIB et son déficit budgétaire pour l’exercice 2024 représente un pour mille de ses dépenses totales ! Pourtant, en réponse au défi douanier de Trump, l’association patronale de l’industrie des machines, Swissmem, a avancé une liste de 10 revendications à l’adresse des autorités fédérales. Elle demande notamment le blocage des dépenses sociales et des mesures environnementales, la signature de nouveaux accords bilatéraux, une attention particulière aux Accords bilatéraux III avec l’Union européenne (un préprojet d’accord est actuellement en consultation en Suisse) et la suppression du contrôle des investissements étrangers (Lex China).
Si le sort de la majorité de sa population était la préoccupation première du gouvernement helvétique, il ne céderait pas aux exigences de Trump qui conduisent de plus en plus clairement à une dictature planétaire des multimillionnaires. Il s’efforcerait au contraire de développer des partenariats industriels et commerciaux avec les pays qui tentent de lui résister. Il lancerait un vaste programme d’investissements publics en faveur du logement social, des transports publics, de l’environnement, de la recherche et de la solidarité internationale. Il dénoncerait le génocide en cours à Gaza et apporterait une aide médicale massive aux victimes de l’offensive coloniale israélienne. Bref, il refuserait d’emboîter le pas à une course effrénée au démantèlement social, écologique et humanitaire de ce monde.
De telles mesures répondraient à de véritables besoins sociaux, écologiques et à un sentiment de justice élémentaire. Elles permettraient accessoirement de lutter contre un franc de plus en plus fort en période de montée des protectionnismes – le très faible taux d’endettement de la Suisse entraînant mécaniquement le renforcement continu de sa monnaie. La Confédération en aurait aujourd’hui largement les moyens, compte tenu de sa situation financière exceptionnelle. Toutefois, seule une mobilisation sociale de grande envergure pourrait imposer une telle volte-face à une politique socioéconomique dictée aujourd’hui par les intérêts d’une toute petite minorité. L’évoquer, c’est déjà faire un tout premier pas dans cette direction.
Notes
[1] Sébastien Guex, « L’impérialisme suisse ou les secrets d’une puissance invisible »
[2] Le rapport Eizenstat : texte intégral / [étude préliminaire coordonnée par Stuart E. Eizenstat], Lausanne, éd. Nouveau Quotidien, 1997. Commission indépendante d’experts Suisse–Seconde Guerre mondiale, La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale : rapport final, Zurich, éd. Pendo, 2002. Pietro Boschetti, Les Suisses et les nazis : Le rapport Bergier pour tous, Genève, éd. Zoé, 2004.

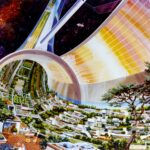


![Trump, la Big Tech et la contre-révolution « libertarienne » : où va l’extrême droite US ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_presents_Commander-in-Chiefs_Trophy_to_Army_team_of_fighters_02-150x150.jpg)