
Back before Trump. Marcuse face au bonapartisme de l’ère Nixon
La victoire de Trump a-t-elle inauguré une nouvelle époque des démocraties capitalistes, comme on le dit parfois à gauche ? Peut-on imaginer, sous quelles conditions et sous quelles formes, un virage des bourgeoisies vers le néo-fascisme ? Pour éclairer ces questions, Emmanuel Barot opère ici un déplacement en revenant sur les analyses méconnues de Herbert Marcuse sur l’ère Nixon, développées dans les années 1960 et 1970. Cet article est paru initialement sur le site Révolution permanente.
Un certain nombre d’historiens, de journalistes, pointent des similarités entre Trump et Nixon, que ce soit sur le style de gouvernement, la personnalité autoritaire et imprévisible, le Huffington Post allant jusqu’à dire en janvier dernier que le « fantôme de Nixon » « rôdait » autour de l’investiture de Trump. Mais si ce rapprochement fait sens c’est surtout pour des raisons plus profondes, que le présent article souhaite contribuer à examiner. Cet article prolonge deux études antérieures.
Dans notre précédent article sur Marcuse, nous ouvrions en conclusion sur les tâtonnements qui ont été les siens lorsqu’il a tenté de caractériser la « nouvelle ère de répression » de la seconde présidence Nixon. Il s’interrogeait sur le « bonapartisme » de ce dernier et l’existence de germes plus ou moins « proto-fascistes » du régime et de la société face à l’instabilité croissante due à la crise économique et sociale naissante engendrée par les contradictions de l’impérialisme américain. La réflexion sur la nature et la signification de la victoire de Trump réactualise le même type d’indécisions, comme en témoignent les approches variées, de Judith Butler à Enzo Traverso en passant par l’historien Robert Paxton. Revenir sur ces études de Marcuse contribuera donc directement à la réflexion sur la situation actuelle.
Marcuse s’est intéressé de près au tout début des années 70 aux formes spécifiques que la contre-révolution capitaliste a prises aux Etats-Unis, spécialement sous l’ère Nixon. La première partie de Contre-révolution et révolte (« La gauche sous la contre-révolution ») de 1972 leur est largement consacrée, de même que plusieurs articles toujours inédits en français aujourd’hui, et en particulier le texte « The Historical Fate of Bourgeois Democracy », rédigé également en 1972, (« le destin historique de la démocratie bourgeoise ») qui lui ne fut même publié en anglais qu’en 20011. En l’occurrence il cherche à comprendre une nouvelle phase de l’autodestruction de la démocratie bourgeoise, son entrée dans une « nouvelle ère de répression » marquée par sa transformation en un état guerrier et policier, l’hyperinflation du discours de la « sécurité nationale », l’émergence structurelle d’un syndrome « proto-fasciste », dans un contexte de niveau zéro, ou presque, de la lutte de classe, même si la crise sociale et la révolte irriguent toute la société américaine.
Celle-ci, pour autant, n’est pas pour Marcuse une société fasciste, et crier sans nuance et prématurément au « danger fasciste » serait autant une erreur théorique qu’une faute politique. Son effort et ses tâtonnements pour donner une caractérisation précise de cette période transitoire l’amène en ce sens à proposer une lecture bonapartiste de l’ère Nixon, sur des lignes comparables à celles de Trotsky dans les années 30. Il en tirera une forme un peu imprécise de « front unique » au titre d’alternative contre la généralisation et l’intensification de cette mécanique répressive. Si Marcuse récuse l’idée d’un « danger fasciste » immédiat dans l’Amérique de Nixon, pour autant il est urgent et vital de s’affronter efficacement, dit-il, à cette
« organisation d’une contre-insurrection à une échelle inédite, chez soi et à l’étranger… [qui] ne sert pas seulement à empêcher préventivement la révolution, mais aussi à contrebalancer les contradictions du système capitalisme qui s’aggravent actuellement »2.
On ne peut que regretter que Marcuse soit totalement ignorant des textes de Gramsci et de Trotsky sur ces questions, et l’on pourra constater que sur le terrain des perspectives, de la stratégie et de la tactique, cette ignorance induit une série de limites, ou du moins d’ambiguïtés. Cela fera l’objet d’un autre article. Dans l’immédiat, et même si toute analogie historique ne vaut évidemment que sous conditions et dans certaines limites, comparaison n’est jamais raison, s’approprier la réflexion qui fut la sienne au sujet de ce bonapartisme de Nixon ne pourra qu’alimenter la réflexion actuelle sur les Trump et consorts, le lecteur verra vite que par bien des aspects nous sommes dans une situation de même nature.
I. De la « grande société » de Johnson à l’instabilité de la fin des années 1960
Revenons d’abord à la décennie antérieure. Quand Marcuse écrit L’homme unidimensionnel en 1964, il n’y a pas encore de crise intérieure. La croissance américaine reste forte, c’est le plein-emploi, la « consommation » bat son plein, facteurs ou tendances à l’intégration permettant à la bourgeoisie et à l’Etat américains de garder la haute main sur l’ensemble.
Au plan international, au pur et simple anticommunisme anti-soviétique qui s’était incarné dans la maccarthysme, l’impérialisme américain, depuis la révolution cubaine, se focalise de plus en plus sur les luttes de libérations nationales pour éviter à tout prix qu’aucune nouvelle enclave socialiste ne voit le jour : soit par l’intervention militaire directe, par exemple au Vietnam, soit en organisant des putschs militaires, par exemple en Amérique Latine. Simultanément, s’opère la détente progressive des relations avec l’URSS et la Chine, tournant qui s’incarnera dans les voyages de Nixon à Moscou et Pékin en 1972.
Mais en arrière-fond, le militarisme américain se renforce et confirme la dimension destructive de son économie. L’émergence du mouvement pour les droits civiques et contre la ségrégation raciale d’un côté, le mouvement étudiant anti-impérialiste de l’autre, le mouvement féministe enfin, ne constitueront pas, au début, des épines réelles face à un pouvoir qui sait encadrer, et mater au besoin, la révolte et la subversion, dans un contexte où le mouvement ouvrier organisé reste très silencieux.
En résumé, au milieu des années 1960, Marcuse insistait lourdement sur l’apparente capacité de la « société de consommation » à produire une sorte de « conscience heureuse » perpétuelle chez les exploités. C’est l’époque de la présidence démocrate Johnson, qui tente de réussir le tour de force de mener la guerre au Vietnam tout en promouvant, formellement aux antipodes, le projet repris de la politique sociale de Kennedy, en matière d’éducation, d’accès à la santé et de lutte contre le racisme, d’une « Grande société » (Great Society) progressiste pour les Etats-Unis.
C’est l’évolution de cette contradiction qui caractérise les années suivantes. Dans l’article « L’individu dans la Grande Société » de 1966, Marcuse écrit ceci :
« Un tel programme, traduits dans les faits, signifierait effectivement une importante amélioration des conditions existantes. Toutefois, la réalisation de la Grande Société, même à l’intérieur du cadre donné, exigerait une réduction considérable et permanente de l’establishment militaire et de ses manifestations physiques à travers toute la société – autrement dit, elle exigerait des changements politiques et économiques majeurs, avant tout dans le domaine de la politique extérieure. A défaut d’un tel changement, la Grande Société serait comme un Etat social [Welfare] tout prêt à se muer en Etat martial[Warfare, mobilisé pour la guerre] » (Pour une théorie critique de la société, Paris, Denoël-Gonthier, 1971 p. 204)
La fin des années 60 va concrétiser cette mue, dans le prolongement de l’intensification de la guerre au Vietnam en 1965. Ce tournant atteste que les Etats-Unis n’exercent plus la même suprématie universelle que dans l’immédiat après-guerre. D’absolue, leur hégémonie est devenue relative, en raison d’une multiplicité de facteurs économiques, technologiques, militaires et sociaux3.
Cela les conduit à chercher à compenser par un déploiement de forces supérieur, et à réorganiser leur politique intérieure dans un contexte où, comme le note Howard Zinn, le mouvement pacifiste, face notamment aux dizaines de milliers de soldats tués au combat et au demi-million d’américains engagés au Vietnam, se fait de plus en plus puissant et où les cotes de popularité et de confiance du gouvernement et du président sont en chute libre, ce qui fait que
« au début des années 1970, le système semblait devenu parfaitement incontrôlable : il ne pouvait plus garantir la loyauté de la population » (Histoire populaire des Etats-Unis, Paris, Agone, éd. 2002, p. 607).
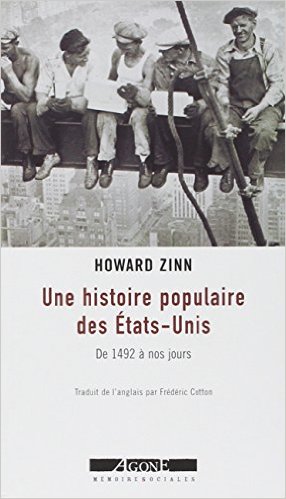
Ce caractère incontrôlable ne provient pas seulement de la guerre : l’instabilité croît sur fond de crise sociale et économique. En effet à la fin des années 1960 émerge toute une série de symptômes avant-coureurs de la crise qui éclatera quelques années plus tard, et s’enracinera en 1973 à partir du choc pétrolier. La situation devient plus instable : inflation, chômage et précarité, en particulier, reflets d’une baisse du taux de profit moyen dans les entreprises qui a débuté en 1966, amènent les contradictions sociales et politiques à s’aiguiser.
Mais les Démocrates restent incapables de tenir tête aux Républicains, le mouvement syndical demeure sur la défensive, et la New Left, divisée, n’arrivant pas à formuler un programme et une stratégie capable à la fois d’articuler les revendications des différents « mouvements sociaux » en se liant étroitement à la classe ouvrière, et de rendre possible une alternative de masse. Pourtant les minorités raciales, noires en particuliers, continuent de subir l’ordre raciste et policier, les étudiants n’abandonnent pas la partie, tentant de poursuivre l’esprit du mai 68 français. Une partie de la jeune génération ouvrière se révolte à son tour, contre l’ordre patronal, les baisses de salaires, les intensifications de cadences, etc. Mais cela reste très sporadique, désorganisé, diffus. Grèves ou occupations sauvages, diverses formes des sabotage, absentéisme croissant, rejet de « l’efficacité » à tout prix, autant de dynamiques qui n’entrent pas en confluence avec les organisations existantes.
Tout cela contribue à polariser un climat social déjà dégradé, marqué par l’effritement rampant du rêve américain et la nostalgie croissante, dans les classes dites « moyennes », d’un âge d’or conspué par ces militants organisés, communistes, anarchistes, pacifistes en tous cas, ou révoltés non-organisés, lesquels, passant de façon croissante à l’action directe, notamment dans la foulée de l’assassinat de Martin Luther King à Memphis en 68, se voient taxés d’anti-américains, de séditieux et de terroristes, et seront la cible privilégiée de la répression étatique et policière4. En résumé, la vérité de la « société de consommation » éclate :
« Le terme de « société de consommation » est d’abord une escroquerie verbale de première grandeur, car rarement une société aura été systématiquement organisée dans l’intérêt de ceux qui ont la haute main sur la production. La société de consommation est le modèle d’autoreproduction du capitalisme monopoliste d’Etat à son stade le plus avancé. Et c’est à ce stade que la répression se réorganise : la phase « démocratique-bourgeoise » du capitalisme s’achève et fait place à une phase contre-révolutionnaire » (Contre-révolution et révolte, p. 39)
L’ère Nixon, symbole de l’autodestruction de la « démocratie » en temps de crise
Début des années 1970, la crise sociale est donc là, commence à faire prédominer des tendances à la désintégration et à une violence sociale accumulée, et la « loyauté de la population » est sujette à caution. Faute d’une alternative révolutionnaire capable de défendre et promouvoir une transition vers le socialisme, ces tendances alimentent et vont alimenter la transformation de la démocratie bourgeoise « libérale-progressiste » en une société « réactionnaire-conservatrice » (Historical Fate, p. 165), « orwellienne » (totalitaire, au sens du 1984 d’Orwell) dit Marcuse à de nombreuses reprises, celle d’un Etat guerrier et policier spécifique, sous la houlette d’un Nixon qui s’était fait élire en 68 face à un adversaire démocrate portant le poids de l’impopularité de Johnson.
Sa présidence est celle par laquelle s’amorce la destruction de l’Etat-providence et du « consensus libéral » associé à l’ordre issu du New Deal, et le développement d’un nouveau type d’interventionnisme d’Etat, poursuivant et radicalisant le militarisme de la présidence Johnson. La stratégie nixonienne de conquête repose sur la formation d’une nouvelle coalition conservatrice appuyée, moyennant une rhétorique sociale, sur le ressentiment de la petite-bourgeoisie et d’une fraction de la classe ouvrières blanches, à la fois de plus en plus en rupture de ban avec les démocrates et profondément opposés à la « violence » des mouvements pour les droits civiques et étudiants.
Cette stratégie paye encore plus en 1972 qu’en 1968, lorsqu’il est réélu de façon triomphale contre le candidat démocrate et pacifiste McGovern, et l’on peut voir cette date comme le début de la « révolution conservatrice » qui culminera, début des années 1980, avec le tournant néolibéral et populiste incarné par l’élection de Reagan. Par-delà leur divergences d’interprétation, il est frappant que les historiens de cette période s’entendent de fait sur la transition qu’incarne Nixon, se demandant s’il est, dans le camp de la droite, « le dernier des libéraux ou le premier des conservateurs »5.
II. Bonapartisme selon Marcuse
Marcuse s’était engagé dans la théorie du fascisme dès les années 1930 dans le cadre des travaux de l’Ecole de Francfort sur « l’Etat total » et les formes contemporaines de l’autorité, de la sphère familiale à la sphère politique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a un temps travaillé avec d’autres intellectuels exilés au sein de l’Office of Strategic Service du département d’Etat américain qui se consacrait à l’étude de la structure et des évolutions de l’Allemagne nazie. A ces textes des années 1940 publiés tardivement6, ont ensuite succédé les analyses, plus connues, avec leur ancrage freudo-marxiste, des mécanismes d’aliénation et de contrôle des subjectivités et des affects propres à l’infrastructure de production et de consommation du capitalisme américain.
Un axe continu de ses analyses, parfaitement dans l’esprit du Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte de Marx, est, comme prolongement de la connexion entre l’analyse matérialiste des contradictions de l’impérialisme et du capitalisme monopoliste en crise et des logiques politiques, idéologiques et institutionnelles associées, et l’enquête plus « subjective » sur les structures et schémas mentaux et comportementaux, l’étude des mentalités sur lesquelles ces contradictions objectives s’appuient et qu’elles entretiennent. Son étude de l’ère nixonienne reconduit cette approche. Le premier réquisit méthodologique est pour lui de récuser tout usage réifié de concepts prétendument valables a priori ou de façon transhistorique, et d’essayer de suivre au plus près, comme l’exige Trotsky, la singularité de la situation concrète.
Dans sa préface allemande à une réédition du Dix-huit brumaire de Marx, traduite en 1969 dans la revue Radical America, il rappelle que « l’analyse par Marx de la façon dont la révolution de 1848 se développa dans la domination autoritaire de Louis Bonaparte, anticipe la dynamique de la société bourgeoise avancée : la liquidation de la phase libérale de cette société s’opère sur la base de sa structure propre », et précise-t-il sous des formes et à des degrés encore plus tragiques. Parlementarisme en fin de règne, la bourgeoisie face à l’alternative historique qui émerge entre « despotisme » et « anarchie », choisit naturellement le premier. Marcuse insiste alors sur un trait pour lui déterminant, la légitimité populaire qu’un tel pouvoir doit conquérir, et rappelle le plébiscite qui vit l’élection à la présidence de Bonaparte en décembre 1848, et qui se radicalisera en coup d’Etat et en dictature fin 1851. C’est, tout d’abord, cette forme de dictature plébiscitaire post-parlementaire qu’il voit à l’œuvre en 1972.
« Le spectacle de la réélection de Nixon est le modèle cauchemardesque de la période au cours de laquelle l’auto-transformation de la démocratie bourgeoise en néofascisme s’opère – stade le plus élevé (de loin !) du capitalisme monopolistique d’Etat » (Historical Fate, p. 170).
« Néo-fascisme » ? On y revient plus bas. Dans un contexte contre-révolutionnaire, et en l’absence d’une alternative solide à gauche, le « cercle vicieux » de la démocratie bourgeoise s’exprime par le fait que toute élection est condamnée, en l’état, à voir vaincre un membre de « l’establishment » appuyé sur une majorité conservatrice. Majorité « populaire » pourtant. Premier point : ce « peuple » absolument non délimité, interclassiste (qui a même, regrette évidemment Marcuse, pénétré certains courants de la gauche radicale), cette mystification nationaliste par excellence qui est exaltée lors l’élection de 1972, est avant tout le produit d’une stratégie populiste réactionnaire qui réussit, tout particulièrement, à capter une part considérable des voix ouvrières en plus de celle des classes moyennes et petite-bourgeoises. C’est le premier aspect du bonapartisme nixonien.
« La démocratie bourgeoise entretient la structure de classe capitaliste, et en même temps, la classe dominée, la population subalterne au sens large devient le sujet-objet de la politique et de cette démocratie : le peuple, « libre » au sens et à l’intérieur des limites du capitalisme, qui, au travers de cette liberté, reproduit sa servitude ». (Historical Fate, p. 167)
Enfin, indépendamment de Nixon, le vote croissant d’extrême-droite (mairie de Philadelphie, score électoral important de G. Wallace aux présidentielles de 1968, démocrate connu pour sa politique ultra-ségrégationniste en Alabama) est pour Marcuse un autre symptôme évident du mouvement à droite de l’échiquier politico-idéologique.
« Bonapartisme »… « sans Bonaparte »
Second point. L’avant-dernière citation montre que Marcuse manque parfois de précision, passe insensiblement de la caractérisation « bonapartiste » à celle du « néofascisme », « néo » englobant à la fois l’aspect « proto » déjà indiqué, d’une société qui n’est pas fasciste, mais qui, donc, en enveloppe la possibilité. D’où cette évocation du bonapartisme :
« Bonapartisme ? Peut-être, mais sans Bonaparte, sans le dictateur charismatique réel ou apparent. Dans tous les cas, l’analyse est confrontée à des changements structurels qui militent contre la congélation de ses concepts élaborés à des stades antérieurs du développement. » (Historical Fate, p. 167)
« Bonapartisme sans Bonaparte » : où l’on ne peut que regretter que Marcuse ne soit pas au fait des élaborations de Trotsky et Gramsci, ce dernier caractérisant exactement dans ces termes le « césarisme moderne », comme « césarisme sans César ». Marcuse ce faisant semble douter de la pertinence de la catégorie, alors que c’est clairement celle qui convient le mieux à son analyse, comme en témoigne la longue citation suivante qui articule ses principales coordonnées :
« L’administration Nixon a renforcé l’organisation contre-révolutionnaire de la société dans toutes les directions. On a fait des forces de l’ordre et de défense de la loi une force au-dessus des lois. Dans de nombreuses villes, l’équipement normal de la police ressemble à celui des SS ; la brutalité de leur action nous est familière. Une dure répression s’abat sur les deux foyers de l’opposition radicale : les centres universitaires et les militants non blancs ; toute activité est étouffée sur les campus et le parti des Black Panthers a été systématiquement pourchassé avant de se désintégrer sous la pression de ses conflits internes. Une immense armée d’agents en civil quadrille tout le pays, s’infiltre dans toutes les branches de la société. Le Congrès a baissé pavillon (ou plutôt, s’est lui-même émasculé) devant l’exécutif, lequel dépend à son tour de son énorme appareil militaire.
Il ne s’agit nullement d’un régime fasciste. Les tribunaux protègent encore la liberté de la presse ; les journaux « underground » sont encore en vente libre, et les media tolèrent une critique vigoureuse et assidue du gouvernement et de sa politique. Bien sûr il n’y a guère de liberté d’expression pour les Noirs, et on limite efficacement celle des blancs. Mais les droits de l’homme sont toujours là : dire (et c’est juste) que le système peut encore se « permettre » le luxe de ce genre de contestation, n’est pas un argument pour nier l’existence de ces « libertés ». Plus décisive est la question de savoir si la phase actuelle de contre-révolution préventive (sa phase démocratique-constitutionnelle) ne prépare pas le terrain à une phase fasciste ultérieure.
Il n’est sans doute pas nécessaire d’insister longuement sur le fait que la situation est différente aux Etats-Unis de ce qu’elle était dans l’Allemagne de Weimar : il n’existe pas de parti communiste fort, pas d’organisations paramilitaires de masse, pas de crise économique généralisée, on ne manque pas d’ »espace vital », on n’a pas de chefs charismatiques, la Constitution et le gouvernement constitué fonctionnent bien, etc. L’histoire ne se répète jamais exactement, et un degré supérieur de développement capitaliste aux Etats-Unis appellerait un degré supérieur de fascisme. Ce pays possède, pour une organisation totalitaire, des ressources économiques et techniques incomparables à celles que l’Allemagne de Hitler a jamais eues. Sous le triple effet des coups d’arrêts portés à son expansion impérialiste, des difficultés économiques internes et du mécontentement envahissant de la population, l’Administration peut être amenée à mettre en branle un système autoritaire bien plus brutal et plus englobant.
J’ai souligné le caractère apolitique, diffus et inorganisé du mécontentement. La base de masse potentielle du changement social pourrait très bien devenir la base de masse du fascisme. […] L’intensification de la répression et la nouvelle politique économiques des autorités capitalistes d’Etat paraissent indiquer que la classe dirigeante, aux Etats-Unis en tous cas, est en train de prendre peur. Et parmi le gros de la population, une certaine constellation de traits politiques et psychologiques permet de déceler l’existence d’un syndrome proto-fasciste » (Contre-révolution et révolte, p. 39-41).
Si par fascisme on entend succinctement « l’organisation terroriste des contradictions capitalistes » (Contre-révolution et révolte, p. 46), société, régime et gouvernement américains ne sont pas fascistes (Contre-révolution et révolte, p. 39, Historical Fate, p. 177). En revanche ils laissent apparaître ce que Marcuse nomme alternativement certaines « préconditions » possibles du fascisme, une « nouvelle forme » de fascisme (« The Mouvement in a New Era of Repression », p. 148) ou « néo-fascisme », ou encore un « syndrome proto-fasciste » (Contre-révolution et révolte, p. 41).
Troisième point : bien que, simultanément, il juge que Nixon n’est pas un « leader » populaire-populiste au même stade que Bonaparte, ou que les dirigeants fascistes des années 1930 et 1940, Marcuse va très loin dans la mise en avant de la logique passionnelle d’identification au chef. Cela se voit dans le volet de l’analyse consacré à la « crise morale », la « désintégration structurelle » au sens d’une « désintégration morale » (Historical Fate, p. 184) qui est portée par et s’exprime par l’union assumée, ouverte, décomplexée, du capital et de l’Etat, laquelle se paye par la « disparition de la distinction entre business, Mafia et politique » (Historical Fate, p. 176) et le fait que le mot de « corruption » ait lui-même perdu sa signification (puisqu’il suppose de distinguer entre la norme et sa pathologie, ce que justement la nouvelle situation interdit tendanciellement).
Cette crise « morale » est ambivalente, car elle entretient la droitisation idéologique et politique sur la base de l’idée que l’ordre libéral ancien est laxiste et pourri, autant dans les « élites » que la « populace », mais en même temps, semble ne pas affecter, en vertu même de la profondeur de la logique populiste, la stature présidentielle et l’autorité gouvernementale. Dans l’article de 1972 Marcuse va jusqu’à estimer que la figure du président (Nixon) et celle du gouvernement semblent avoir reconquis une profonde immunité (Historical Fate, p. 176), en raison de cette légitimité « populaire », par rapport à toute contestation potentielle.
Watergate
En réalité Marcuse oublie dans l’article de 1972 une distinction importante : entre gouvernement et leaders, et régime. Le scandale du Watergate poussera en effet Nixon à la démission en 1974, preuve s’il en est de sa non-immunité. Mais sans pour autant affaiblir, au contraire, le régime, qui se verra renforcé dans sa dynamique populiste de lutte contre la « corruption » des « élites » (dynamique que Nixon a donc rendu possible contradictoirement), rhétorique qui sera au cœur de la stratégie de Reagan. C’est bien le régime qui se renforce. La conclusion de sonarticle du 27 juin 1973 publié dans le New York Times, « Watergate : when Law and Morality stand in the way », va d’ailleurs dans ce sens :
« Il est trop tôt pour écrire la nécrologie du Watergate, trop tôt pour dire quel côté va triompher. Les pouvoirs responsables du Watergate pourraient survivre : les tendances fondamentales de la société capitalistes les soutiennent, spécialement la concentration exponentielle du pouvoir, l’amalgame du grand capital et du politique, la répression de la révolte radicale suscitée par les difficultés économiques qui s’aggravent. » (Watergate…, p. 192).
Ce qui revient bien à marquer l’objectivité de la décomposition des mécanismes démocratiques (de représentation comme de contre-pouvoir), dans sa dimension de symbole et d’agent d’une transition autoritaire requise par l’état du système, comme le début de cet article sur le Watergate le résumait : ce « cas extraordinaire de corruption dans les plus hauts cercles du gouvernement – extraordinaire en vertu de sa maladroite brutalité et de la violation des droits constitutionnels élémentaire » n’est évidemment pas une « aberration », c’est un « événement ordinaire » en réalité, au sens de la « forme politique extrême d’un état de choses devenu normal » (Watergate, p. 189). Il rappelle au passage que l’ascension des gouvernements fascistes ou d’extrême-droite avaient été, dans les années 1930, en partie préparés subjectivement par de grands scandales (Watergate, p. 192, note 2) témoignant de la décrépitude des fusibles démocrates-bourgeois.
« Gestapo mentality » et variations sur le « fascisme »
En résumé, la décomposition spécifique de la sphère politique ne peut échapper à celle, dont elle est l’excroissance visible, portée par les tendances objectives sont celles des transformations du capital et du rapport de forces entre les classes, à la fois au plan du renouvellement de l’impérialisme américain et des effets de la concentration monopoliste favorisée, en interne, par la crise. Le vaste « réseau (ou chaîne) de rackets, cliques et gangs, assez puissants pour passer outre la loi ou la briser là où la législation existante n’est pas suffisamment adaptée ou interprétable en leur faveur » auquel s’adosse les corporations et l’exécutif, trouvant sa justification dans l’idéologie du secret et de la « sécurité nationale », et se traduisant à grand coups d’espionnage de répression, incarnant une véritable « mentalité gestapiste » (« Gestapo mentality »).
Concluons sur la définition par laquelle il synthétise son approche, qui combine une définition trotskyste/gramscienne-compatible avec la notion de « capitalisme totalitaire » de Franz Neumann dans son ouvrage de 1942 sur le nazisme Béhémoth7 :
« Le fascisme peut être défini comme l’organisation totalitaire de la société en vue de la préservation et de l’expansion du capitalisme dans une situation où cet objectif ne peut plus être atteint pas le développement normal du marché. La principale menace qui pèse sur le capitalisme est double : l’existence en son sein d’une forte opposition socialiste-communiste, et les obstacles à l’accumulation du capital constitués par la guerre perdue, une grave dépression, etc. Dans cette situation, la « solution » est recherchée dans la baisse des salaires, la destruction du pouvoir des syndicats, et l’embarquement dans une politique impérialiste agressive. Cette solution requiert la mobilisation de la population tout entière derrière l’intérêt national tel qu’il est défini par la classe dominante, abolition du rôle de la loi, émasculation du parlement comme colonne vertébrale de l’opposition, militarisation tous azimuts, et mise en suspens, de facto, de l’idéologie démocratique ». (Historical Fate, p. 185)
Sur la base de cette définition, qui montre que malgré leurs différences, bonapartisme consolidé (et pas naissant) et fascisme sont des plus proches, il ré-insiste sur la spécificité de la situation :
« le fascisme italien et allemand a été battu dans le cadre d’une guerre mondiale, pas de l’intérieur. Il est hautement improbable qu’une configuration similaire se produise si le fascisme s’installe dans le pays capitaliste le plus avancé de l’ère actuelle. Le danger de l’autodestruction est imminent » (Historical Fate, p. 185).
Danger « imminent » ? On le voit, selon les articles ou même les passages au sein d’un même article, Marcuse fluctue quelque peu dans son évaluation de l’imminence du danger, c’est-à-dire dans son évaluation du degré de décomposition socio-politique, du niveau d’avancement des contradictions économiques et des rapports de forces. A situation transitoire, théorisation transitoire : et malgré la rigueur et le sang-froid requis pour éviter de crier prématurément au loup, qu’il revendique, on voit que Marcuse n’arrive pas à finaliser totalement sa définition.
Cela aura, naturellement, un impact, sur sa façon de penser le « front unique » de résistance contre cette situation. Dans l’immédiat, ce qui ressort est l’exacerbation de la contradiction constitutive de la démocratie bourgeoisie, qui a la fois est politiquement et idéologico-culturellement antagonique à l’autoritarisme – et mérite pour cette raison d’être « défendue » (en un sens sur lequel on reviendra) – mais qui, en l’état « ne constitue dorénavant plus une barrière au fascisme » (Historical Fate, p. 176).
Quant à la violence accumulée dans la population blanche petite-bourgeoise (groupes d’extrême-droite, actes racistes et/ou anti-jeunes, etc.), elle se présente naturellement, en l’absence d’alternative progressiste, comme à la fois un instrument de l’autoritarisme, et le terreau fertile pour une « disponibilité » croissante à ce dernier, contre la violence subversive des exploités et opprimés. Terreau d’un « syndrome proto-fasciste » auquel Marcuse s’intéresse de près.
III. Technologie et structure mentale du syndrome proto-fasciste
Le premier terrain d’expérimentation du « freudo-marxisme » fut celui de la « psychanalyse de masse du fascisme » de Reich dans les années 30. Combiné à ses propres travaux déjà évoqués, il revient ici sur le volet « subjectif », au sens de vécu dans l’existence individuelle, mais reflétant, en l’occurrence, une dynamique de masse, de ce syndrome proto-fasciste, qui renvoie à l’infrastructure de de production et de consommation. Marcuse a parfois des formules ambiguës, il dit souvent que la distinction entre infrastructure et superstructure est devenue « discutable » : il faut entendre que la superstructure s’est en partie « infrastructuralisée », au sens où pour lui c’est à même le procès de production et de travail, plus loin qu’une simple « réification » et « atomisation » des travailleurs, que certaines structures subjectives sont façonnées de façon déterminante.
Un premier aspect de cet thèse se trouve dans sa vision de la « rationalité technologique » qu’il formule dès 1942. La technologie est un processus social dons la « technique » stricto sensu, n’est qu’un élément parmi d’autre, grosso modo « neutre » au sens où elle peut, selon lui, favoriser autant la liberté que l’autoritarisme.
« En tant que mode de production, en tant qu’ensemble des instruments, dispositifs ou appareils qui caractérisent l’âge de la machine, la technologie est aussi un mode d’organisation et de perpétuation (ou de modification) des rapports sociaux, une manifestation des modes de pensée et des comportements prédominantes, ainsi qu’un instrument de contrôle et de domination… Le national-socialisme est un parfait exemple de la façon dont une économie hautement rationalisée et mécanisée, capable de la plus grande efficacité au niveau de la production, a pu fonctionner au service de l’oppression totalitaire et de l’entretien de la pénurie.
Le Troisième Reich est en fait une forme de « technocratie » : les considérations techniques sur l’efficacité et la rationalité impérialistes y ont pris la place des normes traditionnelles du profit et du bien-être général. Dans l’Allemagne nationale-socialiste, le règne de la terreur n’est pas soutenu par la seule force brutale – qui est étrangère à la technologie –, mais aussi par une ingénieuse manipulation du pouvoir inhérent à la technologie : l’intensification du travail et de la propagande, l’entraînement de la jeunesse et des ouvriers, l’organisation de la bureaucratie gouvernementale ainsi que de celle du Parti, toutes ces manipulations – qui sont autant d’instruments technologiques de la terreur – obéissent aux mêmes règles que la recherche de la plus efficacité technologique » (« Quelques conséquences sociales de la technologie moderne », 1942, tr. fr. in Tolérance répressive, Paris, Homnisphères, rééd. 2008, p. 88-89).
Or si cette « technocratie terroriste » a atteint son apogée sous le nazisme, en réalité elle est consubstantielle au mode d’organisation du capitalisme monopoliste tout court, qui façonne dès la sphère de la production un type d’individualité et de subjectivité qui justement prépare objectivement le terrain au syndrome proto-fasciste, y compris sous un régime démocratique. Plus largement, cette forme de rationalisation scientifique, en premier lieu dans le procès scientifiquement divisé du travail, via des « relations humains » et un « management » bureaucratisés à l’extrême, fait directement partie du procès de reproduction de la force de travail en façonnant une structure psychologique prédominante qui force le travailleur à fusionner, au prix de la destruction totale de son individualité, avec un appareil qui unifie en permanence productivité et destructivité, prospérité et misère, prolongé par un temps de loisir formaté et organisé sur le même mode : celui de la satisfaction manipulée des désirs et des besoins matériels, qui prolonge le gaspillage et une destruction autant matériel qu’humain, allant de l’obsolescence programmée des marchandises à la production d’armements.
D’où la thèse de Marcuse selon laquelle l’agressivité qui s’exprime politico-idéologiquement est stricto sensu d’abord produite par l’infrastructure de production. Dans le contexte de crise économique, la privation matérielle même relative (la misère absolue restant cantonnée à une minorité, quoique croissante, de couches populaires) exacerbe ce schéma mental y compris en cas de chômage. Cette violence sociale accumulée, où la publicité produit de façon croissante avant toute chose un univers de frustration exponentielle, débouche non seulement sur une agressivité grandissante, mais aussi à un régime de déshumanisation propice à une « hystérie de masse » (« Vietnam, Analysis of an Example », 1966, tr. angl. in German History in Documents and Images, vol. 9, Two Germanies, 1961-1989) et un véritable instinct de mort socialement entretenu et légitimé.
« La politique de « défense » consistant à tuer, à tuer toujours plus, l’entraînement au génocide, la normalisation des crimes de guerre [au Vietnam], le traitement brutal infligé à l’abondante population pénitentiaire, ont créé un terrible potentiel de violence dans la vie quotidienne. Dans les grandes villes, on a abandonné au crime des quartiers entiers, et le crime reste le divertissement favori fourni par les mass media. Lorsque cette violence est encore latente, verbale, ou qu’elle s’exprime seulement par des actes sans trop de gravité (comme malmener des manifestants [sic !, EB]), elle est essentiellement dirigée contre des minorités impuissantes mais toutes désignées qui apparaissent comme des corps étrangers gênant le système établi, parce qu’elles parlent un autre langage, se tiennent autrement et font (ou sont soupçonnées de faire) des choses que ceux acceptent l’ordre social ne se permettent pas de faire. Les noirs et autres gens de couleur, les hippies, les intellectuels [étudiants] radicaux constituent de telles cibles. Le tout – agression et cibles visées – trahit des potentialités proto-fascistes par excellence » (Contre-révolution et révolte, p. 45-46).
Dans « The Historical Fate of Bourgeois Democracy », Marcuse affirme qu’une « force explosive » est à l’œuvre dans un « pouvoir destructif » de plus en plus relâché, dans le discours (orwellien) comme dans un nombre croissant d’actes, qui témoigne d’un « syndrome social » proprement « sadomasochiste » : sadisme pur et assumé comme tel dans les massacres du Vietnam, masochisme dans l’acceptation sociale, névrotique, de cette violence célébrée quotidiennement dans les médias sous toutes ses formes, et d’autre part vécue, sous des formes variées, et tendanciellement acceptées, quoique moyennant un rancœur et un haine accumulée, dans la rue, au travail, etc. (le « syndrome BFM TV » lors des attentats de janvier et de novembre 2015 est à cet égard édifiant).
Marcuse s’appuie ici sur « l’affinité » existant entre « fascisme » et « caractère sadomasochiste » telle que la théorie critique l’avait analysé8, l’important ici que ce plan d’analyse ne se substitue en rien à l’analyse matérialiste proprement dite, au contraire, il s’agit bien ici, et contrairement à Adorno qui tend à substituer à l’analyse matérialiste l’étude psycho-sociologique, de creuser « l’une des « médiations » existant entre infra- et superstructure, l’un des modes par lesquels la structure sociale est reproduite dans les individus » (Historical Fate, p. 170). Parmi ces médiations l’identification primaire au leader reste importante, mais ne suffit pas, c’est le dispositif d’ensemble – production-consommation-manipulation des besoins et instrumentalisation du ressentiment – qui témoigne d’une identification, fut-elle incomplète et en tension, avec lequel les individus tendent à fusionner.
Plus largement, c’est une véritable inversion des valeurs vitales qui est véhiculée : cruauté, injustice, égoïsme industriellement produits sont présentés comme la norme, le légitime, conforme à la rationalité du système, alors que la lutte opposée contre l’oppression, l’injustice, la violence des opprimés contre leurs oppresseurs, reflet d’un véritable instinct de vie dit Marcuse en passant (Historical Fate, p. 172) est, elle, invariablement stigmatisée comme immorale et anti-américaine. Marcuse ré-insiste sur le fait que dans une éventuelle « route vers le fascisme », mais même sans attendre cela, le capitalisme avancé sait parfaitement s’appuyer sur cette agressivité morbide produite non pas seulement par la décomposition sociale, mais bien rendue possible par son appareil économique et idéologique contradictoire, bien que l’histoire ait montré que cette décomposition peut aller plus loin que ce qui est escompté.
Au plan subjectif et idéologique, c’est ce syndrome qui exprime le plus visiblement la tendance à la désintégration sur lequel, contradictoirement, l’appareil d’Etat bourgeois va s’appuyer tout en s’efforçant de leur contenir, de le maintenir intégré (tant qu’une autre solution n’est pas objectivement requise), mais qu’il va néanmoins incarner aussi parce que ce syndrome est lui-même la réfraction de la tendance objective à la désintégration produite par la crise et l’exacerbation des contradictions socio-économiques.
Le degré de décomposition sociale et de polarisation socio-politique actuel, la crise des alternatives révolutionnaires d’aujourd’hui, étant au moins aussi profond qu’au début des 70s américaines, méritent que l’on poursuive la comparaison – même si, encore une fois, une analogie ne vaut que ce qu’elle vaut. La partie II à venir de l’article consacré à la « crise organique » et aux formes contemporaines du bonapartisme intègrera cette approche marcusienne, dans l’analyse des formes actuelles de subjectivité et de décomposition sociales constituant, faute en l’état d’alternative anticapitaliste et révolutionnaire, le terreau de différentes variantes de « populismes » qu’il faudra chercher à caractériser avec le moins d’imprécision possible.
Illustration : un meeting de Trump rally à Dallas (Texas), le 14 septembre 2015. Jamelle Bouie / Flickr.
à voir aussi
références
| ⇧1 | « The Historical Fate of Bourgeois Democracy », inH. Marcuse,Collected Papers, vol. 2., Towards a Critical Theory of Society, London-New York, Routledge, 2001 (éd. D. Kellner), 1972. Noté Historical Fate par la suite. |
|---|---|
| ⇧2 | « The Movement in a New Era of Repression », 3 février 1971 , in H. Marcuse, Collected Papers, vol. 3, The New Left and The Sixties, London-New York, Routledge, 2005 (éd. D. Kellner). Ici p.143. Excepté Contre-révolution et révolte, toutes les autres traductions utilisées sont de nous. Voir aussi, dans le même volume, « Democracy has/hasn’t a future… A present », New York Times Magazine, 26 mai 1968. |
| ⇧3 | Cf. Ernest Mandel, La réponse socialiste au défi américain, Paris, Maspero, Cahiers libres 153, 1969. |
| ⇧4 | La dystopie (utopie négative) du film de 1971 Punishment Park réalisé par Peter Watkins, part d’un décret (fictif) d’Etat d’urgence décrété par Nixon pour faire face à la contestation pacifiste de l’intervention au Vietnam. La législation d’exception permet de faire passer devant des tribunaux exceptionnels tous les subversifs. Systématiquement condamnés à des peines sévères, ils ont le choix d’échanger la peine contre un séjour dans un « punishment park » (parc à punition), un parc d’entraînement pour les forces anti-émeutes, policières et militaires. Ils sont censés traverser un désert pour atteindre un drapeau américain, en évitant de se faire prendre par les forces de répression, avec la liberté pour prix de leur réussite. Qui n’arrive jamais. Une parabole au réalisme glaçant. Sur Peter Watkins, voir par exemple le chapitre que nous lui avons consacré dans E. Barot, Camera Politica. Dialectique du réalisme dans le cinéma politique et militant, Paris, Vrin, 2009. |
| ⇧5 | Citation reprise à l’imposant travail de B. T. Smith, La dialectique du néo-libéralisme aux Etats-Unis. Aux origines de la « révolution conservatrice » et de la crise financière de 2008, thèse de doctorat, Paris, 2015. |
| ⇧6 | On a évoqué ce point dans l’article précédent. Voir en priorité le tome 1 de ses Collected Papers, Routlegde, 1998, (éd. par D. Kellner), Technology, War and Fascism ainsi que sa douzaine de contributions de la période spécifique de l’OSS, récemment édités dans F. Neumann, Herbert Marcuse & Otto Kirchheimer, Secret Reports on Nazi Germany. The Frankfurt School Contribution to the War Effort, Princeton University Press, 2013 (éd.R. Laudani). Le titre affreux du volume ne reflète évidemment pas l’intérêt de son contenu. |
| ⇧7 | Sur lequel s’appuie à diverses reprises E. Mandel dans sa présentation de la théorie trotskyste, Du fascisme, Paris, Maspero, 1969, repris in L. Trotsky, Contre le fascisme. 1922-1940, Paris, Syllepse, 2015. |
| ⇧8 | En particulier dans les études coordonnées par Adorno qui donnèrent lieu en 1950 à la publication de l’ouvrage La personnalité autoritaire, tr. fr. Paris, Allia, 2007, cité in Historical Fate, p. 170 . |
![Rebelles réactionnaires et extrémisation des droites [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_Delivers_Remarks_at_CPAC_49608880598-150x150.jpg)




![Que veulent Modi et les ultranationalistes hindous ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Path_Sanchalan_Bhopal-1-150x150.jpg)
![Trajectoires du fascisme en Turquie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/turquie-erdohan-mhp-bahceli-150x150.jpg)


