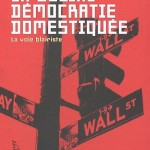Du blairisme
À propos de : Philippe Marlière, La social-démocratie domestiquée. La voie blairiste, Bruxelles, Les éditions Aden, 2008, 176 pages, 19 euros.
Analysant à la fin des années 1970 la théorie du néolibéralisme et son emprise grandissante sur les sociétés européennes, Michel Foucault avait souligné de façon très prémonitoire que la social-démocratie n’avait pas de politique autonome et qu’elle ne parvenait donc pas à se distinguer de ses adversaires[1]. Tels qu’ils sont présentés par Philippe Marlière dans son dernier livre, La Social-démocratie domestiquée, l’aggiornamento travailliste et la décennie d’exercice du pouvoir par Tony Blair et ses gouvernements (1997-2007) offrent une bonne illustration de cette thèse. À cette nuance près que le défaut d’autonomie politique dans le cas britannique était délibéré, parfaitement assumé par le dirigeant du New Labour dont l’adhésion au néolibéralisme, les capacités de communication et l’art de centraliser et concentrer le pouvoir lui ont valu, face à un parti conservateur en pleine déconfiture, une série de beaux succès électoraux. Quoique Tony Blair soit maintenant (déjà) relégué aux oubliettes de l’Histoire (malgré ses nouvelles fonctions publiques et privées fort lucratives), son action passée à la tête de son parti et de l’État, ainsi que ses méthodes de « gouvernance » semblent encore inspirer nombre d’élites politiques de droite ou de gauche. Préoccupé par le sort du parti socialiste français, Philippe Marlière lance un avertissement à ses dirigeants en mettant au jour les faux-semblants du néotravaillisme et de la « Troisième voie ».
Malgré les apparences, la « Troisième voie » ne se voulait pas tant le point médian entre socialisme et néolibéralisme qu’une formule habile et suggestive masquant la « thatchérisation du parti travailliste », comme avait pu le dire l’une des grandes figures de la gauche du Labour, Tony Benn, cité par l’auteur. Elle a été, on le sait, théorisée par Anthony Giddens. Cet universitaire britannique très proche de Blair s’appuyait sur l’idée d’un affaiblissement sinon d’une disparition des traditions pour affirmer que le monde contemporain serait caractérisé par une nouvelle « réflexivité sociale ». Les traditions seraient devenues l’objet de discussions et d’appréciations critiques, les actions et les relations humaines seraient laissées au libre-arbitre et à l’autonomie des individus, la division sociale du travail et la poursuite de l’égalité sociale auraient cédé la place à la défense des « styles de vie ». Le politique ne serait plus vraiment un champ de luttes entre individus et structures partisanes car les nouveaux enjeux sociaux lui échapperaient pour l’essentiel. Aussi la modernité supposerait-elle que soit inventé un projet politique « radical » reposant sur une « démocratie dialogique », voire une « démocratie des émotions » — c’est-à-dire une espace public de discussions et d’échanges où chaque individu, comptant sur la « solidarité » et la « confiance » de ses interlocuteurs, pourrait exprimer ses opinions.
Comme le note Philippe Marlière, cette pensée non dépourvue d’accents humanistes s’adresse avant tout à la fraction des classes supérieures suffisamment privilégiée pour considérer le salaire minimum, les allocations sociales ou la gratuité des services de santé et d’éducation comme autant de « contingences vulgaires », et pour s’imaginer que de nouvelles « politiques de la personne » pourraient tendre vers l’établissement du « droit universel au bonheur ». Cependant, adroitement reformulée par la rhétorique politique, la mise en scène savante d’une société individualiste, consensuelle et dépolitisée a contribué à embrouiller les esprits, à faire passer pour obsolètes les distinctions entre droite et gauche, pour miraculeuses les performances économiques les plus fragiles et pour démocratiques et « participatives » les pratiques politiques autoritaires et répressives.
Droite et gauche n’avaient plus aucune raison de s’opposer à partir du moment où les élites politiques étaient parvenues à un diagnostic commun. À partir du début des années 1980, elles se sont progressivement ralliées à l’idée que des forces économiques impersonnelles auraient contraint l’État à se « moderniser » et à réorienter son action. Débordé « par le haut », dépourvu de marges de manœuvre du fait de la mondialisation, l’État aurait été, pour cette même raison, impuissant face à la résurgence des inégalités sociales. Aussi ne lui restait-il plus qu’à gérer la « contrainte extérieure » ou, pour emprunter la formule de Lionel Jospin rappelée par l’auteur vers la fin de son ouvrage, admettre que le temps de « l’économie administrée était terminé ». Au passage, cela semblait justifier, comme dans le cas du blairisme (notamment), le regroupement en « une sorte d’union sacrée d’individus et d’institutions venus de droite et gauche ».
Bien sûr, cette représentation du monde ne s’est pas imposée d’elle-même, abstraitement. Trois événements décisifs y ont contribué : la grève des contrôleurs aériens d’août 1981 aux États-Unis, le tournant de la rigueur en France (1981-1982) et, en Grande-Bretagne, la grève des mineurs britanniques (1984-1985) — un fait capital insuffisamment mis en valeur par Philippe Marlière. Ces événements ont permis de cristalliser le consensus sur l’ « épuisement » du compromis social keynésien et sur la « nécessaire » et rigoureuse subordination des politiques sociales aux impératifs de « compétitivité ». Pour sa part, Margaret Thatcher ne doutait pas de l’effet dissuasif que provoquerait une défaite des mineurs. Elle s’était préparée de longue date à l’éventualité de ce conflit dont l’issue désastreuse pour les mineurs a simultanément « fermé la vie des gens[2] », affaibli le mouvement social dans son ensemble, accéléré la flexibilisation de la main-d’œuvre et la précarisation de la population, et donné l’exemple au reste de l’Europe. Vécue par l’aile droite du Labour comme « une “année perdue” dans le processus de “modernisation” du parti[3] », cette grève lui a pourtant largement profité. Elle a permis de sceller le rapport de forces en sa faveur. A fortiori, elle a levé les obstacles aux réformes internes au parti, des réformes qui le videraient en dix ans de sa composante de gauche et prépareraient le terrain au futur « modernisateur de choc », Tony Blair.
La « modernisation » du Labour a servi de laboratoire à celle de la société britannique. Sous la direction de Tony Blair, elle a été, dans un premier temps, conduite avec succès. Les méthodes qui l’ont guidée ont été du même ordre que celles choisies pour mener à bien la « gouvernance » de la Cité : une rhétorique de la « nouveauté » qui se voulait « inclusive » au point de rendre illégitime l’idée même du conflit[4] ; le flirt avec les grosses fortunes et la mise à distance des syndicats ; l’individualisation de la relation aux adhérents et des recrutements tous azimuts ; la dépolitisation des débats… Cela, tandis que s’accentuait toujours plus la tendance à la personnalisation et la centralisation du pouvoir. À bien des égards, les succès apparents de cette « modernisation » ont été éphémères (le mot lui-même inspire du dégoût dans l’opinion publique). Le nombre d’adhérents a fondu comme neige au soleil. Il est évalué aux alentours de 200 000, après avoir approché les 450 000 en 1997. Les syndicats se sont révélés des alliés indispensables, bien plus fiables et utiles que le big business dont les contributions aux recettes du parti se sont assez rapidement taries. Comme le souligne Philippe Marlière, non seulement Tony Blair n’a pas réussi à créer un « néosyndicalisme » à l’image du New Labour, mais encore, à force de museler le débat et de traiter les syndicats comme des adversaires politiques, il a favorisé la renaissance d’un syndicalisme combatif qui se renforce depuis 1999.
Sur le front économique et social, l’actuelle crise financière et ses conséquences au Royaume-Uni suffisent à souligner la fragilité du « miracle » britannique. Mais comme l’Union européenne et la plupart de ses membres ne semblent pas encore avoir réellement pris la mesure du cataclysme causé par les politiques néolibérales, et comme la gauche, notamment le parti socialiste français, ne saisit pas l’occasion offerte par l’effondrement du projet néolibéral pour se donner la liberté de penser et définir un programme politique autonome, la démythification du consensus maintenant mort reste à l’ordre du jour.
Tony Blair a été loué par les grands de ce monde pour sa capacité à flexibiliser le marché du travail, faire baisser le taux officiel du chômage et commercialiser les biens sociaux en usant et abusant d’indicateurs de performance. Y avait-il un lien de causalité entre flexibilisation et taux de chômage ? Philippe Marlière constate que les « performances » du Royaume-Uni en matière d’emplois et de chômage ne s’expliquaient pas par la flexibilité, le workfare (la mise au travail) ou les politiques d’activation[5]. Elles masquaient de fortes disparités et inégalités régionales ainsi que des phénomènes comme le report sur l’inactivité[6] et la quasi-stagnation de la population active sur la décennie 1990. En outre, elles ont tenu pour beaucoup à une croissance relative soutenue par une politique classique de dépenses budgétaires. Ainsi, les deux tiers des emplois créés — souvent des temps partiels — après 1998 l’avaient été dans le secteur public.
Ce recours pragmatique (et discret) à des instruments de type keynésien pour étoffer les politiques d’emploi ne mettait pas en question le fondamentalisme de marché du premier ministre britannique. Indispensable tant leur état est déplorable, l’investissement dans les services publics a été piloté sans perdre de vue l’objectif premier de leur « modernisation », c’est-à-dire leur privatisation au moins partielle. Les néotravaillistes ont amplement recouru à la technique des PPF (Partenariats privé-public)[7] qui permet à l’État d’aménager des modes de financement et de gestion par le privé de services publics aussi vitaux que les écoles publiques, les logements sociaux, le contrôle du trafic aérien, le métro de Londres, la santé publique ou les soins hospitaliers. Or le secteur privé fonctionne sur la base de critères de rentabilité mal adaptés — c’est le moins que l’on puisse dire — aux besoins sociaux et aux exigences de qualité et de sûreté des services publics. Il en découle immanquablement de graves dysfonctionnements. Ainsi, Philippe Marlière cite le cas de cette nouvelle infirmerie construite par un contractant privé chargé d’offrir des services « de soin de meilleure qualité, davantage adaptés aux besoins des patients et plus sûrs ». À peine l’infirmerie venait-elle d’ouvrir que deux plafonds aux matériaux de qualité médiocre s’écroulaient et que l’on constatait des conditions d’hygiène et de sécurité inadéquates ainsi qu’un nombre insuffisant de lits pour faire face à la demande de soins.
Cette politique a une cohérence qu’il importe de souligner. À plusieurs reprises, Philippe Marlière souligne que la composante théoriquement « de gauche » du programme néotravailliste n’a été rien d’autre qu’une « béquille sociale », un « volet social-démocrate subalterne », un « aspect mineur » d’une politique subordonnant la dimension sociale-démocrate à la dimension néolibérale. « D’une certaine manière, le génie du blairisme est de feindre de redécouvrir la “question sociale” (la pauvreté infantile, par exemple) et de mettre en œuvre des politiques sociales minimalistes pour s’exonérer de l’accusation de “trahison”. » Ajoutons que le minimalisme social — c’est-à-dire le renoncement aux politiques de protection sociale à visée universaliste au profit de politiques d’assistance aux pauvres et d’une généralisation des prestations sous conditions de ressources — a été activement recherché par les hautes autorités nationales (de droite ou de gauche) qui se sont appuyées sur l’échelon européen pour coordonner leurs efforts et les rendre plus efficaces. On a de sérieuses raisons d’estimer que la « préservation » d’un « modèle social européen » se traduit par l’institutionnalisation volontariste du minimalisme social dans tous les pays européens — même si, selon les sociétés concernées, c’est à des rythmes, suivant des modalités et à des degrés divers. Pour le dire autrement, « l’État social minimal » représente aux yeux des élites un modèle à suivre. Il sous-tend les restructurations et réorganisations permanentes des systèmes nationaux de protection sociale, leur donne une cohérence et sa mise en place conduit à la multiplication de dispositifs destinés à contrôler, mettre au pas et sanctionner les pauvres. Du point de vue de la Commission, la valorisation du minimalisme social s’explique par son souci d’économies budgétaires, d’efficacité gestionnaire et de promotion de la concurrence. En effet, dans l’état actuel de la réglementation et de l’idéologie communautaires, limiter la « solidarité » publique à un socle « assistantiel », à une très faible prestation accordée aux seuls nécessiteux, c’est créer des conditions jugées souhaitables pour soumettre au droit européen de la concurrence tout ce qui ne relève pas de ce socle « assistantiel »[8].
L’actuelle crise économique ébranle la légitimité de ce modèle parce qu’il transfère les risques sociaux sur les individus au nom de leur « responsabilisation », sans toutefois leur donner les moyens d’y faire face. Il est urgent de rompre avec cette approche et d’en finir avec une social-démocratie domestiquée qui n’a plus aucune raison d’être.
[1] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours du Collège de France. 1978-1979, Paris, Gallimard-Seuil, pp. 93-94.
[2] Comme l’avait dit à l’époque une femme de mineur.
[3] Expression de Neil Kinnock, ancien leader du parti travailliste, cité par Philippe Marlière (p. 25).
[4] La négation du conflit ou le consensus imposé a été largement utilisé comme technique de dépolitisation ces trente dernières années. Pour des approches européennes, voir Roser Cusso, Anne Dufresne, Corinne Gobin, Geoffroy Matagne et Jean-Louis Siroux (dir.), Le Conflit social éludé, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2008.
[5] Au sens strict, l’activation consiste à reconvertir une allocation sociale en tout ou partie de la rémunération d’un travail. Dans bien des cas (sinon la plupart), c’est une forme déguisée de subvention aux bas salaires car elle est articulée à des stratégies politiques de à développement du segment des bas salaires, stratégies poursuivies au nom de la « compétitivité » des économies nationales.
[6] Au Royaume-Uni, les chômeurs marginalisés ou rejetés par le marché du travail sont très nombreux à avoir échoué dans le régime d’invalidité. On comptait 2,7 millions de personnes « invalides » en 2003 selon les sources officielles, dont une proportion significative d’hommes de 25 à 54 ans, un chiffre en progression d’un million en dix ans. Voir Florence Lefresne, « Les trappes du modèle social britannique », Politique. Revue de débats, n° 42, décembre 2005 et « Les politiques d’emploi et la transformation des normes : une comparaison européenne », Sociologie du travail, vol. 47, n° 3, juillet-septembre 2006.
[7] Nom donné à cette technique en France, où elle est également mobilisée. En Grande-Bretagne, il s’agit de la PFI (Private Finance Initiative).
[8] Voir Noëlle Burgi, « La construction de l’État social minimal en Europe », Politique européenne, n° 27, hiver 2009, pp. 201-232.