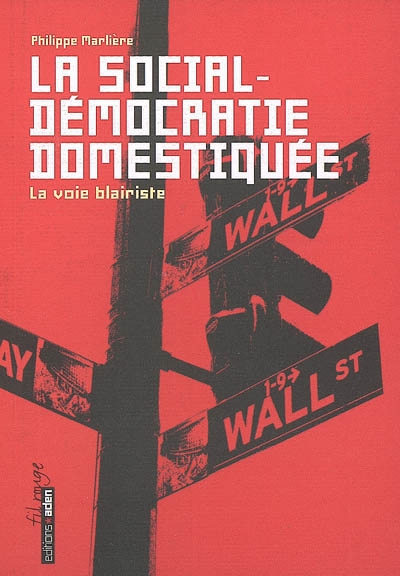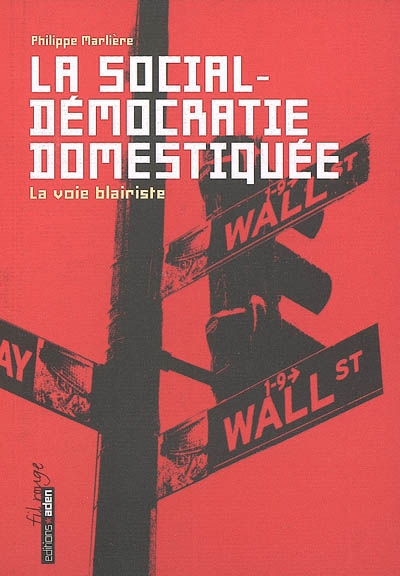
Le blairisme in situ
Nous publions ici le prologue de l’ouvrage de Philippe Marlière : La social-démocratie domestiquée : la voie blairiste (Aden éditions, 2008).
Plus d’une année s’est écoulée depuis le départ de Tony Blair du 10 Downing street. Ce laps de temps procure le recul nécessaire pour apprécier dans toute sa complexité l’héritage de ce que l’on appelle le « blairisme ». Stricto sensu, le terme « blairisme » renvoie à l’action politique de Tony Blair leader du Parti travailliste entre 1994 et 2007 et Premier ministre de la Grande-Bretagne entre 1997 et 2007. De manière générale, il peut également définir l’action politique entreprise par le New Labour au pouvoir, sous le leadership de Tony Blair. Mais il existe une acception encore plus large : le blairisme peut être pensé en termes d’héritage laissé à l’ensemble de la social-démocratie européenne. Selon cette définition, la « voie blairiste » n’est plus un passé, mais un avenir ; celui des forces social-démocrates qui se sont inspirées et continuent de s’inspirer des idées et des politiques mises en œuvre par Tony Blair.
Cet ouvrage propose de revenir sur la genèse du blairisme, les débats qui ont été conduits autour de la Troisième voie blairiste[1] ; un discours combinant libéralisme politique et économique. Les aspects les plus significatifs de la politique menée entre 1997 et 2007 sont commentés : les résultats économiques, la rénovation des services publics, la relation avec les syndicats du Trade Union Congress ou encore la politique étrangère et européenne.
TINA !
Le bilan de dix années de politique blairiste doit donc être examiné à l’aune du nouveau révisionnisme de la social-démocratie[2] : au début du 20e siècle, le débat opposa « réformistes » à « révolutionnaires » ; les partisans d’une socialisation des moyens de production à ceux qui peu à peu prônèrent la coopération avec le capitalisme à travers l’établissement d’une « économie mixte ». Le blairisme peut être perçu comme la tentative la plus poussée de dépasser ce débat centenaire en traçant le sillon d’une social-démocratie du libre marché. Celle-ci se veut accompagnatrice de la mondialisation capitaliste à quelques rares exceptions, près. Elle affiche sa fidélité aux objectifs traditionnels de justice sociale de la social-démocratie, mais elle épouse de manière acritique le capitalisme globalisé et financier.
Les leçons du blairisme sont encore à tirer et elles nous amènent résolument à scruter l’avenir ; celui de la social-démocratie européenne. Il convient en effet de voir dans le blairisme doctrinal ou politique une sorte de feuille de route, voire de modèle dont s’inspirent aujourd’hui tout ou partie des partis socialistes ou sociaux-démocrates en Europe. L’attrait de la Troisième est suffisamment fort pour ne laisser aucune de ces formations en dehors du prêt-à-penser blairiste. Les partis socialistes belge et français, pendant un temps les moins disposés à « blairiser » leur discours et leur politique, se sont depuis quelque temps rapprochés de l’action de l’ex-Premier ministre britannique, aussi bien dans le fond que dans la forme.
Quand le New Labour fut triomphalement élu en mai 1997, une alternative s’offrait à Tony Blair : il pouvait soit rompre avec le néolibéralisme thatchérien, discrédité et brutalement rejeté par les électeurs, soit composer avec le paysage laissé par les conservateurs sans fondamentalement le remettre en cause. Il était prévisible que Blair et ses alliés retiendraient la deuxième option, car ils avaient averti le public qu’il n’y aurait aucune rupture fondamentale avec le thatchérisme, mais de simples inflexions de la politique conservatrice. Blair a longuement décliné le cri de guerre thatchérien : « TINA » ! (There Is No Alternative)[3] : « Les différences entre la droite et la gauche sont obsolètes[4] » (Tony Blair et Anthony Giddens) ; « Il n’y a pas d’alternative à la mondialisation [néolibérale] » (l’ensemble du New Labour) ; « Nous n’avons rien contre le fait que certains s’enrichissent outrageusement » (Peter Mandelson) ou encore « Je prendrai le pouvoir en tant que New Labour, je gouvernerai en tant que New Labour » (Tony Blair). C’est en effet ce qui survint : le New Labour s’est adapté à l’environnement thatchérien et ne l’a pas modifié de manière substantielle. Il faut toutefois préciser que l’adaptation du blairisme au thatchérisme s’est déroulée d’une manière particulière : le New Labour s’est donné une stratégie à long terme, un projet qu’Antonio Gramsci appelait le « transformisme » (il trasformismo). Le blairisme peut essentiellement être compris comme le transformisme de la social-démocratie, c’est-à-dire une variante particulière de l’idéologie néolibérale. Cette variante diffère de la conception du « gouvernement minimal » mise en œuvre par Ronald Reagan dans les années 80 ou du néoconservatisme étatsunien sous les présidences de George W. Bush. Elle s’attache à consolider une société de marché tout en maintenant un Etat social minimal chargé de gérer les situations de détresse sociale les plus criantes. En dépit de correctifs sociaux à la marge, le fondamentalisme de marché du projet blairiste est flagrant. Le New Labour de Tony Blair a soutenu inconditionnellement les institutions chargées de gérer le cours de la mondialisation néolibérale (FMI, OMC, Banque mondiale) ; il a consolidé la dérégulation et la flexibilité dans le monde de l’entreprise, sans accorder de contrepartie aux salariés : la législation sociale la plus restrictive en Europe héritée de la période thatchérienne est restée en place (à l’exception de l’introduction d’un salaire minimum ; une concession faite aux syndicats par John Smith, le prédécesseur de Tony Blair). Le blairisme est le courant de la social-démocratie qui a fait de l’homme d’affaire et de l’entreprise privée les étalons de son action politique. Davantage, l’entrepreneur a été érigé en modèle social. Depuis 1997, les services publics ont continué à être bradés et privatisés (le métro de Londres, le trafic du contrôle aérien, la poste, le service médico-légal). Les modes de gestion du privé ont été imposées dans des secteurs publics-clés tels l’Ecole, la santé publique ou les prisons, à travers les très controversés partenariats public-privé[5].
La gouvernance blairiste
Le blairisme diffère du thatchérisme dans le sens où il a tempéré son néolibéralisme fondamental pour conserver le soutien de son électorat traditionnel (la classe ouvrière et les salariés du secteur public). Ainsi, l’antiétatisme primaire des néolibéraux de droite a été gommé. Le blairisme a préféré parler d’un « gouvernement actif », pâle version du Welfare State. Le recours à la notion néolibérale de « gouvernance » (et non au terme de « gouvernement ») indique de manière subtile que le gouvernement du New Labour a adopté une nouvelle rationalité, celle qui s’inspire de la logique économique. La « gouvernance entrepreneuriale » promeut la concurrence entre des prestataires de services, ne parle plus d’usagers mais de « consommateurs » et préfère les mécanismes de gestion de l’entreprise privée à ceux de l’administration publique. C’est dans le domaine de l’Etat que les réformes du New Labour ont essentiellement porté. On peut à ce titre parler d’une « réinvention » de l’Etat ; c’est-à-dire de l’apparition d’un « Etat entrepreneur », conçu et géré comme une entreprise privée. Tony Blair a, à diverses reprises, affiché une nette préférence pour le « privé », jugé plus « efficace » et « rentable » que le « public », considéré comme « dépassé », « bureaucratique » et donc « inefficace ». L’ex-Premier ministre a, à diverses reprises, vertement critiqué les fonctionnaires (infirmières, enseignants) qui s’opposaient à la privatisation de l’Etat social, fustigeant la nature « obsolète » et « corporatiste » de leurs luttes. La notion d’« intérêt public » a disparu des discours gouvernementaux et médiatiques. Le New Labour a repris les présupposés hayékiens et thatchériens selon lesquels le marché est le vecteur essentiel du « bien social ».
La « gouvernance » blairiste a permis aux politiques néolibérales de se doter d’un second souffle. Ces réformes de l’Etat, réalisées branche professionnelle par branche professionnelle, ont naturalisé le néolibéralisme. Elles ont fait en sorte que ces pratiques de gestion hautement politisées, soient perçues comme allant de soi, comme relevant de lois naturelles de la gestion et de l’économie. On peut citer comme exemple le recours à la notion de « choix public » (entre deux écoles ou deux hôpitaux, par exemple). En vérité, de « choix », il n’en est guère question dans la plupart des situations, car l’Etat se garde bien de donner les moyens aux « consommateurs » de discerner entre les bonnes et les mauvaises écoles ou entre les bons ou mauvais hôpitaux. Le public n’attendait pas tant de se voir offrir un « choix » souvent théorique ou illusoire. Il souhaitait pouvoir compter sur un service public de qualité et accessible dans leur quartier ou dans la ville où ils habitent, ce qu’ils n’ont pas obtenu dans nombre de cas.
L’« Etat blairiste » est un Etat qui centralise les décisions et les modes d’interventions « stratégiques » (contrairement aux apparences, l’Etat néolibéral n’est ni décentralisé, ni en retrait dans tous les domaines d’activité) et qui gère les micro-managements au niveau local. A l’inverse du thatchérisme, il n’y a ici nulle tentative explicite d’endoctrinement aux supposées « valeurs du privé », mais une volonté de se doter de « valeurs nouvelles » dans l’entreprise, dans les services publics, en encourageant certaines « capacités » et en en « déclassant » d’autres. En modifiant les conditions de travail, le gouvernement blairiste a tenté de changer les manières de faire, de travailler et aussi de penser le travail. Le point central de cette offensive managériale a été d’évaluer toute activité sociale non en fonction de l’intérêt public (souci traditionnel de la gauche), mais des « besoins » et des « choix » des « consommateurs » et du « libre marché ». L’Etat managérial cher au blairisme n’a pas pour vocation de venir en aide aux plus défavorisés, mais d’aider les individus à s’aider eux-mêmes, sur le plan de la santé, de l’éducation ou des transports. Les classes moyennes ont subi de plein fouet ce mouvement de commercialisation des biens sociaux. Ils doivent dorénavant payer cher des soins ou une éducation privatisés, car les services publics restent désespérément à la traîne. Les plus pauvres ne reçoivent plus qu’une aide sociale réduite à sa portion congrue, assortie de mesures de contrôle de plus en plus draconiennes.
Un sous-agenda social-démocrate
Le blairisme a été présenté comme « progressiste » ou « de gauche » par les blairistes car son projet de nature néolibérale s’accompagne d’un volet social-démocrate subalterne (introduction d’un salaire minimum ; crédit d’impôt familial ; incitations du retour à l’emploi – en mettant la priorité sur les compétences et la formation pour solidifier l’« offre » conformément à la priorité néolibérale ; investissements dans la santé publique et dans l’école, mais en favorisant une logique néolibérale avec les partenariats privés-publics). C’est cet aspect mineur de la politique gouvernementale que les cadres et les militants du New Labour évoquent pour justifier un positionnement « de gauche » et montrer à leurs électeurs désabusés qu’ils sont tout de même « différents » des conservateurs.
Cette dimension social-démocrate est subordonnée à la dimension néolibérale. Les partisans du New Labour ont trouvé la parade à l’accusation de « trahison » qui leur est souvent adressée. Ils affirment que les politiques mises en œuvre (c’est-à-dire la poursuite d’un Etat-marché) constituent une adaptation nécessaire à la poursuite de la justice sociale, objectif social-démocrate. D’une certaine manière, le génie du blairisme est de feindre de redécouvrir la « question sociale » (la pauvreté infantile, par exemple) et de mettre en œuvre des politiques sociales minimalistes pour s’exonérer de l’accusation de « trahison ». Ce léger recentrage sur les exclus du système permet certes de rompre avec le capitalisme pur et dur de l’ère thatchérienne.
Cependant, la béquille sociale proposée par le blairisme a re-légitimé pour partie le néolibéralisme discrédité à la fin des années 90. Disons-le tout net : le blairisme a constitué une aubaine pour les tenants du capitalisme globalisé. Alors que le thatchérisme était lessivé, il a pu compter sur le soutien zélé d’un parti censé représenter les intérêts du salariat. En cultivant un sous-programme social-démocrate, le New Labour a détourné l’attention de son action essentielle : la consolidation d’un Etat marché en Grande-Bretagne et, accessoirement, au sein de l’Union européenne. Les forces capitalistes et la droite se sont publiquement réjouies de voir qu’un parti « de gauche » acceptait de faire la basse besogne et sans rechigner !
En 2001, peu avant la deuxième victoire néotravailliste, The Economist, publication néolibérale intransigeante, appelait à un vote en faveur de Tony Blair. L’hebdomadaire le présentait alors comme le « seul conservateur crédible ». Beau compliment ! Au demeurant, l’ensemble des forces et des dirigeants de la droite mondiale n’ont pas tari d’éloges à propos de l’action menée par Tony Blair et de son gouvernement : George W. Bush, Nicolas Sarkozy, Guy Verhofstadt, Silvio Berlusconi, José Maria Aznar, Jean-Pierre Raffarin et tant d’autres encore, ont pointé les convergences politiques profondes entre leur politique et celle de l’ex-leader travailliste. Un néolibéralisme tempéré par quelques mesures correctives pour les plus pauvres : voilà l’« originalité » du blairisme.
Pour la Nouvelle social-démocratie européenne, le blairisme a été et demeure une source d’inspiration : un peu honteuse (dans les PS en France ou en Belgique, quoique de moins en moins) ou revendiquée (la plupart des autres partis). C’est à ce titre qu’une connaissance des mécanismes de formation de la « voie blairiste », c’est-à-dire des choix et des présupposés politiques qu’elle sous-tend ou encore de son bilan est d’une brûlante actualité. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, le blairisme constitue bien l’avenir de la social-démocratie domestiquée : une force politique qui, de renoncement en renoncement, en est venue à mimer de plus en plus la droite réactionnaire.
La douce mélodie de la « réforme » et de la « modernité » qu’elle nous susurre pour tout viatique, n’est ni progressiste, ni de gauche : elle n’est que l’expression d’une rupture historique avec les idéaux égalitaires et de justice sociale de la gauche européenne.
[1] Voir sur ce point : Ph. Marlière, La Troisième voie dans l’impasse. Essais sur Tony Blair et le New Labour, Paris, Editions Syllepse, 2003.
[2] Ph. Marlière, « La social-démocratie », Encyclopedia Universalis (texte sur CD-Rom), Paris, Editions Encyclopedia Universalis, 2006.
[3] Mme Thatcher répétait inlassablement dans les années 80 qu’il n’y avait aucune alternative à l’économie de marché néolibérale.
[4] Récemment, Walter Veltroni, post-social-démocrate et leader du Parti démocrate (ex-PCI et ex-Parti démocratique de la gauche) a affirmé que les démocrates « étaient des réformistes », mais qu’ils « n’étaient pas de gauche ». Revendiquer un tel positionnement pour un parti qui, plus que tout autre, s’est engagé dans la « voie blairiste » n’est pas un acte fortuit. Ses thuriféraires reconnaissent que le blairisme n’est pas de gauche et que les « réformes » ne sont pas l’apanage de la gauche. Voir M. Mora (entretien avec W. Veltroni), « Somos reformistas, no de izquierdas », El País, 1er mars 2003.
[5] Voir Chapitre 4: Services publics et intérêts privés.