
« Il y a urgence à repolitiser le féminisme ». Entretien avec F. Vergès (2nde partie)
Dans la première partie de cet entretien, Françoise Vergès a souligné l’importance des enjeux liés à l’histoire coloniale et postcoloniale de la France, ainsi que les conséquences du colonialisme sur les femmes colonisées et descendantes de colonisés. Dans cette seconde partie, elle s’attache à préciser en quoi ces enjeux interrogent le féminisme et invitent à le repenser et à le repolitiser.
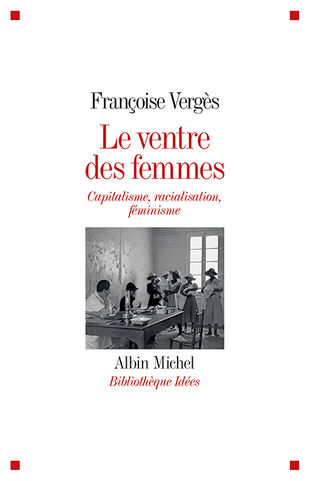
CT – La dernière partie du livre[1] s’interroge sur la « cécité » des féministes françaises non seulement face aux mutilations subies par les femmes réunionnaises, mais plus généralement à la situation coloniale des outre-mer. Pouvez-vous revenir sur ce point ? Qu’est-ce qui a selon vous empêché que le mouvement féministe en France prenne à bras le corps la question des (post)colonies françaises et du sort des femmes dans les outre-mer ?
FV – Je pense que le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) a d’une part adopté la cartographie étatique post-1962 (il n’y aurait plus de colonies dans la république). Le récit qui s’élabore puis se consolide sur l’histoire du féminisme en France devient linéaire et national. On étudie les luttes des femmes en France et cette France est limitée à l’Hexagone mais un Hexagone où ne vivraient que des femmes « blanches » (et bourgeoises en majorité). Je ne fais pas partie de celles qui disent que le MLF n’aurait été que « bourgeois et blanc ». C’était un ensemble de groupes avec une très grande diversité de positions, de pratiques, d’objectifs, certains étaient très radicaux dans leur analyse. Il y avait des groupes de femmes dans les syndicats, dans les groupes d’extrême-gauche, dans les partis de gauche, les femmes se battaient pour se faire entendre… Au MLF, il y avait une forte dimension anti-impérialiste mais l’impérialisme était états-unien, il n’y avait pratiquement aucune analyse concrète de l’impérialisme français. Les femmes des groupes qui constituait cette organisation souple appelée MLF ne se sont jamais montrés très intéressées par les luttes contre le BUMIDOM qui organisait la migration des jeunes des DOM, ni à l’Ordonnance Debré, ni au procès contre les jeunes du Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe (GONG) en 1968 où témoignèrent Sartre, Leiris, Césaire, Vergès. Je pense qu’elles ne voyaient pas quels liens les luttes anticoloniales dans les outre-mer auraient pu avoir avec les luttes de femmes. La question coloniale – de cette forme de domination – avait disparu comme une des questions qui auraient pu éclairer la manière dont l’Etat pesait sur le social. Comme j’ai moi-même été dans des groupes du MLF, j’ai observé cela et j’y ai répondu non pas en portant ces questions à l’intérieur de ces groupes ou alors de manière marginale, mais en continuant à militer à côté dans des organisations anticoloniales, en participant à leurs actions et manifestations.
Le récit des luttes des femmes en France exclut les luttes des femmes esclaves, celles qui vivaient en France hexagonale au 18ème siècle : comment leur présence contribue à la construction de la « femme blanche », de la « beauté blanche » ; quelles étaient leurs conditions d’existence, quelles furent leurs luttes pour se libérer (acheter leur liberté ? réclamer le droit d’être libre ?), comme celles des femmes esclaves aux colonies pour leur liberté, leurs droits comme mère ou compagne contre les droits que donnaient le Code noir aux propriétaires d’esclaves. Ça a déjà été difficile d’ajouter les femmes ouvrières (les paysannes existent à peine), aujourd’hui les femmes immigrées commencent à apparaître mais si vous interrogez une jeune femme aujourd’hui sur les luttes des femmes, elle vous citera au mieux Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi ou Simone Veil mais jamais Sanite Bélair, la mulâtresse Solitude ou Héva (des femmes esclaves insurgées ou marronnes). Le « féminisme » comme idéologie des luttes des femmes est blanc de manière hégémonique.
Que fait le récit féministe de l’absence de droits civiques des femmes blanches mais qui ont quand même le droit de posséder des êtres humains, de les acheter, les vendre, les louer, les tuer puisque comme femmes blanches elles ont le droit d’être esclavagistes ? Comment analyse t-il le fait que l’anti-esclavagisme fut une des matrices du féminisme européen, mais sans jamais analyser la dimension coloniale et raciale qui ont produit la suprématie blanche ?
Pas un mot non plus sur ce que la décolonisation a apporté au féminisme européen. Pratiquement rien sur le fait que des républicaines, ou bien après la seconde guerre, des résistantes, des déportées ont soutenu la colonisation (dans sa reconfiguration de « l’Union française ») ? Pourquoi ? Quelles étaient les sources de leur adhésion, de leur aveuglement ? Certes, des féministes françaises ont rejoint des mouvements anticoloniaux, mais je parle de la manière dont l’histoire des femmes continue à être écrite. Comment les femmes deviennent-elles « blanches » ? Que veut dire renoncer concrètement aux privilèges de la suprématie blanche ? Et pour moi, la réponse n’est pas exclusivement la politique des identités, je comprends sa nécessité mais je ne lâche pas la lutte anticapitaliste et anti-impérialiste.
Aucun mouvement n’est entièrement protégé de l’universalisme abstrait et aveugle ou du désir de représenter le « tout » (social, culturel,…). Il faut une lutte constante contre ces dérives. Aujourd’hui les groupes afro-féministes ou du féminisme musulman reprennent l’histoire de ces luttes et articulent de nouveaux discours. Le film d’Amandine Gay « Ouvrir la voix », la marche du MAFED en octobre 2015, les débats et rencontres qui se multiplient dans les facs, les associations sur le féminisme, la théorie queer, le transgenre…, témoignent que le féminisme, comme lutte pour la justice sociale, est toujours important.
CT – Le discours universaliste mis en avant par le mouvement féministe (« nous les femmes ») ainsi que la métaphore de l’esclavage ne sont-ils pas à replacer dans le cadre intellectuel et politique de l’époque, dominé par le marxisme (dans ses différentes variantes) ? La mise en avant d’une situation supposément commune à toutes les femmes serait alors une façon de répondre à un discours « marxiste » qui met au premier plan la division entre prolétaires et bourgeoises.
FV – On peut dire ça. C’est sans doute un aspect mais en rester là évite de penser pourquoi des textes qui, dès les années 1950-1960, soulignaient l’importance de la dimension coloniale/raciale sont restés ignorés. Parce que leur auteurs ne sont toujours pas considérés comme faisant partie de la « tradition théorique » de gauche ? Je pense au Discours sur le colonialisme (1950 déjà!) d’Aimé Césaire qui analyse le nazisme comme un effet-retour du colonialisme et qui cite longuement les déclarations racistes d’icônes républicaines, ou à sa lettre de démission du PCF en 1956 dont je me dois de citer un long passage :
« Dans ces conditions on comprend que nous ne puissions donner à personne délégation pour penser pour nous ; délégation pour chercher pour nous ; que nous ne puissions désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de nos amis, se porte fort pour nous. Si le but de toute politique progressiste est de rendre un jour leur liberté aux peuples colonisés, au moins faut-il que l’action quotidienne des partis progressistes n’entre pas en contradiction avec la fin recherchée et ne détruise pas tous les jours les bases mêmes, les bases organisationnelles comme les bases psychologiques de cette future liberté, lesquelles se ramènent à un seul postulat : le droit à l’initiative.
Je crois en avoir assez dit pour faire comprendre que ce n’est ni le marxisme ni le communisme que je renie, que c’est l’usage que certains ont fait du marxisme et du communisme que je réprouve. Que ce que je veux, c’est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs, et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Que la doctrine et le mouvement soient faits pour les hommes, non les hommes pour la doctrine ou pour le mouvement. Et bien entendu cela n’est pas valable pour les seuls communistes. Et si j’étais chrétien ou musulman, je dirais la même chose. Qu’aucune doctrine ne vaut que repensée par nous, que repensée pour nous, que convertie à nous. Cela a l’air d’aller de soi. Et pourtant dans les faits cela ne va pas de soi.
Et c’est ici une véritable révolution copernicienne qu’il faut imposer, tant est enracinée en Europe, et dans tous les partis, et dans tous les domaines, de l’extrême droite à l’extrême gauche, l’habitude de faire pour nous, l’habitude de disposer pour nous, l’habitude de penser pour nous, bref l’habitude de nous contester ce droit à l’initiative dont je parlais tout à l’heure et qui est, en définitive, le droit à la personnalité. »
Pourquoi ce texte ne fait-il toujours pas partie des grands textes théoriques critiques ? Les nombreux exemples de lâcheté de la gauche française ne sont seulement à dénoncer – au bout d’un moment, c’est stérile – mais à analyser : qu’est ce qui conduit à ce consentement ? Dans les « Cahiers du communisme » d’avril 1945, on lit :
« A l’heure présente, la séparation des peuples coloniaux avec la France irait à l’encontre des intérêts de ces populations. »
Le 6 avril 1951, alors que des milliers de Malgaches pourrissent dans les geôles de la France, François Mitterrand déclare :
« Je me déclare solidaire de celui de mes prédécesseurs sous l’autorité duquel se trouvait M. de Chevigné quand il était haut commissaire. Les statistiques manquent de précision mais il semble que le nombre de victimes n’ait pas dépassé 15 000. C’est beaucoup trop encore, mais à qui la faute si ce n’est aux instigateurs et aux chefs de la rébellion. »
Heureusement, il y a eu des voix, d’anarchistes, de surréalistes, de trotskystes et de communistes contre le colonialisme, mais ce que disent Césaire puis Frantz Fanon (sur l’attitude de la gauche française pendant la guerre d’Algérie) reste des questions fondamentales. Donc, pour revenir à votre question, je répondrai par cette question : pourquoi, alors que ces textes sont accessibles, continuer à les ignorer ? Est-ce parce que la gauche française marxiste se pense comme universelle ? Qu’elle ne ressent pas le besoin de se mettre en position de se taire et d’écouter ?
Certes, il y avait l’énorme couvercle du masculinisme de la gauche et de l’extrême-gauche à soulever. Leur machisme était assez insensé. On peut comprendre l’appel à une « sororité » globale, l’idée que les femmes constituent une « classe », mais comprendre c’est aussi poser la question de l’impossibilité à voir ce qui est là. L’épistémologie de l’ignorance – nécessaire au maintien du colonialisme et du post-colonialisme – autorise ces aveuglements. L’histoire que je raconte était rapportée dans des journaux nationaux lus par les femmes du MLF et pourtant elles l’ont ignoré quand elles ont développé les idéaux de la lutte pour la libéralisation de la contraception et de l’avortement.
On peut aussi dire que l’idée d’une sororité globale était un symptôme de cette pensée européenne qui cherche « la » communauté, « la » classe rédemptrice, qui serait « l’avant-garde », qui concentrerait en elle toutes les victimisations et donc toutes les capacités d’émancipation. Et ça, je n’y crois pas du tout.
Les hommes d’extrême-gauche, des syndicats, ne comprenaient pas le besoin de non-mixité, ça les rendait agressifs, réellement agressifs. Il est arrivé qu’ils envahissent les réunions de femmes, qu’ils insultent, menacent de viols, de coups, et qu’ils frappent. Mais jamais, comme il y a deux mois, une élue de gauche et une association dite « antiraciste » n’ont menacé de faire appel à la loi pour les interdire comme avec le Festival des Mwasi. Ça, ça indique un changement. Et cette fissure qui apparaît clairement est importante, elle permet enfin de s’attaquer à un fémonationalisme, au fait que se dire « féministe » aujourd’hui est à la mode alors que c’était une insulte. Même les femmes d’extrême-droite peuvent se dire « féministes ». Il y a urgence à repolitiser le féminisme.
CT – Comment analysez-vous l’évolution des mouvements/organisations féministes depuis les années 1970 sur la question raciale ? Il semble y avoir eu un double mouvement, à la fois d’institutionnalisation, mais aussi d’intégration par des organisations plus radicales des questions raciales. La polémique autour du festival afroféministe organisé à Paris par Mwasi semble mettre en lumière ces deux tendances.
FV – Je parlerai de plusieurs glissements et institutionnalisations, pas nécessairement de coupures nettes. D’une part en 1970, le nom donné par les médias et rapidement adopté par les groupes de femmes, « Mouvement de Libération des Femmes », qui fait écho au nom du mouvement des femmes aux USA (Womens’ Lib) mais aussi, et surtout dans le contexte de l’époque, aux mouvements de libération nationale, c’est-à-dire à des mouvements de décolonisation anti-impérialistes, qui se disent souvent désireux de construire le « socialisme », est abandonné au profit de « droits des femmes », « parité », ce qui dépolitise le féminisme. Il s’agirait de lutter pour l’égalité avec les hommes. Certes, aucune justification à ce que les salaires des femmes soient toujours pour la même formation, le même poste, inférieurs à celui des hommes. Et la féminisation des métiers a toujours signifié leur infériorisation et dépréciation. Sans parler des crimes envers les femmes – une femme tuée tous les trois jours en France par un proche ! Mais les luttes de libération des femmes doivent aussi porter sur la justice sociale, l’antiracisme, l’anticapitalisme, l’anti-impérialisme. Je tends à me répéter là-dessus mais c’est parce que je trouve que ce n’est toujours pas assez dit.
Il y a eu des institutionnalisations mais ça ne répond pas à la question : pourquoi ça a marché ? Les divisions internes n’ont pas été sans conséquences. L’appropriation du sigle « MLF » par le groupe Psychanalyse et Politique qui le dépose à l’Institut national de la propriété industrielle en 1979 (je m’en souviens, j’étais à Psy et Po) a été terrible. Procès en diffamation et attaques se succèdent. Des récits en ont été faits, mais je pense qu’il serait utile d’y revenir. La décennie de la femme décrétée par l’ONU a accéléré la dépolitisation des luttes de femmes, comme l’a bien montré Silvia Federici. L’impérialisme et le capitalisme ont compris comment l’intégration des « droits des femmes » pouvait servir leurs intérêts. On savait déjà comment la question de civiliser les femmes de couleur et de les « protéger » des hommes de couleur avaient servi le colonialisme mais là, ça s’est accentué. Des guerres impérialistes ont été déclenchées notamment au nom des « droits des femmes ». Il y a eu suffisamment d’études là-dessus, sur le rôle de l’idéologie développementaliste ou humanitaire pour que je n’y revienne pas. Ce qui importe, c’est de comprendre à quel point une idéologie des « droits des femmes » a contribué à pacifier les luttes des femmes pour la justice sociale, la liberté, la dignité et contre le capitalisme et l’impérialisme.
Alors qu’il y a 15 ou 20 ans, des femmes de droite et d’extrême-droite ne se seraient jamais dites « féministes », aujourd’hui tout le monde peut l’être et même porter des tee-shirts à 100 € avec écrit dessus « je suis féministe ». Il y a un féminisme corporate, un féminisme de droite et d’extrême-droite, un féminisme « blanc » qui défend les « valeurs républicaines », se dit de gauche et est obsédée par l’Islam.
Concrètement, je dirai qu’il faut reprendre les récits, reconstruire des alliances, dénationaliser, décoloniser le féminisme, le repolitiser. Cela se fait déjà. Des jeunes femmes brillantes sont nommées dans des universités – Nadia Yala Kisudiki, Hourya Bentouhami…-, je vois de plus en plus de doctorantes s’emparer de ces sujets ; artistes, journalistes et militantes associatives interviennent de manière créatrice dans les débats. Je ne dis pas que ça va être facile, ne sous-estimons ni les adversaires, ni la division des subalternes, mais ça ce n’est pas nouveau. Mais c’est une période excitante car elle exige de penser et d’agir en déployant de nouvelles méthodologies transversales, en désoccidentalisant ses références, en installant le doute et la curiosité comme principes, en réduisant l’écart entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Les femmes et les peuples des Sud sont particulièrement concernés par cet écart, ayant été associés à la « Nature » qui est de plus en plus appropriée par le Capital et la Science.
Propos recueillis par Elsa Boulet.
Notes
[1] Françoise Vergès, Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin Michel, 2017.









