
Des féministes noires au coeur de la lutte anticoloniale
Nous sommes heureux·ses de proposer à nos lecteurs·rices un extrait de l’introduction du livre Imaginer la libération. Des femmes noires face à l’Empire, d’Annette Joseph-Gabriel, paru tout récemment aux éditions Ròt-Bò-Krik.
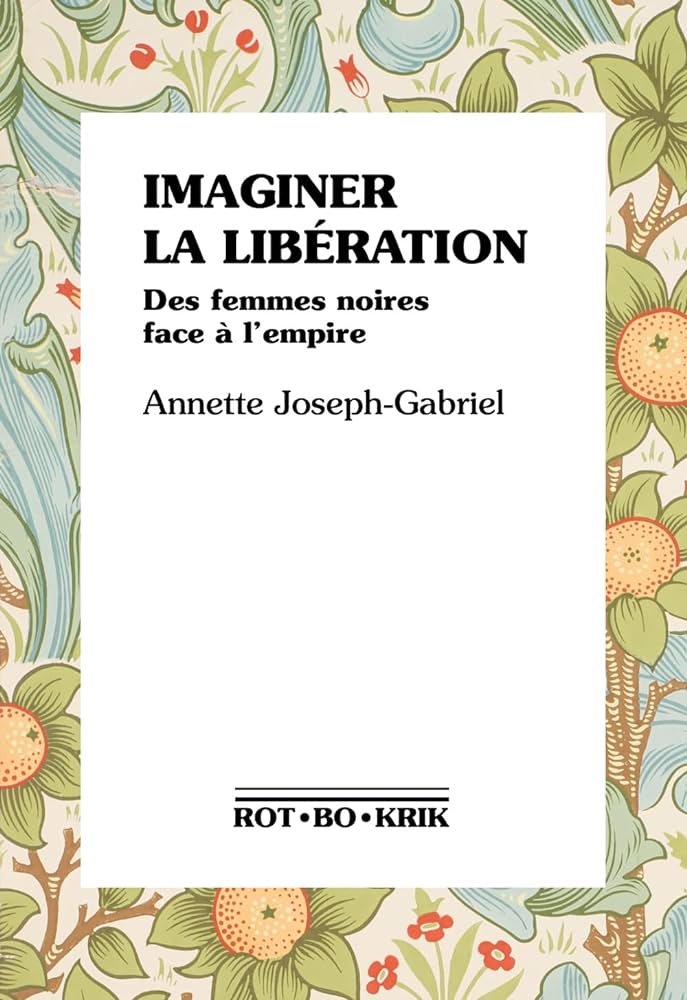
Des récits libérateurs
Imaginer la libération débute avec Suzanne Césaire, dont les écrits sur la citoyenneté politique et culturelle en France et dans la Caraïbe furent parmi les plus puissantes articulations de l’antifascisme et de l’anti-impérialisme dans les Antilles françaises. Si les chercheuses et les chercheurs se sont jusqu’ici penchés sur sa participation à la négritude et au surréalisme exclusivement par le biais des essais qu’elle publia, j’ai recours à des archives inexploitées, dont sa correspondance privée, des écrits inédits et des photographies, qui permettent d’explorer sa pensée de l’identité politique antillaise dans les bouleversements de la guerre mondiale. Le premier chapitre, « Suzanne Césaire : la libération par-delà le grand camouflage », entend réarticuler la conception de la citoyenneté qui fut la sienne dans le cadre de son engagement en faveur de l’archipel des Caraïbes en général et d’Haïti en particulier. Ses écrits de Port-au-Prince, datant du séjour qu’elle y fit avec son mari en tant que membre d’une délégation culturelle française, montrent le déplacement de son point d’analyse central, qui passa de l’héritage du colonialisme français en Martinique aux possibilités d’une appartenance pancaribéenne, exprimée tant par la pratique politique que par la création artistique. Les cinq mois formateurs passés en Haïti en 1944 lui révélèrent l’île comme un site d’imagination politique, un espace génératif où une identité caribéenne pouvait être forgée.
Le chapitre se clôt sur une lecture minutieuse de l’interprétation que fit Suzanne du poème canonique d’Aimé, Cahier d’un retour au pays natal, et de sa véritable vision d’une résistance et d’une créativité noires et diasporiques. Sa correspondance construisit un espace depuis lequel elle put développer ses engagements au long cours dans les débats littéraires et politiques de son temps, bien après la publication de ses écrits dans Tropiques. De la Martinique à la Caraïbe, de l’archipel à la diaspora africaine, le travail en constante évolution de Suzanne Césaire conserve la marque de sa foi inébranlable en la création artistique comme fondation imaginaire de nouvelles communautés politiques, de nouvelles configurations d’appartenance, par-delà l’oppression de la domination coloniale.
L’analyse de la virulente dénonciation par Césaire du colonialisme et son espoir d’une expression propre à la Caraïbe procurent des éléments contextuels utiles pour étudier les écrits d’après-guerre de Paulette Nardal. Le deuxième chapitre, « Paulette Nardal : les Martiniquaises comme protagonistes politiques en outre-mer », voit le débat sur la citoyenneté lancé par Suzanne Césaire en Martinique changer de contexte en raison du statut départemental nouvellement acquis de l’île. L’attachement de sa compatriote à la question d’une nouvelle identité caribéenne, Nardal l’affina en explorant plus explicitement le rôle des femmes dans la fabrique de cette identité. Sa définition de la citoyenneté des Martiniquaises s’ancre dans une pluralité plutôt que dans l’appartenance à un état-nation unique. S’adressant spécifiquement aux plus récentes citoyennes de France, les Antillaises, les écrits de Nardal entendaient les placer au centre d’une citoyenneté franco-antillaise plurielle et composite soigneusement négociée. Les Martiniquaises étaient selon elle dans une position incomparable pour remettre en cause les formes d’exclusion de la citoyenneté déployées par la métropole, et de ce fait elle les enjoignit à s’engager dans la politique et la production culturelle. Pour Paulette Nardal, les femmes sont le catalyseur de la transformation politique de la Martinique coloniale en un espace décolonisé, où la citoyenneté française pourrait coexister avec les spécificités de l’héritage caribéen de l’île plutôt que de les effacer, et où le recours à la loi pourrait contrer le pouvoir hégémonique de l’élite créole blanche.
Comme pour Césaire, j’élargis le périmètre des travaux existants sur Nardal en ne me limitant pas à une sélection de récits et d’essais publiés. Ses écrits de l’entre-deux-guerres sont de plus en plus étudiés dans leur rapport à la négritude et à l’internationalisme noir. Ces textes ne sont néanmoins qu’un sous-ensemble d’une œuvre qui s’étend sur près de quatre décennies et deux continents. Dans ce chapitre, l’analyse de la pensée nardalienne au-delà de la négritude figure toute l’ampleur de son implication dans la question de l’identité politique martiniquaise, puisqu’on la retrouve jusque dans des travaux bien moins connus : ses articles dans des journaux parisiens de l’entre-deux-guerres, ses contributions à un guide touristique commandé par le gouvernement, son rapport de 1946 sur le féminisme colonial ou ses éditoriaux publiés après-guerre dans la revue La Femme dans la cité. Cette diversité de genres permit à Nardal de s’adresser à différents publics des deux côtés de l’Atlantique, tandis qu’elle cherchait à trouver un équilibre délicat entre son appartenance culturelle antillaise et son identité politique française dans les premières années de la départementalisation de la Martinique.
La revue de Nardal, La Femme dans la cité, souligna le rôle crucial des femmes antillaises dans la reconstruction d’après-guerre. Étant un des seuls lieux de préservation des témoignages des femmes noires sur leurs expériences de la guerre, sa revue nous rappelle aussi que l’histoire des Africaines et des Antillaises pendant les conflits mondiaux reste à faire. L’engagement d’Éboué-Tell et de Vialle dans la Résistance française est l’un des points d’entrée possibles dans cette histoire, montrant les effets que la Seconde Guerre mondiale put avoir dans l’approche de la citoyenneté par les femmes noires françaises dans l’après-guerre. Au sommet de leur carrière, Éboué-Tell et Vialle furent des voix éminentes du dialogue transatlantique sur la race, le genre et la citoyenneté, à une époque où la France se réinventait en tant que nation et tentait de redéfinir ce que signifiait être français. Les souvenirs de la Résistance et de la collaboration étaient encore frais dans la mémoire collective quand l’Assemblée nationale constituante ratifia la nouvelle Constitution de 1946. À l’époque députée, Éboué-Tell fut impliquée dans la rédaction de cette Constitution qui reconfigura l’empire français en Union française, une fédération comprenant la France métropolitaine et ses territoires d’outre-mer en Afrique, en Indochine, dans les océans Atlantique et Indien. Éboué-Tell et Vialle avaient été élues au Conseil de la République, nouveau nom du Sénat, pour représenter respectivement la Guadeloupe et l’Oubangui-Chari, à un moment historique qui vit Antillais et Africains acquérir un nouveau statut, quelque part entre celui de sujet et celui de citoyen. Exploitant la puissante et souvent séduisante rhétorique des idéaux républicains français, les deux élues proposèrent des législations accroissant les opportunités économiques et éducatives des Africaines et des Antillaises. En construisant activement des réseaux féministes à travers la diaspora africaine, elles cherchèrent également à exprimer leur conception élargie de l’appartenance, au-delà du cadre de l’empire français.
Le chapitre trois, « Eugénie Éboué-Tell et Jane Vialle : changer les représentations du pouvoir dans l’Union française », fait fonction de pont entre les deux premiers chapitres, sur les possibilités de libération imaginées depuis la zone grise de la départementalisation des Antilles, et les deux suivants, qui portent sur les revendications indépendantistes des femmes africaines. Je ne cherche pas à présupposer une interconnexion inhérente à l’Afrique francophone et aux Antilles dont l’origine serait à chercher uniquement du côté de leur commune colonisation par la France. J’examine plutôt comment les travaux d’Éboué-Tell et de Vialle au Conseil de la République dans les années 1940 et 1950 raccordèrent délibérément l’activisme anticolonial des femmes des Antilles à celui des femmes de l’AEF (Afrique-Équatoriale française) et comment elles étendirent cet activisme au-delà des frontières de la France impériale pour y inclure les États-Unis. Éboué-Tell et Vialle forgèrent des réseaux féministes noirs transnationaux et se revendiquèrent ainsi de multiples communautés et affiliations politiques, enjambant les frontières nationales et impériales. Ce chapitre examine leurs idées telles qu’exprimées dans une grande variété formelle, discours, entretiens, essais et même affiches de campagne électorale, pour montrer combien leur expérience dans la Résistance française — Éboué-Tell avec les femmes des Forces françaises libres à Brazzaville, Vialle dans la clandestinité puis comme prisonnière dans un camp de concentration en France — informa leur politique anticoloniale. Éboué-Tell, Guyanaise vivant en Afrique centrale, et Vialle, métisse* africaine voyageant entre la France métropolitaine et l’AEF, tracèrent une géographie nouvelle et étendue de la résistance féministe et transnationale afrodiasporique.
Filles de mères africaines et de pères français, Jane Vialle et Andrée Blouin naviguèrent dans les eaux tumultueuses de la politique raciale des mouvements anticoloniaux. Les deux femmes se revendiquèrent comme métisses*, tant du point de vue de l’identité raciale que du genre. Elles y virent aussi une affiliation politique et affirmèrent que les réalités sociales qui leur étaient imposées par la logique racialisante du colonialisme français appelaient en retour un ensemble spécifique de stratégies politiques de libération. Dans son autobiographie, Blouin décrivit la réalité vécue d’une métisse* africaine évoluant dans un espace chargé politiquement, toujours fluctuant, en particulier dans le contexte des luttes de décolonisation. Elle montra qu’établir une communauté et des alliances politiques pour les Africaines qui s’identifiaient ou étaient catégorisées comme métisses* réclamait de négocier son identité entre de multiples espaces coloniaux, à savoir, dans le cas de Blouin, la France, la Belgique et leurs Congos respectifs. Le chapitre 4, « Andrée Blouin : métissage et libération africaine dans My Country, Africa », se penche sur la défense par Blouin de modes de citoyenneté sensibles aux gradations et aux nuances souvent perdues dans les fissures d’un discours anticolonial binaire sur les identités, opposant Noirs et Blancs, Africains et Européens. C’est de s’être elle-même débattue à l’intersection de multiples positions raciales, culturelles et politiques qui forma sa vision d’une citoyenneté panafricaine plus vaste à l’aube des indépendances. En décryptant les interventions paratextuelles de Jean MacKellar — l’Américaine qui transcrivit ses entretiens avec Blouin pour en tirer My Country, Africa — et en lisant parallèlement le roman d’Henri Lopes Le Lys et le Flamboyant, librement inspiré de la vie de Blouin, j’appréhende l’expression identitaire de celle-ci par le prisme du métissage* textuel à l’œuvre dans son autobiographie controversée. Cette hybridité textuelle qui remet en jeu la frontière entre biographie et autobiographie produit un écho à la double appartenance* de Blouin en tant que métisse* engagée dans la décolonisation de l’Afrique.
Autrice autant que sujet de Femme d’Afrique : La Vie d’Aoua Kéita racontée par elle-même, Aoua Kéita fait figure de protagoniste politique par excellence. Elle est à la fois le sujet d’un récit historique — la première autobiographie publiée en français par une Africaine — et une figure centrale de la lutte anticoloniale du Soudan français. Militante syndicale dans le Soudan français colonial, Kéita devint la première femme députée à l’Assemblée nationale du Mali nouvellement indépendant et remporta le prestigieux Grand Prix littéraire d’Afrique noire, qui distinguera par la suite des auteurs et autrices comme Senghor, Mariama Bâ ou encore Véronique Tadjo. À la différence des autres femmes étudiées jusqu’ici, qui s’impliquèrent dans ces questions de citoyenneté depuis la perspective des élites urbaines éduquées, Kéita porta la voix des femmes non alphabétisées du Mali rural, aussi négligées dans la recherche actuelle qu’elles l’étaient alors par la France impériale. Ses écrits s’opposèrent à cet effacement en présentant les femmes de la campagne comme une force redoutable dans la lutte pour une citoyenneté décoloniale au Soudan français.
Le chapitre 5, « Aoua Kéita : les femmes rurales et le mouvement anticolonial dans Femme d’Afrique », prolonge le récit sur les réseaux féministes noirs pour y inclure la résistance collective et la formation communautaire chez les femmes des zones rurales. Aborder l’autobiographie de Kéita au côté du roman d’Ousmane Sembène Les Bouts de bois de Dieu et de son film Emitaï aide à recentrer le rôle des femmes rurales dans la lutte anticoloniale en Afrique de l’Ouest et leurs stratégies de résistance collective, fondées de manière primordiale sur une mobilité transgressive. Par des marches, des manifestations ou des occupations — actions souvent accompagnées de tout un ensemble de prises de parole, dont des chants et des ululements —, les femmes des communautés rurales travaillèrent à inverser la dépossession coloniale des terres et la marginalisation des femmes noires. Ce chapitre s’intéresse principalement à l’autobiographie de Kéita en tant que source littéraire et historique sur l’autoreprésentation politique et l’activisme public des femmes dans les années qui précédèrent l’indépendance. Il a aussi recours à l’œuvre de Sembène, qui représenta dans des fictions les actions politiques de masse menées par des femmes d’Afrique-Occidentale française contre l’exploitation coloniale. Les œuvres de Kéita et de Sembène présentent des récits historiques alternatifs qui témoignent du rôle central des femmes africaines dans les mouvements de libération.
Eslanda Cardozo Goode Robeson est le lien qui rapproche un peu plus encore ces histoires interconnectées. Dans son travail journalistique et anthropologique aux États-Unis, en Afrique centrale et en Europe, Robeson rencontra presque toutes les femmes dont les œuvres sont étudiées ici. Elle conduisit un entretien avec Nardal à Paris en 1932 et avec Vialle en Oubangui-Chari en 1946. Elle correspondit avec Éboué-Tell dans les années 1940. De fait, beaucoup de ces femmes étaient liées, directement ou indirectement. Vialle et Blouin se connurent. Kéita et Blouin participèrent toutes les deux au congrès historique de 1957 du Rassemblement démocratique africain, qui réunit des centaines de délégués d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale en vue d’établir une stratégie commune vers l’indépendance.
La présence de Robeson dans l’histoire que cette étude cherche à raconter ne tient pas qu’à ses relations avec des femmes comme Nardal et Éboué-Tell. Ses voyages dévoilèrent aux femmes noires des possibilités nouvelles d’œuvrer à une citoyenneté décoloniale au-delà du contexte francophone. Les réflexions qui furent les siennes au cours de ses déplacements peuvent beaucoup apporter aux débats actuels sur la définition du Sud global. Ce qui m’intéresse donc au plus haut point dans le travail d’Eslanda Robeson, c’est combien elle investit dans la notion de solidarité alors qu’elle cherchait à articuler une citoyenneté du Sud global enracinée dans la résistance à l’impérialisme. Le chapitre 6, « Eslanda Robeson : un féminisme noir transnational dans le Sud global », se concentre sur les journaux de voyage de Robeson, racontant ses pérégrinations en Afrique australe en 1936 et en Afrique-Équatoriale française en 1946. Dans ses textes, elle imagina un projet pour le Sud global en rupture avec l’idée que c’était la sujétion commune à l’ordre impérial qui unissait les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. Le Sud global qu’elle décrivait était au contraire défini par la résistance à l’impérialisme dans des formes variées, une résistance dans laquelle les femmes tenaient un rôle prépondérant. Même lorsqu’elle débattait avec les forces oppressives du suprémacisme blanc et du patriarcat, Eslanda Robeson savait les décentrer. Cette citoyenneté transnationale unissant les marginalisés du monde qu’elle appelait de ses vœux nous permet de comprendre combien les femmes noires façonnèrent le Sud global par leurs mots.
Les femmes dont les voix sont mises en exergue dans ce livre écrivirent à un moment spécifique, où le monde était encore sous le choc de la Seconde Guerre mondiale, que la solidarité anticoloniale était à son apogée et qu’imaginer un monde nouveau, égalitaire et décolonisé, signifiait reconfigurer le monde des colonisés, mais aussi celui des colonisateurs. Avec la dissolution de l’Union française et la vague des indépendances qui balaya le continent africain, les possibilités d’auto-détermination changèrent également. Dans la conclusion de cette étude, je me penche sur les écrits d’une génération postérieure d’autrices, sur leurs perspectives d’organisation politique et de production intellectuelle. Circulant en Afrique de l’Ouest dans les années 1960 et 1970 sous la direction éditoriale d’Annette Mbaye d’Erneville, Awa : La Revue de la femme noire offre un lieu d’observation de la construction des réseaux féministes transnationaux après les indépendances. Imaginer la libération présente les écrits des femmes noires dans une approche renouvelée des identités noires globales. Pour comprendre les expressions d’appartenance et de solidarité, ces textes se fondent sur le dépassement des frontières nationales et linguistiques. Les vies et les expériences de ces femmes témoignent du fait que si l’impérialisme s’étendit sur tous les continents, il en fut de même pour les réseaux féministes et les modes de résistance.









