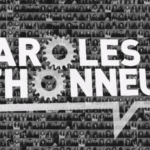Décolonisons-nous ! Un extrait du livre de Frank Lao
Nous sommes heureux·ses de proposer des « bonnes feuilles » du livre Décolonisons-nous de Frank Lao, qui vient de paraître aux éditions JC Lattès.
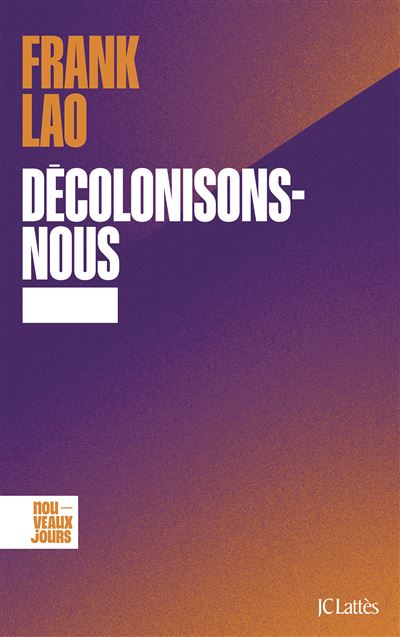
« Non, la race n’existe pas. Si, la race existe. Non certes, elle n’est pas ce qu’on dit qu’elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. »
Colette Guillaumin
J’ai perdu mon père à l’âge de neuf ans en 1993. L’État l’a tué. Il l’a assassiné. Si mon père n’était évidemment pas que ça à mes yeux, c’est en victime d’un des plus grands scandales sanitaires de la fin du XXe siècle qu’il a quitté ce monde : l’affaire du sang contaminé par le VIH. Survenue dans les années 1980, cette crise majeure a révélé la responsabilité de l’État dans l’absence de contrôle de la conformité des produits sanguins destinés à la transfusion. Un besoin en sang dû à une anémie passagère a été pour lui une condamnation à mort, qui s’est prolongée presque une décennie. J’en ai été le premier témoin. Il sera très souvent fait référence à ces premières années de vie et à la mort de mon père, car cette période a hanté et hante encore mon existence.
Propulsé dans le monde des adultes, auxiliaire de vie à ses côtés puis orphelin, j’ai été un enfant sans enfance, puis un adolescent en colère, des questions sans réponses plein la tête. Il m’a fallu des années pour accepter la tragédie que j’avais vécue, apprendre à vivre avec cette rage sans cher‑ cher à l’enfouir, l’apprivoiser pour coexister avec, puisqu’elle ne s’évanouirait jamais. On tente sans relâche de comprendre pour quelles raisons et à quel moment on a quitté les sentiers d’une certaine normalité, mais aucune logique à ça. C’est ce qui caractérise l’injustice : se demander obsessionnellement « pourquoi » sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Puis progressivement, au gré des recherches, en suivant l’actualité judiciaire de cette affaire, des liens se sont dessinés. Peu à peu, j’ai compris que l’intérêt de quelques puissants détermine parfois le quotidien et les trajectoires d’individus que l’on considère insignifiants. Voici comment les rêves d’une vie meilleure, ceux qui ont motivé la trajectoire migratoire de mes parents, se sont retrouvés brisés, et voici les prémices de ma conscientisation politique.
Mon père et ma mère sont issus d’une des immigrations postcoloniales d’Asie du Sud‑Est, plus précisément de familles sino‑laotiennes ayant toutes deux déjà vécu à la génération de mes grands‑ parents une migration contrainte par la guerre, celle provoquée par l’invasion du Japon impérialiste dans la Chine des années 1940. C’est ainsi que mon père est né à Pakse, et ma mère à Savannakhet, des villes situées au sud du Laos, un territoire de l’ex‑Indochine française enclavé entre la Thaïlande, le Myanmar, la Chine, le Cambodge et le Việt Nam. Leurs naissances ont respectivement eu lieu au début et à la fin des années 1950, et c’est dans les années 1970 qu’ils ont été amené·es à fuir à leur tour les exactions de la guerre civile qui déchirait le pays, doublement touché par celle qui ravageait le Việt Nam voisin. Quant à moi, je suis né à Paris XIXe dans les années 1980, là où mes parents se sont rencontrés, en France. Je suis donc un enfant d’immigrés, de réfugiés non‑blancs, ce qui fait de moi ce qu’on appelle communément un immigré « de seconde génération » – une formulation que j’ai toujours trouvée problématique : à partir de quelle génération n’est‑il plus nécessaire de compter ?
Les questionnements identitaires de la personne non‑blanche que je suis, évoluant en France, n’ont pas été de tout repos. « Français » a été la première identité à laquelle je me suis associé consciemment. Celle que j’ai intégrée à travers l’enthousiasme de mon père, et celle que l’on nous enseigne dès les premiers jours d’école. Pourtant, c’est aussi paradoxalement dans l’enceinte de celle‑ci que je suis devenu asiatique. J’y ai appris à me redéfinir comme « Sino‑Laotien de nationalité française », un compromis trouvé pour satisfaire la curiosité d’une institutrice à qui la nationalité française que j’avais indiquée ne suffisait pas. Cette formule s’est imposée à moi comme une nécessité, pour éviter aussi que le regard des autres ne m’enferme dans ce « Chinois » que je n’étais pas, et qu’aujourd’hui je ne considère toujours pas être.
L’identité est, selon l’Académie française, le « caractère de ce qui, dans un être, reste identique, permanent, et fonde son individualité ». Je considère qu’il serait intéressant d’y ajouter, sans que cela implique une contradiction, la notion de libre‑arbitre et donc de fluidité, qui complète cette définition en y intégrant plus explicitement la dimension expérientielle d’un individu. Ainsi, mon identité n’est pas seulement celle du « Chinois » à laquelle je suis assigné par la société. Je suis aussi entièrement, et à ma manière, « Laotien, Teochew, Français, hip‑hop, issu des quartiers de banlieue parisienne, du 9.4 – qui a sa propre culture –, puis de Chinatown à Paris XIIIe », et j’en passe… Je m’appelle Frank, mais aussi 維斌 pour la famille (WéiBīn en mandarin). Certains potes m’appellent Seum’R. Seuseu. Je suis tout ça. Mon identité est multiple. Insaisissable. Mienne.
Avant d’en arriver à cette conviction, je me souviens à l’âge de six ans avoir qualifié de racistes les propos tenus par ma mère ; elle avait employé le mot « Blanc » pour m’expliquer, dans un contexte où j’avais subi du racisme à l’école, pourquoi j’étais différencié dans cet environnement. Ses mots étaient durs, peut‑être trop pour mon oreille immature, c’étaient des mots d’adulte. Quand elle m’avait dit que je n’étais « pas français aux yeux des gens », je m’étais senti exclu une nouvelle fois. Je comprends aujourd’hui qu’elle m’expliquait que je n’étais pas blanc, et que c’était pour cette raison que je vivais cette expérience particulière. Elle me disait que le monde extérieur me voyait avant tout comme « quelqu’un avec une tête de Chinois », avant de conclure : « Tu verras, tu comprendras plus tard. » En retour, je lui martelais : « Non, à l’école, on nous a dit que c’était raciste de dire les couleurs, car on est français et tous égaux. » Pourtant, je l’appelais à l’aide pour ce que provoquaient chez les autres mon faciès et mes origines, réelles ou présumées. Mon déni servait de système de défense, mais, comme je l’ai compris plus tard, moins pour moi que pour l’ordre racial de la société.
Il y a urgence, mais on persiste à dire qu’il faut donner du temps au temps, que celui‑ci fait bien les choses. Un soir, en allant chercher mon fils aîné à la sortie de l’école maternelle, quand je l’ai vu tirer ses yeux et me demander pourquoi un camarade avait, ce jour‑là, reproduit cette mimique destinée, sans qu’il en ait conscience, à moquer ses traits, mon cœur s’est brisé et j’ai été ramené trente ans en arrière. Tout est à refaire, me suis‑je dit. Depuis, je suis tiraillé entre mon désir de préserver son sourire innocent et mon devoir de le préparer au monde qui l’attend. Il est la preuve vivante que le temps seul ne fait rien. La raison pour laquelle je ne peux rester impassible.
À son âge, je me souviens avoir ressenti de la fierté à me dire français. La France, je l’ai aimée. L’emploi de ce passé ne veut pas dire qu’aujourd’hui je la hais, ni elle ni sa population majoritaire. En réalité, il n’est nullement question d’amour ou de haine, j’ai dépassé ces considérations émotionnelles, et je sais aujourd’hui que nul sentiment nationaliste ne permettra la disparition du racisme – bien au contraire, car en Occident le racisme est lié aux concepts de nation et de civilisation. En fait, il a toujours été davantage question de politique que de sentiments.
Cet amour patriotique, que nous sommes invité·es à cultiver dès notre plus jeune âge – au moins dès que nous foulons le sol de l’école républicaine –, remplit une fonction particulière. C’est un héritage de l’histoire coloniale, qui permet d’effacer la conscience des rapports de domination raciale, et sert de ciment au mythe du vivre‑ensemble à la française. La devise « liberté, égalité, fraternité » trônant sur les frontons des institutions, nous y avons cru sans réserve, dans la candeur de l’enfance ou l’idéalisme plein d’espérance d’individus issus de l’immigration. Et il n’y a pas plus grande déception que celle causée par un être qui vous a été cher, qu’on a estimé, en qui on a placé sa confiance. En fin de compte, cette déception m’apparaît à présent comme le résultat d’une erreur de jugement, car je suis convaincu d’une chose : la société française produit plus de race qu’elle n’est véritablement antiraciste.
Aujourd’hui, comme ma mère à l’époque, je n’hésite plus à parler de race, à appeler « Blanc » celui qui en a tous les privilèges et « Non‑Blanc » celui qui subit des discriminations et des violences. N’en déplaise à ceux qui, non sans hypocrisie, s’emparent de cet argument pour faire des antiracistes les racistes par excellence. Parler de la race, ce n’est pas valider l’existence de catégories biologiques, mais affirmer que, du fait de leur couleur de peau, de leurs origines ethniques, de la connotation de leur nom, certains groupes ont une expérience différente de celle du groupe dominant.
La race est bien réelle, mais elle n’existe pas a priori ; c’est la conséquence d’un rapport de domination, le produit d’une racialisation, une construction sociale héritée d’une histoire longue d’au moins cinq siècles. Si certains nient cet état de fait, c’est qu’il est à leur avantage et qu’ils souhaiteraient, en plus, en jouir dans une bonne conscience collective.
J’ai passé ma vie à subir dans le silence les conséquences d’une couleur supposément invisible, sous peine d’être taxé de rabat‑joie, d’être trop susceptible, de mal interpréter les choses, ou de ne pas avoir la sagesse de dépasser ce qui résulterait d’un manque de maturité, d’intelligence, ou d’une ignorance. «Raciste ? Comment est‑ce possible dans le pays des droits de l’homme ? » « Va voir ailleurs si c’est mieux. » « Ne fais pas attention, ils sont juste bêtes et méchants. » Le sujet semble hérisser toute personne ayant été conditionnée à ne pas voir que la société catégorise et discrimine racialement à une échelle industrielle, et je ne compte plus les diversions pour ne pas condamner un préjudice pourtant évident.
Bien souvent, on refuse de reconnaître qu’il s’agit de racisme, ou bien on concède que c’est du racisme « ordinaire », qui fait pourtant partie selon moi du racisme que l’on dit systémique, institutionnel et structurel. En effet, le racisme s’exprime sur un large spectre et dans toutes les sphères – familiale, amicale, institutionnelle, professionnelle –, et il me semble donc indispensable de mettre en lumière toutes ses dimensions, afin de montrer qu’elles sont liées, et qu’il ne s’agit pas d’actes isolés. La minimisation de la violence n’est pas toujours intentionnelle, mais devient finalement une violence supplémentaire, la fabrication et l’entretien d’un angle mort où l’on nie la fonction de la race en tant que catégorisation sociale permettant que des rapports de force s’exercent. Ces approches très morales du racisme empêchent que l’on prenne conscience de sa dimension culturelle, politique, économique et sociale.
Le racisme relève de quelque chose de bien plus grand que cette trop simpliste notion de bien ou de mal. Dans les années 1990, ma découverte du hip‑hop, et plus précisément du rap français, a achevé de former mon opinion sur la question. Pour la première fois, j’entendais des artistes aborder le sujet du racisme en faisant référence à la colonisation et à l’esclavage. Ma mère m’avait mis la puce l’oreille grâce à ses explications sans détour, le rap me confortait dans l’idée : cette oppression avait quelque chose à voir avec une histoire coloniale mal connue de la majorité de la population. Des noms revenaient en boucle : Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, mais aussi – et c’est important de ne pas nous détourner de l’histoire de France – Aimé Césaire et Frantz Fanon.
Au lycée, je me suis décidé à aller au‑delà de l’éducation par le rap et me suis procuré Discours sur le colonialisme1 d’Aimé Césaire. Cette lecture a été un choc ; j’avais enfin la confirmation que la problématique raciale en France était indissociable de la colonisation, était son héritage direct. Et de cette prise de conscience pleine émergeait la pièce manquante d’un puzzle qui allait m’apporter une vision claire du système. J’obtenais enfin une réponse satisfaisante à la question à qui profite le crime ? ou, pour individualiser la problématique, à quel groupe social ?
C’est ce qui m’a en partie motivé à créer mon compte Instagram en mars 2019, sous le nom de « Décolonisons‑nous ». J’avais à cœur de documenter tous les aspects du racisme, et je souhaitais que mes publications concernent tout le monde, qu’importe son assignation raciale. Évidemment, une assignation raciale implique des responsabilités, des questionnements et des modalités d’actions et de réflexions spécifiques, mais le contenu de mon compte était destiné à toute personne souhaitant décentrer son regard.
Avec Décolonisons‑nous, je voulais participer à déconstruire l’héritage colonial de notre inconscient collectif, permettre de saisir la dimension systémique du racisme, et faire entendre l’importance d’une action non plus limitée à un discours moral ou palliatif. Se décoloniser, c’est faire l’effort de relier les points qu’un ordre établi voudrait qu’on perçoive comme indépendants, alors qu’ils forment, une fois mis en relation, le contour distinct d’un seul et même système qui nous déshumanise, qui que nous soyons.
Au fil des posts, j’ai reçu de nombreux retours positifs, en commentaires ou en messages privés, des remerciements provenant autant de personnes blanches que de personnes non‑blanches. En une poignée de jours, je suis passé à plusieurs centaines d’abonné·es, puis, très vite, à quelques milliers. Qu’autant de personnes témoignent de leur intérêt pour la question antiraciste m’a motivé à poursuivre. Avant de créer le compte, j’avais mûrement réfléchi à mon anonymat : il me permettait de me sentir entièrement libre d’un point de vue éditorial. Libre de m’exprimer sans prendre en compte ce que mon image pouvait véhiculer en parallèle, libre d’aborder les sujets les plus divers, et, pour mon audience, libre de s’identifier au contenu plus qu’à l’auteur et à son identité, réelle ou présumée. Ainsi, la question de la légitimité se posait beau‑ coup moins.
Bientôt, j’ai adopté une ligne de conduite : relayer des contenus avec lesquels j’étais politique‑ ment et idéologiquement aligné, qui adoptaient le plus possible la perspective des populations concernées, avant d’y ajouter mon opinion et mon analyse personnelle pour accompagner le lectorat. Le tout dans une démarche d’échange, pédagogique et participative, avec des publications toujours rigoureusement sourcées. Une réunion, je pense, de bonnes conditions pour qu’une communauté se développe autour de cette page qui, à ses débuts, n’était en fin de compte qu’un blog personnel rendu public, et qui s’est transformée depuis, au‑ delà de toutes mes attentes, en un média alternatif d’opinion et d’information politiques.
Mon identité, une fois révélée lors d’un épisode du podcast Kiffe Ta Race a surpris de nombreux abonné·es. Sur mon compte, la prédominance des publications concernant la lutte contre la négrophobie n’est pas un hasard : je considère que ce combat est central dans les questions antiracistes et décoloniales. Aussi, pendant ces trois années à ne pas dévoiler mon identité, de nombreuses personnes m’avaient interpellé comme si j’étais une femme noire ou nord‑africaine. Je crois que cela reflète aussi les représentations collectives que nous avons des luttes antiracistes actuelles.
À ce propos, j’aimerais apporter une précision importante : j’ai fait des choix terminologiques pour désigner les personnes non‑blanches, bien qu’ayant conscience qu’ils ne reflètent pas correctement la richesse des identités existantes. J’aurais bien évidemment préféré rendre compte de toutes les spécificités, c’est pourquoi je fais parfois des distinctions sémantiques, comme lorsqu’au lieu de dire Asiatiques je précise de l’Est, du Sud, etc. J’ai conscience que cela est encore insuffisant pour décrire avec fidélité les réalités de chacun·e. Lorsque je dis Nord‑Africain plutôt qu’Arabe, je réponds partiellement à un devoir de justesse, mais je ne prends malheureusement pas le temps nécessaire pour traiter par exemple de la question des populations noires imazighen qui existent aussi dans le nord du continent africain. Ainsi, ces termes seront employés surtout dans un souci de compréhension, dans un but descriptif, analytique et critique d’une société donnée et d’un système spécifique. Et bien évidemment pas dans une perspective identitaire.
Avec ce livre, je souhaite défendre l’idée qu’il nous faut changer le moule et la machine, plutôt que remodeler le produit, afin de permettre aux populations non‑blanches d’exister, de se reconnaître et de se célébrer hors de l’imaginaire collectif ; elles au‑dessus desquelles plane l’injonction intégrationniste contemporaine, comme autrefois le projet assimilationniste. Le racisme se déploie autant sur le plan social que culturel, économique, politique, sanitaire, intime ou environnemental. Il est tentaculaire. Si j’ai décidé d’écrire, c’est pour participer à un combat : que l’on cesse de faire des corps non‑blancs des marchandises, des instruments de production, des objets sexuels ; que l’on remette en cause un système de plagiat, le pillage des esprits et des cultures indigènes ; que l’on arrête l’exploitation des terres du Sud global en en faisant des terrains de jeu et d’expériences, ou des zoos.
Au cœur de la lutte antiraciste et de la question décoloniale, il y a des individualités, aussi variées que fluides, aspirant à la liberté. Des communautés, des groupes, des populations d’une richesse à laquelle l’essentialisation2 ne rend pas hommage. Par ce livre, je souhaite parler de race pour combattre le racisme. L’analogie n’est certes pas la meilleure, puisqu’elle ramène au biologique ce qui relève du politique, mais décrire un symptôme n’a jamais empiré la maladie. Comprendre le racisme, connaître sa genèse et identifier la manière dont il traverse et imprègne nos sociétés, c’est commencer à constituer les savoirs, à forger les armes qui le rendront inopérant. Ce livre, je l’espère, permettra à mes enfants de gagner un temps précieux : celui dont jouissent les personnes qui n’ont pas à courir derrière des pourquoi.