
Amianto. Une histoire ouvrière. Un extrait du livre d’Alberto Prunetti
Alberto Prunetti, Amianto. Une histoire ouvrière, Marseille, Éditions Agone, 2019, 144 p., traduit par Serge Quadruppani.
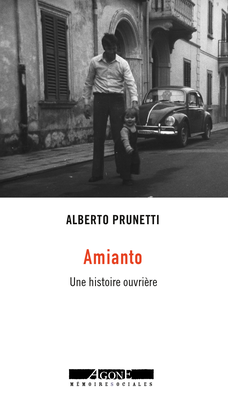
Présentation de l’éditeur
« C’est un travail dangereux de souder à quelques centimètres d’une cuve de pétrole. Une seule étincelle est capable d’amorcer une bombe qui peut emporter une raffinerie. C’est pour cela qu’on vous dit d’utiliser cette bâche gris sale, qui résiste aux températures élevées car elle est produite avec une substance légère et indestructible : l’amiante. Avec elle, les étincelles restent prisonnières et vous, vous restez prisonnier avec elles, et sous la bâche en amiante, vous respirez les substances libérées par la fusion de l’électrode. Une seule fibre d’amiante et dans vingt ans vous êtes mort. »
Alberto Prunetti raconte l’histoire de son père, Renato, né en 1945 à Livourne. Soudeur dans les raffineries et les aciéries italiennes depuis l’âge de quatorze ans, Renato s’empoisonne lentement au travail : il respire de l’essence, le plomb lui entre dans les os, le titane lui bouche les pores de la peau, et finalement, une fibre d’amiante se glisse dans ses poumons. Il meurt à 59 ans, après plusieurs années passées à l’hôpital.
En contrepoint de ce récit tragique, l’auteur rapporte ses souvenirs d’enfance, entre parties de foot et bagarres, et décrit une époque, sa musique, ses dialectes, ses grands événements sportifs – dans cette Toscane ouvrière où les années 1970 furent une décennie de luttes sociales, avant que les restructurations des années 1980 n’y mettent bon ordre.
L’opposition entre le père, parfait représentant de l’idéologie stalinienne du travail, et le fils qui incarne très vite la figure du précaire, n’empêche pas que s’exprime le profond amour qui les lie, teinté d’agacement et d’amusement avant que la maladie ne s’installe. L’humour constant, la délicatesse des sentiments, l’érudition historique et technique se mêlent dans ce récit.
Extrait – Dans un palais de justice
Quand Renato mourut, il ne nous vint pas même à l’esprit de réclamer des « dédommagements » en intentant un procès pénal. Mais, un jour, les services sociaux du syndicat nous ont contactés : on nous informait qu’approchait la date limite pour demander les indemnités de l’assurance sociale prévues pour les salariés exposés à l’amiante, demande que Renato avait déposée quand il était encore vivant. En tant qu’héritiers, nous avions le droit de le représenter pour cette demande. Nous décidâmes de nous lancer, non pas pour des raisons économiques – en cas de victoire, ma mère aurait eu droit à une légère augmentation de la pension de réversion de mon père – mais pour voir affirmé un principe : que Renato avait été exposé à l’amiante et que l’amiante était pour quelque chose dans la tumeur aux poumons qui l’avait assassiné. Il fallait se lancer, même devant cette déesse aux yeux bandés et balance en main, dont nous nous méfiions parce que nous l’avions vu trop souvent du côté des puissants, en espérant que la mobilisation des familles des victimes du travail ouvrirait des marges de manœuvre pour la vérité, laquelle n’apparaît pas si souvent dans les salles d’audience. Il fallait se lancer pour ceux qui nous avaient dit qu’on ne pouvait pas, qu’il fallait exhumer la dépouille. Il fallait se lancer parce que, quand maman alla aux services sociaux, même si les employés ne savaient par quel bout prendre l’affaire, les vieux ouvriers amis de Renato l’encouragèrent à continuer la lutte contre l’INPS et l’Inail. Il fallait se lancer contre les médecins qui ne voulaient pas s’exposer à déclarer noir sur blanc que Renato était tombé malade à cause des substances nocives respirées sur le chantier, des médecins qui invoquaient « l’objectivité scientifique », qui prétendaient soigner une tumeur sans remonter aux causes sociales et professionnelles qui l’avaient produite. Il fallait se lancer à cause des cadres des entreprises où il avait travaillé, qui avaient tourné la tête quand nous leur avions demandé un témoignage contre la société. Il fallait se lancer, en somme.
La première chose à faire, d’après la procédure, était de reconstruire le CV de la personne exposée à l’amiante, si possible avec une déclaration de l’entreprise sur la présence d’amiante dans ses chantiers. Ce qui n’était pas facile : Renato a travaillé dans bien des lieux différents. Les entreprises ne délivrent pas volontiers de certificats attestant leur nocivité pour la santé des travailleurs, et l’INPS et l’Inail ne vous répondent pas facilement. Ma mère a dû écrire à plusieurs reprises. Et quand on lui a répondu, les réponses étaient négatives. Un employé de l’Inail, sachant combien il est douloureux de réveiller un deuil, a même dit à ma mère que le seul moyen pour faire avancer la procédure serait d’exhumer le cadavre pour une autopsie (ce qui est absolument faux).
Voilà un exemple de réponse de l’Inail :
Inail de Gênes
À Renato Prunetti
Communication de rejet
En réponse à votre demande présentée le 02/12/1996 [en réalité, c’était en 2006, nda], sur la base des vérifications effectuées par le présent institut, et tenant compte des indications figurant dans le curriculum professionnel émis par l’employeur […], il est déclaré qu’au sein de l’entreprise Crosa, établissement de Busalla, l’employé Prunetti Renato n’a pas été exposé à l’amiante au-delà des limites prévues par la loi.
Il s’agit d’un chef-d’œuvre d’humour noir : à une lettre de ma mère, où elle se présentait comme veuve de Renato, ils lui répondaient à lui, en se trompant de date, à savoir en la reculant de dix ans, sans même avoir compris que mon père était mort, exposé bien au-delà des « limites prévues par la loi ». Quant au fait que, dans l’établissement de Busalla, il y avait de l’amiante, ils ont été contraints de l’admettre par la suite.
La première tentative de l’INPS et de l’Inail, nier simplement que Renato avait travaillé au contact d’amiante, ayant échoué, la deuxième a consisté à affirmer que oui, Renato avait bien été exposé à l’amiante, mais pendant moins des dix ans « prévus par la loi », et par intervalles échappant à l’estimation. En réalité, il était resté en contact avec l’amiante pendant une période de très loin supérieure à dix ans, mais comme il n’avait pas toujours travaillé dans le même chantier et qu’il était impossible de retrouver les dirigeants de l’ancienne société Gargano, il était impossible d’estimer de manière précise les lieux et les périodes de travail : au milieu de 2011, le procès semblait en bien mauvaise voie. Ce qui ne réussit pas à ma mère : les procédures judiciaires gardent ouvertes les blessures, elles s’allongent à l’infini, l’élaboration du deuil est repoussée dans le temps et la tentation de jeter l’éponge est grande.
À un moment, la thèse selon laquelle Renato n’aurait pas été exposé à l’amiante dans les années 1970 et 1980 a semblé être accréditée, parce que son entreprise avait son siège sur le cours Trieste, à Novare, en un lieu où il n’y avait pas de pollution à l’amiante. Renato a toujours travaillé comme ouvrier détaché, à part quelques rares passages à Novare. Pour démontrer cette vérité, j’ai remis à l’avocat une liasse de bulletins de salaire et la photocopie de deux pages du vieux carnet de téléphone de la famille des années en question. C’étaient les pages qui correspondaient à la lettre R et, de fait, à quelques exceptions près, toutes les lignes renvoyaient au nom de Renato et à ses mille déplacements. Ce sont des pages de l’agenda de la femme d’un ouvrier détaché. Il y a une myriade de numéros d’hôtel, quelquefois indiqués par leur nom, quelquefois il n’y a qu’un numéro associé au nom de Renato. D’autres fois apparaît le restaurant ou le bistrot où il dînait avec ses collègues du chantier. En général, il téléphonait à la maison ou se faisait appeler à l’heure du dîner, ou juste après. Et, en réalité, là aussi les données présentées étaient lacunaires, parce qu’il y manquait les nombreux hôtels du Sud, à Tarente, quand il travaillait, par exemple, dans l’aciérie la plus grande et la plus polluée d’Europe, puis dans les raffineries et le pôle chimique de Syracuse. Il suffit de considérer les indicatifs, on verra qu’il y a tout le Nord-Ouest. Ce sont des bistrots et des hôtels qui lui servaient de base, à une portée de fusil des établissements où on l’expédiait pour souder des tuyaux. Voilà une liste, certes non exhaustive :
0321 Novara Il Gabbiano (province de Novare)
050 Hôtel Roma Tirrenia (province de Pise)
Renato 0321 (province de Novare)
Restaurant San Martino di Trecate (Novare)
0321 (province de Novare)
Renato Marina C. 0585 (province de Carrare)
Il Tabarro 0382 (province de Pavie)
Renato Empoli da Gina 0571(Empoli)
Renato Cartiera ma 051 (province de Bologne)
Hôtel Villa Rosa 070 (province de Cagliari)
Renato Arcola 0187 (province de La Spezia, Arcola)
Renato Colleferro 06 (province de Rome, Colleferro)
Salvatore (AL) 0131 (San Salvatore Monferrato, Alessandria)
Mantoue 0376 (province de Mantoue)
Novara Galliate hôtel S. Carlo 0321 (province de Novare)
Villa Gina Gonzaga 0376 (Gonzaga, province de Mantoue)
Hôtel Italia San Nazzaro 0382 (San Nazzaro dei Burgundi, province de Pavie)
Hôtel Il pappagallo 0376 (province de Mantoue)
Trattoria stella Cremona 0372 (province de Crémone)
La Brianza 0523 (province de Plaisance)
Hôtel Mistral, Sardaigne 0781 (province de Cagliari)
Pian de Grilli 010 (province de Gênes)
Locanda i due mori Carbonaro Po 0386 (province de Mantoue)
Restaurant Ines Colleferro 06 (Colleferro, province de Rome)
L’autre élément que nous réussissons à trouver dans un tiroir est une liasse de fiches de paie de Gargano au nom de Renato. Elles prouvaient qu’il travaillait presque toujours en détachement, à savoir dans des chantiers qui imposaient vraisemblablement (ne fût-ce qu’en raison des tâches accomplies par un soudeur-tuyauteur) un contact évident avec l’amiante.
Les fiches de paie retrouvées démontrent une moyenne, documentée pour la période 1980-1983, de plus de deux cent vingt jours par an en déplacement (grosso modo). À ces données, il faut ajouter un document issu des papiers de Renato, à savoir une récapitulation de sa fiche de paie pour l’année 1976. Sur un salaire brut de 4 907 535 lires, la rétribution nette de Renato s’élève à 3 212 193 lires. De nombreuses rubriques rendent difficile la lecture de cette fiche de paie, mais il est évident que, cette année-là aussi, le détachement a son importance, correspondant à 1 010 700 lires. Pas moins d’un tiers du salaire réel, peut-être plus encore, considérant qu’au salaire net concourent d’autres rubriques comme « heures supplémentaires », « primes », « chèques famille », etc. Au fait, il y a aussi la mention « pénibilité chantier ». Elle s’élève en 1976 à 11 000 lires. Parmi les collègues de Renato, on racontait que cette expression recouvrait une manière informelle de dédommager les ouvriers de la présence de matériaux dangereux et nocifs dans les chantiers. Quand l’amiante a commencé à être identifié comme un danger concret pour la santé humaine, les entreprises industrielles ont remplacé cette rubrique par une expression plus aseptisée, débarrassée du fardeau de la responsabilité de la société, à savoir « prime ». Belle prime, vraiment.
Cour d’appel de Florence, tribunal civil, section sociale. 29 septembre 2011. Une journée très chaude d’un mois de septembre anormal. Trente degrés humides et beaucoup de moustiques, plus la circulation sur les avenues de Florence, la voiture mal garée risquant de se faire enlever et une course anxieuse depuis la gare jusqu’à la via Cavour, en frôlant les librairies historiques dans un état comateux. Je cherche le numéro 57, dépasse la place Saint-Marc, jette un regard fugace aux balustrades de l’Académie, installées pour priver les étudiants et les marginaux d’un abri, et j’arrive enfin à l’immeuble de la cour d’appel. Je m’attends à une fouille minutieuse, mais ils se contentent de me donner un badge en échange d’une pièce d’identité. J’entre, je suis une indication, je monte au deuxième étage. Je repère un groupe de personnes, me glisse dans une salle nue. Aucun faste judiciaire. Il n’y a que le truc habituel de la loi égale pour tous et un groupe d’avocats en train d’attendre, qui feuillettent une liste punaisée à un tableau. C’est la liste des audiences. Il y en a trente-cinq, celle qui porte mon nom est la vingt-cinquième. Je me dis : « Ici, on prend son temps. » Avec cinq minutes d’avance, la cour prend place. Trois juges, plus la greffière. Les avocats commencent à s’exciter.
On commence, mais ce que je prenais pour un marathon s’avère être un cent mètres. La cour ajourne, renvoie, la pièce n’a pas été transmise, renvoi au, silence, s’il vous plaît ! On discute, en leur absence, d’ouvriers du port et de dockers livournais dont on n’a pas reconnu l’indemnité maladie, d’un ramasseur d’olives de Grosseto qui poursuit son entreprise, d’un ouvrier d’une fromagerie de Sorano et de quelques maçons en conflit avec l’ingénieur de la commune. S’ils pouvaient être ici avec moi, au moins, j’aurais été en bonne compagnie. Mais des plaignants, il n’y en a aucun. Je suis entouré d’avocats propres, lavés, parfumés, en veste et cravate ou en tailleur. Mais il fait une chaleur horrible et, comme d’habitude, je suis le seul à transpirer, mais je suis le plus grand, aux épaules les plus larges. La chanson « Figli dell’officine » (« Fils de l’atelier ») me vient à l’esprit et il s’en faut de peu que je l’entonne. Numéro vingt-trois, numéro vingt-quatre. Quand mon nom arrive, deux avocats se présentent devant le juge. Le mien, qui est en réalité une adjointe de l’avocat du service social de Grosseto, et un autre, la partie adverse, qui a l’air d’un vieux routier. Le juge ne dit qu’un mot : « Sentence ? » Mon avocate hoche la tête, celui de la partie adverse aussi. Le juge continue la liste : le numéro vingt-six est… J’en reste bouche bée. Elle n’aura duré que six secondes, l’audience qui, à mes yeux, dans sa tristesse, pose sur le plateau de la balance le poids de la mort de mon père. Six secondes, le temps de dire « sentence », mot qui fait résonner en moi un harmonica, le temps de voir Lee Van Cleef dans un film de Sergio Leone que Renato et moi avons regardé quarante-cinq fois. Je suis encore plus étonné quand je regarde ma montre. Il est 10 h 25, près de trente affaires ont été examinées au rythme d’une à la minute. Elle fonce, la justice, avec sa balance à la main. Encore quelques minutes et je pourrai parler avec mon avocate. Je dois comprendre. Pourquoi a-t-elle accepté qu’on prononce la sentence ? À quelques jours de l’audience, le rapport de l’expert technique désigné n’avait pas encore été déposé. Moi, je craignais même un énième renvoi. Si l’expertise nous a été favorable, pourquoi le défenseur de la partie adverse n’a-t-il pas davantage fait obstruction ? Peut-être parce que l’exposition à l’amiante et les arguments n’étaient que trop évidents ? À moins que l’expert ait été en notre défaveur et que l’avocate n’ait pas voulu continuer à résister ? Avait-elle la fiche de paie que, quelques jours auparavant, j’avais remise à l’avocat de Grosseto, qui contredisait l’hypothèse selon laquelle Renato travaillait au siège central de l’entreprise ? Au fond, elle ne savait même pas que j’étais présent à l’audience. En tout cas, je l’attends, je me présente et lui demande ce qui se passe. Elle dit que très bientôt la sentence arrivera par la poste. Et que si la session a été si rapide, c’est parce que la discussion se fait auparavant en chambre du conseil.
— Oui, je lui demande, mais le rapport du médecin, de l’expert technique de la partie civile ?
— Il a été positif, c’est ce qu’on m’a dit au cabinet.
— Et donc, vous avez accepté qu’on entre dans le prononcé de la sentence ?
Si c’est ça, bien. Si c’est ça, ce serait une victoire, certes amère, une victoire à la Pyrrhus, peut-être même pas, mais au moins la réaffirmation d’un principe et la reconnaissance de ce qu’un médecin disait et qu’un autre « par objectivité scientifique » ne se sentait pas de mettre sur le papier, mais qu’il affirmait à voix basse : que Renato, c’est l’amiante qui l’a tué, jour après jour, dans les différents chantiers d’Italie où il a travaillé. Je m’en retourne place Saint-Marc, je sors avec le soupir de soulagement que je pousse toujours en m’éloignant des palais du pouvoir. Il me revient à l’esprit une chanson de Ciampi sur le palais de justice, il se demandait comment expliquer une vie en deux phrases, mais c’était une autre histoire, ici c’est d’un seul mot qu’ils ont expliqué une vie. Sentence ? Un instant, Lee Van Cleef me revient, le justicier que papa aurait voulu avec lui, un seul mot pouvait suffire, le reste était silence, harmonicas, piétinements de chevaux et puis le plomb du colt 45. Genre « Tex Willer contre ces tisons de l’enfer de la Bande de l’Amiante ». J’en ai plein le cul et en même temps je me sens électrisé, je n’ai même pas envie d’un sandwich à la caillette, pas même du pot-au-feu de Nerbone au Vieux Marché, peut-être d’une petite mousse blonde ou d’un coup de pinard, un de ceux qu’il se buvait lui, avec un arrière-goût de métabisulfite, à sa mémoire. Nous attendons cette sacrée sentence, elle doit arriver par la poste dans quelques jours.
Mais elle n’arrive pas. L’avocat ne nous communique aucune nouvelle, et le facteur non plus. Ma mère est de plus en plus inquiète : le seul moyen de la tranquilliser est de retourner via Cavour à Florence pour chercher des informations au greffe. J’y retourne par une autre journée de soleil : je laisse ma carte d’identité, demande des indications, prends la volée de marches. Je me trompe deux fois de porte, puis je trouve la section sociale. Il y a un peu de queue. Une jeune avocate, de celles qui font leur apprentissage dans les cabinets professionnels en passant d’un bureau à l’autre, se met à bavarder avec moi pour tuer le temps. C’est elle qui m’aide à trouver les éléments du dossier sur le terminal au fond du couloir : c’est la première confirmation, télématique, que la sentence a bien été prononcée. Je remplis un formulaire papier et, enfin, j’entre. Cinq minutes plus tard, la greffière sort et me remet la photocopie de l’original du jugement. Sans me lever de ma chaise, je sélectionne les passages fondamentaux.
Sur le rapport de l’expert désigné, je lis que Renato Prunetti « s’avère avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans une mesure égale ou supérieure aux niveaux du déc. lég. 277/91 (art. 24 et 31) ». Les entreprises et chantiers cités sont l’entreprise Comont, Manutenzioni e Carpenteria Mettallica à Solmine di Scarlino (entre 1971 et 1972), l’entreprise Gargano, Manutenzioni e Carpenteria, sur différents sites, surtout des raffineries (entre 1972 et 1985), l’entreprise Termat, Manutenzioni e Carpenteria, aux aciéries de Piombino (entre 1989 et 1990) et l’entreprise Crosa, Manutenzioni e Carpenteria, dans la raffinerie de Busalla.
Il est déclaré en outre que Renato Prunetti,
« sur la base de l’analyse de l’activité de travail effectuée », a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante « durant les périodes : a) 8/09/1971-10/5/1972 ; b) 5/9/1972-4/2/1985 ; c) 1/10/1989-2G5/1/1990 ; d) 2/7/1990-31/12/1992 pour une période totale de 15 ans, 9 mois et 21 jours ».
« La cour reçoit l’appel introduit » par les héritiers, « certifie que le plaignant en appel a été exposé à l’amiante dans les termes de la loi, pour la durée de 15 ans, 9 mois et 21 jours » et « condamne l’INPS à opérer la réévaluation conséquente des dédommagements », en plus du paiement des frais de justice. Tout cela à Florence, en date du 29 septembre 2011.
Le jugement a été déposé au greffe le 21 octobre 2011.
Justice est faite ? Non, elle n’est jamais faite. La justice, c’est de ne pas mourir au travail, et de ne pas voir mourir ses collègues. Sans devoir mourir « aux termes de la loi ». C’est de travailler sans être exploité. Et ne pas voir reconnu un droit de vivant seulement après la mort. La sentence affirme seulement que Renato a été exposé à l’amiante, non pas que l’amiante l’a tué, même si la conclusion n’est pas difficile à tirer. Mais certains médecins invoqueront encore leurs épistémologies pour ne pas admettre le lien entre nocivité et exposition, qui impliquerait une retombée sociale de leur savoir. Et le système d’assurance sociale, en prenant en charge une légère réévaluation des pensions des veuves, décharge sur la collectivité (sur les travailleurs qui financent les caisses de l’INPS) ces responsabilités, qui devraient au contraire être attribuées à l’employeur, aux entreprises qui ont fait des bénéfices sur le dos d’ouvriers malades ou exposés. Ce sont elles qui devraient payer et elles qui devraient désamianter. Mais il est plus facile de faire payer la collectivité que la confraternité des patrons.
Même la sentence laisse un goût amer. Renato aurait eu le droit de partir à la retraite avec quelques années d’avance, parce que le coefficient 1,5 implique, d’après mes calculs, une retraite anticipée sept ans avant l’échéance normale. Imaginez l’escroquerie : on vous l’annonce non seulement quand vous êtes déjà à la retraite, mais carrément quand vous êtes mort. Sept ans de préretraite signifient sept ans hors du joug du travail, sept ans de vie, ce sont sept ans sans être exposé aux nuisances, à davantage d’amiante, davantage de plomb, et d’autres métaux lourds. Sept ans peuvent vous sauver la vie, interrompant la dérive cellulaire d’un organisme poussé au-delà des limites biologiques au nom de la productivité, au nom des boulots de merde que les patrons nous font faire en nous demandant ensuite des sacrifices, de la flexibilité, de la docilité et de la gratitude. Sept ans et il aurait pu voir Livourne en série A. Allez vous faire foutre, je vous le dis de tout mon cœur, pour sept ans, mille fois sept ans, je vous maudis, du petit patron jusqu’aux sommets de la classe industrielle italienne. Tous ces gens-là, si, par erreur, vous leur serrez la main, vos doigts, y faudra les recompter pour être sûr qu’ils vous les ont pas fauchés, c’te bande de voleurs.
En sept ans de retraite anticipée, il aurait pu faire des choses qu’il n’avait jamais faites, qu’il m’avait dit vouloir faire. Quand je suis revenu de ma période de boulots de merde en Angleterre, après m’être décarcassé dans des chiottes, des entrepôts, des cantines et des pizzerias d’outre-Manche, je lui ai promis que, quand il se serait remis de ses malheurs, nous irions à Londres voir jouer Arsenal contre Chelsea. Il aimait le foot anglais, il voulait se retrouver là pour comprendre comment diable ils faisaient pour ne pas envahir le terrain depuis ces tribunes sans grillages, et puis il voulait aller au pub boire quelques bières. Il me posait toujours des questions sur les travailleurs anglais qui travaillaient avec moi, ceux de l’entretien. Je lui avais expliqué comment ils travaillaient, que les pauses étaient sacrées, qu’ils avaient toujours sur eux l’équipement de sécurité, mais qu’ils le gardaient sale, comme si la crasse était un emblème, qu’il y avait des gens qui savaient tout faire, comme mon collègue Bryan de la maintenance, qui avait presque son âge, qui une fois fit même démarrer une voiture en reliant deux fils sous le capot en nous expliquant que, bien des années auparavant, il était Teddy Boy et qu’il avait eu quelques petits problèmes avec la justice, ou comme ceux que Renato avait rebaptisés « les marteleurs », des gens qui, pour mettre un collier autour d’un tube, le faisaient entrer à force de fucking et de coups de marteau plutôt que de le serrer avec un tournevis. Il s’était sacrément enthousiasmé pour cette histoire que j’avais un peu inventée, juste pour lui donner une idée : « Putain, ces types, y z’y vont au marteau, c’est rien que des marteleurs. T’vois, ceux-là, y z’y vont pas par quatre chemins, rien à battre, deux coups de marteau et allez, y te baisent, ils ont plus vite fait de t’en coller une que de cracher par terre », me disait-il comme s’il les avait connus, lui. Et il les voyait vraiment, de ses propres yeux, brutaux barbares blonds gonflés de bière, avec leur clé anglaise et leur casque jaune. Des gens qui avaient des épaules comme des armoires deux-portes. « Putain, si j’avais ces épaules, je la ramènerais encore », disait-il. Il me demandait toujours s’ils buvaient, s’ils juraient, de quelle équipe ils étaient supporters, bref s’ils étaient comme nous, et moi, je répondais « oui… oui… ».
Mon père était soudeur-tuyauteur. Quelqu’un qui avait commencé à travailler à 14 ans et qui à 40, déjà, avait subi l’invasion des aliens et ne nous entendait plus à cause du barouf du chantier. Pour lui, un travail, ça devait être un truc pour lequel on se cassait le cul. Ceux qui restaient devant un bureau et ne transpiraient pas, ceux-là ne travaillaient pas. Quoiqu’ils fussent, comptables, avocats ou professeurs, ils faisaient partie d’une catégorie unique : les prêtres. Des gens qui n’avaient pas envie de travailler. Un jour, je lui lus ces mots de Bianciardi dans Il lavoro culturale (Le Travail culturel), attribués à un certain Corinto, maçon invalide et puis concierge d’école stalinien, mais fils d’anarchistes. Ce fut une révélation : Mao lui apparut et il resta bouche bée :
Il y en a un qui arrive et qui dit qu’il veut faire comptable.
— Toi, je dis alors, tu veux faire comptable, pas vrai ?
— Oui, il dit, comptable.
— Alors, je dis. Écoute. La comptabilité est au deuxième étage. Tu le vois, ce sac, là, dans la cour ?
— Oui, dit le comptable.
— Il est plein de poudre de marbre, je dis. La comptabilité est au deuxième étage. Maintenant, toi, cher comptable, au deuxième étage, là où il y a la comptabilité, tu portes le sac plein de poudre de marbre. C’est clair ?
Tu sais, la poudre de marbre est compacte et lourde, un sac plein, ça doit faire un quintal, peut-être un quintal et demi. Celui qui y arrive devient comptable, sinon rien. C’est quoi ces branleurs de comptables bourgeois, avec de ces petits torses qu’on dirait ceux des pigeons ?
Les prêtres aussi, mon père voulait les envoyer à la coopérative, suivant les instructions de Corinto-Lucianone :
Les prêtres aussi, à la coopérative. […] Le matin, à 6 h, réunion de tous les prêtres. J’entre : « Bon, alors, il y a combien de prêtres ? Deux cents ? Ah oui ? Bien, pour la messe, trois ça suffira, les autres, à la coopérative, au battage du blé. » Encadrés, en soutane noire, l’évêque en tête, avec la mitre sur la tête et le bâton à la main. À la coopérative à battre le blé. Allez, les prêtres, enlevez la balle de sous la batteuse, allez, tirez sur le râteau. Huit heures réglementaires. Puis une bonne bastonnade pour tout le monde et après, on voit : qui a bien travaillé mange, les autres, juste la bastonnade et rien d’autre. Pas toute la vie, hein ? Trois mois, trois ça suffit. Qui y arrive bien : bastonnade, pain et soupe ; les autres, juste la bastonnade.
Et puis, Corinto concluait : « Y’a trop de branleurs qui traînent, trop de prêtres, trop d’intellectuels. »
Renato pensait pareil et il le disait. « Du bouillon », ajoutait-il, lapidaire, en parlant des exploiteurs de la classe moyenne supérieure, des gens sans consistance. Mais cela, c’était une manière de raconter une vérité qui n’est pas celle du chrétien Paul et de ces naïfs Thessaloniciens (lesquels, aujourd’hui, en fait, se retrouvent dans la mouise jusqu’au coup), pour qui « Qui ne travaille pas ne mange pas ». Ça, c’est l’histoire bourgeoise, un mensonge qui cache la vérité, parce que qui travaille meurt de travailler. Comme Renato. C’est pour ça que, paradoxalement, après s’en être pris aux « leggére », ce qui, en argot de Grosseto, signifie « vagabonds », il aurait presque préféré que je ne travaille pas. Il ne voulait pas m’emmener au chantier pour nettoyer les citernes d’hydrocarbures des raffineries, pas même l’été, quand j’avais déjà 18 ans. « L’usine, c’est le dernier pain. Étudie », me disait-il. « Au moins, tu tomberas pas malade. »
Mon père était un ouvrier qui, sur la vague du boom économique néocapitaliste, avait pu envoyer ses enfants à l’université. Il m’avait appris quelques trucs à faire avec les mains, genre couper deux tuyaux, conduire un tracteur, mettre un carreau sur un mur, démonter, graisser et remonter une tronçonneuse, fixer une tôle à un squelette métallique avec des rivets ou plier un fer à béton dans un étau. Mais il s’est arrêté là. « Non, pas la soudeuse », m’a-t-il dit. « Avec ça tu te rends malade. Ne travaille pas. Étudie », me disait-il.
J’ai étudié. Puis, après une série de boulots de merde, j’ai commencé à travailler dans l’édition. Je suis rédacteur externe et traducteur. Sur un mode précaire. Quelquefois, je ne fais rien. D’autres fois, je tape dix mille signes minimum par jour. Si les délais sont serrés, plus encore. Mon record personnel est de quarante-trois mille signes par jour. C’est énorme. Je l’ai fait une seule fois pour finir un travail à remettre, en m’aidant d’un dictaphone. Un truc à devenir dingue. Mieux vaut le chantier, je me suis dit.
Je fais un travail culturel et j’ai 39 ans. À mon âge, mon père ouvrier métallo syndiqué à la Fiom s’était déjà acheté sa maison. Moi, « travailleur cognitif précaire », je peine à payer un loyer. Tu parles de flexibilité : à force d’être assis à traduire des essais de l’anglais et de l’espagnol pendant huit à dix heures, dans une posture contre nature, je me suis retrouvé avec une protrusion discale avec rétrécissement des disques intervertébraux de la zone lombaire. Mes genoux grincent à cause de l’immobilité excessive. Et j’ai une tendinite quasi chronique qui, depuis les mains, me remonte jusqu’au coude, me faisant hurler de douleur même quand j’écris ces lignes. Voilà les derniers mots que je voudrais lui dire : papa, le sac de poudre de marbre, je l’ai monté, moi, au deuxième étage. Mais la comptabilité a déjà été pillée par les patrons et pour nous, fils des ouvriers qui ont tenté de monter les marches, il n’est rien resté. Ils nous ont juste baisés, saleté de Maremme.









