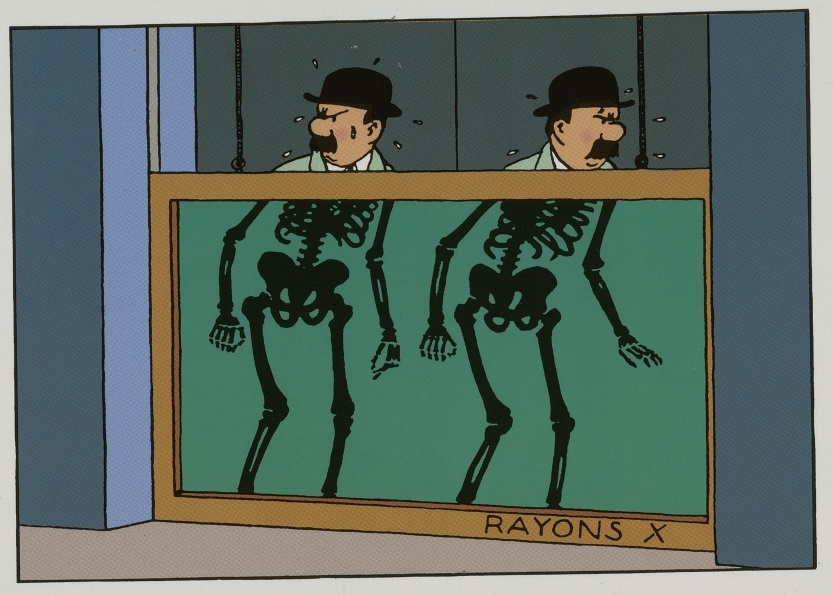
Les dangers de l’anti-trumpisme
Le mandat de premier ministre italien de Silvio Berlusconi montre quelles sont les voies à éviter pour résister à un démagogue autoritaire.
Les comparaisons entre Donald Trump et l’ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi ont été pléthoriques tout au long de la campagne électorale et elles ont même proliféré depuis que Trump a été déclaré vainqueur. Elles ne sont pas complètement sans fondement. Trump et Berlusconi sont tous deux des hommes qui avant d’arriver au pouvoir appartenaient au monde des affaires plutôt qu’au champ politique ; tous les deux ont affiché leur inexpérience politique comme un signe de pureté. Ils ont l’un et l’autre insisté sur leurs succès d’entrepreneurs comme la preuve la plus évidente de leur compétence à diriger le pays.
Comme le Tyran de Platon, aussi bien l’un que l’autre exhibent un ethos fondé sur un rêve de jouissance continuelle et illimitée mais aussi sur un éros agressif et démesuré (même si Berlusconi préfère se voir comme un séducteur irrésistible plutôt que comme un violeur). Les deux se livrent à des blagues grossièrement misogynes et racistes et ont remodelé le langage public en légitimant l’insulte et le politiquement incorrect comme des formes acceptables de communication politique, tout en incarnant un retour grisant du refoulé. Ils se délectent tous deux de l’esthétique kitsch et arborent la teinte orange du bronzage artificiel. Et les deux se sont alliés avec l’extrême droite pour mener à bien un projet politique de néolibéralisme autoritaire et de capitalisme débridé.
Les analogies s’arrêtent là. La montée, très résistible, de Trump au pouvoir est, dans une certaine mesure, plus étonnante que la première victoire électorale de Berlusconi qui était davantage prévisible. Alors que Trump a pris en otage le Parti républicain, se heurtant à l’opposition d’une grande partie de l’establishment de son parti et des médias, Berlusconi a utilisé son empire médiatique pour à la fois contrôler l’information et créer un nouveau parti politique, en reconfigurant par la même occasion tout le spectre politique en Italie. À cause des particularités du système parlementaire italien, Berlusconi a été forcé à s’allier avec d’autres partis de droite, opposés les uns aux autres, Alleanza nazionale et la Ligue du Nord : le premier provenant d’une évolution du parti néo-fasciste italien, le Mouvement social (MSI), et le second un parti d’extrême droite xénophobe et fédéraliste. De surcroît, Berlusconi n’a pas agi en faveur de l’isolationnisme et du protectionnisme, n’a pas contesté les accords du marché international et n’a pas contesté la participation de l’Italie à la création de l’Union européenne et de la zone euro – au moins jusqu’en 2011. Enfin, l’Italie ne joue aucun rôle géopolitique hégémonique comparable à celui des États-Unis.
Ces différences sont suffisamment significatives pour mettre en garde contre des prédictions faciles basées sur les vicissitudes italiennes sur le cours de la présidence de Trump. Pourtant, cela ne veut pas dire que l’on ne pourrait pas tirer des enseignements utiles de l’expérience italienne. Au contraire, nous pouvons tirer des leçons importantes si nous nous éloignons un moment des similitudes apparentes entre Berlusconi et Trump, et si nous nous concentrons plutôt sur les analogies entre l’anti-Berlusconisme à l’italienne et la forme d’anti-trumpisme que risque de prendre le mouvement contestataire aux États-Unis.
Amnésie sélective
Dans un récent article du New York Times, Luigi Zingales offre une interprétation assez peu rigoureuse des erreurs commises par l’opposition face à Berlusconi, soutenant que la résistance nuisible à tous les actes de Berlusconi et les mobilisations populaires contre son gouvernement, ainsi qu’une focalisation excessive sur sa personnalité, ont en fait travaillé pour renforcer le pouvoir de Berlusconi au lieu de l’affaiblir. Dans l’interprétation de Zingales, les seules défaites que Berlusconi aurait subies auraient été dues aux campagnes électorales de Romano Prodi et de Matteo Renzi axées sur des propositions positives plutôt que sur le bashing du personnage Berlusconi. À partir de cette analyse, Zingales propose que les opposants à Trump arrêtent les manifestations de rue actuelles et montrent une volonté de coopérer avec son administration au Congrès sur les questions autour desquelles il y a accord entre le président et les démocrates contre l’establishment républicain, par exemple sur de nouveaux investissements pour les infrastructures.
Voilà une recette désastreuse. Permettez-moi de rétablir des faits historiques. Le premier gouvernement de Berlusconi, en 1994, n’a duré que sept mois peu glorieux. Il a été balayé par une combinaison de facteurs hétérogènes, mais nous pouvons en identifier deux de première importance. Le premier fut la turbulence de la Ligue du Nord, dont Berlusconi avait besoin pour obtenir sa victoire dans le Nord, mais à qui il n’avait rien à offrir en échange. En particulier, la tentative de Berlusconi de réformer le système des retraites et son incapacité à poursuivre une réforme fédéraliste se heurtèrent aux intérêts électoraux de la Ligue du Nord, qui craignait de perdre une bonne partie du soutien de la classe ouvrière. Lorsque la Ligue du Nord a décidé de retirer son soutien au gouvernement, Berlusconi a été forcé de démissionner. Le second facteur a été la mobilisation populaire, en particulier la grève générale contre la réforme des retraites lancée en octobre 1994 par les trois principaux syndicats qui, selon des sources syndicales, a vu trois millions de personnes dans les rues de quatre-vingt-dix villes, et une autre en novembre pendant laquelle un million de personnes a défilé à Rome, l’une des plus grandes manifestations syndicales jusqu’alors.
Mais c’est ce qui s’est passé après la chute du premier gouvernement de Berlusconi qui peut offrir les leçons plus significatives pour l’opposition anti-Trump d’aujourd’hui, car c’est à cause des politiques néolibérales et d’austérité menées par le centre-gauche dans les six années suivantes que le pouvoir de Berlusconi a été consolidé. Tout d’abord, le gouvernement technocratique dirigé par Lamberto Dini entre 1995 et 1996 a entrepris la réforme la plus dévastatrice du système des retraites jamais vue, introduisant pour la première fois le système contributif destiné à remplacer progressivement le système par rétribution. La réforme a été adoptée avec le soutien du centre-gauche et l’accord des syndicats, avec la justification de vouloir empêcher à tout prix le retour de Berlusconi au pouvoir. Lors des élections de 1996, la coalition de centre-gauche a réussi à obtenir une majorité parlementaire grâce au soutien externe de Rifondazione Comunista et au refus de la Ligue du Nord de former une coalition avec Berlusconi. La coalition de centre-gauche a d’abord donné lieu au premier gouvernement Prodi et par la suite au gouvernement de Massimo D’Alema. Pendant cinq ans, les gouvernements de centre-gauche ont adopté les premières réformes du droit du travail pour introduire une précarisation massive et réduire sensiblement les droits des travailleurs ; ils ont essayé de faire passer une réforme dévastatrice de l’enseignement public et ont introduit avec succès des politiques d’autonomie dans les écoles qui ont ouvert la voie à une gestion de style managérial des écoles publiques, ainsi que des réformes néolibérales pour l’enseignement supérieur ; ils ont procédé à la plus grande privatisation d’entreprises et de capitaux actifs publics jamais vue dans l’histoire européenne ; ils ont participé aux bombardements de l’OTAN contre la Serbie ; et ont adopté une loi sur l’immigration instituant les premiers centres de détention pour les sans-papiers. Pour finir, le gouvernement D’Alema a créé la tristement célèbre « Bicamerale », une commission parlementaire bipartisane qui, d’après D’Alema, aurait dû conduire à un accord avec Berlusconi sur un projet de réforme semi-présidentielle de la Constitution renforçant les prérogatives de l’exécutif au détriment de la représentation et de la démocratie parlementaire. À chacune de ces mesures, les gouvernements de centre-gauche ne rencontrent que l’opposition organisée dans les rues par la gauche radicale, parce que les syndicats et les électeurs de centre-gauche étaient prêts à tout avaler pour empêcher le retour de Berlusconi au pouvoir.
L’aboutissement de ces politiques a été le véritable commencement de l’ère Berlusconi, qui avec sa victoire aux élections de 2001, a engrangé une large majorité au Sénat et à la Chambre des Députés. Pendant qu’après 2001, les électeurs de centre-gauche ont souvent pris la rue pour des manifestations anti-Berlusconi en défense de la démocratie et contre la corruption, les députés de centre-gauche ont continué autant que possible à coopérer avec Berlusconi et à le protéger des poursuites judiciaires, comme ils l’avaient déjà fait auparavant pendant les gouvernements Prodi et D’Alema en refusant d’adopter une loi contre le monopole de Berlusconi sur l’information. La cerise sur le gâteau a été l’accord de 2014 entre Renzi et Berlusconi sur la réforme constitutionnelle et la nouvelle loi électorale, bénie par le président de la République de l’époque, l’ancien communiste Giorgio Napolitano. Il convient également de rappeler que Berlusconi a effectivement perdu les élections de 2006 et qu’il n’est revenu au pouvoir qu’après l’échec du second gouvernement Prodi à maintenir sa faible majorité parlementaire en raison de la défection d’un petit parti centriste (l’Union des démocrates pour l’Europe).
L’anti-Berlusconisme mainstream italien a toujours souffert d’une grave forme d’amnésie sélective. Les effets de six années de sévères politiques d’austérité et pratiquement aucune opposition sociale significative n’ont jamais été considérés comme un facteur décisif de la consolidation du pouvoir de Berlusconi. L’anti-Berlusconisme traditionnel n’a jamais montré aucune volonté d’admettre la continuité substantielle entre les politiques d’austérité du second gouvernement Berlusconi et celles du centre-gauche. L’attaque de Berlusconi contre les droits syndicaux n’a été, par exemple, qu’un effort visant à accroître la précarisation du travail introduite par le centre-gauche (objectif réalisé plus tard par le gouvernement de centre-gauche Renzi par l’intermédiaire du Jobs Act – la loi travail). Ses privatisations de services publics ont été amorcées par l’adoption par le centre-gauche de l’idée que le « privé », c’est mieux. La loi du centre-droit sur l’immigration, qui criminalise l’immigration clandestine, n’est rien d’autre qu’un amendement à la précédente loi de centre-gauche. La participation italienne aux guerres en Afghanistan et en Irak a été rendue politiquement possible par la première violation de l’article 11 de la Constitution italienne – qui empêche l’Italie de participer à des guerres d’agression – portée par D’Alema pour permettre aux forces italiennes de contribuer au bombardements en Serbie.
L’anti-Berlusconisme traditionnel a toujours préféré se concentrer sur les perceptions et les impressions plutôt que sur des faits réels. Dans l’imaginaire anti-Berlusconien, le régime de Berlusconi a duré vingt longues années plutôt que neuf, Berlusconi était un fasciste, la démocratie italienne était en danger, la gauche radicale a aidé à consolider le pouvoir de Berlusconi en raison de son sectarisme et de sa réticence à coopérer avec le centre-gauche, les électeurs de Berlusconi étaient tous des losers racistes et misogynes sans éducation, le pays était constitutivement de droite et c’était la raison pour laquelle même des politiques keynésiennes modérées étaient impossibles et pour laquelle la gauche devait s’allier avec toutes sortes de technocrates néolibéraux, sous prétexte d’empêcher le retour de Berlusconi à tout prix.
Cela vous semble familier ? Cela vous rappelle quelque chose ?
Éviter les mêmes erreurs
La conclusion de cette triste histoire est éclairante. Concernant le fascisme de Berlusconi, son irrésistible empire médiatique et son contrôle de l’information publique, sa « vidéocratie » et la fin de la démocratie républicaine, une semaine de doux terrorisme financier et l’alliance d’intérêts entre la Commission européenne, la Banque centrale et le secteur européiste de la capitale italienne – avec le soutien du président de la République et du centre-gauche – ont suffi à faire rapidement tomber Berlusconi de son poste et à le remplacer par le gouvernement technocratique de Mario Monti. C’était la fin du centre-droit qui, aux yeux des anti-Berlusconiens, était si invincible quelques mois plus tôt.
Et voici la leçon : l’anti-Berlusconisme italien a fini par consolider et renforcer le pouvoir de Berlusconi, plutôt que l’affaiblir, en esquivant constamment les véritables causes du succès de Berlusconi et en justifiant et légitimant des années d’austérité sévère sous couvert d’empêcher à tout prix le retour de Berlusconi au pouvoir. De plus, il a contribué à l’auto-désintégration de la gauche italienne et a permis une nouvelle dégénérescence néolibérale et technocratique du Parti démocrate. En 2014, Paolo Flores D’Arcais, directeur de Micromega et l’un des fondateurs du mouvement démocratique anti-Berlusconi, « I girotondi », emblématique de la plupart des limites de l’anti-berlusconisme traditionnel, prétendait que Renzi était pire que Berlusconi. Au final, il semble bien que la politique du moindre mal ait engendré le pire.
L’anti-Trumpisme court le même risque. Immédiatement après les élections présidentielles, la classe ouvrière blanche a été ciblée par les décideurs publics démocrates comme la cause de la victoire de Trump et rejetée comme intrinsèquement raciste et grossièrement ignorante. Les électeurs des partis mineurs ont été accusés d’avoir contribué à la défaite de Clinton. Les tentatives d’expliquer à la fois le soutien des électeurs de la classe ouvrière à Trump ou l’abstention comme des effets de la mondialisation néolibérale et de la désillusion envers la présidence Obama ont été moquées comme du réductionnisme économique. Et un certain nombre de réflexions ont glosé sur la fin de la démocratie et l’avènement du fascisme américain. Une analyse approfondie de la composition du vote Trump et de son importance pour les changements politiques moléculaires qui se produisent dans l’électorat américain devra encore attendre. Cependant, des informations nouvelles significatives semblent avoir déjà émergé. Trump a finalement gagné un million de votes de plus que Romney, et il est possible qu’il ait même fait mieux que Romney avec les électeurs latinos. La marge de la victoire de Clinton dans le vote populaire a augmenté jusqu’à un étonnant 1,7 millions, mais Clinton est toujours en baisse de 2,3 millions de votes par rapport à Obama en 2012, et il est probable que plusieurs anciens partisans d’Obama aient voté pour Trump. Enfin, le taux de participation a été plus élevé qu’en 2012.
Ce qui semble avoir fait la victoire de Trump est la combinaison de deux facteurs principaux. Il y a, bien sûr, un système électoral profondément anti-démocratique, que le Parti démocrate n’a jamais vraiment contesté. Un autre facteur a été la capacité de Trump à catalyser des motivations de vote profondément hétérogènes. Une partie importante de son électorat blanc a certainement été galvanisé par son racisme épouvantable, son homophobie et sa misogynie et a identifié Trump comme l’agent de la vengeance contre l’élection d’Obama et la nomination d’une femme dans le camp adverse. Mais une composante importante du vote pour Trump ne peut s’expliquer sans se référer à la désillusion pour la présidence Obama, aux effets sociaux dramatiques de la crise économique mondiale, des délocalisations et de l’austérité, et à la perception bien fondée des accointances des Clinton avec Wall Street et l’établissement. Ces motivations et attentes hétérogènes, conjuguées à la relation tendue entre Trump et un grand nombre de dirigeants républicains, représentent des éléments de fragilité dans la future présidence Trump.
Une opposition efficace à Trump devrait s’efforcer de démêler ces motivations hétérogènes et même incompatibles, d’une part en luttant contre la nouvelle vague de racisme, de misogynie et d’homophobie qui est devant nous, et d’autre part en répondant au désir légitime de changement radical exprimé en partie par certain•e•s• électeurs et électrices de Trump et par l’abstention de millions d’anciens électeurs démocrates. Cela implique de travailler pour créer de larges coalitions et mouvements sociaux pour s’opposer à ce qui va venir, mais aussi d’abandonner une fois pour toutes l’idée que le moindre mal, qui a déjà causé de graves dégâts, est une option viable.
Comme l’a montré la catastrophe de l’anti-berlusconisme italien, la seule façon de s’opposer efficacement au néolibéralisme autoritaire, raciste et sexiste est d’offrir une alternative radicale et crédible.
Traduit par Gianfranco Rebucini, cet article est paru initialement sur Jacobin.

![Rebelles réactionnaires et extrémisation des droites [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_Delivers_Remarks_at_CPAC_49608880598-150x150.jpg)







