
La classe ouvrière, les chartistes et le suffrage universel
Entre 1851 et 1862, Marx et Engels contribuent régulièrement au journal étatsunien The New-York Daily Tribune. Ils produisent au cours de ces années près de cinq cents articles, proposant des analyses concrètes et riches de l’actualité économique, politique et géopolitique du milieu du XIXe siècle, sur la « révolution et contre-révolution » en Allemagne, le mouvement chartiste anglais, la guerre de Crimée, les guerres de l’opium en Chine, la révolte des Cipayes en Inde, ou encore la guerre de Sécession aux États-Unis.
Ces écrits, composés dans une période de relative inactivité politique marquée par l’échec des révolutions européennes de 1848, et avant que ne s’organise la Première Internationale, prolongent les textes historiques de Marx sur les luttes de classes en France. Ils constituent en même temps un laboratoire pour certains éléments théoriques des Grundrisse et du Capital, jouant ainsi un rôle déterminant dans le développement de la conception matérialiste de l’histoire.
Le premier volume rassemblant les articles des années 1851-1852 dans une traduction nouvelle vient de paraître aux Éditions sociales ; une partie de ces articles étaient inédits en français. Ce volume contient en particulier la série d’articles publiés sous le titre Révolution et contre-révolution en Allemagne, ainsi qu’une chronique minutieuse de la vie économique et des luttes politiques en Angleterre, alors la pointe avancée du capitalisme mondial.
Contretemps publie ci-dessous un article décisif de Marx sur le chartisme, où il esquisse une stratégie de conquête du pouvoir pour la classe ouvrière accordant une importance centrale au suffrage universel. Cet article est précédé d’une partie de l’introduction du volume consacrée à l’analyse par Marx et Engels de la situation de l’Angleterre. L’introduction a été écrite par les traducteurs/rices : Alexia Blin, Yohann Douet, Juliette Farjat, Alexandre Feron et Marion Leclair.
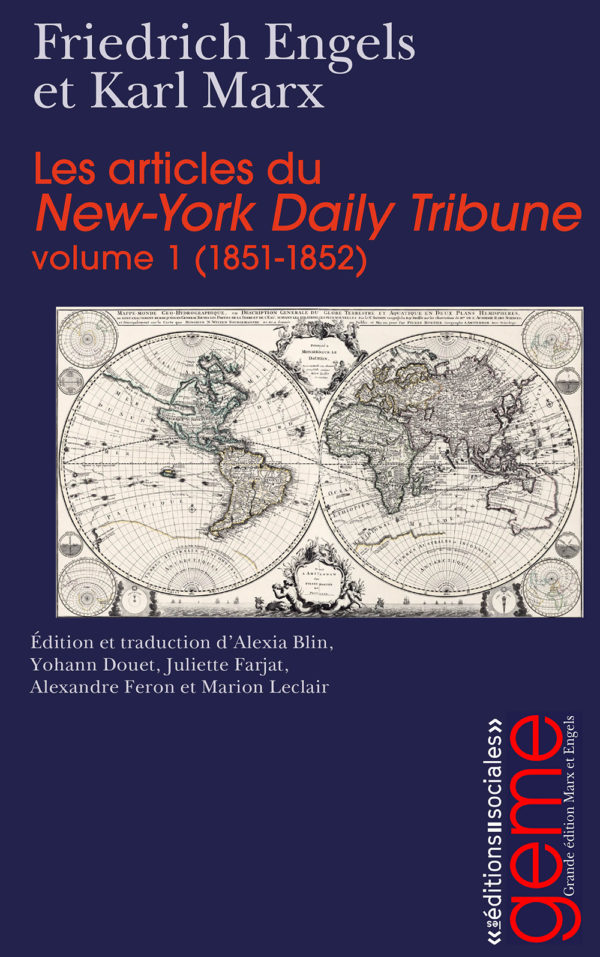
Introduction : Dépêches d’Angleterre
Vie politique de l’Angleterre en 1852
Les articles qui composent la seconde partie du volume sont pour l’essentiel consacrés à la situation politique en Angleterre[1]. Si les phénomènes étudiés par Marx sont moins hauts en couleur que les événements allemands de 1848-1849 et français de 1848-1851, ils s’inscrivent dans un tournant majeur dans la vie politique britannique, qui voit imploser la vieille opposition entre whigs et tories prévalant depuis la fin du XVIIe siècle, et se recomposer progressive- ment un nouveau système bipartite autour de l’adhésion ou non au libre-échange. Ces deux partis dominent le Parlement britannique depuis la Glorieuse Révolution de 1688-1689 jusqu’au milieu du XIXe siècle – ou plutôt depuis la crise dite de l’Exclusion (exclusion crisis) qui oppose dix ans plus tôt les whigs, soucieux d’interdire au catholique Jacques d’York de succéder à son frère Charles II sur le trône d’Angleterre, et les tories, qui le soutiennent (avec succès). La Glorieuse Révolution, qui substitue Guillaume d’Orange à Jacques II sur le trône d’Angleterre à l’invitation du Parlement, et institue une monarchie parlementaire dans le pays, contribue plus encore à forger l’identité des deux partis – même s’il s’agit alors de groupes assez lâches plutôt que de partis organisés au sens moderne du terme. Politiquement, les whigs se définissent par leur défense des acquis de la Glorieuse Révolution (monarchie parlementaire, Bill of Rights, principe de succession protestante), tandis que les tories restent en partie, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, attachés à la monarchie absolue et à la famille Stuart, que des rébellions dites « jacobites » s’efforcent de réinstaurer jusqu’en 1745. Sociologiquement, les membres des deux partis sont issus de l’aristocratie foncière, qui, du reste, domine le Parlement : à la veille de la « Grande Réforme » parlementaire de 1832, seuls 15 % des membres de la Chambre des communes ne sont pas issus de l’aristocratie. Mais ils ne représentent pas les mêmes intérêts : les tories sont le parti de l’aristocratie traditionnelle, tandis que les whigs défendent au Parlement l’aristocratie capitaliste acquise à l’agriculture de marché (y compris coloniale) et à la spéculation financière, ainsi que la grande bourgeoisie de planteurs, gros marchands, financiers de la Banque d’Angleterre ou de l’East India Company, qui entretient des liens étroits avec l’aristocratie. Les whigs sont majoritaires aux Communes pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle, mais les tories reviennent au pouvoir dans les années 1760, après l’avènement de George III, et l’occupent de façon continue de 1784 à la Grande Réforme.
Cette réforme est l’aboutissement d’un demi-siècle de campagne, soutenue, au sein du Parlement, par quelques modernisateurs des deux bords soucieux de mettre fin à la « vieille corruption », liée notamment à un découpage électoral très inégalitaire qui favorise la surreprésentation de certaines circonscriptions pourtant très peu peuplées – les « bourgs pourris » (rotten boroughs) – alors que les villes industrielles du nord ne sont pas représentées en dépit de leur forte croissance, à l’instar de Birmingham, de Manchester, de Sheffield ou de Leeds. Hors du Parlement, la réforme est défendue par un mouvement radical principalement urbain, rassemblant les laissés-pour-compte d’un suffrage censitaire qui, jusqu’en 1832, ne permet de voter qu’à un sixième de la population masculine et environ 3 % de la population totale : le radicalisme suscite l’adhésion de la bourgeoisie, de la petite-bourgeoisie et de l’artisanat urbains et, à mesure que progressent le XIXe siècle et la révolution industrielle, des travailleurs de l’industrie.
La campagne radicale pour la réforme s’appuie essentiellement sur des moyens constitutionnels, de tracts en journaux et de pétitions en rassemblements. Elle n’en fait pas moins l’objet d’une répression sévère au milieu des années 1790 par le gouvernement tory de William Pitt le Jeune qui craint la propagation outre-Manche de la Révolution française[2]. Quand elle resurgit à la fin des années 1810, le chômage de masse et la dépression économique qui suivent les guerres napoléoniennes, et les émeutes qui en résultent (du soulèvement des bonnetiers à Pentrich en 1817 aux Swing Riots des travailleurs agricoles en 1830), forcent un rapport plus favorable aux partisans de la réforme[3]. Si le rassemblement de « Peterloo » à Manchester en 1819 fait encore l’objet d’une répression brutale qui laisse une quinzaine de morts et près de sept cents blessés chez les réformateurs, les émeutes déclenchées dans plusieurs villes (notamment à Londres, Bristol et Nottingham) en 1831 à la suite du rejet par la Chambre des lords du projet de réforme voté aux Communes, contraignent finalement le Parlement à son adoption[4].
La réforme, votée en 1832, double le nombre d’électeurs, qui représentent désormais 7 % de la population adulte, soit environ 813 000 électeurs sur les 24 millions d’habitants que compte alors le Royaume-Uni. Elle opère aussi une redistribution des sièges alloués aux bourgs (boroughs) et aux comtés (counties) du pays, aux dépens des « bourgs pourris » et au profit de l’Écosse, de l’Irlande et des villes industrielles qui accèdent ainsi à la représentation parlementaire.
Cependant, cette extension du droit de vote ne profite qu’à la bourgeoisie. Les artisans et les ouvriers qui y ont œuvré en sont exclus par un cens encore élevé[5]. S’il n’est plus le monopole de l’aristocratie, le droit de vote reste donc un privilège de nantis, que les travailleurs continueront à revendiquer, cette fois sans l’appui de la bourgeoisie, à travers le mouvement chartiste. En outre, même pour ceux qui accèdent au suffrage, l’absence de vote à bulletin secret (il ne sera institué qu’en 1872) empêche souvent les nouveaux électeurs de voter contre leur employeur ou leur protecteur et favorise la reconduction des élites traditionnelles. De surcroît, ce sont toujours les deux mêmes partis qui dominent la vie politique : la bourgeoisie peut désormais voter, mais ce sont les whigs qui représentent ses intérêts au Parlement.
Les clivages et équilibres politiques sont modifiés en 1846, date de l’abrogation des lois sur les grains (Corn Laws)[6]. En effet, la suppression de ces tarifs protectionnistes, qui profitaient à l’agriculture britannique et à l’aristocratie foncière, n’a pas seulement constitué une victoire pour la bourgeoisie industrielle libre-échangiste, mais aussi l’entrée en scène d’une nouvelle force politique. Car l’abrogation est votée, sous la houlette du premier ministre tory Robert Peel (qui souligne l’urgence de l’importation de blé étranger dans le contexte de la Grande Famine irlandaise), par les whigs et une partie des conservateurs – les peelites[7]. Le vote rebat ainsi les cartes politiques en esquissant les contours d’un nouveau bipartisme, construit autour d’une opposition d’abord économique entre libre-échangisme et protectionnisme, et d’une nouvelle formation politique – l’alliance des whigs et des peelites, qui se concrétisera une dizaine d’années plus tard avec la création du parti libéral en 1859, qui intègre aussi des courants libéraux plus radicaux.
Marx saisit donc l’Angleterre pour le New-York Tribune au moment de cette recomposition du paysage politique, et l’analyse déployée dans les pages du journal met en lumière les enjeux des tâtonnements et des retournements qui accompagnent ce bouleversement entre 1846 et 1859 : la conquête par la bourgeoisie libre-échangiste d’une représentation politique qui lui soit propre ; les efforts déployés par l’aristocratie foncière pour se maintenir au pouvoir ; mais aussi les compromis et les alliances que peuvent trouver ces deux fractions des classes dominantes, dans un contexte marqué par le souvenir encore vif du chartisme et la menace d’une classe ouvrière organisée – voire insurgée[8].
La politique des classes dominantes : Marx analyste du système parlementaire
Dans ses articles sur l’Angleterre, Marx met en œuvre une analyse en termes de classes similaire à celles des textes sur la France ou sur l’Allemagne, et considère notamment que les différentes forces politiques en présence (les partis au sens large du terme) représentent différentes classes ou fractions de classe. Plus précisément, il étudie la manière dont les classes dominantes – dans leur diversité – exercent le pouvoir dans un régime parlementaire établi de longue date, ce qui singularise la situation anglaise.
Marx élucide les moyens concrets et quotidiens grâce auxquels ces classes peuvent maintenir, bien que chaotiquement, leur emprise sur l’État. Il évoque notamment le recours massif à la corruption, ou à des manipulations plus étonnantes comme la distribution d’alcool lors des journées électorales[9]. De même, il décrit les ancrages territoriaux des différents partis, fournissant une analyse géographique, ce qui est rare dans la presse de l’époque[10]. Surtout, on comprend le rôle décisif joué par le système censitaire, même après la réforme électorale de 1832. Il rend ainsi compte des expédients par lesquels les tories, pourtant largement minoritaires dans la population, sont parvenus à rester au pouvoir en gagnant les élections de juillet 1852. Ce faisant, il donne un éclairage plus général sur le système parlementaire, et sur le pouvoir aristocratico-bourgeois dans son ensemble.
Ce qui se dessine dans ces textes, c’est la manière dont, malgré les conflits entre partis, se réalise un certain compromis de classes. Marx situe bien sûr le clivage principal de la vie parlementaire entre les tories (représentants conservateurs et protectionnistes de l’aristocratie foncière) et les libéraux, même s’il souligne les divisions de ces derniers entre les peelites (conservateurs libéraux), les whigs (« représentants aristocratiques de la bourgeoisie[11] ») et les libre-échangistes proprement dits (directement liés à la bourgeoisie industrielle et organisés dans l’École de Manchester[12]). Pour autant, malgré leur retour au pouvoir en février 1852 et leur victoire (relative) aux élections de juillet, les tories ne remettent pas en cause l’abrogation des Corn Laws. Ils s’efforcent plutôt de compenser les pertes qu’elle a impliquées pour les fermiers – par le biais d’une réforme des taxes en leur faveur, pesant sur le reste de la population – de façon que les rentes qu’ils paient aux propriétaires fonciers ne baissent pas[13]. C’est une telle mesure de compromis entre classes dominantes, qui accepte le libre-échange mais cherche à en limiter certains effets, qui se laisse discerner dans le projet de budget de Disraeli[14]. Du reste, Marx estime que la prospérité économique, qui est précisément nourrie par le libre-échange, sert la « réaction tory[15] », notamment parce que dans cette situation, la bourgeoisie est peu disposée à l’agitation politique. Plus généralement, cette dernière, et ses représentants politiques, sont portés à faire des concessions avec les anciennes classes dominantes, afin d’éviter d’être « contraints de faire appel à la classe ouvrière[16] ».
Malgré ce compromis objectif entre classes dominantes, les partis politiques se déchirent et la vie parlementaire est très instable. D’une part, les tories, bloc compact mais minoritaire à la Chambre des communes, cherchent à réprimer les voix dissidentes et conçoivent de nouveaux moyens pour conserver le pouvoir (campagne d’inscription des électeurs ; formation de la milice[17]). D’autre part, les différents partis d’opposition (les trois courants libéraux et les députés irlandais), bien que majoritaires, sont divisés et rechignent à renverser le gouvernement Derby. Ils le feront toutefois à la fin de l’année 1852, à l’occasion de l’examen du budget Disraeli ; le dernier article du volume, intitulé « La défaite du gouvernement », est consacré à cet événement. Le texte se conclut sur un dilemme évoqué plusieurs fois par Marx : « ou bien le maintien des tories au gouvernement, ou bien la réforme parlementaire ». Il estime en effet que les partis d’opposition sont trop divisés pour former un gouvernement stable, et que si le gouvernement tory venait à tomber, une dissolution de la Chambre serait inéluctable ; or de nouvelles élections aboutiraient à la même répartition des forces, et la vie politique britannique resterait prise dans le même « cercle vicieux[18]». Cette prévision de Marx s’est révélée fausse : les gouvernements reposant sur l’alliance des whigs, des peelites et des libéraux radicaux ont en effet duré jusqu’en 1858.
Mais l’important est moins cette erreur historique que la solution politique que Marx propose pour sortir de ce cercle vicieux évoqué : une réforme parlementaire qui, en accroissant le corps électoral, retirerait aux tories le poids disproportionné qu’ils avaient encore en raison du système censitaire ; car cette solution recoupe les revendications chartistes.
Le chartisme, parti de la classe ouvrière
Le chartisme, qui s’est développé entre 1838 et 1848 en Angleterre, n’était pas uniquement le prolongement du mouvement radical pour la réforme parlementaire, revendiquant pour la classe ouvrière dépourvue du droit de vote le suffrage conquis par la bourgeoisie en 1832[19]. Les revendications du mouvement chartiste sont assurément politiques, et l’héritage du réformisme radical est manifeste dans les six points de la Charte du peuple qui les synthétise : le suffrage universel masculin, le vote à bulletin secret, un découpage plus égalitaire des circonscriptions électorales, la possibilité de devenir député sans disposer d’une fortune personnelle préalable et en étant rémunéré, et l’élection annuelle du Parlement. Cet héritage radical est aussi sensible dans les formes que revêt la contestation chartiste, des rassemblements en plein air aux pétitions régulièrement présentées au Parlement, et aux journaux que produit le mouvement, notamment le Northern Star édité par Feargus O’Connor.
Ceci étant dit, les chartistes systématisent un usage de la pétition que seuls prônaient avant eux les ultra-radicaux[20] : la pétition devient simple prétexte à des rassemblements réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes, l’occasion de faire la preuve de l’ampleur du mouvement et d’instaurer un rapport de force favorable. D’ailleurs, certains rassemblements s’accompagnent d’exercices armés, notamment dans les comtés industriels du Nord, tandis que dans les vallées minières du pays de Galles le rejet de la première grande pétition chartiste par le Parlement en 1839 entraîne une insurrection : en novembre, une colonne de 7 000 chartistes menée par l’ancien maire de Newport, John Frost, marche sur la ville portuaire, plaque tournante de l’industrie minière galloise, dans l’espoir de paralyser toute l’activité industrielle de la région – sans succès : les insurgés sont dispersés par la police et l’armée, et leurs leaders, dont Frost, arrêtés. L’agitation chartiste donne également lieu à des formes d’action industrielle, notamment lors des plug riots de l’été 1842 : ouvriers de l’industrie céramique du Staffordshire et ouvriers de l’industrie textile du Lincolnshire et du Yorkshire débrayent en une amorce de grève générale, arrachant les bouchons (plugs) des chaudières et détruisant les barrages de retenue pour empêcher les usines de fonctionner. Le chartisme constitue ainsi une sorte de mouvement transitionnel entre l’agitation politique radicale et l’action ouvrière organisée.
Mais l’usage de la force divise les dirigeants du mouvement chartiste, où s’opposent tenants de la « force morale » et partisans de la « force physique ». Et ces divisions, combinées à la répression à laquelle doit faire face le chartisme, finissent par avoir raison du mouvement : lors du dernier rassemblement chartiste d’ampleur à Kennington Common, au sud de Londres, en avril 1848, un grand déploiement de forces armées bloque tous les ponts de la capitale et interdit la procession jusqu’au Parlement. Après quoi, le chartisme s’essouffle et cesse d’être un mouvement de masse, mais continue de présenter des candidats aux élections tout au long des années 1850.
Marx – qui est proche des nouveaux chefs de file du mouvement, Ernest Jones et Julian Harney – voit dans le chartisme « le segment politiquement actif de la classe ouvrière anglaise[21] », et au fond le parti de masse du prolétariat anglais. Bien qu’il soit conscient que le mouvement a perdu en puissance depuis 1848, il en discerne un regain de vigueur. Cette prévision, qui s’est révélée fausse, est liée chez lui à deux autres hypothèses qui ont également été infirmées : celle d’une crise parlementaire et politique profonde, et celle d’une crise économique imminente[22].
Le point le plus intéressant des analyses de Marx est peut-être la manière dont il comprend les revendications des chartistes, centrées autour de la question du suffrage universel ainsi que de ses conditions de réalisation concrètes. Car pour lui, ces revendications, loin d’être purement démocratiques, sont aussi implicitement socialistes :
« En Angleterre, le suffrage universel est synonyme de pouvoir politique pour la classe ouvrière : le prolétariat y est largement majoritaire, il a acquis au cours d’une guerre civile longue mais souterraine une claire conscience de sa position en tant que classe ; même les circonscriptions rurales ne comptent plus de paysans, mais seulement des propriétaires fonciers, des capitalistes agricoles (fermiers) et des travailleurs salariés. L’adoption du suffrage universel en Angleterre serait par conséquent une réforme bien plus socialiste que tout ce qui a eu l’honneur de recevoir ce nom sur le continent : son résultat inévitable serait, ici, la suprématie politique de la classe ouvrière[23]. »
On trouve dans ce texte la première exposition claire par Marx (ou Engels) de l’idée d’un passage démocratique et pacifique au socialisme[24]. Bien entendu, le suffrage universel n’est pas acquis en Angleterre, et il est possible que sa conquête requière une révolution violente. Mais Marx considère vraisemblablement que, une fois cette condition démocratique réalisée, l’édification d’une société communiste pourra être initiée sans en passer par une nouvelle révolution, dans la mesure où la classe ouvrière – majoritaire – possédera de fait le pouvoir.
Comme le souligne Jacques Texier, il est frappant que ce texte soit écrit à quelques mois d’intervalle de Révolution et contre-révolution, où Engels défend un modèle révolutionnaire jacobin, esquisse les règles d’un « art de l’insurrection » et critique férocement le « parti démocratique ». Il ne faut comprendre le contraste entre ces textes ni comme la preuve d’un désaccord entre Engels et Marx, ni comme la conséquence d’un changement brusque de ligne politique. Ce sont plutôt les spécificités de la situation socio-politique anglaise (l’importance numérique du prolétariat industriel et agricole, sa maturité politique, la perspective concrète de la conquête du suffrage universel dans un régime parlementaire bien établi) qui expliquent la formulation d’une hypothèse stratégique distincte de celle qui vaut pour le Continent, en premier lieu en France et en Allemagne.
Extrait de l’introduction des traducteurs/rices : Alexia Blin, Yohann Douet, Juliette Farjat, Alexandre Feron, Marion Leclair
Article de Karl Marx
Les chartistes
Du correspondant du New-York Tribune
New-York Daily Tribune
N° 3543, 25 août 1852[25]
|323| Tandis que les tories, les whigs et les peelites, autrement dit tous les partis dont nous avons parlé jusqu’ici, appartiennent plus ou moins au passé, les libre-échangistes (c’est-à-dire les tenants de l’École de Manchester et les partisans de réformes parlementaires et financières) sont les représentants officiels de la société moderne anglaise, les représentants de cette Angleterre qui domine le marché mondial. Ils constituent le parti de la bourgeoisie consciente d’elle-même, du capital industriel s’efforçant de convertir son pouvoir social en pouvoir politique et d’éradiquer les derniers orgueilleux vestiges de la société féodale. Ce parti est dirigé par la fraction la plus active et la plus énergique de la bourgeoisie anglaise : les industriels. Ils réclament la suprématie complète et sans fard de la bourgeoisie, l’assujettissement explicite et officiel de la société tout entière aux lois de la production bourgeoise moderne, et donc aux hommes qui dirigent cette production. Par libre-échange, ils entendent le mouvement du capital entièrement libéré de toute entrave politique, nationale et religieuse. La terre doit être mise sur le marché et l’exploitation de la terre doit respecter les lois générales du commerce. Il faut des fabricants d’aliments comme il y a des fabricants de fil et de coton, mais il ne faut plus de seigneurs de la terre. On ne doit tolérer, en somme, aucune restriction, aucune régulation et aucun monopole d’ordre social ou politique, à moins qu’ils ne découlent des « lois éternelles de l’économie politique », c’est-à-dire des conditions sous lesquelles le capital produit et distribue. La lutte de ce parti contre les vieilles institutions anglaises, fruits d’un stade de l’évolution sociale dépassé et sur le point de disparaître, peut être résumée par le mot d’ordre suivant : produisez au plus bas prix possible, et éliminez tous les faux frais* |324| de la production (toutes les dépenses qui, au sein de la production, sont superflues et non nécessaires). Et ce mot d’ordre s’adresse non seulement à l’individu isolé, mais aussi et surtout à la nation tout entière.
Or, que dire de la royauté, avec ses « splendeurs barbares », sa cour, sa liste civile[26] et ses domestiques, si ce n’est qu’elle compte parmi ces faux frais* de la production ? La nation n’a pas besoin de la royauté pour produire et échanger : eh bien, adieu la couronne ! Les sinécures de la noblesse, la Chambre des lords ? Faux frais*. La grande armée de métier ? Faux frais*. Les colonies ? Faux frais*. L’Église d’État avec ses richesses, butins issus du pillage ou de la mendicité ? Faux frais*. Que les membres du clergé se concurrencent librement et que chacun les paie selon ses propres besoins. Toutes les procédures minutieuses du droit anglais, avec sa Cour de la chancellerie[27] ? Faux frais*. Les guerres nationales ? Faux frais*. L’Angleterre peut exploiter des nations étrangères à plus bas prix encore si elle est en paix avec elles.
Voyez-vous, pour ces champions de la bourgeoisie britannique, pour ces tenants de l’École de Manchester, toutes les institutions de la vieille Angleterre apparaissent comme une machine aussi coûteuse qu’inutile, et n’ont d’autre fonction que d’empêcher la nation de produire le plus possible au moindre coût, et d’échanger ces produits en toute liberté. En toute logique, la république bourgeoise est leur dernier mot : règne absolu des lois de la libre concurrence sur toutes les sphères de la vie, réduction du rôle du gouvernement au strict minimum indispensable à l’administration, à l’intérieur comme à l’extérieur, des intérêts de classe de la bourgeoise et de ses affaires – minimum de gouvernement qui doit être organisé aussi sobrement et aussi économiquement que possible. Dans d’autres pays, un tel parti serait qualifié de démocratique. Mais il est nécessairement révolutionnaire : l’annihilation complète de la vieille Angleterre en tant que pays aristocratique est, de façon plus ou moins consciente, l’objectif qu’il poursuit. Son but le plus immédiat, cependant, est d’obtenir une réforme du Parlement qui placerait entre ses mains le pouvoir législatif nécessaire à une telle révolution.
Mais les bourgeois britanniques ne sont pas des Français exaltés. Quand ils visent une réforme parlementaire, ils ne font pas une révolution de Février[28]. Bien au contraire. Après leur grande victoire de 1846 sur l’aristocratie foncière par l’abolition des Corn Laws, ils se sont contentés d’en recueillir les avantages matériels, sans en tirer les conclusions politiques et économiques nécessaires. C’est ce qui a permis aux whigs de rétablir leur monopole héréditaire sur le gouvernement. Pendant toute la période de 1846 à 1852, ils se sont exposés au ridicule avec leur cri de guerre : « grandeur des principes, réalisme (comprendre petitesse) des mesures ». Pourquoi cela ? Parce que pour tout changement radical, ils sont contraints de faire appel à la classe ouvrière. Or si l’aristocratie est un adversaire en voie de disparition, |327| la classe ouvrière est leur ennemi montant. Ils préfèrent s’entendre avec l’adversaire en fin de règne et lui faire des concessions de taille, plutôt que de renforcer l’ennemi montant, à qui l’avenir appartient. Ainsi, ils s’efforcent d’éviter tout affrontement violent avec l’aristocratie ; mais ils sont poussés en avant par la nécessité historique et les tories. Ils ne pourront échapper à leur mission, à savoir réduire en miettes la vieille Angleterre, l’Angleterre du passé. Et, le jour où ils se seront emparés du pouvoir politique dans sa totalité, quand le pouvoir politique et le pouvoir économique seront concentrés dans les mêmes mains et quand, par conséquent, la lutte contre le capital ne sera plus séparée de la lutte contre le gouvernement en place, ce jour-là marquera le début de la révolution sociale anglaise.
Venons-en à présent aux chartistes, le segment politiquement actif de la classe ouvrière anglaise. Les six points de la Charte pour lesquels ils se battent, n’ont d’autre contenu que la revendication du suffrage universel et des conditions sans lesquelles il resterait lettre morte pour la classe ouvrière : le vote à bulletin secret, l’indemnité parlementaire, des élections législatives annuelles, etc. Mais, en Angleterre, le suffrage universel est synonyme de pouvoir politique pour la classe ouvrière : le prolétariat y est largement majoritaire, il a acquis au cours d’une guerre civile longue mais souterraine une claire conscience de sa position en tant que classe ; même les circonscriptions rurales ne comptent plus de paysans, mais seulement des propriétaires fonciers, des capitalistes industriels (fermiers) et des travailleurs salariés. L’adoption du suffrage universel en Angleterre serait par conséquent une réforme bien plus socialiste que tout ce qui a eu l’honneur de recevoir ce nom sur le continent.
Son résultat inévitable serait, ici, la suprématie politique de la classe ouvrière.
J’évoquerai à une autre occasion le renouveau et la réorganisation du parti chartiste[29]. Pour le moment je m’en tiendrai simplement aux dernières élections.
Pour pouvoir participer à l’élection du Parlement britannique, il faut occuper dans les bourgs [boroughs] un logement d’une valeur locative annuelle de 10 £ lors de l’établissement de l’impôt des pauvres[30], et dans les comtés [counties], il faut détenir en propriété dite franche [freehold] un bien d’une valeur locative annuelle de 40 shillings[31], ou louer un bien évalué à 50 £ par an au moins. Du seul fait de ces conditions, les chartistes n’ont pu participer officiellement que de manière restreinte à la bataille électorale qui vient de s’achever. Pour expliquer le rôle qu’ils y ont effectivement joué, il me faut rappeler une spécificité du système électoral britannique :
Jour de la nomination et jour de la déclaration ! Vote à main levée et scrutin !
Quand les candidats se présentent, le jour des élections, pour haranguer publiquement le peuple, ils sont, dans un premier temps, élus à main levée – et toutes les mains ont le droit de se lever, que ce soit celle d’un non-électeur ou d’un électeur. Celui |328| pour lequel la majorité des mains est levée est alors déclaré élu (provisoirement) par le commissaire des élections. Mais voici le revers de la médaille. L’élection à main levée n’était qu’un cérémonial, un acte de politesse toute formelle envers le « peuple souverain ». Mais la politesse s’envole dès que les privilèges sont menacés. En effet, si le vote à main levée n’est pas favorable aux candidats des électeurs privilégiés, ces candidats exigent un scrutin. Or, seuls les électeurs privilégiés peuvent y participer, et seul celui qui obtient la majorité des votes est déclaré dûment élu. La première élection à main levée donne, l’espace d’un instant, une satisfaction apparente à l’opinion publique. Mais c’est pour la convaincre, l’instant suivant et de manière d’autant plus flagrante, de son impuissance.
On pourrait croire que cette élection à main levée, cette dangereuse formalité, a été inventée pour ridiculiser le suffrage universel et pour permettre aux aristocrates de jouir d’un petit moment d’amusement aux dépens de la « canaille » (expression du major Beresford, ministre de la Guerre). Mais ce serait faire fausse route : l’ancienne coutume, à l’origine, commune à toutes les nations teutonnes, a pu se transmettre, péniblement, par tradition jusqu’au XIXe siècle, parce qu’en Grande-Bretagne elle donnait au Parlement de classe une apparence de popularité, et ce à peu de frais et sans danger. Les classes dirigeantes tiraient de cette coutume la satisfaction de voir la masse populaire se préoccuper, de façon plus ou moins passionnée, de leurs propres intérêts particuliers, comme s’il s’agissait de l’intérêt national. Ce n’est qu’à partir du moment où la bourgeoisie a occupé une position indépendante aux côtés des whigs et des tories, les deux partis officiels, que la classe ouvrière s’est affirmée en son nom propre, les jours de nomination. Mais jamais, avant cette élection de 1852, le contraste entre le vote à main levée et le scrutin, entre le jour de la nomination et le jour de la déclaration, n’a été si important, si nettement défini par des principes opposés, si menaçant, si généralisé à travers tout le pays.
Et quel contraste ! Il suffisait d’être désigné par le vote à main levée pour être battu au scrutin. Il suffisait d’obtenir la majorité au scrutin pour être salué par le peuple à coups de pommes pourries et de pavés. Les membres du Parlement dûment élus devaient alors, avant tout, s’efforcer de mettre leur propre corps de parlementaires à l’abri. D’un côté, la majorité du peuple, de l’autre un douzième de toute la population ou un cinquième des hommes d’âge adulte du pays. D’un côté, l’enthousiasme, de l’autre, la corruption. D’un côté, des partis reniant leurs caractéristiques respectives, des libéraux plaidant pour le conservatisme, des conservateurs affirmant des opinions libérales ; de l’autre, le peuple affirmant sa présence et plaidant sa propre cause. D’un côté une machine usée qui, tournant indéfiniment dans son cercle vicieux, n’est jamais capable de faire un seul pas en avant ; un processus stérile de friction par lequel tous les partis officiels se réduisent peu à peu en poussière les uns les autres ; de |329| l’autre, la masse de la nation en marche, menaçant de briser le cercle vicieux et de détruire la machine officielle.
Je n’analyserai pas ce contraste entre nomination et élection dans tout le pays, ni la manifestation électorale menaçante de la classe ouvrière ou les manœuvres électoralistes craintives des classes dirigeantes. Parmi tous les bourgs, je vais plutôt en choisir un qui révèle tout particulièrement ce contraste : parlons donc de l’élection d’Halifax. Les candidats qui s’opposaient étaient : Edwards (tory) ; Sir Charles Wood (ancien chancelier de l’Échiquier whig, beau-frère du comte Grey) ; Franck Crossley (de l’École de Manchester) ; et enfin Ernest Jones, le représentant le plus doué, le plus conséquent et le plus énergique du chartisme. Halifax étant une ville industrielle, le tory n’avait que peu de chances. Crossley, l’homme de Manchester, était allié aux whigs. La véritable bataille opposait ainsi Wood et Jones, le whig et le chartiste : « Sir Charles Wood a fait un discours d’une demi-heure environ, parfaitement inaudible au début, et ne suscitant par la suite que l’hostilité de l’immense majorité du public. D’après le journaliste qui était à ses côtés, il s’est contenté de récapituler les mesures déjà votées en faveur du libre-échange, d’attaquer le gouvernement de Lord Derby et de rendre hommage à “la prospérité sans égale du pays et du peuple !” (Bravo !) Il n’a pas proposé une seule nouvelle réforme et n’a fait qu’une légère allusion, en quelques mots à peine, au projet de loi électorale de Lord John Russell. »
Je vous livre maintenant un extrait plus substantiel du discours d’E. Jones puisqu’on ne le trouvera dans aucun des grands journaux de la classe dirigeante londonienne :
« Ernest Jones, qu’on a accueilli avec un immense enthousiasme, s’est exprimé ainsi : Électeurs et non-électeurs, vous vous êtes réunis pour célébrer un grand événement solennel. Aujourd’hui, la Constitution reconnaît, en théorie, le suffrage universel même si elle va peut-être le renier en pratique par la suite. Aujourd’hui, les représentants de deux systèmes se tiennent devant vous et vous devez décider lequel des deux vous gouvernera pendant les sept prochaines années. Sept ans – une petite vie ! Au seuil de ces sept années, je vous demande de réfléchir : aujourd’hui, ils vont défiler devant vous lentement et calmement ; aujourd’hui vous pouvez choisir, vous, vingt-mille hommes, si environ cinq cents hommes pourront anéantir votre volonté demain ! (Bravo !) J’ai dit que les représentants de deux systèmes se tenaient devant vous. Il est vrai qu’à ma gauche il y a les whigs, les tories et les spéculateurs, mais ils ne font qu’un. Le spéculateur dit : achetez à bas prix et vendez cher. Le tory dit : achetez cher, et vendez plus cher encore. Cela revient au même pour les travailleurs. Mais le premier système est en train de l’emporter et, en son cœur, le paupérisme persiste. Ce système repose sur la concurrence étrangère. Or, j’affirme que le principe d’acheter à bas prix et de vendre cher, appliqué à la concurrence étrangère, accentuera à coup sûr la ruine de la classe ouvrière et de la classe des petits artisans et commerçants. |330| Pourquoi ? Car le travail est créateur de toutes les richesses. Il faut qu’un homme travaille pour que pousse une graine ou qu’un fil soit tissé. Mais dans ce pays, le travailleur n’est pas son propre employeur. Le travail est une marchandise qui se loue – une chose qu’on achète et qu’on vend sur le marché ; et comme le travail crée toutes les richesses, il est aussi la première marchandise qu’on achète. – “Achetez à bas prix ! Achetez à bas prix !” On achète le travail au plus bas prix possible. Mais à présent voilà qu’on dit :
“Vendez cher ! Vendez cher !” Vendre quoi ? Les produits du travail. À qui ? À l’étranger bien sûr ! Et au travailleur lui-même – car n’étant pas son propre employeur, il ne jouit pas des premiers fruits de son labeur. “Achetez à bas prix, vendez cher.” Qu’en dites-vous ? “Achetez à bas prix, vendez cher” : achetez le travail de l’ouvrier à bas prix, et vendez cher à ce même ouvrier le produit de son propre travail ! Le principe de la perte est inhérent à ce marché. L’employeur achète le travail à bas prix – puis il vend et doit tirer profit de cette vente ; il vend au travailleur lui-même – et ainsi tout marché entre un employeur et un employé est délibérément truqué par l’employeur. Le travail sombre ainsi, perpétuellement voué à perdre ce que le capital acquiert continuellement par la fraude. Mais le système ne s’arrête pas là. Cela est amené à s’appliquer à la concurrence étrangère – c’est-à-dire qu’il faut ruiner le commerce des autres pays, comme nous avons ruiné le travail dans le nôtre. Comment cela fonctionne-t-il ? Les pays qui sont davantage taxés doivent vendre moins cher que ceux qui le sont peu. La concurrence extérieure ne cesse d’augmenter, si bien que les prix ne cesseront de baisser. Par conséquent, les salaires en Angleterre continueront de baisser sans cesse. Comment fait-on diminuer les salaires ? Grâce au surplus de travailleurs. Comment obtient-on ce surplus ? Grâce au monopole sur la terre qui pousse plus de travailleurs qu’il n’en faut vers les usines. Grâce au monopole sur les machines qui pousse ces travailleurs à la rue – grâce au travail des femmes qui chasse les hommes de la navette – grâce au travail des enfants qui chasse les femmes des métiers à tisser. Puis, en se servant de cette base vivante de surplus comme d’un marchepied, ils écrasent du talon ces cœurs douloureux et s’écrient “C’est la famine ! Qui veut du travail ? Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras” – et les masses, se tordant de douleur, sont prêtes à accepter avidement leurs conditions. (Grands cris d’approbation ; Bravo !) Voilà ce qu’est le système pour les travailleurs. Mais vous, électeurs ! Quelle est l’action du système sur vous ? Quels sont ses effets sur le marché intérieur, sur le commerçant, sur l’impôt des pauvres et sur le reste des impôts ? Tout renforcement de la concurrence extérieure appelle nécessairement, chez nous, une intensification de la baisse des prix. Toute baisse du prix du travail repose sur une augmentation du surplus de travailleurs et ce surplus s’obtient par l’augmentation du nombre de machines. Je vous le redemande, quelle est l’action du système sur vous ! Le libéral de Manchester à ma gauche dépose un nouveau brevet, et met un surplus de trois cents hommes à la rue. Commerçants ! c’est pour vous trois cents clients de moins. Contribuables ! c’est pour vous, trois cents pauvres de plus (tonnerre d’applaudissements). Mais écoutez-moi bien ! Le mal ne s’arrête pas là. Ces trois cents hommes servent d’abord à faire baisser les salaires de ceux qui ont encore du travail dans leur métier. L’employeur leur dit “Je vais maintenant réduire vos salaires”. Les hommes protestent. Mais il |331| ajoute : “Vous voyez ces trois cents hommes qui viennent de quitter l’usine – si vous le souhaitez, vous pouvez prendre leur place ; comme ils meurent de faim, ils sont prêts à revenir à n’importe quelle condition.” Les hommes le sentent bien et ils sont anéantis. Ah ! Vous le libéral de Manchester, pharisien de la politique ! Ces hommes-là nous écoutent – je vous tiens maintenant, n’est-ce pas ? Mais le mal ne s’arrête toujours pas là. Ces hommes, chassés de leur métier, cherchent du travail ailleurs, viennent gonfler le surplus et font ainsi baisser les salaires. Les métiers les moins bien payés d’aujourd’hui étaient autrefois les mieux payés – et ceux qui sont bien payés aujourd’hui seront bientôt les moins bien payés. Ainsi, le pouvoir d’achat de la classe ouvrière diminue chaque jour et le commerce intérieur se meurt. Gardez cela à l’esprit, vous, les commerçants ! Vos clients sont de plus en plus pauvres, et vos profits de plus en plus faibles. Le nombre de vos indigents augmente en même temps que votre impôt des pauvres et que le reste de vos impôts. Vos recettes diminuent, vos dépenses augmentent. Vous gagnez moins et dépensez plus. Que pensez-vous donc de ce système ? C’est sur vous que le riche industriel et le propriétaire foncier font peser le poids de l’impôt des pauvres et des autres impôts. Vous, hommes de la classe moyenne !
Vous êtes la machine à payer les impôts pour les riches. Ils créent la pauvreté qui crée leur richesse et ils vous font payer pour la pauvreté qu’ils ont créée. Le propriétaire foncier y échappe grâce à ses privilèges, l’industriel en se dédommageant sur les salaires de ses hommes, et tout cela rejaillit sur vous. Que pensez-vous donc de ce système ? Eh bien, c’est le système que soutiennent les messieurs à ma gauche. Mais quelle est l’alternative que je propose ? J’ai montré où était le mal. C’est déjà quelque chose. Mais je vais faire davantage ; je me tiens ici devant vous pour vous montrer comment faire le bien, et m’en justifier. (Tonnerre d’applaudissements) »
Ernest Jones en est alors venu à exposer ses propres idées en matière de réformes politiques et économiques, poursuivant ainsi :
« Électeurs et non-électeurs, je viens de vous exposer certaines mesures sociales et politiques dont je préconise l’adoption immédiate. Je l’avais déjà fait en 1847. Cependant, parce que j’essayais d’étendre vos libertés, les miennes ont été réduites. (Bravo !). Parce que j’ai voulu édifier pour vous tous le temple de la liberté, j’ai été jeté en prison, comme un criminel. Et là, assis à ma gauche se trouve l’un de mes principaux geôliers. (Grondements prolongés et bruyants dirigés vers la gauche). Parce que j’ai voulu me faire le porte-voix de la vérité, j’ai été condamné au silence. Pendant deux ans et une semaine, il m’a jeté en prison, mis à l’isolement et astreint au silence forcé : sans plume, sans encre, sans papier, avec pour seule distraction de faire de l’étoupe. Ah ! (il se tourne vers Sir Charles Wood) vous avez eu votre chance pendant deux ans et une semaine, aujourd’hui, c’est mon tour ! J’en appelle à l’ange du châtiment qui habite le cœur de tous les Anglais ici présents. (Un grand tonnerre d’applaudissements). Écoutez ! On entend battre ses ailes dans le souffle de cette foule immense ! (à nouveau, de longues acclamations). On alléguera qu’il ne s’agit pas là d’une affaire publique. Mais c’en est une ! (Bravo !) C’est une affaire publique, car celui qui n’a pas d’empathie pour la femme d’un prisonnier, sera tout aussi incapable d’empathie pour la femme du travailleur. Celui qui n’éprouve rien pour les enfants du captif, n’éprouvera rien pour les enfants du travailleur-esclave. (Bravo ! Acclamations). Sa vie passée en fait la démonstration |332| et sa promesse d’aujourd’hui ne vient pas le contredire. Qui a voté pour la répression en Irlande, pour le bâillonnement et la manipulation de la presse irlandaise[32] ? Le whig ! Il est assis là. Sortez-le ! Qui a voté quinze fois contre la motion de Hume pour l’extension du droit de vote, contre celle de Locke King en faveur du suffrage dans les comtés, contre celle d’Ewart pour la réduction des périodes de législature et contre celle de Berkeley pour le vote à bulletin secret[33] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre la libération de Frost, Williams et Jones[34] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre l’enquête sur les abus coloniaux et en faveur de Ward et Torrington, les tyrans des îles ioniennes et de Ceylan[35] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre la réduction du salaire de 12 000 £ du duc de Cambridge, contre les réductions dans l’armée et la marine, contre la suppression de l’impôt sur les fenêtres, et 48 fois contre toute autre réduction d’impôts, y compris contre les réductions de son propre salaire ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre la suppression de l’impôt sur le papier, de l’impôt sur les annonces et de la taxe sur le savoir[36] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté pour des fournées de nouveaux évêques, pour l’impôt servant à la rémunération des pasteurs, pour la subvention de Maynooth et contre sa réduction, contre l’exemption de la dîme pour les non-conformistes[37] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre les enquêtes sur le frelatage des denrées alimentaires ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre la réduction des droits de douane sur le sucre et l’abolition de l’impôt sur le malt[38] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Qui a voté contre la réduction du travail de nuit des boulangers, contre l’enquête sur les conditions de travail des ouvriers tricoteurs, contre les inspections sanitaires des usines, contre l’interdiction de faire travailler les enfants avant six heures du matin, contre les aides de la paroisse pour les femmes enceintes pauvres et contre la loi sur la journée de dix heures[39] ? Le whig, assis là ; sortez-le ! Sortez-le au nom de l’humanité et pour l’amour de Dieu ! Hommes d’Halifax ! Hommes d’Angleterre. Les deux systèmes sont là devant vous. À présent, jugez et choisissez. (On ne saurait décrire l’enthousiasme suscité par ce discours, en particulier vers la fin ; la vaste foule, retenant son souffle, attentive à chaque mot, sa voix s’élevant lors des pauses comme le fracas d’une vague qui se brise, exécrant le représentant de la whiggerie et de la classe dirigeante. Ce qui est certain, c’est que cette scène restera longtemps gravée dans les mémoires. Lors du vote à main levée, seuls quelques individus, pour la plupart intimidés ou achetés, se sont prononcés en faveur de Sir C. Wood, tandis que presque tout le monde levait les deux mains en faveur d’Ernest Jones, au milieu des acclamations, dans un enthousiasme indescriptible.)
Le maire a déclaré que M. Ernest Jones et M. Henry Edwards étaient élus à main levée. Sir C. Wood et M. Crossley ont alors exigé un scrutin. »
Ce que Jones avait prévu arriva ; il a été désigné par vingt-mille votes, mais le whig Sir Charles Wood et Crossley, l’homme de Manchester, ont finalement été élus par cinq cents voix.
Karl Marx
Londres, mardi 10 août 1852
*
Illustration : photographie du Grand meeting chartiste à Kennington Common, le 10 avril 1848
Notes
[1] Sur les treize articles de la seconde partie, dix sont consacrés à l’Angleterre. Les articles restants sont, d’une part deux courtes mises au point sur Kossuth (« Kossuth, Manzini et Louis Napoléon », « Une réponse au “secrétaire” de Kossuth »), et d’autre part « Le récent procès de Cologne », qui s’inscrit plutôt dans la série d’articles consacrés à la révolution allemande.
[2] Sur le mouvement radical britannique des années 1790 et sa répression, voir Edward P. Thompson, La Formation de classe ouvrière anglaise, trad. G. Dauvé, M. Golaszewski et M. N. Thibault, Paris, Seuil, 2017. Voir aussi Edward P. Thompson, Les Romantiques : l’Angleterre à l’ère des révolutions, trad. M. Leclair et E. Lee-Six, Paris, Les éditions sociales, 2023.
[3] Sur les Swing Riots, voir l’étude classique de Eric Hobsbawm et George Rudé, Captain Swing, Londres, Verso, 2014.
[4] Sur le mouvement radical des années 1810 et le massacre de Peterloo, voir Robert Poole, Peterloo : the English Uprising, Oxford, Oxford University Press, 2019. Voir aussi Samuel Bamford, La Vie d’un radical anglais au temps de Peterloo, F. Bensimon (dir.), trad. L. Bury, Paris, Les éditions sociales, 2019.
[5] Le seuil varie dans les comtés suivant qu’on est propriétaire, en tenure franche ou en bail long, de sa terre (dont la valeur doit être d’au moins 40 shillings à l’année), ou simple fermier louant sa terre (50 livres au moins à l’année) ; dans les bourgs, un seuil unique est fixé à 10 livres.
[6] Les lois sur les grains (ou Corn Laws), en introduisaient des droits de douane importants sur les céréales (notamment états-uniennes), conduisaient à une augmentation du prix de ces dernières qui favorisait les grands propriétaires et producteurs britanniques.
[7] Les « peelites » constituaient la fraction du parti conservateur (tory) acquise au libre-échange. Les partisans du premier ministre Robert Peel ont voté avec les whigs et les radicaux en 1846 l’abrogation des lois sur les grains, se mettant ainsi à l’écart du parti conservateur, et formant par la suite avec d’autres groupes (principalement les whigs) le parti libéral.
[8] Nous reviendrons sur le chartisme infra, p. 51-52.
[9] Voir infra, « Corruption électorale », p. 180-186.
[10] Voir infra, « Résultats des élections », p. 187-192.
[11] Voir infra, « Les élections – tories et whigs », infra, p. 166.
[12] Voir infra, « Les chartistes », p. 170-179.
[13] Voir infra, « Conséquences politiques de l’emballement du commerce », p. 200.
[14] Voir infra, « Du Parlement – Le vote du 26 novembre – Le budget Disraeli », p.221-227.
[15] Voir infra, « Conséquences politiques de l’emballement du commerce », p. 200-209.
[16] Voir infra, « Les chartistes », p. 172.
[17] Voir infra, « Conséquences politiques de l’emballement du commerce », p. 202.
[18] Voir infra, « La défaite du gouvernement », p. 233.
[19] Sur le chartisme comme mouvement ouvrier, voir Malcolm Chase, Le Chartisme. Aux origines du mouvement ouvrier britannique (1838-1858), trad. L. Bury, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.
[20] Sur les transformations de l’usage de la pétition, voir Robert Poole, « Petitioners and Rebels : Petitioning for Parliamentary Reform in Regency England », Social Science History, volume 43, n° 3, automne 2019, p. 553-579.
[21] Voir infra, « Les chartistes », p. 172.
[22] Voir infra, « Tentatives pour former un nouveau parti d’opposition », p. 209-213 (fin de l’article). Nous reviendrons sur la question de la crise économique au point suivant.
[23] Voir infra, « Les chartistes », p. 172.
[24] Voir Jacques Texier, Révolution et démocratie chez Marx et Engels, Paris,
PUF, 1998, p. 22-25. Pour une série de textes – antérieurs et surtout postérieurs – où l’on retrouve cette idée, voir ibid., p. 367-368.
[25] « Les chartistes » est le premier article de Marx et d’Engels qui ait paru non seulement dans l’édition principale du New-York Daily Tribune, mais aussi dans les éditions spéciales, semi-hebdomadaires (The Semi-Weekly Tribune) et hebdomadaires (The New-York Weekly Tribune) du journal.
[26] La « liste civile » (civil list) désigne les fonds alloués par le Parlement pour les dépenses de la couronne.
[27] La Cour de la chancellerie (Court of Chancery), appelée aussi Cour d’équité (Court of Equity) était un tribunal de grande instance en Angleterre ; après une réforme du système judiciaire en 1873, elle est devenue une simple division de la Haute Cour de justice. La juridiction de cette cour, présidée par le grand chancelier (Lord Chancellor), incluait les litiges liés aux questions d’héritage, de contrats, de compagnies par actions. Les prérogatives de cette cour recoupaient, en plusieurs endroits, celles d’autres tribunaux de grande instance. La Cour de la chancellerie devait servir de contrepoids aux autres tribunaux qui appliquaient le droit commun anglais : ses décisions, par conséquent, relevaient de l’équité.
[28] Allusion à la révolution de février 1848 en France : elle constitue, dans l’analyse qu’en font Marx et Engels, la phase bourgeoise de la révolution de 1848, qui a renversé Louis-Philippe et la monarchie constitutionnelle ; ont suivi, quelques mois plus tard, les journées de Juin, phase ouvrière de la révolution dans laquelle l’insurrection populaire suscitée par la fermeture des ateliers nationaux a été réprimée dans le sang par le gouvernement provisoire né de la révolution de Février.
[29] Voir supra, « Tentatives pour former un nouveau parti d’opposition », p. 209-213.
[30] Le poor rate, littéralement « le taux des pauvres », était l’impôt sur la propriété perçu dans chaque paroisse pour financer l’aide dispensée aux pauvres. Le taux d’imposition étant fonction des biens détenus, les différents seuils d’imposition servaient aussi à déterminer l’accès ou non au vote, à une époque où le suffrage était encore censitaire.
[31] Les francs-tenanciers (freeholders) sont une catégorie de petits propriétaires terriens, datant du Moyen Âge. Contrairement aux « tenanciers » simples (tenants), fermiers ou métayers louant leur terre contre un loyer en argent ou en nature, les francs-tenanciers ne payaient à l’origine au seigneur qu’un impôt symbolique et disposaient d’une propriété quasi complète sur leur terre. Ces petits fermiers indépendants ont tendu à disparaître à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la révolution agricole et la dernière vague des enclosures ont accéléré la constitution de grands domaines agricoles avec lesquels les francs-tenanciers n’étaient pas en mesure de rivaliser.
[32] L’Irlande a connu elle aussi son printemps des peuples en 1848 : en juillet, une insurrection nationaliste dans le comté de Tipperary a tourné court ; mais elle a fait l’objet d’une répression sévère de la part du gouvernement britannique : les meneurs qui n’ont pas réussi à fuir ont été arrêtés et condamnés à mort ou à la déportation à vie en Tasmanie.
[33] Allusion aux tentatives de réforme parlementaire (extension du droit de vote, vote à bulletin secret, moindre durée des sessions parlementaires) défendues entre 1832 et 1867, par des députés libéraux tels que Joseph Hume, Peter Locke King, William Ewart ou Henry Fitzhardinge Berkeley.
[34] Leaders chartistes, arrêtés après l’insurrection de Newport en novembre 1839. Initialement condamnés à la pendaison, ils ont vu leur peine muée quelques mois plus tard en déportation en Tasmanie. Au cours des décennies suivantes, leurs soutiens à la Chambre des communes se sont efforcés d’obtenir la libération des trois hommes. Frost, gracié en 1854 à condition de quitter la Grande-Bretagne, a bénéficié deux ans plus tard d’une grâce complète qui lui a permis de revenir en Grande-Bretagne.
[35] Allusion à une motion présentée lors de la session parlementaire de 1851 visant à démettre de leurs fonctions Lord Torrington et Sir Henry Ward, administrateurs coloniaux de l’île de Ceylan pour l’un et des îles ioniennes pour l’autre, visés par une enquête parlementaire pour zèle excessif dans la répression d’émeutes survenues dans leurs juridictions respectives.
[36] « La taxe sur le savoir » (tax on knowledge) était le surnom donné au XIXe siècle à l’impôt sur la presse qui, en augmentant le prix des périodiques, rendait moins abordable une des principales sources de diffusion élargie du savoir, à une époque où l’école n’était pas encore obligatoire et gratuite.
[37] Jones fait ici allusion aux subventions votées par le Parlement britannique en 1846 pour la construction et l’entretien d’un nouveau bâtiment au sein du Collège catholique de Maynooth (en Irlande), fondé en 1795. Par ces mesures, les classes dirigeantes anglaises espéraient concilier le clergé catholique irlandais, de façon à diviser, et affaiblir, le mouvement de libération nationale en Irlande.
[38] Ces réductions d’impôts, notamment la réduction de moitié de l’impôt sur le malt qui suscitait la colère des agriculteurs, étaient une des pièces maîtresses du budget présenté au Parlement par Benjamin Disraeli, alors ministre des Finances du gouvernement conservateur du comte de Derby.
[39] Une loi des dix heures (Ten Hours Bill), défendue notamment par le député conservateur Richard Oastler et adoptée en 1847, avait réduit en théorie la journée de travail à dix heures pour les femmes et les enfants de moins de dix-huit ans – bien qu’elle fût peu appliquée dans les faits : il a fallu attendre 1878 pour que la journée de dix heures devienne effectivement la règle partout.

![1848. Marx et l’épreuve de la révolution [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/marx_engels-150x150.jpg)




![Le jeune Marx (partie 2), ou comment Marx est devenu communiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/2022-02-09-11.47.07-150x150.jpg)
![Marx, Engels et la Commune de Paris [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Spectre-Commune-150x150.jpg)
