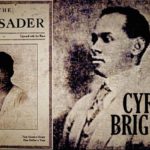Échos du Black Power et lutte des classes en France. Entretien avec Sylvain Pattieu
Dans son dernier livre, Panthères et pirates (La Découverte, 2022), Sylvain Pattieu retrace le parcours de Jean et Melvin McNair, deux pirates de l’air africains-américains, des États-Unis, en pleine guerre du Vietnam et en lutte contre la ségrégation raciale, à l’Algérie indépendante, jusqu’aux prisons françaises et leur engagement social auprès des populations paupérisées de Caen. Depuis une focale resserrée sur la micro-histoire de ce couple de militant-es, l’historien déploie, au sein d’un ouvrage historique dense, une histoire transnationale à la croisée des enjeux des luttes sociales, antiracistes et anti-impérialistes.
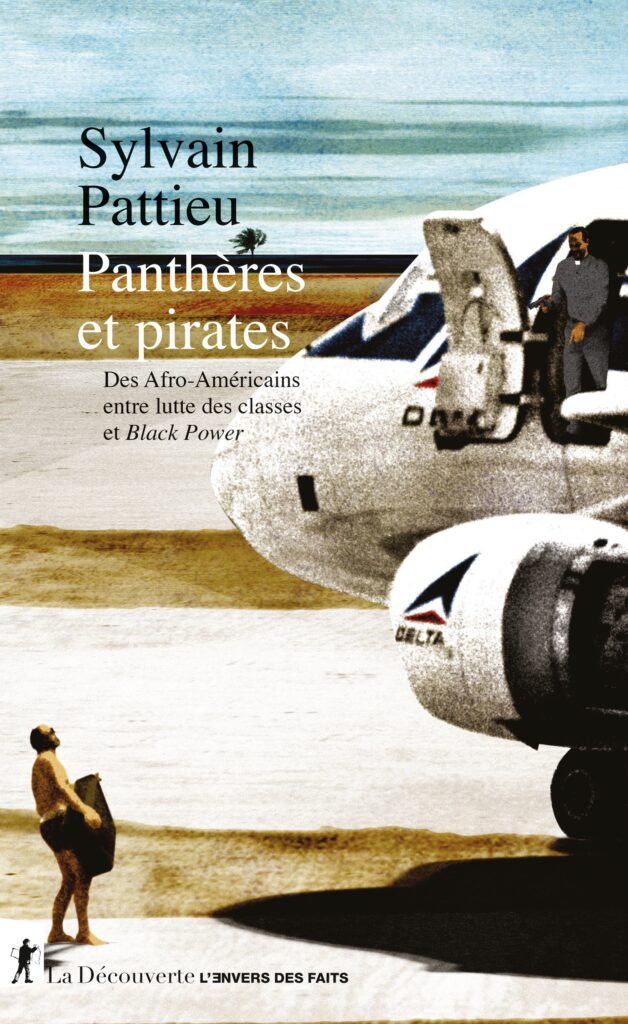
Contretemps – Dans ce livre d’histoire, tu retraces le parcours de Jean et Melvin McNair et plus largement des « 4 de Fleury » (avec George Brown et Joyce Tillerson) des années 1970 jusqu’à nos jours. C’est le second ouvrage que tu consacres à ce couple et leurs compagnons. Il vient en effet après un roman titré Nous avons arpenté des chemins caillouteux (Plein jour, 2017). Pourquoi as-tu souhaité revenir sur ce sujet, mais cette fois-ci à partir de ta casquette d’historien ? Doit-on penser ce livre comme un complément, une extension de ton premier travail ou comme un espace dissocié qui s’adresse à un autre public ?
Sylvain Pattieu – Ce sont deux livres très différents. J’avais l’impression de ne pas être allé au bout de cette histoire, je pouvais encore creuser. De fait, j’ai considérablement élargi les archives sur lesquelles j’ai travaillé : pour le premier livre, j’avais seulement consulté celles du procès, pour Panthères et pirates je suis allé voir celles du ministère de la Justice, de l’Intérieur, ainsi que les archives départementales du Calvados car Jean et Melvin McNair ont finalement passé la majeure partie de leur vie dans un quartier populaire de Caen. J’ai beaucoup travaillé sur les archives de l’avocat des pirates de l’air, Jean-Jacques de Felice, conservées dans ce centre d’archives si important qu’est La Contemporaine [ex BDIC], à Nanterre. J’ai aussi fait de nombreux entretiens et, par ailleurs, je me suis plongé dans toute une littérature concernant le Black Panther Party inédite en français.
Outre tout ce travail supplémentaire, la démarche n’est pas du tout la même entre mes deux livres. Pour le premier, il s’agissait d’un texte littéraire, même s’il s’appuyait sur des sources historiques. Alors que Panthères et pirates est un vrai livre de sciences sociales. Dans un cas, la finalité est poétique, dans l’autre, elle est scientifique. Ce n’est pas la même chose même si je me suis inspiré de mon travail littéraire pour donner du souffle à l’écriture scientifique.
Ce qui m’a poussé aussi à faire ce nouveau livre, c’est la façon dont était (mal) posé selon moi, en France, le débat sur race et classe. Il y a bien sûr toutes les controverses caricaturales sur le « wokisme » qui n’ont pas un grand intérêt scientifique. Mais il y a aussi de vraies réticences à prendre en compte la question de la race en histoire, envisagée bien sûr d’un point de vue culturel et social et pas biologique. J’ai ainsi été très déçu par le livre de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, de grands chercheurs selon moi, mais complètement à côté de la plaque sur ces questions.
Dans Race et sciences sociales, ils opposent grossièrement la race et la classe, comme si travailler sur l’une se faisait forcément au détriment de l’autre. Ils y voient une importation de problématiques anglo-saxonnes comme si la question de la race ne se posait pas dans l’histoire française. Enfin, la race serait selon eux une ruse de la droite et de certains mouvements de gauche qu’ils appellent « identitaires » pour écarter la question sociale de l’horizon politique.
Sur ces trois points, je crois qu’ils se trompent complètement, sans doute à cause d’une lecture normative de la réalité. Comme je suis historien, je prends les débats non par la théorie (on est souvent un peu terre-à-terre, nous autres historiens), mais à partir d’archives et d’un cas empirique, concret, celui de l’histoire des McNair. Cette histoire peut paraître extraordinaire parce qu’elle part d’un événement spectaculaire, un détournement d’avion. Mais elle révèle aussi beaucoup de l’ordinaire de l’enchevêtrement des questions de race et de classe aux États-Unis et en France, permet des comparaisons pour saisir la complexité, loin des caricatures, de ces questions.
Contretemps – Le titre de l’ouvrage entremêle les notions de lutte des classes et de Black Power. Cette double focale forme une sorte de fil rouge qui arpente ses pages. La singularité de leurs parcours respectifs nous permet d’embrasser la manière dont les conditions sociales et les dominations raciales et genrées viennent percuter les individus de part et d’autre des continents, mais aussi répond par l’exemple, comme tu le dis toi-même, aux débats relatifs à la domination présumée d’un débat américain sur la race qui serait importée des États-Unis et marquerait, si ce n’est supplanterait, les rapports de classes. Pour qui a lu entre autres Aimé Césaire ou Frantz Fanon en français dans le texte cette prétendue importation théorique des Black Studies depuis les États-Unis paraît bien bancale. Aussi je voudrais t’interroger à rebours de ces regards extérieurs : comment la compréhension du racisme et de la domination de classe en France est, selon toi, appréhendée par ces Africains-Américains tout autant que chez certain.e.s acteur.rice.s français que tu évoques dans le livre ?
Sylvain Pattieu – Jean et Melvin ont quitté les États-Unis pour fuir le racisme. En France, ils ont été arrêtés et jugés, condamnés à des peines de prison mais considérés comme des militants politiques qui ne devaient pas être extradés. Ils ont pu refaire leur vie et devenir des travailleurs sociaux dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen, où ils se sont établis et où un stade porte désormais leur nom. Résumée comme ça, leur vie pourrait être vue comme une démonstration qu’il y a du racisme outre-Atlantique et pas en France. Mais, au contraire, leur histoire permet de comprendre que les phénomènes de racialisation ne sont pas homogènes, on ne peut les comprendre qu’en les mettant en relation avec d’autres facteurs.
Ainsi, durant leur procès, ils sont jugés en tant que Noirs Américains, et dans une certaine mesure, la façon humaine dont ils ont été jugés est aussi une façon de se donner bonne conscience et de faire le procès des États-Unis. On le voit bien dans les commentaires de la presse de l’époque, plutôt bien disposée face aux pirates de l’air, mais avec des termes souvent condescendants. Plus tard, ils occuperont une place importante dans leur quartier parce qu’ils seront en position de faire le lien entre une partie de la population plus âgée et plus blanche et les jeunes souvent d’origine immigrée ; en tant qu’Afro-Américains, ils bénéficieront d’a priori favorables, d’une image « cool », différente des préjugés concernant des personnes d’origine antillaise ou d’Afrique sub-saharienne. On voit ici qu’il n’existe pas une voie unique de la racialisation.
Néanmoins, leur trajectoire s’inscrit bien dans une histoire française de la race et des phénomènes de racialisation, qui a été défrichée par de nombreux chercheurs et chercheuses : Silyane Larcher a travaillé sur l’exclusion de la citoyenneté des descendants d’esclaves aux Antilles, Philippe Dewitte sur les mouvements noirs des années 1920 et 1930, Emmanuelle Sibeud sur la citoyenneté dans l’espace colonial, Myriam Paris sur l’organisation du travail maternel par le pouvoir colonial à La Réunion. Pap Ndiaye, dans La Condition noire, avait également lancé des chantiers historiographiques dont beaucoup restent ouverts. Le regretté Tyler Stovall, historien afro-américain malheureusement décédé en 2021, avait été un des premiers à poser la nécessité d’une histoire française de la race. En ce qui me concerne, je travaille aujourd’hui sur le BUMIDOM, le Bureau des migrations d’outre-mer, qui a organisé la venue en France hexagonale de milliers d’Antillais et de Réunionnais dans les années 1960 et 1970.
Il ne s’agit donc pas d’importer les Black Studies depuis les États-Unis. Mais plutôt de voir comment les phénomènes de racialisation se sont déployés en France, dans un pays qui, contrairement aux États-Unis, n’a pas mis en place l’esclavage et la ségrégation raciale sur son territoire métropolitain, tout en étant partie prenante de la traite négrière puis de l’esclavage dans les territoires qui sont devenus des DOM, et à Saint-Domingue devenue Haïti ; pour compléter le tableau il faut dire aussi que la ligne de couleur et la ségrégation étaient une réalité dans les territoires colonisés.
Il y a autre chose dont il faut parler : sous l’Ancien régime, les colonies et la race faisaient partie de l’imaginaire national, sinon de la réalité, avec tous les captifs rachetés par la monarchie française, faits prisonniers en Méditerranée et pour beaucoup menacés /soupçonnés d’être des musulmans convertis/renégats. La littérature populaire et les premiers journaux grand public illustrés en parlaient beaucoup. Et ça occupait nombre de conversations quotidienne dans tous les milieux. Le beau travail de Gillian Weiss, dans Captifs et corsaires, a montré tout ça de façon convaincante.
N’oublions pas aussi l’histoire des grands ports de France, par où passaient tous les flux de voyageurs, d’exilés et de travailleurs qui ont fait la France historiquement, dont Marseille, en tant que « porte » de l’Empire colonial. Le rapport que nombre de Français, d’origine immigrée ou non, ont avec cette ville, est tributaire d’une longue histoire où race, classe et religion s’entremêlent. Il ne faut pas voir l’histoire de la France que du point de vue de Versailles ou de Paris. L’histoire française de la race se comprend donc en fonction de ces spécificités. Elle est marquée par une conception souvent davantage culturaliste du racisme qu’aux États-Unis.
Contretemps – L’un des apports importants de cette histoire est justement de s’enraciner finalement dans la banlieue jusqu’à Caen, soit une région périphérique vis-à-vis de l’expérience vécue à Alger, cette Mecque des révolutionnaires, et dans les prisons de la région parisienne. Tu affirmes en effet que les stigmates du ghetto et plus largement de la Color Line ont été des vecteurs d’intégration/insertion pour eux lorsqu’ils se sont établis à Caen. Peux-tu nous en dire plus sur ces vecteurs d’identifications en miroir ?
Sylvain Pattieu – Jean et Melvin ont grandi dans une société marquée par la ségrégation, ils sont nés en Caroline du Nord, un ancien État du Sud pendant la guerre de Sécession notamment. Dans leur pays natal, ils ont connu la violence à laquelle a été confronté, dans les années 1960, le mouvement des droits civiques, malgré les avancées et les victoires. Dans l’armée, Melvin a fait directement l’expérience du racisme. Ils ont voulu fuir ce contexte et se sont retrouvés dans un pays, la France, où leur statut d’Afro-Américain leur offrait une certaine bienveillance et même, concernant Melvin, du prestige dans l’exercice d’activités sportives comme le base-ball et le basket-ball, typiquement américaines.
Mais ils se sont bien rendus compte que leur situation était fort différente de celle que subissaient d’autres Noirs en France. Ils sont arrivés dans un quartier populaire au moment où ils commencent à être associés, au niveau national, à un « problème » des banlieues dans les années 1980. Il en découle des phénomènes d’altérisation et d’essentialisation des jeunes, voire des populations des banlieues, contre lesquelles ils ont lutté. Leur combat pour la justice sociale s’est nourri des expériences communautaires qu’ils avaient connues dans leur jeunesse, quand la jeunesse noire des villes américaines était fortement encadrée par le sport, les loisirs, la religion.
Contretemps -Ce qui est étonnant dans le parcours de Melvin est qu’il a œuvré par le sport pour aider les jeunes de quartiers populaires alors que lui-même avait éprouvé une certaine forme d’impasse dans la stratégie de contournement des barrières sociales et raciales par le sport lorsqu’il était footballeur à l’université américaine. Doit-on comprendre que les voies possibles d’émancipation des identités assignées et de contournement des discriminations restent inchangées ?
Sylvain Pattieu – Le sport a d’abord été un vecteur d’émancipation pour les populations noires aux États-Unis, comme le montre l’historien Nicolas Martin-Breteau. Il s’agissait de démontrer, contre les stéréotypes en vigueur à l’époque, les capacités des corps noirs et d’en faire une source de fierté, une preuve pratique de l’égalité. Ensuite, cette réussite sportive a donné lieu à de nouveaux stéréotypes. Dans les années 1980, la volonté de Melvin, dans son quartier, de passer par le sport pour entrer en lien avec les jeunes n’a pas forcément bonne presse à gauche, malgré toute l’histoire du sport ouvrier. Si Melvin s’était révolté contre ses entraîneurs à l’université dans les années 1960, c’est parce que cet encadrement lui semblait porté non par des valeurs d’émancipation mais par une volonté d’humiliation, de l’autoritarisme et du sexisme.
Il a essayé de porter un projet différent quand il est lui-même devenu éducateur sportif. Bien entendu, cette importance du sport ne fait pas disparaître le racisme. Claude McKay raconte, dans son autobiographie Un sacré bout de chemin, sa rencontre avec un boxeur noir à Londres, qui l’avait invité à un de ses combats. Le boxeur noir remporte le combat par KO, un spectateur blanc vient le féliciter mais quand il s’aperçoit que la petite amie du boxeur est une Anglaise blanche, il l’insulte au point que l’autre l’assomme d’un coup de poing. Puis le boxeur et ses amis vont au restaurant pour célébrer la victoire, mais la fête est gâchée : « Je crois qu’on ne veut pas des gens de couleur dans ce putain de pays de Blancs », dit le boxeur. McKay écrit : « Il baissa la tête sur la table et se mit à sangloter comme un enfant. C’était son KO à lui ».
Contretemps – Cette histoire débute dans les années militantes en 1970 et nous rappelle l’engagement de nombreuses personnalités dans les luttes anti-impérialiste, féministe et antiraciste, mais aussi que la médiatisation attire, puis éteint certaines affinités au-delà de la couverture publique du procès. Ce désengagement des soutiens forts au sein des institutions et personnalités publiques pour ces « 4 de Fleury » est-il seulement le signe de la fin d’une couverture médiatique ou est-ce l’amorce d’un tournant qui annonce le long effritement des organisations de gauche sur ces questions ?
Sylvain Pattieu – Quand on compare la solidarité autour des « 4 de Fleury » en 1978, lors du procès, avec la situation à leur sortie de prison, il y a une énorme différence en effet. Notamment quand on voit dans les archives que le gouvernement de l’époque craint les réactions de l’opinion s’il expulse les pirates. Il n’est pas encore question de dénonciation des « droits-de-l’hommistes » à l’époque et il y a même une députée de droite qui intervient pour les défendre. Aujourd’hui, le pouvoir politique cherche à mettre en scène son autorité plutôt que son humanité. Il y a indéniablement un recul, conséquence sans doute de l’essor de l’extrême droite qui pèse politiquement du fait de son poids idéologique et électoral. Mais le développement du terrorisme et les craintes qui lui sont afférentes a sans doute contribué aussi à des amalgames et des craintes qui touchent par ricochet tous les mouvements d’émancipation.
Contretemps -Dans ton livre est mentionné à plusieurs reprises l’excellent ouvrage de Joshua Bloom et Waldo E. Martin Black against Empire. The History and Politics of the Black Panther party (University of California Press, 2013). Primé au American Booked Award et réédité en 2016 aux États-Unis, ce livre n’est toujours pas traduit en français. Comment expliques-tu cela ? Et dans le même sens, pourrais-tu nous en dire plus sur la place actuelle de ces questions raciales et sociales, et plus largement l’écriture scientifique de l’histoire coloniale dans les universités françaises alors que des autrices scientifiques, comme Colette Guillaumin par exemple, ont pourtant balisé et établi des travaux fondateurs dans la sphère francophone ?
Sylvain Pattieu – Traduire des livres coûte cher, et comme bien d’autres secteurs l’édition d’ouvrages en sciences humaines souffre d’un nombre de ventes structurellement bas. Il y a toujours des craintes sur la rentabilité d’une telle entreprise de traduction. C’est bien dommage car de nombreux ouvrages restent inaccessibles en français. Le Black Panther Party est ainsi mal connu en France, soit perçu comme un mouvement terroriste, soit vu au contraire dans une vision romantique qui néglige la réflexion sur la violence ou sur le machisme. C’est pourtant un mouvement très riche qui gagnerait à être mieux connu en France aussi, d’autant que si son existence a été brève, son imaginaire est resté très important. Ce n’est pas un hasard si un film récent a été intitulé Black Panther. Il est vrai que lorsque j’interviens sur mon livre dans des lycées, il y a des jeunes qui connaissent uniquement le film et pas le mouvement.
Sur l’écriture de l’histoire coloniale, je ne suis pas spécialiste mais il me semble que depuis plusieurs années il y a un véritable renouvellement et des travaux très stimulants sur ces questions. Il y a certes parfois des réticences sur ces questions de race, mais il y a aussi une dimension générationnelle et beaucoup de jeunes chercheurs et chercheuses ont complètement intégré ces problématiques. Dans une tribune très intéressante dans le journal Le Monde, l’historienne Sylvie Thénault montrait, à propos de l’affirmation par le président Macron de la nécessité d’une commission d’historiens algériens et français pour travailler à la « réconciliation », comment ces questions sont à la fois méconnues et instrumentalisées par les responsables politiques.
Contretemps – Cela revient in fine à analyser depuis un espace transnational de la spécificité de la situation en France où les notions mêmes d’émancipation et d’universalisme, qui sont une terminologie héritée de la Révolution et des Lumières, semblent porter une certaine forme d’ambiguïté au sein des espaces scientifiques, médiatiques et politiques. À l’aune de ton ouvrage, pourrais-tu nous en dire plus sur le recul historique que nous pourrions prendre sur de tels enjeux contemporains ?
Sylvain Pattieu – Il y a un livre très intéressant de Mame-Fatou Niang et Julien Suaudeau sur ce terme d’universalisme, dans lequel ils démontrent que l’universalisme ne s’oppose pas à la nécessité de prendre en compte les discriminations héritées du passé et réactivées par des phénomènes du présent. On rejoint finalement les termes d’Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez en 1956, quand il a quitté le Parti communiste. J’aime aussi la réponse de Suzanne Césaire, née Roussi, à la censure par le régime de Vichy de la revue Tropiques, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été reproduite dans Le grand camouflage, livre dans lequel Daniel Maximin rassemble les écrits de cette femme étonnante :
« Monsieur,
Nous avons reçu votre réquisitoire contre Tropiques.
« Racistes, sectaires, révolutionnaires, ingrats et traîtres à la Patrie, empoisonneurs d’âmes », aucune de ces épithètes ne nous répugne essentiellement.
« Empoisonneurs d’âmes », comme Racine au dire des Messieurs de Port-Royal.
« Ingrats et traîtres à notre si bonne Patrie », comme Zola au dire de la presse réactionnaire.
« Révolutionnaires », comme l’Hugo des Châtiments.
« Sectaires », passionnément, comme Rimbaud et Lautréamont.
« Racistes », oui. Du racisme de Toussaint Louverture, de Claude Mac Kay et de Langston Hugues – contre celui de Drumont et d’Hitler.
Pour ce qui est du reste, n’attendez de nous ni plaidoyer, ni vaines récriminations, ni discussion même.
Nous ne parlons pas le même langage. »
Tout est dit ici, je trouve.
Contretemps – Dernière question, autour du sujet de la piraterie. Tu es l’auteur d’un roman sur la piraterie intitulé Et que celui qui a soif, vienne (Rouerge, 2016) et dans le présent essai historique tu mets bien en perspective cette montée en puissance de la piraterie de l’air comme acte politique. Ces deux ouvrages ont en commun de saisir un espace de représentation transnational plus complexe et politique à l’appui de cette figure du pirate. Engager tes deux formes d’écriture sur ces sujets historiques pourrait-il être lu comme une forme de réenchantement, de réengagement des imaginaires, liés à ces utopies et réseaux de solidarité alternatifs ? Ou doit-on sincèrement valider aux côtés de l’historien Philippe Artières, qui a signé une recension très critique, qu’il y a dans Panthères et Pirates une « forme d’héroïsation » de ce type de figure et mouvement de résistance ?
Sylvain Pattieu – Quand j’avais écrit mon roman de pirates, j’avais fait le choix d’envisager la piraterie à partir des travaux de l’historien Marcus Rediker, qui voit dans la piraterie un grain de sable dans la première mondialisation de cette époque. Pour lui, la piraterie est un espace qui permet des formes d’émancipation et de solidarité qui rompent avec les logiques autoritaires et marchandes de cette époque. D’autres historiens ont davantage mis l’accent sur la piraterie comme un phénomène de prédation beaucoup moins sympathique.
En tant que romancier, je connais ces enjeux du débat historique mais je choisis ce qui m’intéresse le plus, l’utopie, et j’écris un roman de pirates avec une écriture contemporaine, dans laquelle je m’autorise la fantaisie et le parti-pris. Je ne cherche pas à faire un roman historique, mais de partir de l’histoire pour l’éclater littérairement, pour déployer mon propre imaginaire à partir des faits, pour jouer avec la langue. Même s’ils portent, en français, le nom de pirates, et même si je les cite dans mon roman, Jean et Melvin McNair et leurs camarades sont en réalité bien loin de cette piraterie des temps modernes.
Leur acte était plutôt un acte désespéré, une fuite face à une situation inextricable. L’utopie en laquelle ils croyaient, celles de la section internationale du Black Panther Party à Alger, part vite en capilotade et la solidarité tant espérée leur vient des porteurs de valise et du réseau Curiel, juif communiste égyptien précurseur du tiers-mondisme. Je me demande s’il n’y a pas plus de sens à rapprocher leur action de celle des militants écologistes radicaux aujourd’hui : à l’époque, le racisme et l’impérialisme (avec la guerre au Vietnam) rendait la situation d’une extrême urgence.
Aujourd’hui le réchauffement climatique et le sentiment que le monde va basculer conduit à certaines formes d’action radicales, même si la limite de la comparaison est qu’il y a loin entre un jet de tomate sur une œuvre et un détournement d’avion. Mais l’inquiétude et le sentiment d’avoir épuisé les voies de contestation traditionnelle sont comparables.
Dans tous les cas, il ne s’agit pas du tout d’héroïser ces militants et militantes. Je crois que Philippe Artières, comme Beaud et Noiriel mais pour d’autres raisons, passe à côté du vrai débat auquel j’essaie de contribuer, après d’autres collègues, avec Panthères et pirates. Si je veux raconter des vies de héros, la littérature m’offre beaucoup plus de liberté. En tant qu’historien, je me borne à donner du sens aux archives en montrant des rapports de force, des violences et des drames, mais sans perdre de vue, c’est vrai, l’espoir qui fait vivre les gens. Cela n’a rien d’illusoire ou de naïf, il me semble, d’en parler aussi dans un livre d’histoire.
*
Entretien réalisé par Émilie Goudal.
Sylvain Pattieu est maitre de conférences à l’université Paris-8, écrivain et historien.