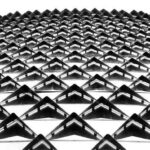Comment des hauts fonctionnaires de l’État ont « réinventé » un « problème » de l’immigration en France
Sylvain Laurens, Une politisation feutrée. Les hauts fonctionnaires et l’immigration en France, Belin, 2009.

La prise en charge politique de l’« immigration » est récurrente et s’est encore accentuée depuis que la droite – et en particulier Nicolas Sarkozy – en a fait un thème de mobilisation de son propre électorat et de « reconquête » des électeurs du Front National. La focalisation des discours et des mesures d’action publique sur les immigrés constitue presque une pierre angulaire de la politique gouvernementale menée par la droite depuis 2002. L’agitation des figures renvoyant à l’immigré – le « jeune de banlieue », le « musulman », la « femme voilée », le « clandestin » – est mobilisée pèle mêle pour opposer travailleurs nationaux et étrangers, pour stigmatiser une fraction des classes populaires en mettant en scène les « défauts » d’intégration d’une partie de la population et la « mise en péril » de la République et de l’identité nationale, ou encore pour imputer certains « maux » (délinquance, échec scolaire, incivilité…) de la société – du moins ceux identifiés comme tels par une partie des responsables politiques – aux enfants d’immigrés.
L’ouvrage du sociologue Sylvain Laurens est, dans ce contexte, particulièrement important car il propose un double éclairage sur la politique d’immigration en France. Il invite d’abord à prendre de la profondeur historique en revenant sur une conjoncture particulière, celle des années 1960 et 1970, au long de laquelle l’immigration a été constituée en « problème public et politique ». Il participe ainsi à « déconstruire » ce qui semble « évident » : l’immigration n’a pas toujours été considérée comme un « problème » et sa mise sur le devant de la scène publique doit à certaines conditions historiques. Il place ensuite la focale non sur les responsables politiques, les plus visibles médiatiquement et pour lesquels on peut dire aisément que l’immigration constitue « un fond de commerce politique », mais sur des acteurs de l’ombre, les hauts fonctionnaires, qui, au jour le jour, dans leurs pratiques, opérationnalisent l’action de l’État sur ceux qu’ils désignent « les immigrés ». Il montre ainsi que bien avant la crise économique du milieu des années 1970 et avant toute instrumentalisation politique du thème de l’immigration par la droite giscardienne, c’est une fraction de la « noblesse d’État » qui participe à construire le « problème de l’immigration » et à persuader les acteurs politiques d’une nécessaire réduction des flux migratoires. En cela, cet ouvrage développe une réflexion nécessaire sur le rôle d’« un groupe social », à la charnière entre politique et administration, dans la définition des problèmes pris en charge par l’État. Cette approche implique de penser l’autonomie (relative) du pouvoir d’État et les intérêts propres à ce « groupe social », vis-à-vis des responsables politiques mais aussi vis-à-vis d’autres fractions des classes dominantes, au premier rang desquelles le patronat.
Le tournant des années 1970 et l’adoption d’une politique d’immigration restrictive
Les années 1960-1970 marquent un moment décisif concernant la politique d’immigration en France. Alors qu’après la Libération et jusque dans les années 1960, l’immigration reste une question politique subalterne et peu mobilisée par le personnel politique de droite et de gauche, elle va s’imposer comme enjeu public et partisan dans les années 1970. La création, lors de l’arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d’Estaing en 1974, d’un secrétariat d’État aux Travailleurs immigrés en est un des symboles. Si l’immigration a été un enjeu crucial au long des années 19301, son traitement est resté, après 1945 et jusqu’au début des années 1960, cantonnée à un travail administratif confiné aux préfectures2. La faiblesse des changements législatifs affectant cette politique sont un signe de sa marginalité. La re-politisation de la question migratoire dans les années 1960-1970 va de pair avec une transformation du lexique mobilisé pour la penser et la définir : « les immigrés » remplacent les « travailleurs étrangers », « l’intégration » se substitue à « l’assimilation », la question du racisme et le discours antiraciste sont récupérés par la droite. Surtout, l’impératif d’une « maîtrise des flux migratoires » s’impose au cours des années 1970 et avec elle les mesures de durcissement des conditions d’entrée et de séjour des étrangers. La circulaire Marcellin-Fontanet de 1972 interdisant la régularisation des travailleurs entrés en France sans contrat de travail, la décision du Conseil des ministres du 3 juillet 1974 de suspendre l’immigration ou encore les lois Stoléru-Bonnet (1977-1980) favorisant le « retour » et l’expulsion dans leur pays d’origine des immigrés traduisent cette conversion des sommets de l’État puis des responsables politiques à une politique restrictive concernant les droits des étrangers.
Ces transformations dans la prise en charge de l’immigration font couramment l’objet d’explications admises comme « naturelles » : la crise économique du début des années 1970 (choc pétrolier de 1973) aurait, dans un premier temps, incité les pouvoirs publics à restreindre puis « arrêter » l’immigration. Dans un second temps, la venue des « familles » d’immigrés bloqués en France aurait rendu trop « visible » ces « immigrés » et ouvert la voie, à partir des années 1980, à l’instrumentalisation de l’immigration par le Front National3, incitant alors les autres partis politiques à prendre en charge cette question. La politisation de l’immigration serait donc le résultat mécanique d’une part, de la crise économique, d’autre part de la montée d’un « racisme populaire » traduite politiquement par celle de l’extrême droite.
L’intérêt de l’enquête de Sylvain Laurens, qui porte sur la période 1962-1981, est de remettre en cause cet « enchaînement logique » et de montrer ce que ce processus doit à des transformations internes à l’État.
Continuité « postcoloniale» dans le traitement des immigrés ou conversion de la « noblesse d’État » au contrôle des flux migratoires ?
Le traitement de l’immigration se reconfigure au début des années 1960 lorsque prend fin la guerre d’Algérie et plus globalement le processus de décolonisation. Une partie importante des migrations qui était traitée sous l’angle de déplacements « internes » entre la métropole et les colonies est requalifiée comme des processus migratoires entre États, principalement entre la France et l’Algérie. En effet, les Français Musulmans d’Algérie (FMA) deviennent après 1962 des « étrangers » algériens. La prise en charge des Algériens qui restent et travaillent en France peut dans certaines conditions être pensée comme marquant une continuité des pratiques « coloniales » de l’État français après la décolonisation (post-colonialisme). Au niveau des administrations de « terrain », les responsables des foyers Sonacotra4 ou encore les cadres de certains services de la préfecture de police de Paris sont peuplés en majorité d’anciens officiers ou sous-officiers ayant exercés en Algérie et/ ou en Indochine. Pour autant, les approches plaidant pour une continuité totale « postcoloniale »5 ne rendent pas compte des transformations propres aux administrations d’État et plus précisément à la haute fonction publique. Si l’on retrouve bien des anciens « commis de l’État » ayant exercés dans les colonies (10% des hauts fonctionnaires intervenant sur les questions d’immigration) [p. 89], force est de constater que pour conserver leur « influence » issue de la période « algérienne » et pour conquérir des positions au sein des ministères, ils se présentent moins comme « des gardiens de l’histoire coloniale » que comme des spécialistes des questions d’immigration [p. 97]. Ainsi, Sylvain Laurens montre que la défense de leur propre intérêt dans l’administration passe ici par la mise en avant d’un discours global sur la nécessité d’encadrer et de contrôler « l’immigration » quelle que soit son origine géographique.
Par ailleurs, là où ces migrations « internes » relevaient d’opérations de police (ministère de l’Intérieur) ou de la gestion de main d’œuvre (ministère du Travail), elles sont, après 1962, prises dans des enjeux diplomatiques (ministère des Affaires Étrangères) et économiques – balance commerciale, protection du marché du travail national – (ministère des Finances). Désormais, les conditions de migration des Algériens, par exemple, voient intervenir, dans le cadre des rapports entre l’État français et algérien, les hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay. L’immigration devient donc une variable dans le jeu des négociations interétatiques où ces hauts fonctionnaires cherchent à défendre les « intérêts français » à l’étranger. De même, la politique d’immigration se trouve modelée dès les années 1960 par la conversion à la doxa libérale des énarques du ministère des Finances : « arrimée à une réflexion sur la stabilité monétaire et le maintien des équilibres économiques », les hauts fonctionnaires de ce ministère défendent une politique budgétaire restrictive en matière d’immigration et un contrôle sur l’introduction de travailleurs non qualifiés sur le marché du travail, ceci bien avant que la crise économique soit déclarée en 1973 [p. 132].
Ce champ d’action étatique est donc marqué par une augmentation croissante des acteurs administratifs qui y interviennent et avec elle d’une concurrence accrue au sommet de l’État pour s’en assurer le contrôle. Contre une vision homogène de l’État, Sylvain Laurens montre en effet comment la politique d’immigration va être constituée en enjeu de luttes entre des administrations dont les logiques d’intervention sont différentes voire opposées sur les questions migratoires.
« Faire » de l’immigration un « problème public »
La reconfiguration des acteurs administratifs autour de l’immigration se traduit par un « ennoblissement » de cette politique publique. Désormais, ce sont des énarques (conseillers d’État, inspecteurs des finances, membres de cabinets ministériels…) et non plus les anciens « rédacteurs » faiblement dotés en capitaux scolaires et sociaux qui s’intéressent et sont intéressés à ce domaine d’action publique. Ce changement dans le statut des acteurs administratifs n’est pas anodin, il implique une revalorisation du statut et du poids de la politique d’immigration et favorise, par les ressources que ces nouvelles élites peuvent mobiliser, sa re-politisation. Pour ces hauts fonctionnaires, la politisation de l’immigration constitue en effet un moyen d’augmenter leur propre pouvoir – accroissement des budgets qu’ils contrôlent, élargissement de leur champ de compétences et de leur autonomie d’action, promotions et avancements de carrière. Sylvain Laurens montre de manière très précise comment les hauts fonctionnaires de la Direction de la Population et des Migrations (DPM), créée en 1966 au ministère du Travail, et ceux du ministère de l’Intérieur vont littéralement « recréer » un « problème » autour de l’immigration et « alerter » le pouvoir politique.
Si, jusqu’au début des années 1960, le ministère du Travail s’était montré favorable à l’entrée de travailleurs immigrés, encourageant le maintien d’un réservoir de main-d’œuvre spécialement dans les secteurs peu qualifiés, l’arrivée de ces jeunes énarques transforme les discours et pratiques sur ce sujet : l’immigration est désormais présentée comme un « problème » qu’il faut traiter. Ce travail de formulation et de construction d’un « problème public » repose sur la mise en cohérence de registres argumentatifs hétérogènes : l’immigration serait un frein à la modernisation de l’économie en favorisant le maintien d’un travail peu qualifié, elle ne serait plus « assimilable » à la population « française » – cet argument réactualisant les discours des années 1930 – ceci se traduisant par la montée d’un « racisme populaire » envers les immigrés. La minutie du travail d’archives permet de rentrer dans les coulisses de la fabrique d’un discours réclamant dès la fin des années 1960 – donc bien avant la crise économique – un contrôle sur les flux migratoires. Le supposé « racisme des Français » est ainsi largement « produit » par ces hauts fonctionnaires. La mise en scène de l’impossible assimilation des « immigrés » passe par la médiatisation et la montée en épingle simultanée des « crimes racistes » envers les Algériens et des « crimes algériens » envers les Français. De même, ces hauts fonctionnaires commandent et sélectionnent parmi les sondages d’opinion ceux qui « attestent » du racisme des français, justifiant ainsi une restriction de l’immigration au nom du supposé antagonisme entre travailleurs français et immigrés et du nécessaire maintien de l’ordre public. Enfin, suite aux tentatives de certains groupes d’extrême gauche pour organiser les travailleurs immigrés au début des années 1970, la « menace gauchiste » est « agitée » par les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur auprès du pouvoir politique comme moyen de défendre une action volontariste et non laxiste envers les immigrés.
« La fermeture des frontières » comme aboutissement du travail de persuasion des hauts fonctionnaires
Ce travail quasi « militant » de la part de ces « fonctionnaires-gouvernants » aboutit non seulement aux premières mesures restrictives (circulaire Marcellin-Fontanet en 1972) mais plus largement à la mobilisation du personnel politique autour de ces questions. Dans ce contexte, la décision, très médiatisée, du gouvernement de fermer les frontières, en 1974, est moins une réaction à la crise économique que l’aboutissement de ce travail de formulation d’un « problème » de l’immigration par ces hauts fonctionnaires. Les notes qu’ils rédigent pour le conseil des ministres du 3 juillet 1974 indiquent clairement que la conjoncture économique n’est pas ou peu présente comme registre de légitimation. En revanche, l’« anarchie » provoquée par les « déséquilibres démographiques entre la France et les pays du Tiers-Monde » ou encore le risque d’un « nouveau mai 68 » sont avancés. Ce n’est qu’ex-post et comme registre « public » de justification que l’argument de la « protection des emplois nationaux » est mobilisé. La déconnexion de cette décision et de la conjoncture économique est par ailleurs attestée par l’opposition patronale à cette politique. En effet, la proclamation de la fermeture des frontières s’opèrent contre l’avis de la majorité du CNPF. Les patrons des secteurs comme le bâtiment ou l’automobile qui recourent massivement à une main-d’œuvre étrangère peu qualifiée et qui ne sont pas en crise en 1974, sont opposés à ce choix gouvernemental. Pour légitimer les mesures proposées, ces hauts fonctionnaires s’appuient alors sur des fractions minoritaires du patronat, puisant notamment parmi les anciens réseaux de résistants.
A partir de 1974, la promotion d’une politique d’immigration restrictive n’est plus le seul fait des hauts fonctionnaires mais est intégrée à l’offre politique de la droite. Ainsi, Paul Dijoud, jeune secrétaire d’État aux travailleurs immigrés, et Valéry Giscard d’Estaing s’appuient sur le stock argumentatif produit par ces hauts fonctionnaires pour mettre au centre du débat public l’immigration. Dans un contexte politique marqué par la montée en puissance de la gauche, la « droite de gouvernement tente de réactiver les lignes de partage entre travailleurs nationaux et étrangers et essaie de séduire les électeurs en politisant leur identité nationale » [p. 252]. Cette stratégie s’articule, d’une part, autour d’un durcissement continu des conditions de séjour des immigrés et par une politique d’incitation (financière) au « retour » des étrangers dans leur pays d’origine et, d’autre part, sur la revalorisation du travail manuel et la tentative de relocaliser la main d’œuvre française sur les métiers peu qualifiés. Ce choix politique est incarné par la création d’un secrétariat d’État aux travailleurs manuels et aux travailleurs immigrés, confié à Lionel Stoléru en 1977. Cette politisation de l’immigration s’accentue encore suite à l’étroite victoire de la droite aux législatives de 1978 et prend forme à travers le projet, promu par Valéry Giscard d’Estaing et Stoléru, d’un « retour forcé » de 400 000 travailleurs étrangers dans leur pays d’origine. Sylvain Laurens montre alors dans quelle mesure les mêmes hauts fonctionnaires qui avaient participé à promouvoir des politiques de maîtrise des flux migratoires vont résister – « traîner des pieds », alléguer des irrégularités juridiques – voire s’opposer publiquement à ce projet, en mettant en avant son « coût » dans la préservation des « intérêts français » à l’étranger – notamment des intérêts économiques et diplomatiques avec l’Algérie. L’opposition « feutrée » de ces hauts fonctionnaires aux injonctions du pouvoir politique et la mise en échec des projets de « retour forcé » illustrent leur capacité à se présenter comme « gardiens de l’intérêt national », « la raison d’État ne recoupant pas toujours les intérêts électoraux portés par les responsables politiques » [p. 300].
***
L’intérêt de ce travail sociohistorique réside d’abord dans la déconstruction des « mythes » justifiant l’adoption et le maintien d’une politique restrictive en matière d’immigration. Loin d’être le sous-produit de la conjoncture économique ou de la « xénophobie » des classes populaires, la logique de contrôle des flux migratoires est initialement le résultat d’un travail de mise en forme et de formulation d’un « problème public » par une « avant-garde » administrative dont le destin social étaient liés à la revalorisation d’un domaine d’action marginalisé après 1945. Il invite à envisager l’État non comme un simple réceptacle des intérêts des responsables politiques ou des intérêts patronaux mais comme le lieu d’expression d’intérêts propres à une fraction des classes dominantes que constituent les hauts fonctionnaires. Les luttes et pratiques qui animent ce champ du pouvoir entretiennent alors « une domination à distance » sur des populations auxquelles on a assigné l’identité d’immigré.
Notes
1 Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme, racisme (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007.
2 Alexis Spire, Étrangers à la carte. L’administration de l’immigration en France (1945-1975), Paris, Grasset, 2005.
3 La première percée électorale du FN a lieu aux élections municipales de 1983, dans la ville de Dreux.
4 Choukri Hmed, « « Tenir ses hommes ». La gestion des étrangers isolés hors travail après la guerre d’Algérie », Politix, n°76.
5 Pour une présentation critique des « études postcoloniales », voir Jean-François Bayart, Les études postcoloniales : un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010.