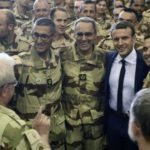Hayek, fédéralisme inter-étatique et libéralisme économique
Pour le lecteur contemporain, habitué aux défenses libérales de la construction européenne, le texte de Friedrich Hayek traduit ici pourra sonner étrangement familier. Pourtant, à sa publication il y a 80 ans, cette concordance n’était en rien acquise. À travers ce texte, présenté par Hadrien Clouet et Hugo Canihac, c’est ainsi une certaine vision libérale de la « construction européenne » qui se laisse apercevoir.
Docteur en sociologie, Hadrien Clouet est est actuellement chercheur postdoctorant au Centre de sociologie des organisations (CSO), à Paris. Hugo Canihac est quant à lui docteur en science politique et actuellement chercheur postdoctorant à l’université Saint-Louis à Bruxelles.
***
Intégrer pour pacifier… et libéraliser
La thèse du texte est simple : une intégration politique poussée entre plusieurs États ne peut se réaliser que sur la base d’un système économique libéral ; inversement, le libéralisme économique conduit logiquement à la défense d’une intégration politique et juridique entre États. Fédéralisme (international) et système économique libéral s’impliquent nécessairement.
F. Hayek recherche avant tout la pacification de l’ordre international. Mais une série de raisonnements logiques l’amènent à en déduire la nécessité d’un fédéralisme libéral. D’abord, il observe que les unions politiques entre États ont toujours été accompagnées d’une union économique. Et ce régime économique commun ne pourrait que limiter fortement toute intervention publique dans les marchés. La raison principale en est la « cohérence » : sans unification économique (abolition des barrières douanières, élimination de tous les obstacles à la libre circulation), des rivalités se maintiendront au sein de l’Union, qui la mèneront à l’échec. L’union politique interétatique passe par l’abandon des moyens d’action économiques nationaux.
Mais, d’un autre côté, il ne s’agit pas pour F. Hayek de défendre le transfert à un niveau supranational des pouvoirs économiques des États nationaux. Au contraire, il cherche à montrer qu’une fédération d’États implique nécessairement une réduction drastique des interventions de l’État. Son argument est d’abord économique : dans une fédération de dimension suffisante, les mesures économiques de protection n’auront pas d’utilité. Mais il est surtout sociologique, puisque contrairement aux États nationaux construits sur une « homogénéité plus forte, [d]es idéaux et convictions communs, ainsi que toute la tradition populaire », une fédération n’aura pas la légitimité nécessaire pour faire accepter des mesures de « direction » de l’économie. Aucun niveau politique ne pourra conduire de politique économique active, sauf, peut-être, au niveau local, dans les limites imposées par le « cadre rationnel » fixé au niveau fédéral. Anticipant sur la célèbre distinction entre intégration négative et intégration positive, F. Hayek affirme que le pouvoir fédéral pourra « empêcher » certaines politiques ; il ne pourra guère agir pour en promouvoir d’autres. La mise en place d’une liberté de circulation des personnes, des capitaux et des marchandises joue alors le rôle de verrou : elle rend vaine toute tentative de régulation nationale, puisque les personnes ou les flux soumis à des contrôles ou à des taxes fuiront immédiatement, par-delà les anciennes frontières. Ainsi, la recherche de la paix internationale via l’hypothèse fédéraliste en Europe est vue comme un rempart contre le socialisme, qui déclencherait une libéralisation imparable des économies par leur intégration.
Il ne faut toutefois pas le lire d’une manière téléologique. L’ambition de Hayek ne s’est pas réalisée au terme d’un travail constant d’élites acquises à son cadrage théorique. L’Union européenne ne résulte pas d’un projet initialement exclusivement libéral, mais d’un compromis entre différents courants – même si les ambitions keynésiennes ou planificatrices à l’échelle continentale sont écartées dès le Traité de Rome (Denord, Schwartz, 2010).
Un texte historiquement situé
Si cette argumentation a connu un franc succès jusqu’aux débats les plus récents sur la construction européenne, c’est au prix d’un travail d’arrachement du texte à son contexte initial. En effet, il s’agit d’abord un texte de circonstance.
L’entre-deux-guerres est une période de crise profonde du libéralisme économique, discrédité par la crise économique de 1929 et ses conséquences. Les États, appuyés par beaucoup d’économistes, mettent en œuvre des politiques qui, aux yeux de F. Hayek et de son maître L. von Mises, tendent inéluctablement au « socialisme ». De plus, à sa publication, les perspectives d’une union d’Etats pacifique ne semblent jamais avoir été aussi sombres : l’article paraît en septembre 1939, au moment même où l’Allemagne hitlérienne envahit la Pologne et où débute la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, la publication d’un plaidoyer pour une union libérale d’États semble curieusement inadéquate.
Avec ce texte, F. Hayek poursuit pourtant l’objectif de répondre en même temps à la crise du libéralisme et aux problèmes posés par le déclenchement de la guerre. Alors âgé de 40 ans, il a quitté Vienne en 1931 pour enseigner l’économie à la London School of Economics, l’un des bastions du libéralisme en Grande-Bretagne. Il y bénéficie d’une notoriété honorable chez les économistes, mais sans comparaison avec celle que la publication de La Route de la servitude lui assurera à partir de 1944. Il est déjà engagé en faveur d’un renouveau du libéralisme économique que le colloque W. Lippmann, auquel il participe à Paris en 1938, hésite à baptiser « néo-libéralisme ». C’est dans la droite ligne de ces efforts pour reconstituer un libéralisme économique international que s’inscrit ce texte.
Mais c’est aussi une argumentation adressée aux pacifistes internationalistes très actifs durant l’entre-deux-guerres. Les liens de F. Hayek avec ces mouvements ne sont pas nouveaux : il a consacré un ouvrage aux problèmes internationaux en 1937, une critique des thèses keynésiennes (Monetary nationalism and international stability) publiée sous les auspices de l’Institut des Hautes Études Internationales de Genève, lieu charnière du pacifisme et du libéralisme de l’époque (où enseigne à partir de 1937 W. Röpke). De même, le texte est traduit ici est publié dans le New Commonwealth Quarterly, une publication britannique lancée en 1935 en vue de promouvoir la création d’un bras armé de la Société des Nations (Le Dréau, 2008). Son fondateur, Lord David Davies, est notamment l’auteur d’un projet d’union franco-britannique qui précède de peu le plus célèbre projet de Jean Monnet en 1940. Le président de sa section britannique est, depuis 1936, W. Churchill, tandis qu’en France par exemple, le mouvement trouve des relais chez les juristes pacifistes (G. Scelle).
C’est ce second groupe, autant que les économistes libéraux, que le texte cherche à atteindre. F. Hayek participe également, à cette période, aux activités de la Federal Union, autre groupement pacifiste qui rassemble (notamment) des économistes libéraux (Louis Rougier, Jacques Rueff, Louis Baudin en France, Lionel Robbins mais aussi William Beveridge en Grande-Bretagne). Ce groupe est particulièrement lié au journaliste américain Clarence Streit (1896-1986). Correspondant à Genève et à Vienne dans l’entre-deux-guerres, celui-ci publie en 1939 un ouvrage, Union Now, développant l’idée d’une union des démocraties occidentales des deux côtés de l’Atlantique nord. C’est très largement dans la voie ouverte par cet ouvrage que l’article de F. Hayek – qui avait visité les États-Unis dans les années 1920 – s’inscrit. Il ne s’agit pas de discuter un projet d’union européenne qui paraît fort compromis : il s’agit de proposer un projet d’union des États occidentaux « libres » face aux 3 régimes qui se mettent en place au sud et à l’est de l’Europe. Le centre de gravité de l’union ne serait pas l’Europe affaiblie, mais bien plus les États-Unis abrités et prospères.
En publiant son texte, F. Hayek espère donc montrer non seulement la compatibilité, mais surtout la nécessité d’une union politique des démocraties occidentales sur la base du libéralisme économique. Défense de l’union politique transatlantique et défense du libre marché ne sont qu’une seule et même tâche : c’est le message qu’il adresse non seulement aux économistes libéraux, mais aussi aux pacifistes fédéralistes.
De la fédération transatlantique à l’Europe : les deux vies du texte après 1945
Ce n’est qu’après 1945 que l’argumentation développée par F. Hayek est réellement appliquée à la construction européenne. Déplacement paradoxal, car F. Hayek écrira très peu sur les problèmes européens proprement dits (Morgan, 2003 ; Gillingham, 2003 : 10). Mais le texte est republié en 1948, d’abord en anglais à Chicago, comme le dernier chapitre du recueil d’essais Individualism and Economic Order. Il est rapidement traduit en allemand (1952) par la maison d’édition Eugen Rentsch, basée à Zurich et qui avait déjà acquis les droits de La crise du collectivisme de W. Röpke l’année précédente. Le livre s’adresse à un public de spécialistes, et marque une tentative de retour de F. Hayek vers un public plus restreint que celui de La route de la servitude, dont le succès avait quelque peu surpris son auteur. Pour autant, il bénéficie de l’immense célébrité acquise depuis 1944. L’activité intense de F. Hayek pour promouvoir le néo-libéralisme au sortir de la guerre, notamment à travers la fondation de la Société du Mont Pèlerin en 1947, en compagnie de W. Röpke et d’autres libéraux, assure par ailleurs une diffusion importante de ses thèses auprès des économistes libéraux.
Les problèmes d’unification européenne sont en effet vivement discutés par les économistes libéraux de cette période. Ils font partie des premiers thèmes débattus dans l’enceinte très fermée de la Société suisse. Les mouvements en faveur d’une construction européenne sur des bases libérales se multiplient, à l’image de la Ligue Européenne de Coopération Economique (LECE) fondée en 1946 et membre fondateur du Mouvement Européen, ou du Comité pour le Progrès Economique et Social (CEPES) créé en février 1952 à Paris. Quant à eux, les économistes proches de l’école autrichienne émigrés multiplient les publications sur ce qui deviendra bientôt le domaine des théories de « l’intégration économique » internationale (voir Machlup, 1977). C’est par exemple le cas de Gottfried Haberler (1900-1995), membre comme F. Hayek du séminaire viennois de L. von Mises, lui aussi émigré aux États-Unis où il poursuit une carrière qui l’amène à prendre la présidence de l’International Economic Association nouvellement fondée en 1950. Il publie en juillet 1949 un article intitulé « Economic aspects of a European Union » dans lequel, sans le citer, il défend des thèses très voisines de celles de F. Hayek[1]. S’appuyant sur les succès personnels de F. Hayek et de l’intérêt renouvelé pour la construction de l’Europe, la thèse exprimée en 1939 peut ainsi circuler plus largement chez les libéraux qui s’intéressent à ces questions.
Toutefois, lorsque les premières réalisations concrètes de la construction européenne voient le jour dans les années 1950, les économistes proches de F. Hayek développent deux interprétations antagonistes des Communautés. Pour certains, malgré des imperfections certaines, elles promettent de réaliser le programme néo-libéral. C’est particulièrement le cas des Français proches de la Société du Mont Pèlerin, J. Rueff ou M. Allais en tête. Ils se montrent enthousiastes à l’égard de l’Europe communautaire dans laquelle J. Rueff voit par exemple « l’aboutissement et le couronnement de l’effort de rénovation de la pensée libérale » (Rueff, 1958 : 8). Les thèses de F. Hayek circulent aussi bien au-delà du cercle des membres de la Société du Mont Pèlerin : autour de J. Monnet par exemple, R. Marjolin (qui assiste au colloque W. Lippmann mais se revendique keynésien) est un lecteur de l’économiste autrichien depuis ses études d’économie dans les années 1930, tandis que l’un de ses protégés, le jeune Raymond Barre, avait traduit un de ses ouvrages en 1952.
Pour d’autres, notamment chez les économistes allemands, l’interprétation est toute différente. La réception en RFA des idées de F. Hayek est pourtant forte, car malgré son départ pour Chicago en 1950, il maintient des liens étroits avec ses collègues allemands qui s’inscrivent dans le courant ordolibéral organisé autour de W. Eucken (1891-1950). Son retour en Europe se fera d’ailleurs à l’université qui est l’épicentre de l’ordolibéralisme, Freiburg, en 1962. Enfin, les liens de son université de Chicago avec certaines universités allemandes sont étroits. En témoigne une série de colloques sur le droit de la concurrence, dont le premier est organisé en 1958 à Chicago et le suivant en 1960 à l’université de Francfort am Main – université de F. Böhm, autre « père fondateur » de l’ordolibéralisme, mais aussi du fédéraliste W. Hallstein, qui préside la CEE, et d’une partie importante de l’équipe de juristes qu’il réunit autour de lui. Si F. Hayek ne participe pas au colloque de Francfort, celui-ci souligne bien les liens transatlantiques qui s’étaient établis, y compris avec les représentants des institutions européennes (outre W. Hallstein, le Commissaire européen à la concurrence, Hans von der Groeben, assiste également au colloque).
Mais parmi les plus proches soutiens de F. Hayek outre-Rhin, les mêmes arguments sont aussi utilisés pour critiquer la construction de l’Europe communautaire. Le cas le plus net est celui de W. Röpke : lui aussi avait, durant la guerre, entamé une réflexion sur les moyens de rendre à l’économie internationale son libéralisme d’antan. Lui aussi plaidait, théoriquement, pour une union des Etats basée sur un libéralisme économique purifié des interventions de l’État, et organisée de façon fédérale (Röpke, 1959 : 48). Contrairement à ses collègues français, il invite cependant dans un style sans nuances à la plus grande méfiance à l’égard des Communautés européennes : elles représentent selon lui une erreur méthodologique, et annoncent une possible victoire du « socialisme » dans l’ensemble des pays européens. L’appel au fédéralisme comme appui du libéralisme économique est alors remplacé par l’impératif de commencer la libéralisation à l’échelle nationale. Après quoi seulement, la véritable solution aux problèmes de l’Europe pourra être mise en œuvre : elle ne réside pas dans la « petite » Europe communautaire, mais dans la zone de libre-échange que promeut activement un autre proche de l’ordolibéralisme, le ministre fédéral de l’Économie Ludwig Erhard.
Aux lendemains de la guerre, l’argumentation de F. Hayek circule donc largement dans les milieux libéraux, d’une part, et européistes, d’autre part. Elle est toutefois utilisée dans deux directions différentes : pour défendre une construction communautaire s’orientant vers une fédération libérale ; pour critiquer l’Europe communautaire au nom d’un projet libéral alternatif. Dans les deux cas triomphe cependant l’idée qu’une construction de l’Europe viable ne pourra s’élaborer que sur la base d’une « intégration négative » seulement.
Après les vifs débats des années 1950, le texte, à l’instar de son auteur, connaît une éclipse. Une simple comparaison des références qui y sont faites dans les publications savantes suffit à indiquer que ce n’est qu’au début des années 1980, puis surtout après 1992 et le Traité de Maastricht, que le texte refait surface. L’attribution à F. Hayek du prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel en 1974 marque le renouveau de l’intérêt pour son œuvre. En 1972, 1976 puis 1980, Individualism and Economic Order est réédité. Cette consécration théorique est appuyée par l’arrivée au pouvoir de gouvernements qui se réclament du néolibéralisme – à commencer, dans les Communautés européennes, par Margaret Thatcher (1979). Enfin, la perspective de l’Union économique et monétaire européenne suscite un regain d’intérêt pour les justifications d’une union fédérale appuyée sur un libéralisme économique strict.
Ce texte a deux usages dans le champ intellectuel et académique. D’abord, une utilisation descriptive, qui l’utilise pour analyser les avantages et inconvénients des régimes fédéraux, et les confronter à des données empiriques. Ensuite, un usage critique. Il pointe les dimensions idéologiques d’une forme organisationnelle comme le fédéralisme. Les évolutions contemporaines de l’intégration européenne sont ainsi reliées aux perspectives de Hayek, afin d’identifier l’Union avec son projet idéologique. Il est par exemple au cœur du dernier ouvrage de Wolfgang Streeck (2014), qui le décrit comme genèse d’une Europe « machine à libéraliser ».
Plusieurs dimensions prévues en 1939 par F. Hayek sont devenues réalité. L’intégration économique croissante, avec l’extension des pouvoirs de la Commission européenne, la mise en place d’une Cour de justice auto-instituée supérieure aux droits nationaux qui subordonne la protection des salariés à la libre prestation de services (Laulom, Lefresne, 2009), le passage à une monnaie unique pour la quasi-totalité des États membres, l’abolition des douanes et du contrôle des personnes, des biens et des marchandises au sein d’un marché commun ont accompagné des politique progressivement de plus en plus libérales. Celles-ci sont ou bien prônées par les autorités européennes, ou justifiées au niveau national par la concurrence interne à l’Union européenne.
Deux logiques sont principalement à l’œuvre, qui font écho au texte ci-après. D’une part, la coordination marchande dans l’espace européen concourt au libéralisme économique. La mise sur les marchés financiers des dettes publiques, les asymétries commerciales du marché unique ou l’impossible ajustement par les prix dans le cadre de l’euro empêchent certaines interventions publiques, et mettent les États sous pression des salaires des autres États membres ou des jugements portés par des acteurs privés, comme les agences de notation de dettes. D’autre part, les institutions européennes produisent des discours normatifs, d’inspiration libérale. Les directives européennes (sous initiative exclusive de la Commission), la méthode de benchmarking[2], la mise en conformité des politiques nationales par le semestre européen, l’extension du champ des sanctions envisageables ou les conditions d’accès au crédit en cas de crise de la valorisation marchande des dettes souveraines promeuvent des réponses libérales : dérégulation des salaires et des prix, flexibilisation des marchés, plans d’austérité, transfert d’industries ou de services publics au secteur privé. Le fédéralisme européen a bien suivi la voie tracée par Hayek, avec l’autonomisation de la sphère économique par rapport au politique. Il l’a même dépassé, en construisant des institutions gardiennes d’une orthodoxie libérale, plutôt que de se fier aux seuls ajustements marchands.
Hadrien Clouet, Hugo Canihac
***
Les conditions économiques d’un fédéralisme interétatique
1
La levée des entraves à la circulation des hommes, des biens et des capitaux est considérée à juste titre comme l’un des plus grands avantages d’une fédération interétatique. Elle rend possible la création de règles juridiques communes, d’un système monétaire unifié, et d’un contrôle commun des communications. Les bénéfices matériels qui résulteraient d’un espace économique aussi vaste ne peuvent être trop soulignés. Il est évidemment tenu pour acquis qu’une union économique et une union politique iraient de pair. Toutefois, nous défendrons ici qu’une union économique jugule la réalisation de certaines ambitions largement répandues. Nous devons donc montrer en premier lieu en quoi l’abolition des frontières économiques entre membres de la fédération n’est pas seulement un concomitant bienvenu, mais également une condition nécessaire de l’objectif central de la fédération.
Incontestablement, l’objet principal d’une fédération est de garantir la paix : prévenir la guerre en éliminant les causes de frictions entre parties, fournir un mécanisme efficace de règlement des disputes qui peuvent surgir, et empêcher la guerre entre la fédération et un État tiers en faisant de la première une entité si forte qu’elle élimine tout danger d’attaque extérieure. Si ce but pouvait être atteint par une simple union politique, hors sphère économique, beaucoup s’arrêteraient, satisfaits, avec la création d’un gouvernement commun en défense et en politique étrangère. Une unification de plus grande portée, de son côté, pourrait entraver d’autres idéaux.
Cependant, il y a de très bonnes raisons pour que tous les projets de fédération incluent une union économique, et même la tiennent pour objectif principal. Il y a également de très bonnes raisons à l’absence de précédent historique d’une politique étrangère et d’une défense communes entre différents pays, sans régime économique commun[3]. Même si des pays concluent des unions commerciales sans investir dans une politique étrangère ni une défense communes, la décision de plusieurs pays de mener une politique étrangère et former une armée commune – comme pour la monarchie duale austro-hongroise – a été inévitablement été accompagnée d’une administration commune concernant les douanes, la monnaie, et les finances.
Les relations de l’Union avec le monde extérieur fournissent plusieurs raisons importantes à cela. Des représentations dans les pays étrangers et une politique étrangère communes sont difficilement concevables sans une politique fiscale et monétaire commune. Si les traités internationaux doivent être conclus uniquement par l’Union, il en découle que l’Union doit disposer d’un pouvoir exclusif sur toutes les relations étrangères, y compris le contrôle des exportations et importations, etc. Si le gouvernement de l’Union est responsable du maintien de la paix, c’est l’Union qui doit être responsable des décisions qui nuisent ou bénéficient à d’autres pays, et pas ses parties.
Les exigences d’une politique commune de défense ne sont pas moindres. Non seulement toute entrave commerciale interétatique empêcherait l’utilisation optimale des ressources disponibles et affaiblirait la force de l’Union, mais les intérêts régionaux créés par toute sorte de protectionnisme régional soulèveraient des obstacles à une politique de défense efficace. Il serait suffisamment difficile de subordonner les intérêts sectoriels à ceux de l’Union ; mais si les États membres demeuraient des communautés d’intérêts séparées, dont les habitants gagnent et souffrent ensemble car ils sont séparés du reste de l’Union par différentes sortes de barrière, il serait impossible de conduire une politique de défense sans être gêné à chaque étape par des considérations d’intérêts locaux. Ceci ne constitue cependant qu’une facette du problème plus vaste dont nous devons à présent tenir compte.
Les raisons les plus impérieuses d’extension de l’union à la sphère économique découlent de la nécessité de préserver la cohérence interne de l’Union. L’existence de n’importe quelle mesure de mise à l’écart ou d’isolement de la part d’un Etat produit une solidarité d’intérêts entre tous ses habitants, et des conflits entre leurs intérêts et ceux des habitants d’autres Etats qui – même si nous sommes tellement habitués à de tels conflits que nous les tenons pour acquis – ne sont en aucun cas naturels ou inévitables. Il n’y a aucune raison recevable qu’un changement affectant une industrie déterminée sur un territoire donné affecte plus les habitants de ce territoire, ou la plupart d’entre eux, que toute autre personne ailleurs. Celui-ci s’appliquerait également aux territoires qui constituent à présent des États souverains ainsi qu’à toute autre région arbitrairement délimitée, sans les barrières commerciales, les organisations monétaires séparées, et toutes les autres entraves à la libre-circulation des hommes et des biens. C’est uniquement à cause de ces barrières que l’incidence des bénéfices et dommages variés qui affectent en première instance un groupe de personnes spécifiques sera principalement confiné aux habitants d’un État donné, et s’étendra à presque toutes les personnes vivant à l’intérieur de ses frontières. De telles frontières économiques créent des communautés d’intérêts, à base régionale, et d’un caractère plus étroit : elles conduisent tous les conflits d’intérêts à devenir des conflits entre mêmes groupes de personnes au lieu de conflits entre groupes à la composition constamment changeante, et au conflit perpétuel entre les habitants d’un État en tant que tels, au lieu de conflits entre différents individus eux-mêmes imbriqués, parfois avec un groupe de personnes contre un autre, et d’autres fois, sur un autre sujet, avec le second groupe contre le premier. Il est superflu d’ajouter ici le cas extrême, mais néanmoins important, de la restriction nationale comme pourvoyeuse de changements considérables de niveau de vie entre la population de deux États[4]. Le simple fait que tous réaliseront, encore et encore, que leurs intérêts sont fortement liés à ceux d’un seul groupe de personnes et antagonistes avec ceux d’un autre groupe, mènera à de graves conflits entre les groupes en tant que tels. Il sera toujours inévitable que des communautés d’intérêts soient affectées de manière semblable par un événement particulier ou une mesure particulière. Mais il est clairement dans l’intérêt de l’unité d’un ensemble plus vaste que ces groupements ne soient pas permanents, et, plus particulièrement, que les différents regroupements d’intérêts se chevauchent territorialement et ne se recoupent jamais durablement avec les populations d’une région déterminée.
Nous étudierons plus tard comment, dans les États fédéraux existants, alors que les États fédérés sont privés des instruments protectionnistes comme la douane et la monnaie, les formes concédées de protectionnisme tendent à accroître les conflits, les représailles cumulatives, et même l’utilisation de la force entre États fédérés. Et il n’est pas difficile d’imaginer quelles formes cela prendrait, si les États fédérés restaient libres d’employer toute l’armurerie protectionniste. Il est tout à fait certain que l’union politique entre des États anciennement souverains ne tiendrait pas longtemps sans s’accompagner d’une union économique.
2
L’absence de barrières douanières et la libre circulation des hommes et des capitaux entre les États de la fédération engendrent d’importantes conséquences, souvent négligées. Elles limitent dans une grande mesure le périmètre des politiques économiques des États individuels. Si les biens, les hommes et l’argent peuvent se mouvoir librement au-delà des frontières nationales, il devient clairement impossible aux États d’influencer les prix des différents produits. L’Union devient un marché unique, et les prix dans ses différentes parties vont uniquement différer suivant les coûts de transport. De même, toute modification dans les opportunités d’investissement ou dans la rémunération du travail, où que ce soit dans l’Union, affectera plus ou moins vite l’offre et le prix du capital et du travail dans le reste de l’Union.
Désormais, presque toute la politique industrielle contemporaine poursuit ses objectifs en agissant sur les prix. Que ce soit par des commissions de marché ou des restrictions, par des « réorganisations » obligatoires ou la destruction des capacités excédentaires d’industries spécifiques, l’objectif est toujours de limiter l’offre et, ainsi, d’augmenter les prix. Tout ceci deviendra impossible pour les États membres de l’Union. Toutes les armes commerciales et autres formes d’organisation monopolistique des industries particulière cesseront d’être à disposition des gouvernements. S’ils désirent toujours assister un groupe de producteurs donné, ils devront alors le subventionner directement avec des fonds levés lors de l’imposition. Mais les méthodes avec lesquelles au Royaume-Uni, par exemple, les producteurs de sucre et de lait, de lard et de pommes de terre, de coton, de charbon et d’acier ont tous été préservés ces dernières années de la « compétition ruineuse » interne et externe, ne seront plus disponibles.
De même, il sera clair que les États membres seront incapables de poursuivre une politique monétaire indépendante. Dans un espace monétaire commun, la latitude donnée aux banques centrales nationales sera restreinte au moins autant que sous l’étalon-or rigide – voire plus, car même sous étalon-or, les fluctuations d’échange entre pays étaient plus grandes qu’entre les différentes parties d’un seul État, ou que ce qui serait désirable au sein de l’Union[5]. En effet, il semble douteux que des banques centrales nationales continuent à exister dans une union pourvue d’un système monétaire commun. Elles auraient probablement à être regroupées dans une sorte de système fédéral de réserve. Mais dans tous les cas, une politique monétaire nationale avant tout guidée par les conditions économiques et financières de l’État mènerait inévitablement à l’effondrement du système monétaire commun. Ainsi, toute la politique monétaire serait du ressort fédéral et non plus national.
En considérant même des interférences plus superficielles dans la vie économique que la régulation de la monnaie ou des prix, les États verraient leurs possibilités sévèrement limitées. Les États pourraient bien entendu exercer un contrôle sur la qualité des biens et les modes de production, mais sans exclure les marchandises produites dans une autre partie de l’union. Tout fardeau placé sur une industrie particulière par la législation d’État lui infligerait donc un désavantage sérieux, par rapport aux industries similaires dans le reste de l’union. Comme l’a montré l’expérience des fédérations existantes, même la restriction légale du travail des enfants ou du temps de travail n’incomberont qu’avec difficulté aux États.
De plus, dans la sphère financière pure, les levées de fonds publiques seraient restreintes. Non seulement la mobilité accrue entre les États interdira toute taxation qui dérouterait le capital ou le travail ailleurs, mais de nombreuses sortes de taxations indirectes se heurteraient à des difficultés considérables. Notamment si, ce qui est sans aucun doute souhaitable, le gaspillage que représente le contrôle frontalier était évité. Il serait compliqué de taxer toute marchandise qui serait facilement importée. Cela exclurait non seulement la fiscalité telle que le monopole des tabacs, mais aussi probablement de nombreuses taxes d’accise[6].
Il ne s’agit pas de traiter ici des limites qu’une fédération imposerait aux politiques économiques des États membres. La dynamique générale dans cette direction a probablement été suffisamment illustrée précédemment. Pour empêcher tout contournement des dispositions fondamentales concernant la libre circulation des hommes, des biens et des capitaux, à vrai dire, les restrictions à la liberté des États membres seraient probablement encore plus importantes que nous ne l’avons jusqu’alors présumé. Leur capacité d’action indépendante devra être encore plus circonscrite. Nous reviendrons ultérieurement sur le sujet.
Il convient d’ajouter que ces limitations ne s’appliqueront pas uniquement aux politiques économiques des États, mais également à celles des organisations commerciales et professionnelles débordant les frontières nationales. Lorsque les frontières sont ouvertes et la libre-circulation garantie, toutes ces organisations nationales, que ce soit les syndicats, cartels, ou corporations, perdent leurs positions monopolistiques et toute capacité, comme organisations nationales, de contrôler leurs offres de service ou de produits.
3
Le lecteur qui a suivi l’argument jusqu’ici conclura probablement qu’avec la limitation du pouvoir économique des États dans la fédération, le gouvernement fédéral exercera les fonctions que les États ne peuvent plus remplir, et accomplira la planification et la régulation dont les États sont incapables. De nouvelles difficultés se présentent alors. Dans cette courte description, il convient surtout de discuter ces problèmes en rapport avec la forme d’intervention publique la plus établie, les droits de douane. Nos remarques sur les douanes sont valables en grande partie pour d’autres formes de mesures restrictives ou protectionnistes. Quelques références à des régulations publiques particulières y seront adjointes par la suite.
Premièrement, la protection d’une industrie particulière au sein de l’Union pourrait n’être guère utile, car les producteurs contre lesquels ils vont souhaiter être protégés proviendront de l’intérieur de l’Union. Le producteur de blé anglais profitera peu d’un tarif douanier qui inclurait aussi dans la même zone de libre-échange son homologue canadien, voire même le producteur de blé argentin. Le fabricant automobile britannique tirera peu avantage d’une barrière douanière qui protège aussi les fabricants américains. Il n’y a pas besoin d’insister plus sur ce point.
Mais même lorsqu’une industrie dans son ensemble voudra être protégée vis-à-vis d’un producteur étranger, certaines difficultés spécifiques surgiront, plus aigües que dans un système douanier national. Pour qu’une industrie bénéficie d’un droit de douane, il est nécessaire que le droit sur ses propres produits soit plus élevé que le droit sur les consommations intermédiaires qu’elle consomme. Un droit de douane fixe à taux uniforme sur l’ensemble des importations bénéficie surtout aux industries concurrençant les importations, au détriment de toutes les autres. Mais l’impact de ces bénéfices est sans distinction. Ils ne vont sûrement pas soutenir les branches en besoin. Même si une telle barrière douanière tend à diminuer la richesse matérielle de tous au sein de l’Union, elle serait probablement employée pour en renforcer la cohérence politique. Aucune difficulté particulière n’y semble liée.
Les problèmes surgissent uniquement lorsqu’un tarif douanier est utilisé pour assister une industrie spécifique, lui permettre de croître plus rapidement qu’elle ne le ferait en son absence, ou la protéger contre des influences adverses. Dans ce cas, pour subventionner un groupe de personnes, un sacrifice est inévitablement imposé aux autres producteurs et aux consommateurs.
Dans le cadre idéologique actuel, il est relativement simple de convaincre le reste de la communauté qu’il est de son intérêt de protéger « son » industrie d’acier, « sa » production de blé, ou autre. La fierté patriotique de « son » industrie et des considérations de puissance nationale en cas de guerre conduisent les gens à consentir au sacrifice. Ils considèrent que leur sacrifice bénéficie aux compatriotes proches. Les mêmes motifs opèreraient-ils en faveur d’autres membres de l’Union ? Croit-on le paysan français disposé à payer pour ses engrais un prix plus élevé pour aider l’industrie chimique britannique ? Le travailleur suédois paiera-t-il plus pour ses oranges afin de soutenir le cultivateur californien ? L’employé de banque de la Cité londonienne paiera-t-il plus pour ses chaussures ou son vélo afin d’aider l’ouvrier américain ou belge ? Le mineur sud-africain est-il prêt à payer plus pour ses sardines afin de secourir le pêcheur norvégien ?
Il est clair que dans une fédération, tout accord sur un tarif douanier commun soulèverait des problèmes différents de ceux qui émergent dans un État. Il lui manquerait le soutien d’idéologies nationalistes puissantes, la sympathie avec le voisin. Même l’argument de la défense perdrait tout pouvoir de conviction si l’Union devenait assez forte pour ne rien craindre. Il est difficile d’imaginer comment un accord serait atteint, dans une fédération, pour protéger des industries particulières. La même difficulté s’applique à toute autre forme de protection. Étant donné la grande diversité de conditions entre les pays, inévitable dans une fédération, l’appel à l’aide des industries obsolètes ou déclinantes se heurtera invariablement aux industries en progrès, qui demandent de la liberté de développement. Il sera plus ardu de retarder le progrès dans un bout de la fédération afin de maintenir le niveau de vie à l’autre bout, que d’accomplir la même chose dans un État. Même lorsqu’il ne s’agit pas simplement de « réguler » (brider) le progrès d’un groupe pour en préserver un autre de la compétition, la diversité des conditions et les différentes étapes de développement économique dans chaque partie de la fédération soulèveront de sérieux obstacles à toute législation fédérale. Plusieurs formes d’interférence étatique, bienvenues en phase de développement économique, sont ensuite considérées comme un lourd obstacle. Même une législation de limitation du temps de travail, ou une assurance-chômage obligatoire, ou encore la garantie d’un acquis quelconque seront envisagées sous un éclairage différent dans les régions pauvres et les régions riches. Dans les premières, elles pourraient même nuire et susciter l’opposition violente de cette même catégorie de personnes qui les exigent et en tirent profit dans les régions riches. Une telle législation devra être confinée dans les limites de ce qui peut s’appliquer localement, sans imposer simultanément de restriction à la mobilité, comme une loi de domiciliation[7].
Ces problèmes ne sont pas inconnus dans les États contemporains. Mais ils sont facilités par l’homogénéité plus forte, les idéaux et convictions communs, ainsi que toute la tradition populaire dans l’Etat-Nation. En fait, les Etats actuels sont généralement d’une dimension et d’une composition qui rendent possible la fixation d’un niveau d’intervention étatique, dont ils ne souffriraient pas s’ils étaient plus petits ou plus grands. Dans le premier cas (où ce qui importe n’est d’ailleurs ni la taille en nombre d’habitants ni la surface, mais la taille par rapport aux groupes existants, lesquels sont plus ou moins homogènes et autonomes), l’essai de rendre l’Etat national autonome serait hors de question. Si l’unité souveraine était le comté, voire des districts plus petits, il y aurait alors peu d’industries à protéger dans chaque unité. Toutes les régions sans industrie et incapables d’en créer constitueraient des marchés libres afin d’en produire. Dans le second cas, si les unités souveraines étaient plus grandes qu’elles ne le sont aujourd’hui, il serait bien plus compliqué d’imposer un fardeau aux habitants d’une région, pour venir en aide aux habitants d’une région très éloignée – laquelle pourrait parler une autre langue et différer en tout point.
La planification, ou direction centralisée de l’activité économique, présuppose l’existence d’idéaux et de valeurs partagés. Le degré auquel la planification peut être menée dépend du degré de consentement auquel peut être poussée l’échelle des valeurs communes[8]. Un tel consentement sera inversement proportionnel à l’homogénéité des points de vue et la similarité des traditions des habitants d’un territoire. Dans l’État-Nation, la soumission à la volonté majoritaire est facilitée par le mythe des nationalités. Pour autant, des individus seront réticents à accepter des interférences dans leurs activités quotidiennes, lorsque la majorité du gouvernement relève d’autres nationalités et traditions. Après tout, c’est le sens commun qui impose au gouvernement d’une fédération composée de plusieurs peuples de restreindre son action, pour éviter de susciter la résistance des divers groupes. Qu’est-ce qui intervient plus profondément dans la vie intime que la direction centralisée de l’économie, avec son inévitable discrimination entre les groupes ? La régulation économique d’un gouvernement fédéral connaît des limites bien plus étroites que celle d’un gouvernement national. Avec la limitation des pouvoirs étatiques, la plupart des interférences économiques auxquelles nous nous sommes habitués seront impraticables dans le fédéralisme.
Le meilleur exemple en est la forme de planification la plus avancée, le socialisme, et les problèmes qu’elle soulève. Demandons-nous en premier lieu si un État socialiste, par exemple l’URSS, pourrait constituer une fédération avec les États atlantiques démocratiques. La réponse est bien sûr négative – pas parce que ces derniers s’opposeraient à l’admission de la Russie, mais parce que l’URSS ne saurait se plier aux conditions qu’impose une fédération. Il lui serait impossible de permettre la libre-circulation des biens, des hommes et des capitaux, tout en maintenant son économie socialiste.
D’un autre côté, il est évident que l’hypothèse d’un régime socialiste pour toute la fédération, Russie incluse, est inenvisageable. En effet, des différences de niveau de vie, de tradition ou d’éducation auraient cours dans cette fédération. Elles rendraient impossible toute solution démocratique aux problèmes fondamentaux de la planification socialiste. Même dans une fédération composée majoritairement d’États démocratiques actuels, comme l’a proposé Clarence Streit[9], les difficultés liées à l’introduction d’un régime socialiste commun ne seraient pas amoindries. Il est concevable que les Anglais ou les Français fassent confiance à un organe supranational pour protéger leurs vies, leur liberté, leurs propriété – en somme, les fonctions d’un État libéral. Mais il n’est ni probable ni souhaitable qu’ils délèguent au gouvernement d’une fédération le pouvoir de réguler leur vie économique, de décider ce qu’ils doivent produire et consommer. Puisqu’une fédération n’accorderait pas de compétence de ce type aux États membres, alors elle signifie qu’aucun des échelons de gouvernement n’aura le pouvoir de planifier la vie économique.
4
En conclusion, certains pouvoirs économiques généralement du ressort des Etats ne pourraient être exercés dans une fédération, ni par cette dernière ni par ses Etats membres. Pour qu’une fédération soit praticable, il faut qu’il y ait, dans l’ensemble, moins de gouvernement. Certaines politiques économiques devront être conduites par la fédération, ou par personne. Leur exercice dépendra de la faculté d’atteindre un réel accord, portant sur l’emploi éventuel de ces pouvoirs et la manière dont ils seraient utilisés. Le point essentiel est qu’il sera souvent impossible d’obtenir un tel accord. Nous devrons abdiquer toute législation dans les secteurs concernés, plutôt que d’avoir une législation qui briserait l’unité économique de la fédération. Accepter l’absence de législation constituera l’épreuve de vérité de notre maturité intellectuelle, nécessaire à la création d’une organisation supranationale.
Une difficulté a toujours surgi dans les fédérations, à propos de laquelle il faut reconnaître que les mouvements « progressistes » ont généralement pactisé avec les forces obscures. Aux États-Unis d’Amérique, notamment, les progressistes ont une tendance lourde à favoriser la législation des États en l’absence de législation fédérale, qu’elle préserve ou non l’unité économique de l’Union. C’est pourquoi, aux États-Unis d’Amérique ainsi qu’en Suisse, les politiques économiques des États ont été loin dans la désintégration graduelle de l’espace économique commun[10].
L’expérience de ces fédérations montre que l’interdiction des droits de douanes ou autres entraves commerciales n’est guère suffisante pour empêcher cette dynamique. Les États peuvent facilement contourner ces règles en s’embarquant dans une course à la planification nationale, via des réglementations administratives. En effet, tous les effets d’une protection douanière peuvent être atteints par la régulation sanitaire, les inspections obligatoires, et les taxations finançant ces contrôles administratifs. Au vu de l’inventivité des législateurs dans ce domaine, il semble clair qu’aucune disposition constitutionnelle fédérale ne suffirait à empêcher de tels développements. À cette fin, le gouvernement fédéral devrait plutôt disposer de pouvoirs restreints. Cela signifie que la fédération possèdera le pouvoir négatif d’empêcher certaines interférences étatiques dans l’activité économique, même si elle ne disposera pas forcément du pouvoir positif d’agir à leur place. Aux États-Unis d’Amérique, les différentes clauses constitutionnelles protégeant la propriété et la liberté de contrat ont rempli dans une certaine mesure cette fonction – en particulier la clause du due process garantie par les cinquième et quatorzième amendements[11]. Elle a contribué bien plus qu’on ne le pense à éviter la désintégration en plusieurs zones économiques. Mais, en conséquence, ces amendements ont été attaqués de manière répétée par ceux qui exigent une extension rapide du contrôle étatique sur l’économie.
Bien sûr, il y aura toujours certaines dimensions de l’activité gouvernementale qui seront accomplies plus efficacement dans les zones correspondant aux États membres, et seront exercées nationalement sans menacer l’unité économique de la fédération. Mais globalement, il est probable que les prérogatives économiques des États membres seront et devront être progressivement affaiblies – plus qu’à première vue. Non seulement leurs pouvoirs seront diminués lorsque la fédération se saisira de certaines fonctions, ou par l’obligation d’abandonner tout contrôle public dans certaines dimensions, mais on peut s’attendre à une forte dévolution depuis les États membres vers des unités plus petites. Dans une fédération, tous les arguments centralisateurs, basés sur le désir de renforcer les États souverains, disparaissent – en fait, le contraire semble se produire. Non seulement la majorité des formes de planification désirables pourraient être conduites par de petites unités territoriales, mais la compétition entre elles, combinée à l’impossibilité de dresser des barrières, exerceraient un contrôle salutaire sur leurs activités. Tout en laissant la porte ouverte à des expérimentations souhaitables, elles les contiendraient dans les limites appropriées.
Peut-être faut-il insister sur les marges de manœuvre laissées aux politiques économiques dans une fédération. Le laisser-faire extrême n’est pas nécessaire dans les affaires économiques. Cela signifie simplement que la planification dans une fédération ne saurait adopter les formes que nous connaissons aujourd’hui sous ce terme. Il ne devra y avoir aucune substitution concernant les interférences quotidiennes et la régulation des forces impersonnelles du marché. En particulier, il ne doit subsister aucune trace du « développement national par monopoles contrôlés », auquel « les dirigeants britanniques s’habituent progressivement », pour reprendre un hebdomadaire influent[12]. Dans une fédération, la politique économique devra prendre la forme d’un cadre rationnel, dans lequel l’initiative individuelle aura l’espace le plus large et fonctionnera de la manière la plus bénéfique possible. Elle suppléera également le mécanisme compétitif, lorsque, dans certains cas, des services ne peuvent être fournis et régulés par le système des prix. La politique de la fédération sera essentiellement de long-terme. Le fait qu’« à long terme nous sommes tous morts »[13] constituera pour elle un net avantage. Contrairement à l’habitude contemporaine, elle ne devra pas être employée comme paravent pour agir selon la maxime « après nous le déluge »[14]. Le temps long qui présidera aux décisions rend presque impossible de prévoir leurs effets sur les individus et les groupes. Ainsi, il empêchera les décisions d’être prises au terme d’une lutte entre les « intérêts » les plus puissants.
Ce court article n’ambitionne pas d’analyser les conséquences positives de l’économie politique libérale que la fédération devra poursuivre. Il n’est même pas possible de s’étendre sur des problèmes aussi importants que la politique monétaire ou coloniale, qui continueront évidemment à exister dans une fédération. Sur la question coloniale, le point le plus brûlant, c’est-à-dire l’administration coloniale par les Etats ou la fédération, serait d’importance relativement mineure. Avec une vraie politique de porte-ouverte pour tous les membres de la fédération, les avantages liés à la possession de colonies s’égaliseraient, qu’elles soient administrées au niveau fédéral ou national. Mais de façon générale, il est sans aucun doute préférable que leur administration devienne fédérale plutôt que nationale.
5
Nous avons plaidé la nécessité d’un régime économique libéral, condition du succès de toute fédération interétatique. Nous pouvons ajouter, en conclusion, que l’inverse n’est pas moins vrai : l’abrogation des souverainetés nationales et la création d’un ordre juridique international constituent le complément nécessaire et l’aboutissement logique du programme libéral. Dans une discussion récente sur le libéralisme international, il a été fort justement expliqué que les avocats du libéralisme au XIXe siècle possédaient une grave lacune. Ils ne comprenaient pas qu’un cadre de sécurité internationale était nécessaire pour atteindre une harmonie d’intérêts entre habitants de différents États[15]. Les conclusions auxquelles arriva le professeur Robbins, résumées dans la déclaration « il ne doit y avoir ni alliance ni unification complète, ni Staatenbund ni Einheitsstaat mais Bundesstaat[16] »[17], correspondent pour l’essentiel à celles développées par Clarence Streit, avec plus de détails politiques.
L’échec du libéralisme du XIXe siècle découle largement de son incapacité à se développer dans cette direction. À cause d’accidents historiques, il a successivement joint ses forces au nationalisme puis au socialisme, chacune de ces deux forces étant également incompatible avec ses principes de base[18]. L’alliance première du libéralisme avec le nationalisme était due à leur lutte contre une même sorte d’oppression, en Irlande, en Grèce, en Belgique, en Pologne, puis en Italie et en Autriche-Hongrie – à laquelle s’opposait le libéralisme. Ensuite, il s’allia au socialisme. L’accord sur les buts ultimes obscurcissait pendant un moment l’incompatibilité absolue des méthodes par lesquelles les deux mouvements tentaient d’atteindre leur objectif. Mais désormais, le nationalisme et le socialisme se sont fondus en une organisation puissante qui menace les démocraties libérales. Même dans ces démocraties, les socialistes deviennent de plus en plus nationalistes et les nationalistes de plus en plus socialistes. Serait-ce trop espérer que de souhaiter une renaissance du vrai libéralisme, fidèle à ses idéaux de liberté et d’internationalisme, revenu de ses errements temporaires dans les camps nationaliste et socialiste ? L’idée de fédération interétatique et le développement constant de l’opinion libérale devraient fournir un nouveau point d’appui[19] à tous les libéraux, désespérés par leur croyance ou l’ayant désertée durant ce vagabondage.
Le libéralisme duquel nous parlons n’est bien sûr pas affaire de parti. Il s’agit d’un point de vue qui, avant la Première Guerre mondiale, fournissait un socle commun à presque tous les citoyens des démocraties occidentales. Il est la base du gouvernement démocratique. Si un parti a peut-être conservé cet esprit libéral plus que les autres, tous se sont néanmoins égarés, dans l’une ou l’autre des directions. Mais l’avènement d’un ordre démocratique international exige d’en ressusciter l’idée sous sa véritable forme. Le gouvernement par consentement nécessite que nous n’ayons besoin de l’action gouvernementale que dans les domaines où nous y avons véritablement consenti. Si, au niveau international, le gouvernement démocratique ne s’avérait possible qu’à condition de se restreindre à un programme essentiellement libéral, cela ne ferait que confirmer l’expérience au niveau national : il est chaque jour manifeste que la démocratie ne fonctionne qu’à condition de ne pas la surcharger, et si les majorités n’abusent pas de leur pouvoir d’interférer dans la liberté individuelle. Mais toutefois, si le prix d’un gouvernement démocratique international réside dans la délimitation de son pouvoir et de sa portée, ce prix n’est certainement pas trop élevé. Tous ceux qui croient authentiquement dans la démocratie doivent être prêts à le payer. Le principe démocratique d’après lequel « compter les têtes évite de les casser »[20] est après tout la seule méthode de changement pacifique inventée jusqu’à présent, jamais mise en défaut. Quoique l’on pense des objectifs gouvernementaux, et quel que soit le désir de les changer, éviter la guerre ou les troubles prime. Si la réussite dépend d’une limitation du gouvernement, ces autres idéaux devront céder leur place.
Je n’ai aucun scrupule à pointer les obstacles vers un objectif auquel je crois profondément. Je suis convaincu que ces difficultés sont mineures. Si nous ne les prenons pas en compte dès le début, elles pourront constituer plus tard l’écueil sur lequel buteront les espoirs d’une organisation internationale. Plus vite nous reconnaîtrons ces difficultés, plus vite nous aurons l’espoir de les surmonter. Il me semble que les aspirations majoritaires ne peuvent voir le jour que par des moyens aujourd’hui minoritaires. Aussi, ni l’impartialité académique ni des considérations d’opportunité ne devraient empêcher quiconque de partager sa conception des bons moyens – même si ces moyens devraient être portés par un parti politique.
Publication originale : Hayek F., « The Economic Conditions of Interstate Federalism”, New Commonwealth Quarterly, V, n° 2, septembre 1939, p.131-149.
Illustration : REUTERS/Yannis Behrakis.
Notes
[1] Il tire deux conclusions de son article : “The first will hardly be disputed. It is that economic unification is impossible without political unification. There is no chance whatsoever that sovereign states will ever agree and stay agreed on the major phases of economic policy. My second conclusion is this: Economic unification in the real sense as indicated above is politically impossible except (a) if it were imposed by force by a dictator, a Stalin or a Hitler, or (b) after a return, not to complete laissez faire (if that ever existed), but to a condition of comparatively little state interference in economic matters as it existed before 1914.”
[2] L’étalonnage comparé, ou benchmarking, consiste à hiérarchiser les pays par rapport à un indicateur quantifié donné, afin d’identifier celui qui « réussit » le mieux, et inciter à l’adoption de ses politiques publiques.
[3] L’étendue de l’exception que constitue le Commonwealth britannique depuis les Statuts de Westminster n’est pas encore visible.
[4] C’est uniquement car, en raison de ces conditions, le niveau de vie de toute la population d’un pays tend à évoluer dans la même direction, que des concepts tels que le niveau de vie ou le niveau des prix d’un pays cessent d’être de pures abstractions statistiques pour devenir des réalités concrètes.
[5] À ce propos, se référer à Monetary Nationalism and International Stability du même auteur.
[6] Taxe qui porte sur une quantité, et non un prix. Par exemple, un produit dont chaque hectolitre est taxé d’une somme fixe, au lieu d’être taxé suivant son prix.
[7] Peut-être une référence ici dans le texte original à la law of settlements chez Adam Smith, qui immobilisait les salariés dans des localités. « Qu’on ajoute à ces suppressions celle de la loi du domicile (law of settlements), de manière qu’un pauvre ouvrier, quand il se trouve perdre son emploi dans le métier ou dans le lieu où il était placé, puisse en chercher dans un autre métier ou dans un autre lieu, sans avoir à craindre d’être persécuté ou d’être renvoyé, et alors, ni la société ni les individus n’auront pas plus à souffrir d’un événement qui disperserait quelques classes particulières d’ouvriers de manufacture, qu’ils n’ont à souffrir du licenciement des soldats. (Recherche sur la nature et la cause de la richesse des Nations, IV, p.41 1776 [1881]). (NdT)
[8] À ce propos et ce qui suit, se référer à Freedom and the Economic System du même auteur (“Public Policy Pamphlets, » No. 29, Chicago, 1939), et, plus récemment, The Road to Serfdom (Chicago : University of Chicago Press, 1944) (La Route de la Servitude en français, NdT).
[9] Clarence Streit (1896-1986), journaliste étasunien, fédéraliste atlantiste. En poste au New York Times, il publie en 1939 Union Now, proposition pour une union fédérale des démocraties de l’Atlantique Nord. Il contribuera à la création du Comité pour une union atlantique en 1949 (qui contribuera à créer l’OTAN), et à deux déclarations pour une unité atlantique en 1954 et 1962, cosignées par plus de 150 intellectuels, politiques, hauts fonctionnaires et patrons. Elles appellent à dépasser le cadre militaire de l’OTAN, et créer un espace économique atlantique sans entrave commerciale ainsi qu’une assemblée confédérale émanant des parlements nationaux (NdT).
[10] Pour les USA, R. L. Buell, Death by Tariff: Protectionism in State and Federal Legislation, « Public Policy Pamphlets, » No. 27, Chicago, 1939, et F. E. Melder, Barriers to Inter-state Commerce in the United States, Orono, Me., 1937.
[11] Qui garantit l’égalité de traitement juridique ces citoyens étasuniens. Le cinquième amendement est promulgué le 15 décembre 1791, le quatorzième amendement le 9 juillet 1868. Ils disposent respectivement que « nul ne pourra, dans une affaire criminelle (…) être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l’intérêt public sans une juste indemnité », et « aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; ni ne refusera une égale protection des lois à quiconque relève de sa juridiction. » (NdT).
[12] Spectator, March 3, 1939.
[13] Réponse indirecte à J. M. Keynes, qui écrit en 1924 « le long terme est un horizon peu intéressant. À long terme, nous serons tous morts. Les économistes n’apportent rien si, en pleine tempête, tout ce qu’ils trouvent à dire est qu’une fois l’orage passé la mer sera calme », Tract on Monetary Reform, MacMillan and co., p.80. (NdT)
[14] En français dans le texte (NdT).
[15] L. C. Robbins, Economic Planning and International Order (1937), p. 240.
[16] Respectivement alliance d’États (Staatenbund), État unifié (Einheitsstaat), et État fédéral (Bundesstaat) (NdT).
[17] Ibid., p. 245.
[18] Cette tendance s’observe très bien chez John Stuart Mill. Son déplacement graduel vers le socialisme est évidemment connu, mais il acceptait également des doctrines nationalistes plus que ce qui était compatible avec son programme totalement libéral. Dans ses Considérations sur le gouvernement représentatif (p.298), il explique : « la coïncidence entre les frontières du gouvernement et celles des nationalités est en général une condition nécessaire d’institutions libres ». Contre ce point de vue, Lord Acton argumentait que « la combinaison de différentes nations dans un État est aussi nécessaire à la vie civilisée que la combinaison d’hommes dans la société », et que « cette diversité dans un même État est une solide barrière vis-à-vis des intentions gouvernementales au-delà de la sphère politique, communes à tous, dans le social, qui échappe à la législation et est dirigé par des lois spontanées » (History of Freedom and Other Essays [1909], p. 290).
[19] En français dans le texte (NdT).
[20] Référence au discours de Rudyard Kipling, au diner d’inauguration du maire de Sussex, dans le pavillon royal (9 novembre 1910) : « Lorsque le royaume du Sussex était un État souverain et indépendant, il y a quelques siècles, les Saxons du Sud considéraient ce que nous nommons la politique comme bien moins important que la piraterie, la navigation, le commerce et le sport. En de rares occasions, lorsqu’ils s’intéressaient à la politique, le représentant de Lewes était susceptible de voter contre le représentant de Brighthelmstone avec une hache ou une épée. Cette méthode, bien que concluante, fut considérée comme du gaspillage, en raison du coût des élections partielles. (…) Si vous brisez les têtes, vous découvrez au moins ce qu’il y a dedans ; si vous les comptez, vous devez accepter leur contenu. Si vous faites confiance au contenu, vous obtenez cette vaste affaire qu’est la politique, comme nous la connaissons aujourd’hui » (NdT).