
Le deuxième corps. Extrait du livre de Karen Messing
Dans son livre Le deuxième corps. Femmes au travail, de la honte à la solidarité (éd. Écosociétés, 2021, traduit de l’anglais par Geneviève Boulanger), Karen Messing revient sur plusieurs décennies de recherches et de débats sur la santé des femmes au travail rémunéré. À partir des recherches qu’elle a menées auprès et avec des travailleuses de secteurs très divers (entretien paysager, techniciennes des télécommunications, soignantes…), elle met en lumière l’inadéquation des conditions de travail et des mesures de prévention des risques professionnels.
Il s’agit non seulement de remettre en cause le modèle implicite de travailleur, toujours pensé comme un homme grand et fort, mais aussi de prendre en compte les rapports de pouvoir dans le milieu professionnel, en particulier la domination des hommes (les chefs mais aussi les collègues) sur les femmes.
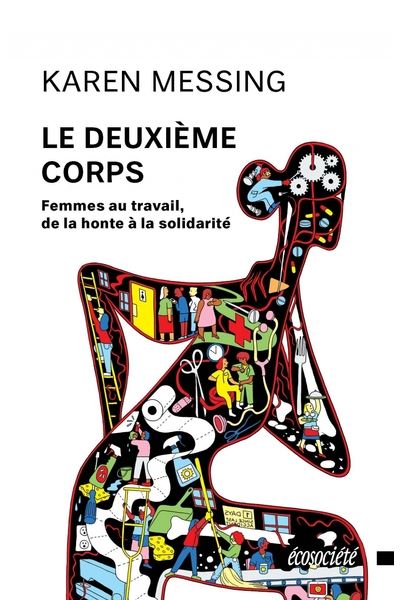
Trouver des pistes de solution
À mon avis, les féministes qui mettent l’accent sur la « ressemblance » ont raison de soutenir que les femmes et les hommes ne sont pas des créatures issues de deux espèces différentes et que leurs particularités cognitives, physiques et émotionnelles forment un vaste éventail de traits où les frontières entre les sexes sont aussi floues que variables.
Je suis également d’accord avec d’autres scientifiques féministes comme Anne Fausto-Sterling et Jeanne Mager Stellman pour affirmer que les différences biologiques ne sont pas uniquement déterminées par le code génétique, mais aussi par le conditionnement, les expériences et les inégalités de genre en matière d’alimentation, d’exercice physique, de normes esthétiques, d’emploi du temps et de bien d’autres facteurs. Je respecte les conclusions de Ruth Hubbard et d’Anne Fausto-Sterling qui affirment que de nombreuses personnes possédant un caryotype XX ou XY ne peuvent être clairement définies d’un point de vue biologique comme appartenant exclusivement à un sexe ou à l’autre.
Par conséquent, il me semble légitime d’affirmer que le sexe génétique ou même l’identité de genre ne devrait pas déterminer la répartition des tâches et des emplois sur le marché du travail. Comme les féministes qui insistent sur la « différence », cependant, je crois que certains traits physiologiques sexués contribuent effectivement à distinguer la plupart des personnes s’identifiant comme des « femmes » de la plupart des personnes se définissant comme des « hommes » et que ces différences peuvent jouer un rôle dans la protection de la santé au travail.
Comme je l’ai déjà mentionné, toutefois, la théorie n’est pas ma tasse de thé ; je préfère laisser les féministes qui se sentent plus à l’aise avec ces questions en débattre. De toute façon, notre conclusion sera sans doute la même : les techniciennes en communication, les femmes travaillant à l’entretien ménager et les préposées aux bénéficiaires ont besoin que les choses changent, et vite. Mais comment leur venir en aide ? Pour rendre un environnement de travail plus sécuritaire et équitable, pour les femmes comme pour les hommes, trois avenues de changement s’offrent à nous : la collecte d’information, une meilleure gestion du personnel et, surtout, le renforcement des liens de solidarité entre les travailleuses (et avec les personnes qui défendent leurs droits).
La collecte d’information : pour que les revendications politiques débouchent sur des solutions qui vont réellement dans le sens des intérêts des travailleuses manuelles à faible revenu, il faut d’abord se poser quelques questions concrètes. Les tâches qui leur incombent sont-elles adaptées au corps féminin ? Comment faciliter leur exécution ? Quelles sont les particularités du corps féminin et à quel point ces dernières sont-elles prises en compte dans les milieux de travail ? Pourrait-on améliorer le sort des travailleuses en repensant la conception de leur poste de travail ? S’il existe un risque pour la santé, quels sont les mécanismes en cause ? (Par exemple, on interviendra différemment si la santé des travailleuses est menacée par une exposition à des solvants en raison d’une interaction hormonale ou si le visage des travailleuses, généralement moins grandes, se retrouve directement à la hauteur des pots de peinture ouverts.)
Bref, pour faire avancer les choses, il importe d’acquérir une base solide de connaissances scientifiques et techniques. Mais avant d’aller plus loin, une précision s’impose : aujourd’hui, les ergonomes et les responsables de la conception des postes de travail s’estiment généralement satisfaits si les paramètres physiques du travail permettent à 95 % du personnel d’exécuter les tâches assignées. Dans le cadre de mes recherches, j’entends souvent parler de ces 95 % de travailleuses et travailleurs « heureux ». En pratique, cependant, il est possible qu’un travail puisse effectivement être accompli par 95 % du personnel, mais que seule une minorité (généralement constituée d’hommes) de cette vaste majorité se sente à l’aise dans son environnement de travail. C’est pourquoi il est important de favoriser l’accès à une plus grande variété d’outils et d’équipements ainsi qu’à des meubles ajustables.
La gestion du personnel : si les différences liées au sexe qui ont été évoquées précédemment peuvent être perçues comme des faiblesses ou des inconvénients, on peut aussi tirer bien des avantages de cette diversité. Une gestion intelligente des ressources humaines doit viser à former des équipes régulières aux habiletés complémentaires travaillant dans un environnement propice à la collaboration. Des pompiers de sexe masculin m’ont déjà confié ne pas vouloir de femmes dans leur équipe parce qu’ils souhaitaient pouvoir compter sur des partenaires robustes pour les porter hors de danger s’ils étaient incommodés par la fumée. Pourtant, ces travailleurs étaient les premiers à reconnaître que ce type de situation ne survenait que très rarement.
Pour être efficace, en fait, une équipe de lutte contre les incendies doit compter des personnes grandes et fortes, d’autres plus petites et rapides, ainsi que d’autres avec une bonne capacité d’analyse. Ce que nous avons constaté, malheureusement, c’est que lorsque des femmes investissent des milieux de travail à prédominance masculine, on les encourage à adopter le plus possible le comportement de leurs collègues masculins. À cet égard, les syndicats ont tout avantage à inciter les employeurs à encourager la diversité de façon à tirer parti des aptitudes particulières de tous et toutes.
Le renforcement des liens de solidarité : pour des millions de travailleuses à faible revenu qui ont été victimes d’oppression, d’accidents et de blessures au travail, que les hommes et les femmes soient pareils ou différents n’a pas dû changer grand-chose. Différentes ou pas, nous ne voulons plus avoir honte de notre corps au travail. Nous en avons assez d’entendre les mêmes plaisanteries éculées au sujet de nos seins, de nos règles ou de notre ménopause. Nous voulons que notre corps cesse d’être considéré comme « différent » ou « atypique ». Il existe une grande diversité de corps humains parfaitement normaux – y compris le nôtre. Au travail, nous voulons qu’on prenne en considération le corps des femmes et leurs besoins comme on tient compte des besoins des hommes (bien qu’il y ait souvent place à amélioration de ce côté aussi).
Aujourd’hui, les travailleuses ont besoin d’unir leurs forces pour revendiquer les changements qui s’imposent. Lorsque nous cesserons d’avoir honte d’être des femmes, nous pourrons commencer à défendre nos intérêts – avec l’appui des syndicats, capables d’assurer la protection d’un plus grand bassin de travailleuses. Au-delà des considérations théoriques, il est dans l’intérêt des travailleuses à faible revenu de réclamer des mesures concrètes tenant compte de leurs différences biologiques (mais sans renforcer les stéréotypes) et favorisant à la fois l’égalité et la santé des femmes. Elles sont en droit de demander un cadre de travail adapté au « deuxième corps » et propice au travail en équipe.
Les changements requis peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de repenser l’environnement de travail en fonction d’un large éventail de corps humains, y compris ceux de femmes et d’hommes de divers âges ou origines ethniques. Ou d’accorder une attention particulière aux conditions susceptibles de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Ou encore de s’intéresser à la diversité humaine et aux manières possibles de s’y adapter et d’en tirer profit. Mais parfois, l’intervention qui s’impose, au-delà d’un cadre de travail spécifique, rejoint la sphère politique.
Des normes différentes pour les femmes et les hommes ?
La recherche d’un équilibre entre l’égalité et la santé des femmes au travail ne date pas d’hier. Dans le passé, par exemple, les femmes ont dû faire des choix difficiles concernant le travail de nuit[1]. En raison de la prétendue moindre résistance des femmes et des rôles sociaux traditionnels leur attribuant la majeure partie du soin des enfants, de nombreux pays ont interdit aux femmes de travailler de nuit en usine. Certains syndicats ont aussi réclamé une législation exemptant les femmes des quarts de nuit.
Selon les données scientifiques disponibles, le travail nocturne nuirait à la santé de la plupart des gens, interférant avec les biorythmes et augmentant le risque d’obésité[2] et de diverses maladies[3]. Les mères qui travaillent de nuit peuvent trouver particulièrement difficile de récupérer pendant le jour et ainsi accumuler des déficits de sommeil néfastes. En tant que féministe, semble-t-il, on peut donc se réjouir de l’adoption d’une législation visant à réduire les effets dommageables du travail de nuit sur la santé des femmes.
Mais pas si vite, car ce type de législation empêche également des femmes d’accéder à de bons emplois ou de travailler au sein d’équipes mieux rémunérées. Et la loi est arbitraire : dans le système de santé et d’autres secteurs perçus comme typiquement féminins, aucune mesure ne « protège » les femmes contre les méfaits du travail de nuit. Sans compter que les lois qui ciblent spécifiquement les femmes peuvent renforcer les stéréotypes de genre, permettant aux femmes (mais pas aux hommes) d’être plus disponibles pour leur famille, tout en réduisant leur accès à l’égalité économique. Pour respecter nos valeurs féministes, ferions-nous donc mieux de nous y opposer ?
Un autre exemple : les normes en matière de santé et sécurité au travail. Les autorités gouvernementales consultent souvent des ergonomes pour connaître le poids que peuvent soulever les femmes par rapport aux hommes. Effectivement, la manipulation d’une charge équivalente a un impact physio- logique plus élevé chez la plupart des femmes. C’est pourquoi bon nombre de féministes réclament des normes et des critères d’embauche différenciés selon le genre[4]. Mais est-il vraiment préférable de diviser ainsi en deux le marché du travail ? Une telle approche ne fermera-t-elle pas certaines portes aux femmes ? Et comment y réagiront les hommes plus petits et moins robustes ou les femmes plus grandes et plus fortes ? Tout ce beau monde voudra-t-il changer de catégorie ? Et où classer les personnes se définissant comme non binaires ?
Des normes de travail fixées en fonction du sexe soulèvent les mêmes enjeux que certaines compétitions sportives où des femmes « trop » douées en athlétisme, souvent noires, doivent se soumettre à des tests de « féminité[5] ». Le débat sur le taux « acceptable » de testostérone chez les athlètes, hommes ou femmes, est complexe, sans compter qu’il ne cesse d’évoluer à mesure que nous en apprenons davantage sur les subtilités de la production hormonale chez l’être humain[6]. Si on établit des normes différenciées dans certains milieux de travail, certaines femmes intenteront-elles des poursuites pour avoir le droit d’être assujetties aux normes masculines et d’obtenir ainsi un salaire plus élevé ? Certains hommes préfèreront-ils être encadrés par les normes féminines pour s’éviter des maux de dos ?
Quoi qu’il en soit, l’état actuel des connaissances est nettement insuffisant pour permettre d’établir des normes adaptées au sexe ou au genre. Et il existe d’ailleurs bien d’autres déterminants que les chromosomes XX ou XY à l’origine des différences physiologiques ayant une incidence sur le travail. De nombreux facteurs socioéconomiques jouent également un rôle important dans le développement du corps humain[7], et certains gènes « neutres » ont aussi une incidence sur les attributs physiques d’une personne.
Serait-il pertinent de réviser aussi les normes appliquées aux travailleuses et aux travailleurs immigrants d’origine est-asiatique, généralement moins grands et plus minces que les Nord-Américains ou les Européens ? Devrait-on aller jusqu’à effectuer des tests d’ADN chez les employés pour déterminer le seuil acceptable d’exposition à des substances toxiques en fonction de leur origine ethnique attestée[8] ? Ou vaudrait-il mieux opter pour des normes de travail plus générales et remettre aux employeurs la responsabilité d’offrir à toutes et tous un accès égal à l’emploi et un environnement de travail adapté ? Comment réagiront les gestionnaires d’entreprise ?
Comment amener les employeurs à créer des environnements de travail sains et sécuritaires ? La réponse ne relève pas uniquement de la science, mais de la justice organisationnelle et de l’action politique. Comme je l’ai déjà mentionné, nous devons d’abord et avant tout, en tant que femmes, cesser d’avoir honte de notre corps. Ensuite, travailler à mettre en valeur la diversité et le travail en équipe, et réclamer des outils et des équipements adaptés aux besoins de l’ensemble du personnel, femmes et hommes. Puis, tisser des liens de solidarité et d’entraide partout où c’est possible. Enfin, il faut cibler les changements qui s’imposent sur le marché du travail – un projet à teneur politique autant que scientifique.
*
Illustration : Wikimedia Commons.
Notes
[1] International Labour Office, «The Prohibition of Women’s Night Work in Industry : Current Thinking and Practice », dans General Survey of the Reports Concerning the Night Work (Women) Convention, 1919 (no 4), the Night Work (Women) Convention (Revised), 1934 (no 41), the Night Work (Women) convention (Revised), 1948 (no 89), and the Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948, Genève, International Labour Office, 2009.
[2] M. Sun, W. Feng, F. Wang et al., « Meta-Analysis on Shift Work and Risks of Specific Obesity Types », Obesity Reviews, vol. 19, no 1, 2018, p. 20-48.
[3] Jeanette Therming Jørgensen, Sashia Karlsen, Leslie Stayner et al., « Shift Work and Overall and Cause-Specific Mortality in the Danish Nurse Cohort », Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, vol. 43, no 2, 2017, p. 117-126
[4] Cox et Messing, « Legal and Biological Perspectives on Selection Tests », op. cit.
[5] Roger Pielke Jr. et Madeleine Pape, « Science, Sport, Sex, and the Case of Caster Semenya », Issues in Science and Technology, vol. 36, no 1, automne 2019, p. 56-63.
[6] Kaye N. Ballantyne, Manfred Kayser et J. Anton Grootegoed, « Sex and Gender Issues in Competitive Sports : Investigation of a Historical Case Leads to a New Viewpoint », British Journal of Sports Medicine, vol. 46, no 8, 2012, p. 614-617.
[7] Anne Fausto-Sterling, « Bare Bones of Sex : Part 1 – Sex and Gender », Signs, vol. 30, no 2, 2005, p. 1491-1527 ; Hana Brzobohatá, Vaclav Krajíček, Zdenek Horák et Jana Velemínská, « Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time : Insights into Shape Variation Using a Surface-Based Approach », PLoS One, vol. 11, no 11, 2016, p. e0166461, <doi: 10.1371/ journal.pone.0166461>.
[8] Mon bagage de généticienne me permet d’affirmer qu’il est absurde de chercher à définir l’origine ethnique d’une personne comme une combinaison de tel ou tel pourcentage de souche européenne, asiatique, etc., au moyen d’une analyse d’ADN, étant donné que chaque continent est occupé par des migrants de diverses provenances et que les espaces géographiques ne peuvent être caractérisés que par la fréquence de certaines formes de gènes (allèles) plutôt que par leur présence ou leur absence absolue. Par définition, on ne peut reconnaître la fréquence d’un allèle en particulier chez une personne, car il n’existe qu’un allèle ou deux pour chaque gène.








