
Les pauvres responsables de leur sort : une mythologie qui a la vie dure
Le parcours et les travaux de Michel Husson, économiste et militant ont déjà été évoqués sur ce site[1]. Son décès prématuré à l’été 2021 creuse un vide majeur dans la réflexion et les capacités d’élaboration économiques des marxistes en France, et, au-delà, de tous ceux qui refusent la doxa néolibérale. Il était capable aussi bien, voire mieux, que les économistes mainstream d’utiliser les outils de l’économie quantitative mais pensait simultanément que la maitrise de l’histoire économique et sociale était indispensable à la compréhension des évolutions passées et présentes de notre monde.
Dans ce livre posthume, ce « portait du pauvre en habit de vaurien », apparait surtout ce second volet, celui de l’économiste qui mobilise une vaste culture pour démasquer les discours mystificateurs sur la pauvreté et le chômage. Nombre d’économistes néolibéraux continuent en effet de prétendre, explicitement ou à mots feutrés, que les pauvres – ou les chômeurs – sont responsables de leur sort et qu’ils constituent une charge indue pour le corps social. Décrypter ces modes de légitimation de l’ordre social est sans doute une condition nécessaire à l’émancipation sociale. C’est ce qui a été tenté dans cet ouvrage.
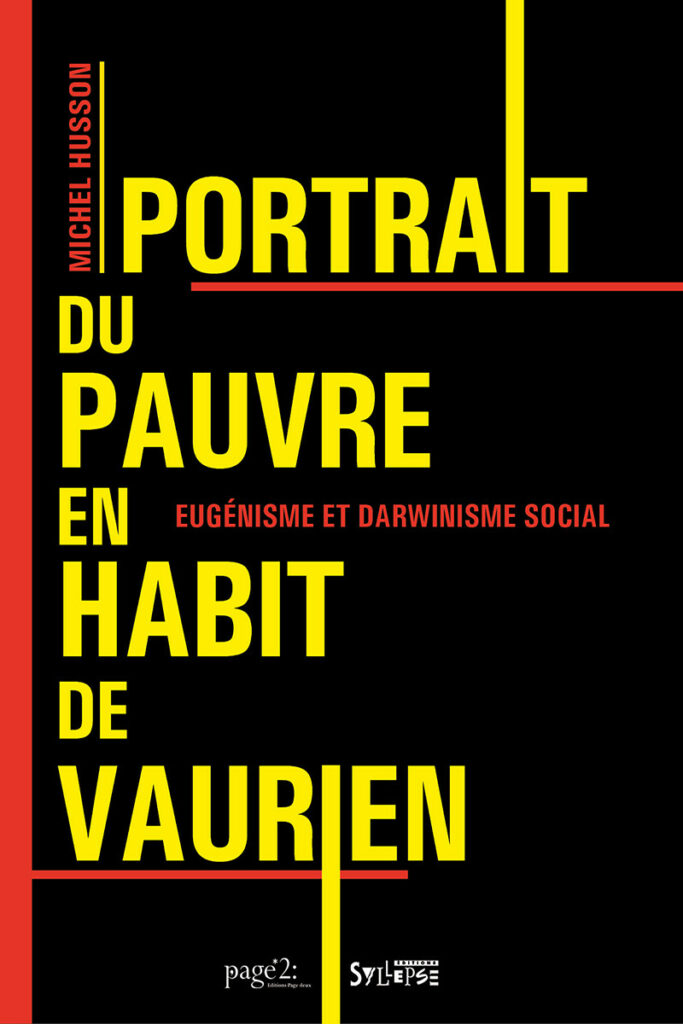
Dans l’introduction de son livre, Michel Husson en résume ainsi le fil directeur : « comment une société peut-elle tolérer de mettre à l’écart une proportion de «surnuméraires» ? » et il rappelle quelques lignes plus loin le témoignage d’un chômeur « qui avait le sentiment que la société lui adressait ce message: «Je n’ai pas besoin de toi», bref qu’il était «inutile au monde».
« Inutiles aux monde », était en fait une expression employée dès le 14e siècle pour désigner gueux et vagabonds. Elle donne son sur-titre au livre de l’historien polonais Bronislaw Geremek Truands et misérables dans l’Europe moderne, 1350-1600, et renvoie à l’idée qu’existent des humains qui sont « de trop », des surnuméraires.
« De trop » ces « vauriens » (le Littré signale qu’au 15° siècle, on trouve un « vaultneant » encore plus parlant) sans doute, et souvent considérés dangereux, mais pas totalement hors de la société et des rapports de travail : dans son ouvrage majeur Les métamorphoses de la question sociale[2], le sociologue Robert Castel montrait que bon nombre de membres de cette catégorie sociale exercent en fait un travail saisonnier ou autrement épisodique : le dépôt de mendicité de Soissons compte ainsi, en 1786, 854 internés dont 256 sont des « ouvriers manuels » et 254 des « ouvriers agricoles sans ressources ».
Robert Castel décrivait ensuite comment la montée, puis la généralisation du salariat et des acquis sociaux (ce qu’il qualifie de « société salariale ») a contribué à réduire, au moins dans les pays capitalistes développés, cette catégorie. Mais cette évolution sera lente et accidentée car l’ « armée industrielle de réserve » a une fonction essentielle forcer la « classe salariée qui se trouve en service actif […] à subir plus docilement les ordres du capital » [3]
D’ailleurs, le « troisième âge du capitalisme », pour reprendre le titre d’un ouvrage d’Ernest Mandel, verra à la fois le retour en masse de la pauvreté, du chômage et de diverses formes de travail précaire. Ceux qui subissent ces conditions et leurs conséquences ont fréquemment eu droit au surplus à la condescendance ou au mépris des puissants : pour François Hollande, ils sont les « sans dents », pour Emmanuel Macron, les « gens qui ne sont rien », soupçonnés à l’instar des salariés de l’abattoir Gad en Bretagne d’être illettrés.
Un peu plus loin dans son introduction, Michel Husson note qu’au fil des ans les multiples analyses dominantes du chômage et de la pauvreté « ont en commun le fait de vouloir rendre les chômeurs (ou les pauvres) responsables de leur sort ». Dans une salutaire entreprise de dévoilement, l’ensemble de l’ouvrage est ensuite une compilation minutieuse et une analyse de bon nombre des « discours de légitimation » de la situation des rejetés, des surnuméraires du XVIIIème siècle à notre époque.
La première partie porte sur la «gestion» des pauvres et l’évolution des premiers édifices idéologiques de justification de leur situation : l’ère des Lumières voit en effet une laïcisation des argumentations : la volonté divine est remplacée par les lois de l’économie et de la démographie. On peut à ce propos citer l’historien économiste Karl Polanyi :
« … on croit désormais que le marché autorégulateur découle des lois inexorables de la Nature et qu’il est d’une nécessité inéluctable que le marché soit libéré, qu’il soit débarrassé de toute entrave »[4].
En fait, quitte à solliciter un texte philosophique antérieur au bouillonnement des Lumières, le monde tel qu’il est serait « le meilleur des mondes possibles » comme l’a écrit Leibniz dès 1710 qui ajoutait :
« Il est vrai qu’on peut s’imaginer des mondes possibles sans péché et sans malheur, et on en pourrait faire comme des romans, des utopies […]; mais ces mêmes mondes seraient d’ailleurs fort inférieurs en bien au nôtre. »[5] .
Pour Malthus, dont le premier « Essai sur la population » est publié en 1798, la question essentielle, on le sait, est celle du déséquilibre entre la progression des ressources et celle de la population : la population augmente selon une progression géométrique tandis que la production agricole augmente selon une progression arithmétique. Il en résulte une situation où trop de gens se pressent à la table du « banquet » (pour reprendre un terme utilisé par Malthus) et sont des fauteurs de perturbation et de désordre. Les mesures visant à alléger la misère sont contre-productives car elles permettent aux pauvres de se reproduire en trop grand nombre.
Marx (cité par Michel Husson) s’est attaché à argumenter contre les raisonnements de Malthus :
« Les intérêts conservateurs dont Malthus était l’humble valet, l’empêchèrent de voir que la prolongation démesurée de la journée de travail, jointe au développement extraordinaire du machinisme et à l’exploitation croissante du travail des femmes et des enfants, devait rendre «surnuméraire» une grande partie de la classe ouvrière, une fois la guerre terminée et le monopole du marché universel enlevé à l’Angleterre. Il était naturellement bien plus commode et bien plus conforme aux intérêts des classes régnantes, que Malthus encense en vrai prêtre qu’il est, d’expliquer cette «surpopulation» par les lois éternelles de la nature que par les lois historiques de la production capitaliste. »
Mais cette critique vigoureuse n’a pas empêché le « malthusianisme » de se perpétuer de diverses façons jusqu’à la période présente. Michel Husson avait dénoncé « le retour des « fils de Malthus » dans un ouvrage antérieur[6]. Par ailleurs, on voit d’emblée, dès ce tournant du XVIIIème au XIXème siècle, s’entrecroiser trois thèmes essentiels destinés à être déclinés de multiples façons jusqu’à notre époque : celui de la responsabilité des pauvres (plus tard des chômeurs) dans leur situation, celui des effets pervers voire contre-productif des politiques qui visent à les aider ou les protéger et enfin le thème de la nécessité de distinguer absolument les vrais pauvres (inaptes au travail ou au moins capables de démontrer qu’ils font tous les efforts pour trouver une activité) des « paresseux » à l’affut de la moindre aide sociale.
Sur ce dernier point, on peut noter la déclaration de la Première ministre néo-fasciste italienne Giorgia Meloni le 1er mai dernier pour justifier un train de mesures antisociales : « Nous réformons le revenu de citoyenneté pour faire la différence entre ceux qui sont capables de travailler et ceux qui ne le sont pas ».
Un des chapitres les plus instructifs pour un lecteur français de cette première partie est celui consacré à la grande famine irlandaise de 1845-1851 qui, sur une population d’environ neuf millions d’habitants, fut marquée par un million de décès et plus d’un autre million de départs d’Irlande pour échapper à une situation mortifère. L’Irlande est à l’époque une colonie anglaise : les gouvernants de Londres et les grands propriétaires fonciers de l’île maitrisent la plupart des paramètres de la situation.
Au départ la pénurie de vivres a été générée par une maladie de la pomme de terre, Michel Husson montre comment elle va se transformer en catastrophe du fait de l’inaction cynique des gouvernants et de la brutalité des propriétaires fonciers. Loin d’être ébranlés, les dominants vont combiner, pour expliquer la famine et justifier le refus de prendre des mesures pour y remédier, tous les arguments possibles : de la Providence divine aux lois de l’économie en passant par l’infériorité raciale des Irlandais moins intelligents et plus paresseux que les Anglais et tout juste bons à exhiber et à exagérer leur misère pour obtenir de l’assistance.
La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée au «darwinisme» et à ce qui a été qualifié de « darwinisme social », c’est-à-dire à l’extension à l’espèce humaine du principe de sélection. Michel Husson s’immisce ici dans un débat complexe : l’historien des sciences et spécialiste français de Darwin, Patrick Tort a toujours vivement exonéré Darwin de toute responsabilité en la matière pour incriminer notamment le philosophe et sociologue Herbert Spencer (1820-1903) et le cousin de Darwin, le scientifique Francis Galton (1822-1911).
Pour Patrick Tort, en fait s’est produite une forme d’extraction de la nature humaine de la loi de la sélection naturelle à travers le processus de civilisation : « en termes simplifiés, la sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui s’oppose à la sélection naturelle. »[7] Tort revient inlassablement sur point sur ce point ; ainsi dans un ouvrage récent Du totalitarisme en Amérique[8], il dénonce la « lecture restreinte » de Darwin par Spencer qui lui permet « d’inféoder la société à une « loi »sélective qui chez Darwin ne vaut que pour l’évolution des vivants non humains et pour l’évolution anté-civilisationnelle de l’homme ».
Michel Husson, pour sa part, à partir d’une lecture minutieuse de Darwin et notamment de sa correspondance privée, montre que celui-ci restait prudent et ambigu tout en ne désavouant pas ceux qui qui se réclamaient de ses travaux et étendaient la sélection naturelle aux sociétés humaines. Michel Husson note également que Darwin soutenait que les femmes étaient inférieures aux hommes sur le plan intellectuel.
Husson montre l’influence de cette ligne de pensée, y compris chez les progressistes. Marx et Engels accueillent avec faveur les écrits de Darwin : sa théorie introduisait une rupture décisive avec les récits religieux de la trajectoire de l’espèce humaine. Ils évolueront ensuite vers une prise de distance à l’égard de l’application des thèses darwiniennes à l’analyse des sociétés humaines. Engels, cité par Michel Husson, écrira ainsi :
« la conception de l’histoire comme une suite de luttes de classes est plus riche et plus profonde que sa simple réduction à des phases à peine différenciées de la lutte pour la vie ».
Cependant, la pénétration du darwinisme et de ses avatars « spencériens » a été plus profonde, chez divers auteurs et notamment, ce qui peut paraître paradoxal, dans la social-démocratie, allemande et anglaise surtout. Pour prendre un exemple non cité dans l’ouvrage, les lecteurs de Martin Eden de Jack London ont certainement noté les références appuyées aux thèses de Spencer du personnage principal : « La vieille loi du développement est toujours valide », argumente-t-il. Le darwinisme semble fournir ainsi une nouvelle explication, voire une justification, à prétention scientifique, de la situation des pauvres et chômeurs.
Nous allons traiter plus rapidement des deux dernières parties de l’ouvrage, ce qui ne signifie pas que leur intérêt est moindre. La troisième partie traite des dérives du « darwinisme social » quand certains ont voulu en tirer la justification, non seulement des inégalités entre individus mais aussi entre peuples. Le français Vacher de Lapouge (1854-1936) affirme ainsi :
« Non seulement les individus sont inégaux, mais leur inégalité est héréditaire, non seulement les classes, les nations, les races sont inégales, mais chacune ne saurait subir un perfectionnement intégral et l’élévation de la moyenne est la conséquence de l’extermination des éléments pires, de la propagation des éléments meilleurs, de la sélection en un mot, inconsciente ou consciente. »
Des telles analyses ont souvent débouché sur la promotion de l’eugénisme : la reproduction de tous les « inutiles au monde » doit être limitée. Un tropisme eugéniste affirmé se retrouve logiquement chez des réactionnaires et racistes affirmés qui trouveront des mérites aux politiques d’amélioration de la « race » conduites par les régimes fasciste et nazi. Mais des dérives eugénistes sont aussi perceptibles chez aussi chez des progressistes comme l’écrivain H.G. Wells (auteur du « Meilleur des mondes »), l’économiste J.M. Keynes ou le scientifique et militant pacifiste Bertrand Russell.
Enfin, la quatrième et dernière partie s’attaque plus directement aux égarements de scientifiques qui s’avèrent avoir deux faces à l’instar du prix Nobel de médecine 1912 Alexis Carrel par ailleurs raciste, pétainiste et tenant de l’infériorité féminine. Michel Husson s’attache surtout ici à des auteurs, statisticiens et économistes dont les apports ont alimenté et sont toujours utiles aux travaux et à la réflexion des économistes contemporains. Il souligne que presque tous les fondateurs de la statistique étaient profondément réactionnaires, indépendamment de la qualité intrinsèque des outils qu’ils ont inventés et qui sont encore aujourd’hui couramment utilisés par les chercheurs (tel l’indice de Gini pour mesurer les inégalités).
Il en va de même de l’économie dont beaucoup de pères fondateurs révèlent à l’occasion une proximité sous-jacente avec le darwinisme social, même si ce lien n’apparaît pas dans leurs contributions majeures. Cette proximité peut-être doucereuse, voir honteuse, chez tous ceux qui, à l’instar des sociaux-libéraux, déplorent les ravages du Léviathan économique et de l’austérité budgétaire tout en émettant des préconisations qui ne remettent pas ou peu en cause leur impact sur « ceux d’en bas ».
Cette stigmatisation des pauvres et des chômeurs demeure pour Michel Husson plus ou moins sous-jacente aux théories modernes du chômage. Il aurait certainement développé ce dernier aspect s’il avait pu achever son livre. Tel qu’il est cet ouvrage est cependant d’un grand intérêt. Il incite à réfléchir sur la permanence et les aspects, multiples et renouvelés, des idéologies qui stigmatisent sous des formes plus sophistiquées que l’expression présidentielles déjà citée les « gens qui ne sont rien », ceux qui seraient incapables de « traverser la rue » pour trouver un travail, qui visent à les inférioriser et à les présenter comme trop couteux. « Décrypter ces modes de légitimation de l’ordre social est sans doute une condition nécessaire à l’émancipation sociale. C’est ce qui a été tenté dans cet ouvrage ».Telle est la phrase finale qui résume aussi d’une certaine façon un parcours d’économiste et de militant.
Le livre est complété par une préface de Laurent Cordonnier, auteur notamment de Pas de pitié pour les gueux (éd. Raisons d’agir), un petit livre d’une grande densité sur les théories économiques du chômage et d’une postface d’Alain Bihr, co-auteur avec Michel Husson de « Thomas Piketty : une critique illusoire du capital ».
Notes
[1] Michel Husson, de la critique du capitalisme à l’écosocialisme, 11 août 2021
[2] Robert Castel « Les métamorphoses de la question sociale », Fayard, 1995.
[3] Karl Marx, « Le capital », livre premier, tome III,
[4] Kar Polanyi, « La grande transformation », Gallimard, 1983
[5] Leibniz, « Essai de théodicée », 1710. Voltaire a fait une satire de Leibniz sous les traits de Pangloss dans Candide.
[6] Michel Husson, « Sommes-nous de trop ? », Textuel, 2000.
[7] Patrick Tort, « Darwin et le darwinisme » (4e édition 2011).
[8] Patrick Tort, « Du totalitarisme en Amérique », Erès, 2022.









