
« Il y a deux Réda dans le même survet, et crois-moi, on est comprimé là-dedans ! » – L’Effraction, d’Omar Benlaala
L’Effraction, Omar Benlaala, 2016 aux Editions de l’aube.
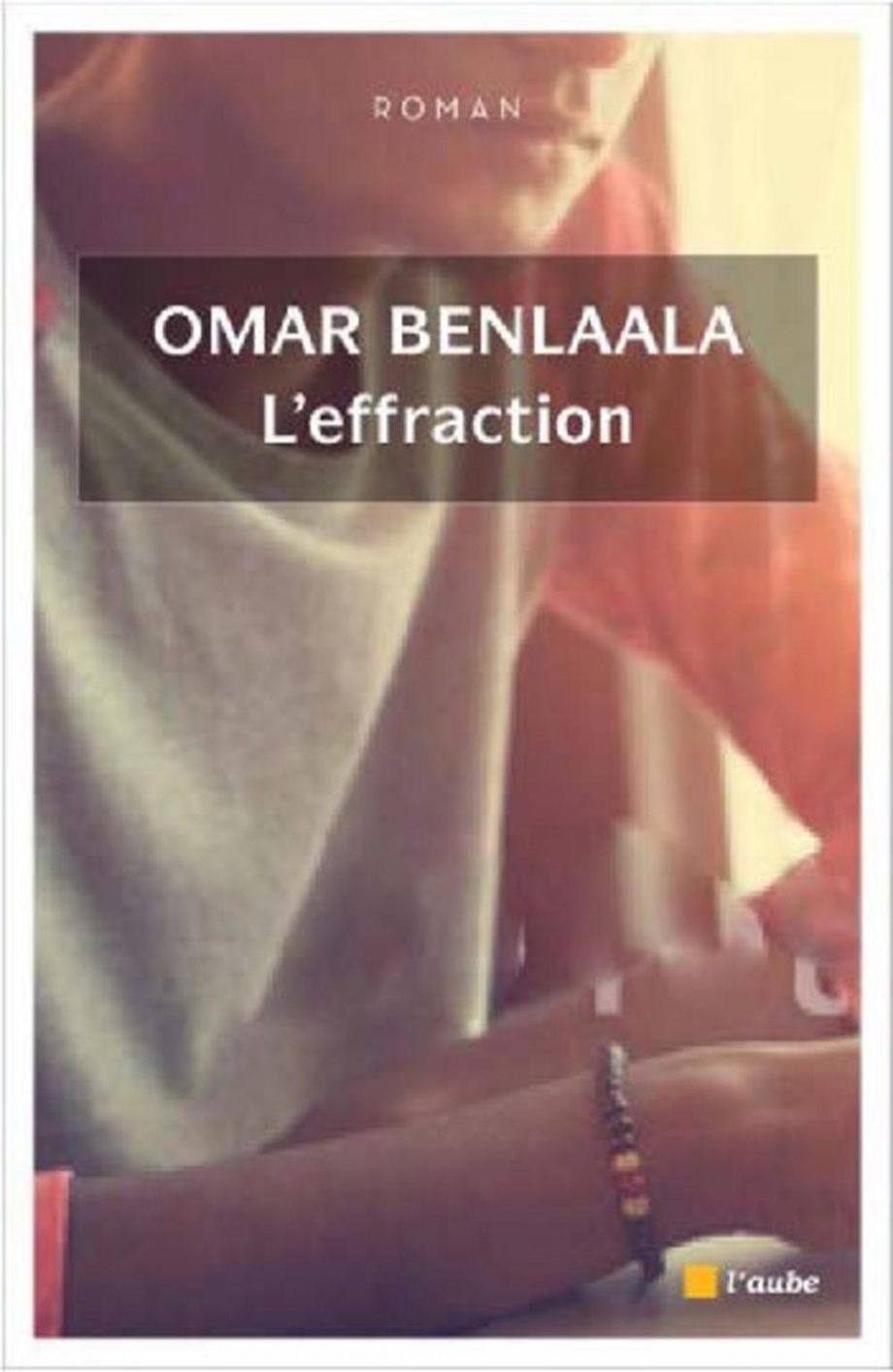
La littérature contemporaine est souvent taxée de nombrilisme. Tournée vers son auteur, son autrice ou sur elle-même plutôt que vers son lectorat, elle aurait remplacé les évènements du monde par les micro-évènements d’un « je » de plus en plus restreint à un petit milieu. Cette critique n’est pas dénuée de toute pertinence. Cependant, les écrits contemporains sont pluriels. Loin des récits autocentrés ou cyniques qui se complaisent dans une lucidité sans débouchés nous voudrions, dans cette chronique, mettre en valeur d’autres littératures : celles qui ne renoncent pas à dire le monde, ses luttes, ses échecs et ses espoirs.
***
L’Effraction d’Omar Benlaala est passé quasiment inaperçu lors de sa parution (2016). Pourtant, la démarche de l’ouvrage est particulièrement originale : Benlaala annonce dès le « Préambule » que son récit a été écrit à partir de et contre celui d’Édouard Louis, Histoire de la violence, phénomène de la rentrée littéraire 2015. L’Effraction reprend les personnages qui forment le duo d’Histoire de la violence : Reda devient Réda (mais c’est un nom d’emprunt, qu’il donne au sociologue qui l’interroge) et Édouard est rebaptisé Hédi, « Le Guide », par Réda. Un nouveau nom qui souligne le parti-pris de L’Effraction par rapport à Histoire de la violence : si, dans le livre d’Édouard Louis, Reda avait peu la parole, dans L’Effraction, c’est lui qui parle, tente de comprendre, tente d’expliquer. Précisons d’emblée que cette réécriture ne reprend pas, pour des raisons éthiques évidentes, la trame de l’histoire terrible racontée par É. Louis : le viol et la tentative de meurtre, mais seulement l’idée d’une rencontre (manquée) entre ces deux personnages. Il s’agit dans L’Effraction de recommencer, de refictionnaliser une histoire d’autant plus difficile à traiter qu’Édouard Louis l’a présentée comme absolument véridique. Ironie du sort, Édouard Louis a lui-même été attaqué en justice par son agresseur présumé, sous prétexte que son livre contreviendrait au principe de présomption d’innocence, ledit livre ayant été cité comme motif de dépôt. Benlaala, lui, choisit et revendique la fiction – même si on reconnaît dans son ouvrage bien des thèmes et des parcours dépeints dans le récit autobiographique La Barbe.
L’Effraction est un récit né d’une déception, qui entend combler ce qui apparaît à Benlaala comme une lacune dans Histoire de la violence : « Je m’attendais à y trouver, sous une forme narrative, une analyse des mécanismes de la domination en situation postcoloniale » (préface de L’Effraction). L’auteur ne s’appesantit pas davantage. Ce reproche est-il fondé ? Revient-il à reprocher à une victime la manière dont elle parle de son viol ? Non, car l’ouvrage d’Édouard Louis ne se présente pas comme le simple récit de son expérience, la relation d’un traumatisme individuel, mais comme une réflexion, voire quasiment comme une enquête, sociologiques. « Histoire de la violence » en général, nous dit le titre. Le préambule lui-même fixe un programme d’analyse : « En revenant sur mon enfance, mais aussi sur la vie de Reda et celle de son père, en réfléchissant à l’émigration, au racisme, à la misère, au désir ou aux effets du traumatisme, je voudrais à mon tour comprendre ce qui s’est passé cette nuit-là. Et par là, esquisser une histoire de la violence. » Les références à Bourdieu (et les convocations de figures bourdieusiennes) sont nombreuses dans le roman. Mais Histoire de la violence n’est pas à la hauteur de cette ambition. Il est possible de le reprocher au roman d’Édouard Louis sans remettre en cause sa parole en tant que victime : si le témoignage personnel qu’apporte Édouard Louis est intéressant et touchant, en fait de sociologie, le récit se résume à quelques considérations qu’on peut ranger hâtivement « à gauche », quand la gauche se résume à des réflexes ou des postures discursives : Reda a dû sans doute souffrir de sa condition de fils d’immigré, les flics sont racistes, c’est mal de porter plainte car la prison ne sert à rien, etc. Mais ces considérations sont très limitées, elles ne s’accompagnent pas d’analyse ou d’interrogation, ne permettent aucune compréhension, et risquent d’être politiquement contre-productives. Pas d’Histoire qui dépasserait l’histoire individuelle. Si nous saisissons pleinement le traumatisme psychologique d’Édouard, nous ne savons rien de Reda.
L’Effraction nous parle de Réda. À travers sa confrontation avec Édouard-Hédi, c’est le rapport à la sexualité et au monde social de Réda qui est interrogé. Réda est un jeune Parisien d’origine kabyle, de classe populaire, tiraillé par un secret qu’il ne sait pas confier, éprouvant un sentiment étrange de fascination et de répulsion pour Édouard-Hédi, celui qui pourrait le guider vers le monde des livres et de la connaissance, mais dont l’aisance sociale le terrasse et l’homosexualité le déstabilise : « Quand je dis que je trouve ça malsain, c’est parce que c’est plus pratique de le penser ». Tout d’Édouard-Hédi le renvoie à ses propres frustrations. Leur rencontre même illustre leur différence : quand il est hélé, place de la République, Réda pense immédiatement à un contrôle de police. Quand il voit la qualité des chaussures de son invité, il repense au fait qu’il a fallu qu’un ami lui dise que, s’il voulait espérer devenir acteur, il valait mieux qu’il évite les chaussettes blanches avec un trait de couleur aux castings. Quand Hédi lui parle de la Kabylie en évoquant Bourdieu et Sayad, Réda fait mine de les connaître et tente de dissimuler son ignorance : « Hédi et moi, j’ai bien vu qu’on n’était pas pareils. Pourquoi le nier, Jean-François ? Tout est fait pour ne pas se rencontrer. (…) On ne se côtoie pas, on ne se connaît pas, on ne peut pas s’apprécier ». C’est un malaise existentiel plus général que finit par révéler Réda, celui d’un fils d’immigré tiraillé entre deux cultures, deux identités ou plutôt deux manques, une incarnation de cette « double absence » dont parlait Sayad. Mais à quel niveau se décalage se situe-t-il ? Certes Réda répond à un sociologue qui l’interroge, après les événements de Cologne, dans le cadre d’une enquête « sur la sexualité des jeunes Français issus de l’immigration ». Mais cette catégorie est-elle pertinente ? La misère sociale, sexuelle, affective de Réda, qui s’écrie, désabusé « C’est pas au kebab que je vais rencontrer l’amour », vient-elle vraiment d’une distance culturelle, ou bien du fossé entre la réalité sociale et les discours marketing d’une société hypersexualisée où, comme le dit Réda, « [p]our écouler le dernier des yaourts, une houri[1] te fait méchamment de l’œil » ?
Le récit de Benlaala présente certaines imperfections – on peut ressentir, à la lecture, que le livre a été écrit hâtivement, Benlaala espérant ainsi répondre à celui d’Édouard Louis et lancer un débat qui n’a malheureusement pas eu lieu. Mais il a le mérite de se confronter frontalement à des sujets qui reviennent fréquemment dans l’actualité, les attentats, Cologne, ce fameux « jeune-de-banlieue ». L’Effraction est donc un exemple de mélange des genres contemporains, entre roman, témoignage, et analyse sociologique. Ce déplacement des frontières des genres, illustré d’une autre manière par D. Eribon et A. Ernaux, peut avoir son intérêt, littéraire et politique, s’il est réfléchi, et ne tourne ni au confort de l’écriture ni à la récupération. Dans Histoire de la violence, la double dimension romanesque et documentaire semble parfois être un prétexte pour ne pas se conformer aux exigences de la démarche sociologique. À l’inverse, sans proposer de réponses toutes faites (Réda n’est pas toujours un locuteur fiable, lui qui essaie de trouver sa voix au milieu des non-dits de sa famille, et des on-dit médiatiques qui l’environnent), L’Effraction prouve que l’(auto)fiction sociologique peut être une démarche littéraire exigeante.
Notes
[1] Le mot arabe houri désigne originellement les vierges du paradis. Mais le terme peut également prendre le sens de « très belle femme » ou de « tentatrice ».
Illustration: photographie, Françoise Larouge.









