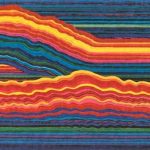Enquêter sur les violences sexistes et sexuelles. Entretien avec Lénaïg Bredoux
En 2016, Mediapart et France Inter révélaient les violences sexuelles (harcèlement et agression sexuelle) perpétrées par Denis Baupin sur quatorze femmes. Dans la foulée, et bien que l’enquête préliminaire qui s’est ouverte dans la foulée de la publication de l’enquête parlait de faits susceptibles d’être qualifiés pénalement, ce dernier dépose une plainte en diffamation. En février dernier, le procès se retourne contre lui[1]. Vendredi 19 avril 2019, Denis Baupin a été débouté de ses plaintes en diffamation et il a été condamné pour procédures abusives[2].
Contretemps revient avec Lénaïg Bredoux, journaliste à Mediapart, sur la signification de cette décision de justice mais au-delà, sur son travail de journaliste sur ces questions, sur la manière dont elle a mené l’enquête Baupin avec Cyril Graziani de France Inter, abordant à la fois les spécificités du monde politique, ses enquêtes en cours sur l’université et les difficultés pour les victimes à témoigner de ce qu’elles ont vécu, tout en soulignant comment après #Metoo, non seulement la parole se libère, mais est davantage entendue.
***
Contretemps : Qu’est-ce que cela signifie cette décision de justice, y compris pour toi en tant que journaliste ?
Lénaïg Bredoux : Cette décision de justice envoie un double signal. Elle signifie que les victimes sont légitimes à parler, et les journalistes sont légitimes à enquêter.
Il n’y a pas eu de procès Baupin car les faits étaient prescrits – l’enquête préliminaire qui avait été ouverte suite à l’enquête de France Inter et Mediapart avait été classée sans suite pour cette raison. Mais nous nous sommes tout de même retrouvé.e.s au tribunal car Denis Baupin avait porté plainte en diffamation contre deux articles de presse, sur Mediapart et France Inter. Ces plaintes ont conduit à la mise en examen de 12 personnes : deux journalistes, deux directeurs de publications, six femmes qui avaient témoigné à visage découvert et deux hommes qui avaient confirmé leurs récits à visage découvert.
C’est pour cette raison qu’il a pris une dimension très particulière alors que normalement, un procès de presse est quelque chose de très banal. C’était un procès extrêmement long puisqu’il a duré quatre jours. Par ailleurs, il a pris cette dimension également parce que lors des audiences, le procès s’est retourné contre celui qui l’avait intenté.
Parce que les femmes qui avaient témoigné ont redit au tribunal ce qu’elles avaient dit à l’époque, mais dans l’enceinte d’un tribunal ce qui confère une force toute particulière, celle de la justice. L’autre chose, c’est que les sources sont également venues témoigner de la solidité de l’enquête de presse.
Ces témoignages là étaient particulièrement forts, notamment celui de Cécile Duflot, en tant que responsable d’EELV qui n’avait pas traité les alertes de façon correcte et en tant que victime elle-même des agissements de Denis Baupin. On a aussi entendu son collaborateur de l’époque Stéphane Sitbon-Gomez expliquer qu’ils savaient tous et presque tout. C’est à mon avis fondamental au regard du rôle que peuvent jouer les témoins, et les témoins hommes, dans la lutte contre les violences sexuelles.
Par ailleurs, Denis Baupin a été condamné pour procédure abusive : cela signifie qu’aux yeux du tribunal, il n’aurait pas dû nous poursuivre ou maintenir sa plainte jusqu’au bout. C’est quelque chose de très rare en droit de la presse car on considère que quelqu’un mis en cause à le droit de se défendre – et c’est juste.
Mais ici, il y a plusieurs motifs qui motivent cette décision : Denis Baupin a refusé d’apporter sa propre version au moment de l’enquête ; il a refusé de venir au tribunal, il ne s’est jamais présenté – il a en revanche fait témoigner son actuelle épouse ainsi que ses deux anciennes compagnes – ; les faits rapportés par l’enquête pouvaient être qualifiés pénalement s’il n’y avait pas eu prescription ; tout l’argumentaire de l’avocat de Denis Baupin a été considéré comme abusif, car il se référait à des éléments postérieurs aux articles.
Dans le jugement, le tribunal balaye également l’idée qu’il s’agit de la vie privée – on parle de faits qui sont susceptibles d’être qualifiés pénalement comme délits (harcèlement et agression sexuelle). Par ailleurs, on se moque du fait que les faits soient considérés comme prescrits : le temps judiciaire n’est pas le temps médiatique.
Peux-tu revenir rapidement sur la manière dont vous avez mené l’enquête en 2016 ?
La première étape correspond à des alertes informelles, dans le cadre de mon travail de journaliste politique, parce que j’avais déjà publié sur ce sujet et que j’étais considérée comme sensible à ces questions. La deuxième étape, c’est Isabelle Attard qui explique à Edwy Plenel et Mathieu Magnaudeix durant l’été 2015 qu’elle a reçu des SMS de Denis Baupin lorsqu’elle est arrivée à l’Assemblée Nationale, ce qui l’avait mise très mal à l’aise. Nous décidons de commencer une enquête. Je piétine un peu dans un premier temps.
Puis, lorsque Denis Baupin met du rouge à lèvre à l’occasion du 8 mars 2016 pour défendre l’égalité entre les femmes et les hommes, cela déclenche des réactions de nos futures témoins clés, notamment Elen Debost. Cyril Graziani apprend alors cette affaire et nous décidons de travailler ensemble, Mediapart et France Inter.
A partir de là commencent deux mois d’enquête conjointe au cours de laquelle on aura interrogé 61 personnes. Il faut se souvenir qu’on est au printemps 2016, et qu’on n’est pas du tout dans le même contexte qu’aujourd’hui, après Weinstein et #MeToo. À ce moment-là, parler de violence sexuelle est presque considéré comme du militantisme. D’ailleurs, dans l’article, je n’utilise pas ces mots – la rédaction avait alors trouvé que c’était trop « violent ». Aujourd’hui, c’est un nom de rubrique chez nous !
Par ailleurs, on se disait qu’il nous fallait énormément de cas avant de publier quoi que ce soit. Nous n’avons pas utilisé certains témoignages. Par exemple, on se disait qu’on ne pouvait pas exposer la notion d’emprise à nos lecteurs-trices ou nos auditeurs-trices, qu’elle ne serait pas comprise, ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui.
On a tiré des fils avec une technique d’enquête très classique : on a demandé à une personne si elle en avait parlé pour recouper le témoignage. On a cherché à interroger des proches jusqu’à ce qu’on ait huit cas puis cinq cas supplémentaires à la fin du mois de mai et un quatorzième cas qui arrive à l’automne.
Ce travail signifie recueillir des paroles et ce n’est pas du tout spontané sur ces questions : la confiance se construit petit à petit et ensuite, c’est tout un travail de recoupement des informations, non pour mettre en question la parole des femmes, ce n’est pas du tout la question, je n’en doute pas à priori, mais c’est mon travail de recouper les informations et ce pour garantir une information la plus juste qui soit et aussi parce que cela protège les femmes dont on recueille les témoignages.
Sinon, on se retrouve avec des papiers pas vraiment satisfaisants de paroles contre paroles et où les femmes sont souvent exposées à des poursuites pour dénonciations calomnieuses, elles peuvent être moins crues et cela dessert tout le monde – les victimes présumées comme la presse.
Quelle sont les particularités du monde politique dans l’appréhension de ces questions ? Y-a-t-il des différences avec le monde du travail, par exemple ?
Évidemment, les violences sexuelles sont structurelles et existent partout, dans tous les milieux. Cependant, elles s’exercent de façon différenciées dans les différents domaines. Pour ce qui est du monde politique, le phénomène est très massif, du sexisme aux violences sexuelles – et on sait que l’environnement sexiste est le terreau des violences sexuelles. Ensuite, cela a été le règne de l’impunité et ce pendant très longtemps.
C’est très massif parce que c’est un domaine qui est dominé par des hommes : il a été conçu et pensé pour et par des hommes. L’Assemblée Nationale était très peu paritaire jusque récemment. À l’Assemblée Nationale et au Sénat, il y a un entre-soi masculin très prégnant. Il suffit d’interroger n’importe quelle élue pour qu’elle rapporte rapidement toutes sortes de remarques, de blagues. Ce sont des lieux où les rapports de pouvoir sont importants et dans le même temps, hypersexualisés.
Durant le procès, il a aussi beaucoup été question du fonctionnement des partis politiques : la solidarité, la loyauté vis-à-vis du parti politique, crée de l’autocensure de femmes qui ne souhaitent pas fragiliser leur parti et cela peut s’appliquer à toutes les organisations. Pour EELV, c’est également la cause de l’écologie au sens large qu’elles avaient peur de fragiliser.
Il n’y a pas de paradoxe sur le fait que EELV était très féministe et très paritaire. Elles ont raconté qu’il y avait même une sorte d’effet pervers de la parité car dans sa volonté d’être paritaire tout le temps, EELV a fait monter des femmes de régions peu expérimentées et peu averties des mœurs de certains dirigeants parisiens de leur organisation. Elles n’étaient pas préparées et ont finalement été mises en danger. Tous ces éléments constituent les ressorts spécifiques du monde politique.
Par ailleurs, comment cela s’était-il géré en interne à EELV ?
Dans le cas d’EELV, il y a eu de nombreuses alertes en interne. De nombreus-e-s militant-e-s étaient au courant. En réalité, c’est très souvent faux de dire que les femmes n’ont jamais parlé et se mettent à parler maintenant car dans la majorité des cas, les femmes avaient parlé, mais elles n’avaient pas été entendues.
Il y a eu des alertes, même si elles n’ont pas saisi les instances directement : il y a eu des paroles internes, mais pas de traitement interne. En 2015, à la tribune du conseil fédéral d’EELV, il y a même eu une intervention de la présidente de la commission féministe qui a fait mention de plaintes visant un cadre du parti. Tout le monde a pensé à Denis Baupin mais Emmanuelle Cosse, sa compagne, était alors secrétaire nationale d’EELV.
C’est parce que toutes ces alertes ont échoué qu’elles ont accepté d’en parler à la presse mais elles n’ont pas décidé d’alerter la presse. Ce n’est pas comme ça que cela s’est passé, c’est un contresens sur comment la parole s’est prise à l’époque. C’est parce qu’on vient les chercher qu’elles se sentent autorisées à en parler. Car très souvent, la honte est du côté des victimes, elles pensent que ce qu’elles ont à dire n’est pas grave ou pas intéressant. Elles se sentent coupables. De ce point de vue, les femmes politiques réagissent exactement comme les autres femmes.
Avaient-elles envisagé de porter plainte ?
Comme elles se disaient que personne n’allait les croire, que c’était parole contre parole, parce qu’elles avaient peur, elles n’envisageaient pas de recourir au droit. L’ouverture de l’enquête préliminaire a été déclenchée par l’article de Mediapart et France Inter. La justice s’est autosaisie et une enquête a été réalisée entre mai 2016 à mars 2017 pour harcèlement sexuel, agression sexuelle, appels malveillants. Elle s’est soldée par un classement sans suite en raison de la prescription : le parquet avait précisé que certains faits étaient susceptibles d’être qualifié « pénalement ».
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, quatre plaintes ont été déposées – mais ce n’est pas du tout une démarche qui est venue d’elles ; elles n’avaient pas prévu tout ce que leur témoignage dans la presse allait déclencher.
Ces affaires sortent-elles plus particulièrement à gauche de l’échiquier politique ?
Il faut relativiser cette affirmation car il y a eu des choses pour des personnalités de droite ou du centre. Je pense par exemple à Georges Tron. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer qu’il y a plus d’harceleurs sexuels dans les partis de gauche que dans les partis de droite.
Mais si c’était le cas, cela pourrait peut-être s’expliquer par le discours que l’on entend souvent : « je suis de gauche, je suis féministe, donc je ne peux rien faire de mal » et « personne ne peut me reprocher quoi que soit car je suis féministe et tous les 8 mars, je vais à la manifestation ou je signe une pétition ». Cette espèce de sentiment d’être dans son bon droit, cette sorte de légèreté peut renforcer une forme d’impunité.
Mais surtout, je crois que c’est parce qu’il y a une contradiction, insupportable, entre les valeurs affichées par ces mouvements et ce que vivent certaines militantes au quotidien. Cela rend la situation encore plus difficile. Par ailleurs, dans une organisation féministe, on met plus facilement les mots parce qu’on a une conscience plus aiguë de ces questions.
Dans tout le processus, vous avez donc une responsabilité importante en tant que journalistes. Qu’elle devrait être la responsabilité de la presse sur ces questions ?
Il y a une double responsabilité de la presse : elle doit enquêter sur ces sujets car jusque là, elle ne l’a pas fait. Le fait que les violences sexuelles aient été sous-traitées ou maltraitées dans la presse, a contribué à les invisibiliser et cela a permis de renforcer ce climat d’impunité.
Les journalistes n’ont pas non plus entendu les alertes, ils les ont laissées de côté. Ces affaires étaient considérées comme des affaires privées, des affaires de « bonnes femmes », indignes etc. C’est l’enjeu de la période dans laquelle on est maintenant – il y a aussi ce verrou médiatique à faire sauter et cela bouge spectaculairement en ce moment car les affaires Baupin ou Weinstein viennent toutes deux d’un travail journalistique, ce qui est donc un vrai encouragement.
Tu mènes depuis quelques temps des enquêtes sur l’université ? Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu es confrontée ?
En fait, sur l’université, comme sur la politique, nous parlons d’un endroit favorable aux violences sexistes et sexuelles. Dans la relation professeurs –étudiantes, tout particulièrement en master ou en thèse, l’ascendant est immense. C’est également une endroit où la cooptation est très forte, où l’entre-soi est également très prégnant – et les dommages potentiellement très grands pour la carrière si on s’en prend à des mandarins.
Par ailleurs, les procédures de sanction posent des problèmes. En cas de violences sexistes et sexuelles, l’université doit saisir une commission disciplinaire ou une commission d’enquête mais le plaignant, c’est l’université et pas la personne elle-même. De plus, on ne peut être jugé que par un grade équivalent à la personne accusée : un professeur des université ne peut être jugé que par un professeur des universités.
Ce sont des éléments structurels que le collectif CLASCHES[3] a déjà bien documentés et qui expliquent que cela reste encore très difficile. Même si cela commence à changer grâce au travail de Clasches et grâce à des lois, notamment de Najat Vallaud Belkacem qui ont fait évoluer les commissions disciplinaires, ce qui fait que la parole est davantage entendue et que des personnes osent davantage parler.
La presse, là encore, doit jouer son rôle. Comme journaliste, je suis de plus en plus contactée, par des profs, des étudiantes et des étudiants, des militantes féministes qui veulent parler de la situation dans leur université.
J’ai déjà publié une enquête sur Paris Diderot : j’ai découvert un niveau d’angoisse très élevé chez des femmes maitresses de conférences ou professeures, ce qui dit beaucoup de choses du rapport de force dans lequel elles sont. Par ailleurs, il y a également des cas de personnes qui ont déjà été sanctionnées et qui recommencent. Et quelquefois, c’est très surprenant de voir qu’il y a des cas de violences sexuelles dans une université ou un institut de recherche où sont produits beaucoup de travaux sur les questions d’égalité femmes/hommes, voire même sur les violences sexistes et sexuelles.
Propos recueillis par Fanny Gallot.
Notes
[1] https://www.mediapart.fr/journal/france/060219/le-proces-intente-par-denis-baupin-se-retourne-contre-lui
[2]https://www.mediapart.fr/journal/france/190419/denis-baupin-est-deboute-de-son-proces-et-condamne-pour-procedure-abusive?onglet=full