
Crimes racistes : vous avez dit « légitime défense » ?
Nous publions, avec l’aimable autorisation des éditions du CNRS, un extrait du livre de Vanessa Codaccioni : La légitime défense. Homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières (2018).
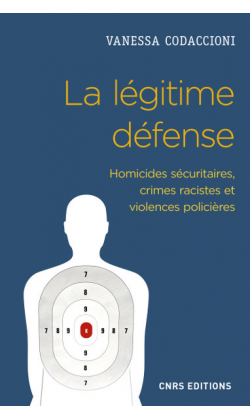
Extrait du chapitre 4 : « Un Far West français » (p. 144-154)
La quasi-totalité des affaires de légitime défense implique des hommes. Ce sont les hommes qui tuent ou blessent et invoquent la légitime défense, mais aussi des hommes qui sont victimes de cet usage privé de la violence. Si les femmes tuent peu dans le cadre de la légitime défense – ou ne tentent pas de qualifier leur crime comme un acte d’autodéfense – elles ne sont jamais victimes de « meurtres défensifs ». Cette faible détermination du critère du genre dans le cadre des cas judiciaires évoqués peut s’expliquer par le virilisme propre aux actes d’autodéfense – c’est l’homme qui protège la famille et ses biens – tout comme par la nature du port et de l’utilisation d’armes, essentiellement masculine. Là encore, ce sont les hommes qui achètent des armes, qui pratiquent la chasse ou qui sont membres de clubs de tir, seuls moyens légaux pour en détenir, quand les femmes sont incitées à se protéger par l’achat de bombes lacrymogènes ou de parapluies…
De l’autre côté de la séquence violente, ce phénomène s’explique également par la moindre proportion des femmes parmi le groupe des délinquants, ceux qui volent, qui agressent ou qui cambriolent, ce qui joue à la fois sur la perception de leur degré de dangerosité et sur leur exposition aux réactions violentes.
Aussi, de tous les cas d’homicide « d’autodéfense » médiatisés entre le milieu des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt-dix, un seul implique une femme. Il s’agit de l’affaire de « la boulangère de Reims » : le 12 février 1989, Marie-Joëlle Garnier, boulangère, tue Ali Rafa, 23 ans, fils d’un harki, qui s’était introduit avec d’autres jeunes hommes à 6h du matin dans sa boulangerie. Ces derniers lui ayant, selon ses dires, volé des pains au chocolat, elle se saisit d’une carabine et tue Ali Rafa d’une balle dans la tête, avant d’être inculpée d’homicide volontaire. Défendue par l’avocat Henri-René Garaud, elle invoque, pour expliquer son geste, la légitime défense (elle sera acquittée[1]).
Il y a donc bien des femmes qui blessent grièvement et tuent dans le cadre d’un vol ou d’une agression, puis évoquent ce fait justificatif pour éviter la répression. Mais la variable explicative ici n’est pas tant le sexe que la catégorie socio-professionnelle, cette dernière déterminant à la fois la possibilité de faire usage de son arme pour protéger ses biens et celle d’être défendue par les avocats qui vont plaider la légitime défense.
En effet, d’ordinaire, l’homicide est le propre de jeunes adultes inactifs, sans emploi ou précarisés, et déjà engagés dans des activités criminelles ou délinquantes. Ici à l’inverse, les auteurs de meurtre dits « défensifs » sont des travailleurs « d’âge mûr » et étrangers à toute forme de criminalité. En l’occurrence, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des commerçants et des artisans. Les auteurs d’homicide « défensif » sont propriétaires d’un bar, d’un hôtel, d’un garage, d’une bijouterie, d’un magasin de vente de matériel vidéo ou audio, d’une pâtisserie ou d’une boulangerie. A eux seuls, les commerçants et artisans représentent plus de la moitié des inculpés des grandes affaires de légitime défense de la période concernée[2], cette observation étant confirmée par les cas publicisés plus récents, comme celui du bijoutier de Nice en 2013[3].
Cette surreprésentation des indépendants dans les affaires de légitime défense trouve plusieurs types d’explications, qui tiennent à la fois au type de commerces qu’ils ont en gérance ou dont ils sont propriétaires, et qui peuvent être des lieux propices aux vols ou aux agressions, mais également à leur rapport à l’insécurité et à la délinquance. Ainsi, pour ce qui est des propriétaires ou des gérants de bars ou d’hôtels, la probabilité de passages à l’acte violents est démultipliée par les relations sociales qui s’y nouent, empruntes de camaraderies masculines et virilistes, et de comportements possiblement agressifs liés à la consommation d’alcool.
Parmi les cas les plus médiatisés citons celui de Guy Schneider, propriétaire d’un bar à Verdun qui, le 21 août 1977, abat Silas Bastien, un « métis de 22 ans » faisant figure « d’épouvantail » pour l’opinion locale[4] et qui, ivre, était en train d’agresser deux consommateurs et sa femme (il l’aurait saisie par les cheveux). Inculpé d’homicide volontaire, il est écroué à Bar-le-Duc. Moins de trois mois plus tard (1er novembre), Henri Lieutaud, 57 ans, sous-brigadier à la retraite et gérant d’un bar dans la banlieue lyonnaise, tue Charles Morel, 40 ans, ancien légionnaire qui le « rackettait et courtisait sa femme ».
L’autre grande affaire politisée par l’association Légitime Défense est celle du cafetier Michel Godard qui, le 5 décembre 1976, tue d’un coup de fusil Jean-Jacques Pinot, 26 ans, qui brisait les vitres de son café. Trois ans plus tard le même type d’homicide se produit lorsque Jean-Claude Tuduson tue d’une balle dans le dos Manuel dos Santo, le 1er janvier 1980, lui aussi en train de briser les vitres de son café. L’avocat Garaud, qui défend ces cafetiers, écrit dans ses mémoires pour justifier la thèse de la légitime défense, qu’il plaide lors de chaque affaire de ce type :
« Le métier de cafetier-restaurateur est sans doute le plus exposé. Le bistro c’est le salon populaire, pour pas cher, tout le monde y vient, la difficulté est de contenir les buveurs qui peuvent se révéler dangereux ».
Propices aux disputes interpersonnelles, aux bagarres et aux règlements de compte non seulement entre délinquants mais également entre des cafetiers pour la plupart armés et leurs racketteurs, les lieux de consommation d’alcool peuvent dès lors être, au regard de la dangerosité supposée des buveurs et de la nécessaire protection des clients, des lieux d’homicides « défensifs ».
Quant aux autres petits patrons et travailleurs indépendants, qu’ils soient bijoutiers, boulangers, vendeurs de matériel vidéo ou garagistes, ce sont les catégories socio-professionnelles les plus susceptibles d’être touchées par les atteintes aux biens, et plus précisément, par les cambriolages et les vols dans leur magasin. L’indistinction entre leur commerce et leur lieu d’habitation – ils vivent le plus souvent au-dessus de leur bar, de leur garage ou de leur pâtisserie – augmente d’ailleurs la probabilité d’être victime d’un vol mais aussi la crainte de la délinquance mineure.
Certains d’entre eux ont déjà été volés, cambriolés ou agressés dans leur commerce, une succession de précédents qui joue tout autant comme facteur de radicalisation dans la gestion des face à face avec des voleurs[5] que comme élément justifiant a posteriori l’usage létal et mortel de la violence. Ils sont d’ailleurs les plus enclins à adhérer aux thèses répressives et sécuritaires diffusées par Légitime Défense, et en particulier à celle du droit de défendre ses biens par les armes.
Enfin, une dernière catégorie d’auteurs d’homicide est particulièrement médiatisée à partir de la fin des années soixante-dix : celles des policiers, des vigiles, des agents de surveillance ou des « videurs » de boîte de nuit. Bien évidemment, ces derniers n’appartiennent pas au même corps de métier et n’ont pas les mêmes missions : les premiers ont une mission de maintien de l’ordre public, les autres doivent assurer la sécurité de lieux ou d’entreprises privées. Néanmoins, ces différents acteurs ont pour point commun d’exercer des « métiers d’ordre » dont les pratiques et les règles sont régies par le droit, la loi et l’État, et qui peuvent être amenés à porter des armes et à faire usage de la force létale.
En ce qui concerne les agents des forces de l’ordre, le recours à la légitime défense pour justifier un homicide n’est pas conjoncturel. Ce dernier est en effet intrinsèquement lié aux conditions d’utilisation de leur arme à feu : « L’utilisation d’une arme à feu par un policier est un acte grave, lit-on dans le Mémento du gardien de la paix de 1985 dont les dispositions sont restées inchangées. Dans une action individuelle, vous ne pouvez utiliser votre arme que dans le cas de légitime défense de vous-même ou d’autrui : il faut une agression injustifiée contre une personne, il faut une attaque caractérisée et non une simple crainte d’une éventuelle violence, il faut que cette attaque, cette menace soient actuelles ou imminentes et entraînent la nécessité immédiate de se défendre. Lorsque le danger est passé, il n’y a plus légitime défense (fuyard). Il faut que la défense soit proportionnée à l’attaque : l’usage de l’arme à feu suppose que l’attaque soit portée avec un objet coupable de procurer la mort ou des violences physiques graves ».
Autrement dit, les agents des forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leur arme que dans le cadre de la légitime défense, une légitime défense relativement encadrée puisque, pour être reconnue, celle-ci doit, comme pour les particuliers, réunir au moins trois conditions : l’immédiateté de la menace, sa gravité, et la proportionnalité. Et précisément, ce que l’on appelle les « bavures policières », euphémisme pour décrire une violence policière meurtrière, sont le plus souvent des cas d’usage des armes à feu en dehors du cadre de la légitime défense, c’est-à-dire des cas où les policiers se sont « trompés » de cibles, ont abattu un fuyard, n’étaient pas directement menacés, tout comme les gens qu’ils déclarent a posteriori avoir voulu protéger.
Hormis les cas des brigadiers Marchaudon et Marquet évoqués précédemment, de nombreuses « bavures policières » sont particulièrement publicisées et suscitent des indignations croisées à partir des années soixante-dix. C’est par exemple le cas de l’affaire Patrick Evra, un gardien de la paix motocycliste qui, le 13 mars 1978 à Paris, vide son chargeur sur une voiture, tuant deux frères qu’il avait pris pour des malfaiteurs : Alain et Bernard Chaussin[6]. Laissé en liberté, placé sous contrôle judiciaire, il est inculpé de « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner » tandis que le père des frères Chaussin demande la requalification des faits en « homicide volontaire »[7]. Mais le cas le plus connu à l’époque des faits est celui du CRS Gilles Burgos qui, dans la nuit du 4 au 5 juillet 1986, abat Loïc Lefèvre, en train de fuir un contrôle policier[8]. Quelques heures plus tard, la Préfecture de police de Paris publie un communiqué indiquant que Gilles Burgos a agi en « état de légitime défense » tandis que ce dernier, défendu par Henri-René Garaud et placé sous contrôle judiciaire, est laissé en liberté.
Ces « déviances policières » sont historiques et fréquentes, et doivent à un ensemble de facteurs déjà bien analysés par les spécialistes de la police. Il en va ainsi des facteurs individuels de l’agent (son âge, son sexe, son niveau de diplôme, sa couleur de peau), des facteurs liés à la situation et au déroulement de l’intervention comme le niveau d’informations reçu, le degré de crainte d’une menace, la nature du lieu (public ou privé), la cible et la raison de l’intervention, ou encore la perception d’un possible discrédit ou déshonneur causé par le « contradicteur »[9].
Plus généralement, ce que Fabien Jobard nomme « les conditions situationnelles du passage à l’acte », comprenant la perception de l’environnement par le policier mais aussi son équipement et le type d’armes, sont déterminantes[10]. Dans certaines périodes de crise, les injonctions à la brutalité ou à la répression de la hiérarchie policière doivent aussi être prises en compte, comme le montrent les massacres du 11 octobre 1961 ou, le 8 février 1962, de Charonne. Révélateur d’une violence d’État, ces crimes policiers sont dès lors des « événements hors norme » qui visibilisent une violence quotidienne et banale inscrite dans des répertoires policiers règlementés[11]. Néanmoins ce qui change dans la période étudiée est leur publicisation accrue, en partie induite par leur inscription politique et médiatique dans la série plus large des « affaires de légitime défense » mais aussi par une sensibilité croissante à tout type de violences, policières incluses.
Plus conjoncturelle en revanche est la multiplication des homicides dits « défensifs » commis par des vigiles ou des employés de société de gardiennage et de sécurité. Celle-ci doit aux conditions mêmes de la construction de cette nouvelle catégorie socioprofessionnelle naissante et peu réglementée. Une circulaire du 24 février 1967 tente d’encadrer leurs activités, spécifiant par exemple la manière dont ils doivent se distinguer des policiers. D’abord, si les vigiles doivent clairement être identifiables (par un vêtement ou un insigne spécifique), leur uniforme et leur carte professionnelle ne doivent pas ressembler à celle de la police.
De la même manière, et pour tenter de dépolitiser ce secteur dans lequel se recrutent d’anciens membres du SAC (Service d’Action Civique), de l’OAS (Organisation Armée Secrète) ou d’officines violentes[12], cette circulaire tente d’influencer le recrutement d’agents « au-dessus de tout soupçon », en conseillant aux sociétés de gardiennage d’employer d’anciens gendarmes ou des militaires en retraite. Or, dans les années soixante-dix, la plupart des agents de société de gardiennage sont recrutés à partir de deux « viviers » principaux. Ce sont soit des étudiants ou des retraités qui trouvent dans ces emplois non qualifiés un débouché professionnel et un moyen d’obtenir rapidement des ressources financières, soit des « nostalgiques » des guerres coloniales ou des candidats ayant échoué aux concours de la fonction publique, et qui voient dans la possibilité de porter une arme l’occasion d’incarner une « autorité » et une source d’honneur.
Cette question de la détention et du port d’armes, l’une des plus problématiques du secteur car elle débouche sur de nombreux incidents mortels. Certaines sociétés de gardiennage et de sécurité forment leurs propres agents, en leur apprenant l’usage des armes et en leur enseignant les conditions d’exercice de la légitime défense et son champ d’application[13]. Mais certaines ne prévoient aucune formation et leur activité ne consiste qu’au recrutement de garde du corps ou de « gros bras » envoyés dans des entreprises en grève, des configurations « à risque » qui peuvent déboucher sur des violences mortelles.
C’est ce qu’il se passe au sein des Etablissement Pirault et fils à Epône (Yvelines) : le 10 novembre 1984, alors que les ouvriers, pour la plupart turcs, sont en grève pour protester contre leur licenciement ou réclamer des mois de salaire non payés, l’agent de surveillance Jacques N’Dzana, un camerounais de 28 ans, tire au fusil à pompe sur l’ouvrier communiste Kemal Ozgul qui meurt sur le coup. Immédiatement lu dans le champ politique à travers une grille de lecture politico-syndicale et réinscrit dans la lignée des cas de répression patronale comme le montrent les références constantes à l’affaire Pierre Overney[14], cet homicide devient l’une des grandes affaires de légitime défense de la décennie quatre-vingt.
Un ample mouvement de solidarité en faveur de la victime est engagé par la CGT et d’autres syndicats, organisations ou associations (CFDT, FO, LDH) tandis que de nombreuses personnalités politiques, socialistes et communistes mais pas seulement, publicisent leur indignation. Le climax de la politisation de l’affaire est atteint lorsque le Président de la République, François Mitterrand, va s’incliner le 12 novembre 1984 devant la dépouille mortelle de Kemal Ozgul à l’Institut médico-légal de Paris. Après avoir dénoncé la « violence qui gagne du terrain », le chef de l’État poursuit :
« Je suis venu m’incliner devant ce corps parce que je suis Président de la République française, et j’entends que la France soit avec moi présente[15] ».
Néanmoins, de telles mobilisations sont extrêmement rares, d’une part parce que les victimes et leurs familles ne disposent pas des ressources favorables à l’émergence de mouvements de soutien comme ici des ressources politiques, et d’autre part parce que le propre de ces affaires de légitime défense est d’invisibiliser les victimes d’homicide, notamment lorsqu’il s’agit de jeunes marginaux, précarisés et, souvent, issus de l’immigration maghrébine.
*
Crédit photo : Martin Noda / Hans Lucas.
Notes
[1] Cf. Chapitre 6.
[2] Dans notre corpus, ils représentent quinze cas sur vingt-huit où la profession du tireur est connue.
[4] Le Monde, 23 août 1977.
[5] Sébastien Roché, « Expliquer le sentiment d’insécurité : pression, exposition, vulnérabilité et acceptabilité », Revue française de science politique, n°2, 1998, pp. 274-305).
[6] Le Monde, 16 mars 1978.
[7] Le Monde, 17 mars 1978.
[8] Le Monde, 9 juillet 1986.
[9] Fabien Jobard, Jacques de Maillard, Sociologie de la police. Politiques, organisations, réforme, Paris, Armand Colin, 2015, p. 55 et suivantes.
[10] Fabien Jobard, Bavures policières ? La Force publique et ses usages, Paris, Éditions La Découverte, 2002, p. 235.
[11] Comme l’a montré Alain Dewerpe pour le massacre de Charonne : Charonne, 8 février 1962, Paris, Gallimard, 2006, 897 p.
[12] Daniel Warfman, Frédéric Ocqueteau, La sécurité privée en France, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 16 et 17.
[13] Le Monde, 9 mai 1979.
[14] Pierre Overney est militant gauchiste abattu le 25 février 1972 par le vigile des usines Renault Billancourt Antoine Tramoni.
[15] Le Monde, 14 novembre 1984.









