
À lire un extrait de Mémoires déboussolés, de Goran Fejić
Goran Fejić, Mémoires déboussolés. Mes pays et autres causes perdues, Paris, L’Harmattan, 2018, 378 p.
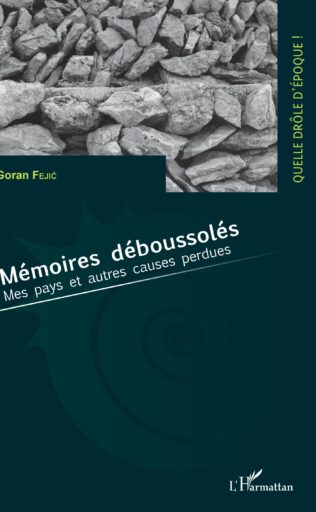
Goran Fejić est né à Sarajevo, Yougoslavie, en 1946. Diplomate de son pays jusqu’à sa disparition en 1992, il s’engage ensuite à titre personnel dans des missions de paix de l’ONU : Haïti, Afrique du Sud, Guatemala, Afghanistan… Son récit autobiographique est coupé de réflexions politiques. Il retrouve dans d’autres conflits les mêmes syndromes d’exclusion et du rejet de l’autre qui ont mené à la guerre fratricide dans les Balkans et qui sapent aujourd’hui les grands espoirs suscités par la fin de la Guerre froide.
***
Le geste (Afrique du Sud, 1994)
Comme nous le savons tous, une campagne électorale consiste, dans la plupart des cas, en une série de promesses intenables, de mensonges criants et de viles bassesses. On mobilise et on aguerrit son camp. On traite l’adversaire avec arrogance et mépris. On caresse ses ouailles dans le sens du poil, on loue leurs sacrifices et leur courage. La « nation », le « peuple », les « jeunes », les « forces vives », peu importe. Le candidat et ses électeurs ne doivent faire qu’un. « Tout ce qui a trait au moral, au décent et même à l’esthétique, souffrira dans une campagne électorale »[1]. Avez vous jamais vu un candidat réprimander sa base électorale, leur dire une vérité déplaisante ?
Fin février 1994 : ils viennent tous les deux à Kimberley. Pas ensemble, bien sûr. L’un après l’autre. D’abord F.W. De Klerk : le Blanc, le candidat du Parti national (NP). Il a évolué depuis la chute du Mur, il faut bien le reconnaître. Il a fait sortir Mandela de prison, il a négocié avec lui le démontage graduel de l’apartheid. Il se présente aujourd’hui comme le candidat de tous les Sud-Africains sages et modérés, opposés aux grands bouleversements. Mais, peut-on oublier que c’est bien sous son régime que Madiba cassait les pierres à Robben Island ? Que c’est bien lui – F.W. De Klerk – qui prônait la ségrégation raciale à outrance dans les universités ? Que c’est lui, encore, qui fut le promoteur des lois interdisant et criminalisant les rapports sexuels entre personnes de races différentes ? Il commence sa journée par une visite à l’hôpital. C’est un bel hôpital de centre-ville, riche et bien équipé. Puis, il visite un collège dans le même quartier huppé. Il souhaite terminer la journée par une visite au township de Ghaleshewe. Mais le township est fait d’un matériau hautement inflammable et justement, à l’idée de devoir accueillir le candidat F.W. De Klerk, il explose. Les jeunes se rassemblent sur les talus, des amoncellements de pneus sont incendiés aux croisements des rues et bientôt les cocktails Molotov voleront vers les Casspirs, ces hideux véhicules blindés de la police. Face à ces regrettables circonstances, le service de sécurité du candidat De Klerk lui conseille fermement de laisser tomber sa visite au township. Le candidat s’exécute. Il n’a vraiment pas le choix. Les observateurs onusiens sont navrés mais n’y peuvent rien.
Quatre jours plus tard, le 25 février 1994 précisément, c’est Nelson Mandela, candidat du Congrès National Africain (ANC) qui visite la ville. Il commence également sa tournée par une ou deux institutions du centre-ville, puis se dirige vers le stade du township. Une autre atmosphère y règne : ballons multicolores, feux d’artifice, drapeaux, chants des écoliers et écolières, uniformes lavés et repassés, rubans dans les cheveux des fillettes, casquettes aux armoiries de l’école sur les têtes des garçons, vendeurs de glaces, boissons pétillantes et autres barbe à papa, syndicats, organisations de la jeunesse, militantes féministes, commerçants et ménagères, porteurs de panneaux aux couleurs jaunes et vertes de l’ANC, grands portraits de Madiba. La fête est partout. Le stade déborde. Des heures passent avant que le programme puisse démarrer et que le maître des cérémonies puisse annoncer l’orateur que tout le monde attend et qui n’a point besoin d’être présenté.
La parole est à Madiba. Mais, Madiba attend que la ferveur s’apaise, que les vivats se calment. Les gens le comprennent et, impatiemment, l’index sur les lèvres serrées, font signe les uns aux autres de se taire. C’est fait. Alors, Madiba parle. Sa voix est à peine audible. L’équipement sonore du stade n’est pas des plus performants. Mais, il parle avec emphase et articule bien. Et voilà ce qu’il dit :
– Mes amis ! Lorsque j’ai appris ce qui s’est passé ici il y a quatre jours et comment vous avez traité mon adversaire, le candidat à la présidence Monsieur De Klerk, j’ai été choqué et attristé. Je lui ai téléphoné sur le champ et lui ai exprimé mes regrets et mes excuses. Je l’ai fait en mon nom, bien sûr, mais en votre nom également. Vous avez commis une faute grave en vous comportant envers lui comme vous l’avez fait, en l’empêchant de venir vous voir et vous parler. Ce que vous avez fait est exactement le contraire de ce que nous voulons avoir dans la nouvelle Afrique du Sud pour laquelle nous allons voter ! Ce n’est pas ça la démocratie ! Vous auriez dû accueillir M. De Klerk comme vous m’accueillez moi, aujourd’hui. Vous auriez dû l’écouter comme vous m’écouterez, moi. Et après nous avoir écouté tous les deux, à vous de choisir à qui vous accorderez votre confiance. Non seulement parce que, comme moi, M. De Klerk est candidat à la présidence et qu’il a le droit de s’adresser aux électeurs. Mais, parce que M. De Klerk, lui aussi, est compatriote sud-africain !
Ces derniers mots résonnent dans le stade avec une parfaite clarté :
– Because he too is a fellow South African !
Silence. On a la chair de poule et la gorge un peu serrée. Madiba peut continuer.
Vote the beloved country[2] titrait l’un des grands quotidiens de Johannesbourg le jour de l’élection. Et publiait le lendemain la photo d’une belle fille noire entraînant dans la danse un policier blanc à l’air un peu paumé.
***
Xamán (Guatemala, 1995)
5 Octobre 1995. Une année devra encore s’écouler jusqu’à la conclusion des Accords de paix. Le pays bouge, mais rien n’est certain. Les vieilles peurs sont toujours là, le doigt toujours sur la gâchette.
Après-midi tranquille au bureau de Cobán. Je suis occupé à finaliser un rapport. Deux équipes parcourent la province en Landcruiser, en zigzaguant au gré des pistes poussiéreuses. Une équipe visite le Nord de l’Alta Verapaz – la malfamée « Frange transversale du Nord », zone peu peuplée à la lisière du « front pionnier » du Petén, un patchwork de villages et de grandes propriétés terriennes bradées par le gouvernement dans les années quatre-vingt à certains de ses fidèles serviteurs, militaires pour la plupart. Ces derniers mois, plusieurs communautés de retornados – anciens exilés au Mexique, sont venues s’y installer. Elles avaient fui la violence en emportant le nom de leur village. Avec le calme qui semble revenir et surtout après la signature de « l’Accord sur le retour » du 17 juin 1994, certains groupes d’exilés reviennent. Parfois, avec un nouveau nom. Parfois, avec l’ancien. Mais, même quand ils reviennent avec leur ancien nom, l’endroit de leur réinstallation n’est plus le même. Leurs anciennes terres ont été occupées, vendues et revendues. Les villages ont bougé sur les cartes géographiques, personne ne s’y retrouve.
Soudain, message alarmant de l’une des équipes : Les « Médecins du monde » d’un village viennent de capter par radio un appel au secours du village voisin nommé – « Aurora – 8 de Octubre ». Les militaires auraient attaqué les retornados. Il y aurait de nombreuses victimes. C’est énorme ! Cela paraît impossible ! J’ordonne à l’équipe la plus proche de s’y rendre tout de suite ; je fais dévier une autre équipe de son itinéraire prévu pour qu’elle s’y rende également. Je me dis qu’il doit y avoir un malentendu. Cela ne correspond à rien : ni au processus politique engagé, ni aux intérêts de l’armée et du régime. Je téléphone tout de même au QG et demande qu’ils préparent un hélicoptère au cas où l’information serait véridique. Ils sont encore plus incrédules que moi. Ils parlent aux militaires tous les jours, les négociations avancent, l’atmosphère est prometteuse.
– Faites attention au vocabulaire quand même, avant d’avoir bien vérifié les faits !
Mais, quelqu’un a déjà lancé le mot « massacre ». La première équipe, arrivée à Aurora en un peu plus d’une heure, confirme l’horreur et répète le mot :
– C’est un massacre, oui un massacre !
Les morts sont encore étendus sur l’herbe à l’endroit même où ils ont été fauchés. Il y a des dizaines de blessés. Les gens sont stupéfaits et ne peuvent, ne savent rien expliquer.
– Restez y, restez avec eux, notre hélico ne vole pas la nuit.
En roulant vers le village, l’équipe a rencontré une patrouille militaire. Les soldats étaient agités et ont confirmé « qu’il y a eu un incident à Aurora », qu’il y a des blessés. Le lendemain matin, nous y sommes tous. Les corps sont encore sur l’herbe, couverts de bâches. Il y a onze morts dont deux enfants, une trentaine de blessés. L’hélico évacue les blessés vers la capitale, fait des allers-retours pendant toute la journée. Nous sommes confus. Nos oreilles bourdonnent dans la moiteur tropicale, parmi des nuages de moustiques. Nous arpentons les sentiers boueux de cabane en cabane, cherchons quelqu’un qui puisse nous aider à comprendre. Il faut trouver des témoins qui veuillent bien parler. Comment la tuerie a-t-elle été déclenchée ? Pourquoi ? Mais aussi, et c’est même ce qui semble le plus urgent, montrer aux gens que nous sommes avec eux. Les réconforter. Ce n’est pas évident. Nous arrivons en hélico et dans une flotte de gros 4×4, nous avons l’air d’être puissants, comment peuvent-ils savoir que nous ne sommes pas avec les militaires nous-mêmes ? Les chefs du village devraient le savoir, mais les autres, les paysans indiens traumatisés, pourchassés et abusés depuis toujours, avec la mémoire de leur fuite et de leurs villages en flammes ? Et puis, il y a parmi nous aussi des hommes en uniformes. Les uniformes font peur. Personne ne leur a dit que les policiers civils et les conseillers militaires de la MINUGUA ne sont pas guatémaltèques. Ils ne font pas la distinction. Les guardias civiles espagnols, les carabinieri italiens, mon conseiller militaire suédois. De surcroît, les jeunes infirmiers de Médicos del mundo – España, qui vivent dans la communauté et partagent le sort des gens, ne nous aident pas beaucoup, pour le moins, au début. Avec eux aussi, la confiance tarde à s’établir. Ils sont basques pour la plupart et n’apprécient pas, mais alors pas du tout, que nous ayons des guardias civiles parmi nous.
– ¡ Un guardia civil para averiguar violaciones de los derechos humanos ! Tu te fous de moi ? ¡ No me hagas reir !
Et puis, ni les Indiens, ni ces jeunes infirmiers basques ne comprennent vraiment ce qu’il y a à « vérifier ».
– Les morts sont-ils là, oui ou non ? Vous les avez vus, vous avez vu les blessés et vous avez même rencontré les soldats qui s’échappaient du village.
La chose leur paraît évidente.
– ¡¿ Que prueba más necesitan, carajo ?!
Les soldats, les ennemis des insurgés et des Mayas, leurs persécuteurs depuis toujours, les mêmes qui, il y a dix ans, ont brûlé leurs villages et les ont fait fuir vers le Mexique, sont de retour. Des jours passeront avant qu’un semblant de confiance ne s’établisse. Il y a d’autres dilemmes aussi. Nous ne voulons pas seulement établir « notre » version des faits. Nous voulons que la justice du pays s’y mette car c’est cela qui, en fin de compte, montrera vraiment si le pays est en train de changer. Faut-il recueillir les douilles qui traînent dans l’herbe et sur les sentiers – éléments de preuve importants – avant qu’elles disparaissent ? Ou bien, faut-il expliquer aux gens qu’ils ne doivent toucher à rien avant que le procureur vienne enquêter ? Mais la justice guatémaltèque, empêtrée dans sa paperasse et menacée elle-même par les militaires, mettra des semaines à venir. Encore la MINUGUA devra-t-elle l’héliporter. Entre temps, nous devons donner la priorité à « notre » vérification. Un à un, les retornados sont interviewés. Leurs témoignages sont souvent imprécis, surtout lorsqu’il s’agit d’estimer un nombre, une durée, une distance. Combien de soldats ? Combien de temps ? A quelle distance à peu près ? Les gens sont épuisés, à deux pas du découragement, de la résignation. Quel est le sens de toutes ces questions ? A quoi bon puisque rien ne changera ? Nous interrogeons aussi les soldats de la patrouille : le Colonel – Chef de la Zone militaire de Cobán – aurait reçu l’ordre de nous y autoriser. Avec les soldats, nos « uniformés » se révèlent être un atout. Leurs grades impressionnent et induisent une réaction d’obéissance. Aux gradés, les soldats répondent. On les a « préparés », c’est évident, mais ils tombent vite dans des contradictions et finissent par dire des choses vraisemblables.
Le QG est impatient. Les journaux de la capitale publient des versions de plus en plus farfelues de ce qui se serait passé à Xamán. Les « analystes » se disputent la connaissance de « ces contrées éloignées et encore peu parcourues de notre pays… jadis infestées par la guérilla, aujourd’hui repeuplées par leurs partisans, les retornados ». Une version – sans doute inspirée par l’armée et la G2 – veut que les communautés de retornados ne soient en fait que de la guérilla déguisée, réarmée. Les villageois Maya – depuis toujours hostiles à l’Etat – auraient donc embusqué les soldats qui n’auraient fait que se défendre. Une autre version prétend que la MINUGUA elle-même était en collusion avec les retornados afin de piéger les soldats. Preuve suprême : les équipes de la Mission sont arrivées sur le lieu deux heures à peine après les faits ; « or chacun sait qu’il faut une demi-journée au moins pour s’y rendre à partir de n’importe où ».
Quatre jours après le massacre, nous envoyons un premier rapport, encore assez approximatif, mais nous y affirmons déjà que les villageois n’étaient pas armés. Nous soulignons que l’Etat guatémaltèque, par le biais de son armée, est le seul responsable de cette gravissime « violation du droit à la vie », la plus grave depuis l’arrivée de la mission dans le pays.
Deux semaines plus tard, un rapport détaillé établit la dynamique des événements. Les témoignages sont comparés, analysés. Les pièces du puzzle finissent par tomber à leur place. Nous n’avons trouvé que des douilles qui correspondaient aux armes en dotation de l’Armée. Finalement, la plupart des contradictions initiales disparaissent et s’expliquent.
La dynamique[3]: la patrouille de soldats de l’avant-poste de Rubelsanto, dirigée par le Sous-lieutenant Camilo Antonio Lacan Chaclán, effectue un parcours à pied qui inclut plusieurs villages de la région y compris la communauté de retornados Aurora-8 Octubre. Objectif : « reconnaissance et activités civiles[4] ». Le matin du jour fatidique, à la lisière du village, quelques retornados rencontrent la patrouille. Ils demandent aux soldats d’expliquer leur présence sur les terres du village, intrusion qui, selon eux, constituerait une violation des accords sur le retour des réfugiés[5]. Les soldats expliquent qu’il s’agit d’une patrouille de routine et qu’ils n’ont pas « d’intentions hostiles ». Cependant, les villageois restent inquiets et continuent à demander des explications. Ils évoquent, entre autre, le rôle sinistre que l’armée a joué pendant les « années de la violence ». Les soldats tentent d’expliquer qu’il ne s’agit plus de la même armée – ya no es el ejército de entonces – et qu’on ne peut leur imputer la responsabilité des violences commises en ces temps-là. Ils demandent à rencontrer les chefs du village. Il y aurait eu, également, un échange de vues sur l’opportunité d’inviter la patrouille à la fête qui se prépare pour célébrer le premier anniversaire du retour du Mexique. Les soldats, ayant eu vent des préparatifs pour la fête, demandent d’y participer, mais les villageois ne sont pas d’accord entre eux. Entre-temps, les soldats et le groupe de villageois arrivent au centre de la communauté où d’autres paysans les rejoignent. La discussion devient plus tendue et se focalise sur les raisons qui ont poussé les soldats à pénétrer dans la communauté. On évoque la peur qu’éprouveraient les femmes et les enfants à la vue des soldats. On demande aux soldats de déposer leurs fusils et de rester au village jusqu’à l’arrivée du HCR et de la MINUGUA afin que ces organismes internationaux établissent s’il y a, oui ou non, violation des accords. Les soldats se trouvent encerclés par environ deux cent villageois. Au bout d’une demi-heure de débat de plus en plus fougueux, le sous-lieutenant et les soldats tentent de rompre le cercle en poussant les gens avec la crosse de leurs fusils, mais ceux-ci se déplacent et obstruent le seul sentier de sortie du village. Le sous-lieutenant se tourne alors vers ses soldats en leur ordonnant de se regrouper. Il se rapproche d’eux et leur intime, à voix basse, l’ordre :
– Préparez-vous les gars !
– ¡ Preparen se, muchá[6]!
A cet instant précis, de nombreux témoins auraient entendu le son caractéristique du chargement des fusils automatiques. Le sous-lieutenant se retourne alors brusquement et fait le geste du bras comme pour entraîner ses soldats vers la sortie. A la seconde, la patrouille rompt les rangs et les soldats se mettent à tirer sur les gens pour se frayer un passage. C’est l’endroit où le plus grand nombre de personnes est tué. Mais, pas tous. Le petit Santiago Coc Pop est tué à deux cent mètres de la place où s’est tenue la réunion, alors qu’il se dirige vers le ruisseau avec sa canne à pêche. Il est d’abord atteint d’une balle au poignet. Il court vers sa maison lorsque le soldat qui l’a blessé se retourne et le descend de deux balles.
Périssent ainsi sous les balles des militaires :
- Abel Ramirez Pérez, âgé de 31 ans, Maya-Mam ;
- Manuela Mateo Antonio, âgée de 20 ans, Maya-Q’anjobal ;
- Maurilia Coc Max, âgée de 7 ans, Maya-Q’ekchi ;
- Pedro Medina Sánchez, âgé de 41 ans, Maya-Ixil ;
- Santiago Coc Pop, âgé de 8 ans, Maya-Q’ekchi ;
- Pablo Coc Coc, âgé de 35 ans, Maya-Q’ekchi ;
- Juana Jacinto Felipe, âgée de 45 ans, Maya-Mam ;
- Hilaria Morente de la Cruz, âgée de 54 ans, Maya-Quiché ;
- Pedro Diego Andrés, âgé de 34 ans, Maya-Q’anjobal ;
- Andrés Miguel Matéo, âgé de 50 ans, Maya-Qanjobal ;
- Carlos Fernando Chic, âgé de 17 ans, Maya-Quiché.
Vingt-sept autres personnes sont blessées par arme à feu.
Le rapport de la MINUGUA ne fait pas l’unanimité. Les associations locales des droits de l’homme, certains militants des droits des peuples indigènes, acceptent mal la constatation que l’ordre de tirer n’a pas été donné par une autorité supérieure de l’armée. Certains soulignent que des témoins auraient vu le sous-lieutenant tenter une communication radio alors que les soldats se trouvaient encerclés. N’aurait-il pas reçu des ordres de tirer sur les villageois désarmés ? Pourtant, nos conseillers militaires affirment que le type de radio dont disposait la patrouille ne permet qu’une communication à très brève distance, quelques kilomètres à peine ; le sous-lieutenant n’avait donc aucune possibilité de demander des ordres. Mais, nous n’absolvons point les hauts gradés de l’Armée. Nous soulignons les conséquences auxquelles mène « l’autonomie dont jouit l’Armée dans ses activités contre-insurrectionnelles » ainsi que les « effets pernicieux d’un discours officiel qui identifie les réfugiés et les retornados à la guérilla ».
Premier résultat : le Ministre de la défense démissionne.
Le procès judiciaire auquel sont soumis les soldats traîne et s’enlise dans des délais de procédure, des irrégularités et des abus aberrants. Les procureurs successifs et les avocats des retornados sont menacés et harcelés par des inconnus, nargués par la presse. L’avocat des militaires jongle avec des vices de forme. Il réussit à différer le procès de plusieurs mois en arguant que le crime imputé aux soldats n’existe pas dans le code pénal. Le procureur avait, en effet, commis une faute d’orthographe. L’armée s’accroche à l’esprit de corps, montre à nouveau son visage le plus détestable, fait jouer ses services secrets, ses spécialistes de la torture et de la disparition. Parfois, la peur reprend le dessus. Les ONG peinent à encourager les villageois de Xamán afin qu’ils persistent dans leurs demandes. Ce n’est que neuf ans après le massacre, en juillet 2004, que le sous-lieutenant Camilo Lacan Chaclán et treize soldats de sa patrouille seront condamnés à quarante ans de prison ferme.
Les responsables des grands crimes et tragédies humaines viennent souvent de loin. A vouloir remonter l’histoire, on s’égare dans l’aplatissement des nuances, le brouillard de l’oubli. La mémoire érigée en devoir, encourage-t-elle la réconciliation ou bien la rancune et la vengeance ? L’oubli mène-t-il forcément à la récidive ou permet-il de continuer à vivre ensemble ? La « paix des braves » – celle qui se conclut entre combattants – est la plus facile à atteindre. Qu’en est-il de l’autre, celle qui doit recoudre le tissu social entre individus, familles, voisins, fils et filles de bourreaux et de victimes ? A supposer que ces catégories soient toujours bien distinctes. Les soldats guatémaltèques sont, le plus souvent, eux-mêmes fils de pauvres indiens Maya, recrutés de force, arrachés à leurs familles et soumis a un endoctrinement et un entraînement féroces. Les tactiques locales de « contre-insurrection » s’inspirent de doctrines élaborées à l’échelle du continent.
Escuela de las Américas : située dans la Zone du Canal de Panama (sous l’Autorité des Etats-Unis), elle forma entre 1946 et 1984 plus de 60.000 militaires et policiers de 23 pays de l’Amérique latine.
L’internet nous facilite la recherche, dit-on, nous épargne de fastidieuses fouilles d’archives. Mais à part le fait d’être parfois de fiabilité douteuse, la source est aussi terriblement volatile. Des documents auxquels on voudrait faire référence ont disparu. Leurs auteurs étaient fiers jadis de quelque chose dont ils sont honteux aujourd’hui. Je n’y retrouve plus la présentation succincte du « Centre d’entraînement et opérations spéciales KAIBIL », jadis situé dans les localités El Infierno (L’enfer), La Polvora (La Poudre) et Melchor de Mencos, puis, dans les anciennes installations de la Zone militaire No 23 de Poptún, province du Petén. Le document se trouvait bien à http://www.quetzal.net/mdefensa/kaibil.html. Il n’y est plus.
Le nom de KAIBIL serait celui d’un roi mythique de l’empire Mam des Mayas, qui, grâce à ses astuces, n’a jamais pu être capturé par le conquistador Pedro de Alvarado.
La mission de l’Ecole KAIBIL :
- Préparer les commandants et les chefs des petites unités de l’Armée à la conduite d’opérations spéciales ; développer l’esprit d’initiative et maintenir le moral en chaque instant, et surtout dans les situations critiques et les opérations spéciales ;
- Sélectionner, par un entraînement ardu et dur, sous pression physique et mentale, les éléments de l’Armée aptes à la réalisation d’opérations spéciales.
La devise du KAIBIL :
- Si j’avance, suis-moi ! Si je m’arrête, pousse-moi ! Si je recule, tue-moi !
Le décalogue du KAIBIL :
- Pour le KAIBIL, le possible est déjà fait ; l’impossible se fera ;
- Toujours attaquer, toujours avancer ;
- Dans la confusion et le désordre, le KAIBIL domine la situation et conduit l’action avec sérénité ;
- Le KAIBIL prépare l’action dans le secret et la sécurité, et avec astuce ; il la conduit avec force, vigueur et agressivité ;
- L’arme de prédilection du KAIBIL est la surprise ;
- Le KAIBIL sait qu’on ne résiste pas en jurant de le faire, mais en ne reculant devant rien ;
- Le KAIBIL ne tente pas d’accomplir sa mission ; il l’accomplit ;
- S’il tombe dans une embuscade, le KAIBIL lance un assaut anéantissant faisant feu de toutes ses armes ;
- Le KAIBIL est une machine à tuer – una maquina de matar – quand des forces ou des doctrines étrangères se soulèvent contre la Patrie ou l’Armée. »
Les soldats de la patrouille de Xamán n’étaient pas des KAIBIL. Le sous-lieutenant Lacan Chaclán non plus. Le décalogue du KAIBIL leur aurait-il été inculqué quand même ?
***
Réflexions a posteriori
Etait-ce inévitable ? Quand je retraverse à rebours toutes les bifurcations du parcours sanglant et suicidaire de mon ancien pays, l’une des constatations qui s’imposent est qu’à chaque étape décisive, chaque bifurcation, c’est la politique du pire qui a prévalu, celle de l’exclusion et de la violence. Le pays s’est brisé en une myriade de petites ethnocraties mutuellement hostiles, économiquement infirmes, politiquement obtuses, culturellement écœurantes. L’esprit de fermeture à l’autre, de repli sur soi ignorant et béat, de cynisme petit-bourgeois, l’« esprit de bourg » évoqué il y a des années par Radomir Konstantinović[7] a prévalu. Les mythes médiévaux ressuscités ont engendré un nouveau folklore épris d’armoiries, de drapeaux et de défilés militaires : Le sceptre d’Ottokar[8].
Ce n’est qu’aujourd’hui, vingt ans après, que les liens commencent à se retisser, mais la route est longue. Que de préjugés, que de mensonges ! Les parents ont inculqué la méfiance aux jeunes. Une autre histoire est enseignée à l’école. Plusieurs histoires, mais une seule pour chaque communauté. Les associations d’anciens combattants en Croatie, exhument et réhabilitent la sinistre mémoire du régime oustachi ; en Serbie, on fait de même pour celle du collabo royaliste liquidé par les partisans, Draža Mihajlović. Le catéchisme est tacitement imposé dans les écoles, les gouvernements font la cour à leurs respectives Eglises nationales tandis que le droit des femmes à l’avortement est ouvertement remis en question. Tous les pays de l’ancienne Yougoslavie, à l’exception de la Slovénie peut-être, ont subi une terrible régression. Les Balkans sont devenus (ou redevenus ?) les bas-fonds de l’Europe, terre de peur latente, de bigoterie provinciale, de trafics douteux et de soif de vengeance. Europe’s soft belly, an unfinished story dans le jargon des géopoliticiens spécialistes de la région. La narration d’une Europe démocratique, protectrice et intégratrice ne passe plus. En Croatie, devenue pays membre de l’Union, cette dernière est vue essentiellement comme promotrice des privatisations abusives, porteuses de corruption et génératrices d’inégalités jamais vues ; en Serbie, comme rabâcheuse de promesses toujours différées et de moins en moins crédibles. Les cœurs se tournent vers le grand frère russe.
Une image qui vient de loin : je me réveille dans une grande chambre aux rideaux de dentelle, dans la pénombre, mais le soleil perce déjà sur les bords des volets. Soleil implacable du sud. J’ai neuf ou dix ans. La lumière dessine des motifs ondulant sur le plafond. La maisonnée s’affaire et des pas sur le gravier du jardin me signalent qu’il est temps de me lever. C’est la maison de Strina, tante paternelle. Au centre de la vieille ville de Mostar. Il y a un petit jardin entre la maison et le mur mitoyen. La « cuisine d’été » – ouverte – occupe un angle ombragé de cet espace. Nous y sommes pour un jour ou deux. Ensuite nous repartirons vers le sud, nous ferons la route qui longe la Neretva en aval de la ville, nous traverserons son delta fertile et cette étrange plaine lunaire qui laisse émerger des monticules rocheux… Ils croîtront et deviendront des montagnes blanches, karstiques, plongeant dans la mer. Déjà en Dalmatie, nous descendrons de la route côtière vers le village de Drvenik pour y prendre le petit ferry et traverser le bras de mer jusqu’a l’île de Hvar.
Mostar – la méditerranéenne et l’orientale, parsemée de clochers et de minarets. Ses vignobles, ses jardins de cyprès, sa pierre blanche, ses senteurs, annoncent la mer toute proche. Pendant la canicule, la Neretva d’émeraude, bouillonnante dans son lit calcaire, écumante autour des rochers, offre des bouffées de fraîcheur. Le pont de pierre a été reconstruit avec les fonds de l’UNESCO – copie conforme de l’ancien chef d’œuvre de Mimar Hayruddin, élève du grand Sinan. La légende veut qu’en 1566, son œuvre achevée, l’architecte ottoman s’éclipsa au moment où l’on allait démonter les échafaudages, craignant le châtiment du Sultan – car il n’était pas sûr du tout qu’une construction si fine, si aérienne, puisse tenir debout. Le pont resta bien debout pendant 427 années et survécut aux deux guerres mondiales avant d’être sauvagement abattu à coups de mortier par les milices croates, le 9 novembre 1993. Sa reconstruction ne semble pas avoir recousu les cicatrices du tissu humain. La ville reste divisée et peu d’habitants, me dit-on, traversent le pont.
Je ne suis jamais retourné à Mostar depuis la guerre. Je craignais d’être envahi par un sentiment d’horreur et de dégoût en voyant les ruines.
Je reste convaincu que l’explosion de la Yougoslavie n’était pas une fatalité. Il n’y avait pas de haines ancestrales. La grande complexité du pays, économique, culturelle, linguistique, ne constituait pas intrinsèquement un mélange explosif, mais exigeait, oui, un engagement démocratique responsable des pouvoirs en place et une attitude d’ouverture beaucoup plus courageuse et visionnaire de la part de l’Europe. Les deux on fait défaut.
Où se situent les premiers germes du mal ? Jusqu’où faut-il remonter dans le temps ? C’est peut-être pendant les années 60-70 que les dirigeants de la première heure de la Yougoslavie de Tito commencent à perdre leur légitimité de révolutionnaires et de résistants antifascistes sans vraiment se préoccuper de lui substituer une légitimité démocratique. La révolution accomplie, le consensus politique renforcé par le refus du diktat stalinien (le Non historique de Tito à Staline en 1948), la pensée et l’action de la classe politique se tournent vers l’administration des affaires courantes. En d’autres termes, la consolidation du pouvoir et la reproduction du système. La mise en place de l’autogestion ouvrière demande des supports théoriques. Ceux-ci se veulent à la fois modernes et fidèles à la pensée des « classiques du marxisme », donc, libérateurs et « désaliénants ». Il s’agit aussi, bien sûr, de se démarquer nettement du système stalinien. Il est facile de le proclamer caduc. Le détricoter dans tout ce qu’il implique d’autoritaire et d’arbitraire demande une approche plus audacieuse et innovatrice. Certains des plus instruits et des plus inspirés des dirigeants révolutionnaires des années de l’après-guerre tentent l’expérience, essentiellement sous la direction de Boris Kidrič, organisateur de la résistance en Slovénie et plus tard premier ministre de cette république. Son œuvre est particulièrement bien analysée dans le recueil d’essais de Darko Suvin, déjà mentionné. Mais, pour rester fidèle à ses sources et à sa stratégie, le nouveau pouvoir ne devrait-il pas se mettre lui-même en question ? C’est bien ce que prônent les chercheurs et intellectuels autour de la revue Praxis, mais le message déplaît. Il introduit le doute. Il questionne le positive thinking de la révolution. Il témoigne de son essoufflement. Dans la sphère économique, les problèmes se manifestent dès qu’il faut faire cadrer le système d’autogestion et son esprit libertaire avec le rôle dirigeant du Parti Communiste, renommé en 1952 Ligue des Communistes de Yougoslavie (LCY). Le contrôle du parti unique pose des limites à l’autogestion et surtout, empêche son extension aux sphères supérieures et au gouvernement du pays. Selon la théorie de l’autogestion les moyens de production ne sont ni privés ni propriété de l’Etat. Ils appartiennent à la société et sont donc considérés comme biens publics ou communs. Les travailleurs sont censés les gérer sans vraiment les posséder. Ils ne peuvent donc ni les vendre, ni les donner en location. Dans les années 60, lorsque les réformes successives introduisent dans ce système des éléments d’économie de marché, les choses se compliquent davantage. S’installe alors une navigation politique « à vue » qui mène à des improvisations et à des constructions hermaphrodites. On tente sans succès de concilier une gestion pragmatique de l’entreprise avec des concepts associatifs marxistes. Tant que la croissance est au rendez-vous, dopée par des crédits occidentaux et par l’inflation, ni la classe politique ni les travailleurs « autogestionnaires » ne se préoccupent excessivement de ces inconsistances. Tito reste l’arbitre suprême des contradictions économiques et politiques qui de temps en temps secouent le pays.
On ne demande pas aux nouvelles générations d’être des sujets politiques. Elles sont supposées connaître et apprécier le sacrifice de leurs parents, se préparer à assurer la continuité du système, à la rigueur le « perfectionner ». Cela n’encourage pas la réflexion politique. Les jeunes des années 50-60 assument bien ce rôle et participent à la reconstruction du pays avec un enthousiasme authentique. Les images évoquant cette période sont celles des grands travaux volontaires des lycéens et des étudiants, la construction de l’autoroute entre Belgrade et Zagreb, puis entre Zagreb et Ljubljana, des nouvelles voies ferrées en Bosnie-Herzégovine, des barrages et des canaux d’irrigation. Vous trouverez encore, parmi les socio-démocrates suédois ou allemands, les socialistes et communistes français, des hommes et des femmes qui ont participé à ces travaux, se laissant séduire par cet esprit collectif et solidaire (plus tard, leurs cadets participeront avec le même esprit aux zafras cubaines). En 1968, il y a les manifestations estudiantines, mais à la différence des mouvements contestataires en France et en Allemagne, celles-ci ne mettent pas en cause le système en vigueur, mais exigent que la pratique s’accorde aux principes proclamés. Les étudiants huent la nouvelle « bourgeoisie rouge ». Ce qu’ils reprochent aux dirigeants n’est pas d’être « rouges », mais de s’être embourgeoisés. Ouverte sur l’étranger, offrant un niveau de vie nettement supérieur à celui des pays du bloc soviétique, la Yougoslavie de Tito apparaît à une grande partie de ses citoyens comme un pays où il fait assez bon vivre. Les Yougoslaves sont fiers de leur spécificité (ni Est ni Ouest, something in between, comme dit le héros d’un film des années 60 à une jeune touriste américaine).
Ce sont aussi les années d’une grande effervescence culturelle transyougoslave. Les artistes, réalisateurs et metteurs en scène – généreusement subventionnés – bravent allègrement les consignes politiques qui d’ailleurs ne sont ni clairement définies ni uniformément imposées. La réprobation idéologique de certains films ou pièces de théâtre reste occasionnelle, s’exerce ex post et ne décourage nullement les créateurs. La décentralisation du Parti leur permet souvent de jouer à cache-cache avec les idéologues dont les critères sont variables et incertains. Ainsi peut-on être dissident à Zagreb ou à Sarajevo, sans l’être à Belgrade ou vice-versa. La mise au ban de certains livres ou films n’est souvent que partielle ou temporaire. Elle a même parfois un effet publicitaire.
Cependant, les circonstances changent et le doute fait son chemin. La crise se manifeste d’abord par l’apparition du chômage, catégorie pratiquement inconnue avant la première reforme économique de 1965 qui entrouvre la porte aux lois du marché. Le chômage qui en résulte est partiellement absorbé par l’emploi de dizaines, puis de centaines de milliers de Yougoslaves à l’étranger. Ils partent, mais la plupart le font avec la ferme intention de revenir. Ils envoient de l’argent aux familles, construisent des maisons au pays, puis, si leur région a une vocation touristique, louent des chambres. Tous les Yougoslaves se familiarisent alors avec deux expressions allemandes : Gastarbeiter – travailleur immigré et Zimmer frei – chambre à louer disponible. En même temps, la libéralisation économique approfondit l’écart entre le Nord et le Sud, les républiques riches (Slovénie, Croatie) et les pauvres (Macédoine, Bosnie-Herzégovine et la province autonome du Kosovo).
Très tôt, bien avant l’apparition de Milošević et de Tudjman, les dirigeants croates, slovènes, serbes et autres, jouent sur le clavier des « intérêts spécifiques », réels ou supposés, de leurs républiques et de leurs peuples afin de récupérer leur légitimité politique chancelante. En fait, ils jouent sur un double registre : d’un côté, ils répriment les voix qui mettent en cause la bureaucratie et le système de parti unique (l’exemple plus notoire reste celui de l’interdiction de la revue « Praxis »), tandis que de l’autre, ils s’efforcent d’aller au devant d’un sentiment d’appartenance locale, voir ethnique. Ce deuxième registre est d’autant plus tentant qu’il permet de projeter sur l’autre, en l’occurrence la Fédération, les causes du mécontentement social. Aucune difficulté à cela vu que les médias, presque sans exception, sont sous le contrôle du régime au niveau des républiques fédérées et des provinces autonomes. Il faut néanmoins rendre justice à une partie de la presse, particulièrement la presse estudiantine antinationaliste, qui fait preuve d’une grande résistance aux pressions idéologiques et policières du régime, et cela malgré des poursuites en justice et des peines de prison infligées à certains rédacteurs et auteurs.
Il ne s’agit pas, de la part du régime, d’une stratégie élaborée. Cette dualité résulte simplement de la volonté de la classe politique de se maintenir au pouvoir et de l’opportunité de faire jouer à cette fin, selon les circonstances du moment, soit l’argument idéologique, soit celui de l’« intérêt national », c’est-à-dire de l’intérêt local de la république en question ou de la province autonome. Ce qui ne veut pas dire que, dans une perspective locale, ces intérêts n’étaient pas fondés. Ils l’étaient, et en ce sens, on peut bien parler d’un certain processus démocratique de recherche de consensus par la négociation, par exemple au sujet de la définition des instruments de politique économique commune : taux de change de la monnaie nationale, répartition des devises étrangères provenant des exportations ou du tourisme, instruments d’appui au développement des régions défavorisées, etc. Dans un Etat fédéral aux écarts économiques aussi prononcés ces sujets sont toujours « chauds ». Il est donc normal qu’ils suscitent des prises de position différentes au sein de la Fédération et que la recherche de compromis soit laborieuse (un peu comme cela se passe aujourd’hui dans l’Union européenne). La Constitution de 1974 consacre le système en concédant aux républiques et provinces autonomes un très grand pouvoir de décision. Pour un Etat aussi complexe que la Yougoslavie, l’autonomie locale est un sine qua non et il est aberrant de voir en elle, comme le feront les disciples de Milošević, l’une des causes de la crise. Ce n’est pas le contenu démocratique des rapports au sein de la Fédération qui fait germer le populisme et les « antagonismes irréductibles », mais le déficit démocratique à l’intérieur des entités fédérales ainsi que l’absence d’un espace civique commun.
Cette tendance à transférer sur l’autre les causes du mécontentement social ne se limite pas au domaine économique. Elle déborde sur la sphère culturelle et plus généralement, politique. Le débat sur la gestion du pays est de plus en plus faussé par des arguments identitaires et ethniques. Tant que Tito est en vie, ses interventions sporadiques mais sans appel empêchent les grands dérapages, sans pour autant toucher aux règles du jeu. A sa disparition en mai 1980, le pays se trouve doublement désemparé. D’un côté, le jeu à effet centrifuge des structures locales du régime n’a plus de frein. De l’autre, la LCY, ce parti unique multicéphale, continue et réussit tant bien que mal à empêcher la constitution d’un courant alternatif de pensée politique qui, basé sur des valeurs de citoyenneté et sans colorations ethniques, aurait peut-être pu trouver des adhérents parmi tous les Yougoslaves en transcendant les prétendues barrières culturelles.
Aujourd’hui, je pense à ces années, sans indulgence envers moi-même, car je constate à quel point mon propre réveil politique fut tardif. Je faisais partie pleinement de cette génération béate qui était censée suivre la grande route tracée par les pères. Je continuais à croire, par optimisme ou commodité, que le système avait les moyens de se corriger. Le plus important, me disais-je, c’est que le pays reste ouvert, économiquement et culturellement, que les gens puissent voyager, s’informer. Des gens informés et ouverts ne construiront pas un système clos. Aujourd’hui, je spécule avec une certaine mélancolie sur toutes les bifurcations ratées. Que serait-il advenu si Tito, au lieu de limoger en 1970 les dirigeants serbes accusés de « libéralisme », les avait encouragés à persévérer sur la voie d’une réflexion démocratique et réformatrice ? Si, au lieu de s’entourer d’acolytes complaisants et médiocres, il avait favorisé un débat libre et rénovateur ?
Que se serait-il passé si autre chose s’était passé ? Un dicton narquois belgradois dit à peu près : « Si ma grand-mère avait eu des roues, elle aurait été un tram ! » Équivalent de « si ma tante en avait, elle s’appellerait mon oncle ».
Notes
[1] Vangelis Kechriotis, Long live the man of the nation – the new Turkish president’s legacy of political language ; http://www.chronosmag.eu/index.php/v-kechriotis-long-live-the-man-of-the-nation.html.
[2] Paraphrase, bien sûr, du titre du célèbre roman d’Alan Paton Cry, the Beloved Country, publié en 1948.
[3] La description qui suit est le résumé du rapport public émis par la MINUGUA.
[4] Dans le jargon militaire guatémaltèque, ce nom désigne des activités de rapprochement et de communication avec la population civile. Evidemment, pendant les périodes de tension cela voulait plutôt dire : propagande et endoctrinement.
[5]L’accord sur le retour des réfugiés guatémaltèques du Mexique reconnaît explicitement le « caractère civil » des réfugiés, clause que les retornados interprétaient souvent comme obligation assumée par l’Armée de ne pas entrer dans leurs communautés. La MINUGUA a vérifié que l’Armée avait émis des consignes internes dans le même sens, mais il n’y avait à ce sujet aucune disposition légale à proprement parler.
[6] Colloquial de muchachos.
[7] Ecrivain et philosophe serbe, voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radomir_Konstantinović.
[8] Voir Hergé, Le Sceptre d’Ottokar, éditions Casterman, Paris/Tournai 1947.









