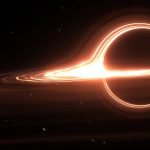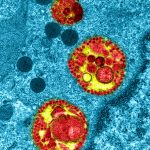Vivre, penser et lutter en collapsonautes ? Entretien avec Jacopo Rasmi
Jacopo Rasmi a écrit avec Yves Citton un ouvrage intitulé Générations collapsonautes, tentative d’analyse critique de la “collapsologie”. Il revient dans cet entretien pour Contretemps sur leur démarche et les questions qu’ils ont voulu poser.
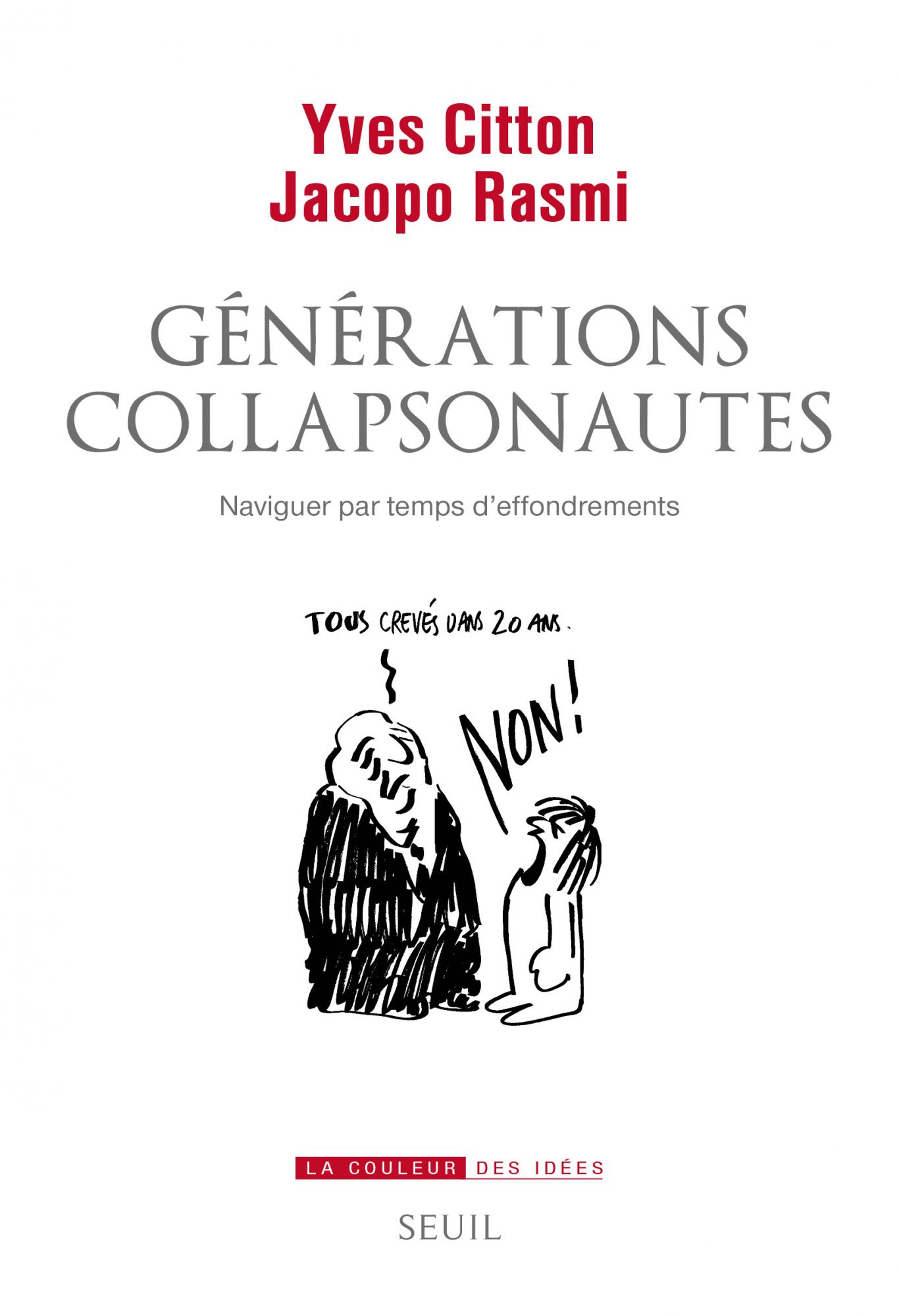
Contretemps : Dans son introduction, Générations collapsonautes se présente comme un travail d’écriture « à quatre mains et deux générations ». Peux-tu nous expliquer l’origine de ce projet, dont l’un des moteurs semble avoir été cette dimension « intergénérationnelle » ?
Jacopo Rasmi : Ce projet de réflexion et d’écriture émerge en effet au milieu de deux auteurs appartenant à des générations relativement éloignées : l’un en train de terminer sa formation et déjà précaire (moi-même), l’autre terminant sa carrière professionnelle de fonctionnaire universitaire (Yves Citton). En ce sens, l’idée de départ était d’observer et de s’approprier depuis deux points de vue différents et mis en dialogue un phénomène qui nous interpellait particulièrement, en raison d’un commun intérêt théorique et politique pour la question écologique : à savoir, l’essor de la perspective « collapsologique » dans le débat autour du problème environnemental.
En résumant d’une manière un peu abrupte les analyses des collapsologues, ils décrivent les conditions de fragilité extrême de notre système socio-économique et ses lignes d’insoutenabilité, qui le destinent à un effondrement global dans le court ou le moyen terme. C’est ce genre de discours – de plus en plus présent pas seulement dans les milieux militants mais aussi dans les grands médias – qui nous attirait tout en nous interrogeant. Un des principes que les collapsologues opposent à l’écroulement de nos structures productives et institutionnelles est précisément le principe de l’entraide, de la collaboration. Disons que nous avons adopté ce même principe dans la rédaction du texte, en nous disant qu’on pouvait mieux saisir les enjeux complexes de notre présent hanté par la collapsologie en mutualisant nos points de vue et en négociant une interprétation commune.
Parfois, les perspectives d’effondrement nous induisent à construire des oppositions frontales entre générations : je pense par exemple à cette scission entre les jeunes militants des marches du vendredi et les vieux égoïstes responsables de la crise écologique. D’un côté, on se méfie de tous les partages de pureté (car le paradigme environnemental nous apprend plutôt à saisir les attachements multiples, impurs et insoupçonnés qui nous relient à tout ce qui nous entoure). De l’autre, on croit qu’il vaut mieux saisir et poursuivre les occasions d’échange et de collaboration pour mener la – très difficile – lutte écologique plutôt que de perdre trop de temps et d’énergie à tracer le partage entre les légitimes et les illégitimes, les jeunes et les vieux…
En réalité, on ouvre notre ouvrage en affirmant qu’on va travailler à quatre mains et deux générations, mais à la fin on renchérit en disant que deux ne suffisaient pas vraiment pour tenter d’y comprendre quelque chose. Il aura fallu convoquer un grand nombre de voix pour s’orienter dans nos temps d’effondrement : des anthropologues, des philosophes, des cinéastes, des agronomes, des historiens… D’ici (de l’Occident), mais aussi d’ailleurs (d’Afrique, d’Amérique Latine…), de maintenant comme d’autrefois.
Un dernier mot pour expliquer cette histoire de « générations » qui donne son titre à l’ouvrage. L’objectif de ce travail sur et avec la collapsologie n’était pas tellement d’expliquer les formes d’un écroulement systémique à venir (le boulot précieux de la collapsologie), mais plutôt de comprendre ce que ce genre de réflexion peut générer d’ores et déjà en termes de pratiques, d’engagements, de formes de vie et de pensées. Ce que la perspective collapsologique crée et nous fait faire dans le présent de milieux vivants précaires et de sociétés en voie de délitement. Il s’agissait de ne pas voir juste les ruines (à venir) depuis le point de vue collapsologique, mais aussi et surtout d’exposer les transformations générées dans le monde qu’on habite aujourd’hui.
CT : Justement, ce choix d’étudier les pratiques et les formes de vie que génère la collapsologie aujourd’hui vous amène à un parallèle avec la religion. De prime abord, la collapsologie nous évoque une recherche rationnelle, scientifique des motifs de « l’effondrement-qui-vient » déjà perceptibles dans notre présent.
Mais Générations Collapsonautes met en lumière une autre dimension, « religieuse » pourrait-on dire, de la collapsologie : comme une religion, elle relie (religare) ceux qui y adhèrent ; comme une religion, on peut dire qu’elle a ses prophètes, ses symboles, ses tabous, et par définition elle porte une réflexion eschatologique. La collapsologie ne serait-elle qu’une résurgence du phénomène religieux, imprégnée de nos angoisses environnementales contemporaines ?
JR: On nous a souvent posé cette question qui représente – il me semble – un élément particulièrement sensible pour le débat critique français. En réalité, avec Yves Citton, nous partons d’une conception élargie et omniprésente du phénomène religieux comme l’ensemble des liens et des attachements qui nous relient les uns aux autres et qui fondent nos mondes (sociaux). On est très proches, à ce propos, des positions de l’anthropologue Bruno Latour qui nous dit que les modernes ont cru être la seule civilisation objective et non-religieuse, selon un biais qui nous fait voir seulement les croyances à la base des autres communautés et pas les nôtres. Alors que nous sommes juste le poisson qui ne voit pas ou ne veut pas voir l’eau transparente dans laquelle il nage, qui le porte.
En ce sens, même notre univers économique (capitaliste), qui revendique une sorte de rationalité mathématique et objective – au nom de laquelle il nous gouvernerait sans passer par le débat politique – est en réalité profondément ancré dans des conditions affectives et relationnelles qui structurent l’horizon de sens et de valeurs de notre propre société. Dans une direction qui s’avère de plus en plus suicidaire, d’ailleurs.
Un certain paradigme économique est précisément ce qui nous relie le plus dans nos sociétés contemporaines, ce à quoi on adhère collectivement : il suffit de relire les thèses de Benjamin sur le « capitalisme comme religion » ou de Stengers et Pignarre sur le capitalisme comme « sorcellerie »… Or, la collapsologie pourrait représenter un phénomène « religieux » alternatif et opposé qui change soudainement la forme et les objets des relations qui tissent notre monde social. L’horizon de l’effondrement génère un détachement de la religion capitaliste (avec ses priorités : la croissance, la production, le salaire…) et de nouveaux attachements qui en remplacent les repères (les capacités d’auto-organisation, des formes de subsistance locale et plus soutenables, la qualité des sols qu’on habite…).
CT : Le concept de « croyance » serait donc essentiel pour comprendre aussi bien le paradigme capitaliste que la perspective collapsologique ?
J.R : Au-delà de son travail plus analytique et scientifique, le courant collapsologique nous a frappé d’abord par sa capacité de mobilisation affective car il semble capable d’induire des transformations assez bouleversantes chez les gens en termes de valeurs, d’attentions et de styles de vie. L’effondrement nous affecte aujourd’hui comme peu (aucun ?) d’autres paradigmes écologiques ont été capable de le faire.
Fidèle à notre esprit « génératif », je soulignerais donc cet aspect puissant de la portée « religieuse » des théories de l’effondrement qui nous font moins croire à la nécessité d’avoir une piscine dans notre jardin tout en nous faisant davantage croire dans l’importance de ne pas exterminer la plupart des formes de vie autour de nous. La distinction entre le « croire à » et le « croire dans » est un des ateliers conceptuels que nous dressons dans notre livre, mais on y reviendra peut-être.
Cela ne nous empêche pas de relever également les dimensions les plus millénaristes et fanatiques qui peuvent accompagner ce phénomène et qui représentent moins un levier qu’une impasse pour l’organisation d’un changement politique. Il faut bien entendu éviter le piège de penser qu’une fin absolue va arriver et que tout va disparaître aussitôt, que l’on considère cela comme un désastre (car très attaché à ce monde-ci) ou comme un grand salut ou la révolution (car on s’oppose à ce monde-ci). De nombreuses lectures critiques depuis un point de vue de gauche ont par ailleurs bien remarqué ces angles morts sans attendre qu’on arrive avec notre livre.
CT : Justement, comment éviter ces écueils ?
Dans notre réflexion, le potentiel aveuglement « eschatologique » qui caractérise ces discours est déjoué par la tentative d’observer et de mesurer le phénomène collaspologique par une série de prismes et de décadrages qui nous font prendre du recul et permettent d’orienter la tendance collapsologique vers le meilleur et non vers le pire.
Pour citer quelques exemples : on propose de faire de la place à une perspective comique plutôt que rester rivés à un désespoir tragique ; on désamorce la soi-disant nouveauté inédite de ces discours en démontrant qu’ils sont souvent des résurgences et des déjà-vus de notre passé ; on décale le point de vue collapsologique par des perspectives post-coloniales pour désamorcer la panique occidentale, aisée et blanche de perdre notre confort face à des univers déjà effondrés depuis longtemps (à cause souvent de nos exploitations colonialistes).
L’idée est d’échapper autant que possible à la hantise « effondriste » sans pour autant négliger sa puissance de transformation de notre monde en un autre plus désirable collectivement.
CT : Votre livre choisit donc de multiplier les perspectives et les éclairages sur la pensée collapsologique. Comme tu viens de le souligner, ces perspectives minent une certaine vision collapsologique, celle de l’humanité au bord du précipice : le point de vue décolonial nous rappelle que pour certains peuples, l’effondrement semble en vérité entamé depuis de nombreux siècles, de même pour certaines classes depuis plusieurs décennies.
N’assistons-nous pas malgré tout à un délitement du concept d’effondrement, qui tire sa force du fait qu’il place l’humanité comme un bloc face au désastre à venir commun ? La pensée collapsologique n’en perd-elle pas en puissance d’agir et de transformer le monde ?
JR : C’est un point assez crucial et en même temps ambivalent, à mon avis. D’un côté, il est impossible et injuste d’imaginer une sorte d’unité et d’homogénéité dans la crise écologique. D’abord parce que certains sont plus responsables que d’autres : il n’y a pas de comparaison possible entre la contribution africaine à la pollution planétaire et celle, disons, de l’Amérique du Nord.
Ensuite, parce qu’il est vraisemblable que les conséquences des situations d’effondrement ne seront pas les mêmes pour tout le monde : les pays et les classes sociales avec plus de moyens pourrait mieux s’en sortir que les plus démunis. Voir les riches qui achètent des terrains dans des endroits protégés et sécurisés de la Nouvelle Zélande en vue d’une possible crise du système alors que ceux qui subissent les premiers dégâts du dérèglement climatique (des îles d’Océanie à la désertification africaine) semblent être surtout des territoires mineurs de l’échiquier géopolitique mondial – qu’on tente de repousser aux frontières de nos forteresses aisées.
À ce propos, imaginer la question écologique comme une sorte de « bataille » frontale et binaire entre l’Humanité d’un côté et de l’autre la Nature est un leurre, il me semble : il y a des communautés humaines différentes qui ont des rapports assez variés à l’ensemble de formes vivantes qui constituent nos milieux. Dans cette perspective, on peut comprendre pourquoi certains rejettent le concept d’anthropocène et suggèrent des remplacements qui mettent en valeur des responsabilités humaines moins universelles : on parle par exemple de Capitalocène pour indiquer les responsabilités d’un certain modèle socio-économique qui n’appartient pas à toutes les sociétés humaines (ni d’aujourd’hui, ni d’hier).
En ce sens, il faut se méfier d’une certaine fiction unitaire qui se niche dans les discours collapsologues, comme on se méfie actuellement des discours du gouvernement et de la présidence quand ils parlent d’une France – militairement – unie face au coronavirus alors qu’on sait que partout émergent plutôt des fractures et des inégalités que les temps d’urgence et de crise rendent encore plus criantes et insupportables.
En même temps, je relèverais effectivement dans la perspective collapsologique une conscience commune qui nous relie, mais celle-ci est plus de l’ordre de la dépendance mutuelle reconnue que de l’appartenance à un seul bloc. C’est la conscience écologique – qui se définit d’une manière flagrante dans le contre-jour de l’Effondrement – de l’enchevêtrement de nos existences à tous les niveaux (entre humains, mais aussi entre humains et non-humains).
Donc je dirais qu’il faudrait tirer de la collapsologie plus le constat de notre être-enchevêtré et co-impliqué que celui de notre être-uni dans un destin commun. Or, cette condition de relation (sans unité et dispersée) nous pousse à adopter des principes de précaution, mais aussi et surtout à chercher des terrains d’entente et de médiation, à la fois dans nos sociétés et entre nos sociétés et les autres formes de vie. Cela n’est pas forcément idyllique, car il y a toujours des conflits d’intérêts, de langages et de valeurs qu’il faut résoudre par des efforts de « diplomatie » (pour citer le philosophe Baptiste Morizot).
Comme le COVID-19 nous le démontre bien, les court-circuits systémiques nous plongent dans des guerres et des inégalités (on vole des masques, on doit négocier des aides, on force certains à travailler pour d’autres…) qu’on devrait gérer moins avec une attitude polémique et militaire qu’à travers des formes de négociation et de collaboration – qui ne nient pas le conflit et la disparité, bien entendu. Morizot nous parle de cette écologie politique fondée sur le geste diplomatique en étudiant les interactions entre hommes, loups et moutons.
Nous pouvons appliquer cette réflexion au cadre des mutations qui investissent nos communautés dans l’imminence de la crise écologique : comment négocier une entente entre les pays riches et polluants et les pays moins développés dans le cadre d’une décroissance globale qui pourrait être très injuste ? Comment réduire ou éliminer les véhicules privés polluant tout en prenant en considération les besoins de certaines classes sociales non privilégiées (voir les gilets jaunes) ?
Ici résident les puissances d’action et de changement : dans la prise en compte des inégalités et de la pluralité de perspectives – irréductibles à l’unité mais susceptibles de trouver une certaine composition diplomatique – que les délitements mettent en évidence. Darwin disait que ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s’adaptent mieux à l’ensemble de contraintes externes de leur milieu de vie, à savoir ceux qui négocient le mieux avec les entités étrangères qui les environnent. Nos sociétés sont-elles capables d’évoluer pour s’adapter à leurs milieux de vie d’une manière plus respectueuse et attentive ou bien tenteront-elles de jouer le jeu « survivaliste » du plus fort jusqu’à leur écroulement ?
CT : Nous en arrivons à évoquer le contexte actuel de crise épidémique. Plusieurs indices nous font penser que nous vivons un « moment collapsologique » : nos modes de vie bouleversés par le virus, notre fascination morbide pour les statistiques exponentielles… La collapsologie et son étude sont-elles pertinentes pour comprendre ce moment ?
JR: Sur l’aspect « collapsologique » de la phase présente, je pourrais d’abord m’en tenir à un constat presque sociologique en observant ce qui se dit et ce qui se fait dans l’espace public – sur les médias, en particulier – en ce moment, entre les différents fronts sociaux et politiques. Dans le discours, les bilans et les programmes d’action qui s’y déploient, une lutte d’interprétation autour de ce qui nous arrive et de ce qui arrivera après est en cours, il me semble. En ce sens, on voit des acteurs opposés faire référence aux termes collapsologiques, notamment à « l’effondrement ».
D’une part, il y a une réactivation très importante des voix principales de la collapsologie comme Pablo Servigne qui nous invitent à interpréter la crise virale à travers les analyses qu’ils avaient produites et proposent, en même temps, toute une série de réponses socio-politiques et économiques déjà esquissées dans leurs précédents travaux : je recommande notamment la lecture du programme assez détaillé publié sur Kaizen.
De l’autre côté, dans les médias, il n’est pas rare de tomber sur des titres annonçant les multiples « effondrements » qui s’amorcent dans cette période critique – le terme est très en vogue. Ici, il est souvent question d’effondrement de la croissance prévue, des échanges commerciaux, du cours boursier… Et, entre les lignes ou même très explicitement, les perspectives d’effondrement de l’ordre actuel sont dans ce contexte à conjurer : qu’est-qu’on doit faire pour que rien ne change ? Jusqu’au paradoxe incarné par les gouvernements néo-libéraux à la Macron, qui tentent de tout changer dans l’immédiat dans leurs lignes politiques (chômage pour tout le monde, nationalisations, limitations des dividendes…) pour que rien ne change après-demain et qu’on puisse revenir au système d’avant. L’histoire de la crise économique de 2008 est à ce propos assez intéressante. Il y a donc au moins deux résurgences assez flagrantes du lexique et des analyses « collapsologiques », mais dans deux champs antithétiques.
Effectivement, avec Yves Citton, on s’est dit que pour certains aspects l’urgence virale d’aujourd’hui correspond aux phénomènes décrits par le mouvement collapsologique qui voit ses arguments confirmés avec une rapidité surprenante. Je pense, par exemple, à la manière dont la collapsologie a su mettre en évidence les risques de court-circuits en cascade dans des systèmes socio-économiques très complexes et interdépendantes, donc très délicats, comme le nôtre – ces risques étant générés et répandus également par les tendances généralisées d’exploitation et d’appauvrissement de nos milieux vivants.
Il est, à ce propos, avéré que les situations d’épidémie en augmentation sont en partie liées aux situations de réduction de la biodiversité et à l’élevage industriel : le Monde Diplomatique du mois de Mars 2020 a publié un article intéressant à ce propos. En même temps, il est difficile de dire – pour la plupart d’entre nous – que nous sommes confronté littéralement à un scénario d’Effondrement systémique puisque nos réseaux d’approvisionnement et de communication sont toujours en fonction (de l’électricité à la nourriture), puisque nos institutions politiques ne sont pas en train de s’écrouler mais au contraire recentrent d’une manière souvent autoritaire leur pouvoir, puisque nous sommes en général plus et non moins dépendants de l’économie industrielle et commerciale (alimentée par le pétrole) lorsqu’on ne fait plus nos courses sur les marchés paysans et mais dans les grandes surfaces…
Un autre élément que je relèverais dans ce parallèle entre la collapsologie et notre situation actuelle est la défaillance du « croire abstraitement à » la catastrophe qui vient, malgré les données et les discours scientifiques qui nous l’annoncent – ce qui nous destinerait à y plonger inexorablement. Cela vaut autant pour la question du dérèglement climatique que pour la crise virale – au niveau individuel comme gouvernemental. À cela nous opposons plutôt la condition de « croire en » qui remplace une perspective abstraite et virtuelle par des capacités qui se développent depuis une situation concrète est vécue, depuis quelque chose qu’on habite.
CT : À l’échelle des individus, nous avons tous considéré tous avec étonnement nos déambulations angoissées dans les rayons des magasins alimentaires, masque sur le nez, à anticiper les potentielles pénuries. Pour mobiliser une opposition assez structurante, sommes-nous tous en train de nous muer en collapsonautes (envisageant un « monde d’après » basé sur un nouveau système de valeurs) en survivalistes (organisant tant bien que mal notre survie dans ce monde, sans en remettre en cause les valeurs) ?
JR : En effet, l’opposition entre « survivalistes » et « collapsonautes » peut départager une série de situations générées par la crise. Et, en effet, un travail sur la collapsologie – dont le nôtre n’est qu’un exemple – peut aider à saisir les enjeux de cette bifurcation. Notre livre, en ce sens, n’est pas un essai de collapsologie mais plutôt une étude de la collapsologie qui tente de décadrer notre manière de voir et de penser ce discours et les contextes qu’il désigne. J’ai l’impression et l’espoir que les décadrages de notre lecture du mouvement collapsologique peuvent aider à mieux nous saisir de notre présent critique.
Je pense à toute une série de propositions de réarticulation de ces théories dans notre livre qui sont aujourd’hui d’actualité : notre suggestion de lire l’effondrement à la lumière d’une perspective post-coloniale pour échapper à nos lunettes occidentales ; notre tentative de ne pas se laisser méduser par le chantage ou la libération d’un Effondrement-qui-vient pour prêter attention aux précarités déjà présentes ou encore une certaine sensibilité préconisée à la manière dont les travaux fictionnels anticipent et condensent les expériences que nous vivons (autant de chapitres de notre ouvrage). Ce sont des approches qui nous permettent de naviguer en collapsonautes à travers cette situation délicate.
Pour ce qui concerne l’opposition entre puissances collapsonautes et dérives survivalistes, j’ai l’impression qu’il faut remarquer les manières dont cette situation de pression et de choc est en train, elle-même, de décadrer notre perception et nos pratiques : pour le meilleur comme pour le pire.
Du côté du pire, donc dans les attitudes survivalistes, on pourrait ranger des phénomènes comme la réponse policière aux conditions d’urgence virale qui semble être la seule réaction aux situations de difficulté que nos sociétés peuvent rencontrer (voir le cas du terrorisme : les camionnettes Vigipirate d’hier patrouillent aujourd’hui les rues à la chasse des ceux qui transgressent le confinement) ; on réduit d’ores et déjà les droits des travailleurs sous prétexte de nécessités productives exceptionnelles et dans une perspective d’emploi plus compliquée qui pourra justifier une compétition accrue et une compression des droits individuels ; il y a aussi une guerre entre États et régions pour s’accaparer les matériaux médicaux de base ; on fantasme une souveraineté à regagner en redressant les frontières (alors que le virus nous démontre notre imprévisible dépendance qui échappe à toute maîtrise souveraine)…
En revanche, du côté du mieux, nous pouvons trouver une série de gestes et de tendances qu’on pourrait qualifier de collapsonautes, moins vouées à une survie désespérée qu’à une mutation collective : le débat renouvelé et parfois appliqué sur le revenu universel ; la mise en discussion de la propriété privée du foncier immobilier qui peut tout d’un coup être soustrait à la rente et donné aux travailleurs, aux victimes de violences et aux sans-abri dans des villes comme Paris ; la nécessité reconnue d’un partage de l’information et des résultats de recherche ainsi que des moyens financiers, au moins au niveau du continent ; une reconsidération du rapport au travail, aux modalités et aux temps où se manifestent ces angles morts en termes de superfluité ou nuisibilité ; le consensus autour de la libération massive de détenus non dangereux ; la renégociation de la question de la dette…
Le Covid-19 constitue un bouleversement puissant qui déplace et décadre notre ordre individuel et social dans des directions différentes : autant il nous rend plus capables d’assumer les défis des problèmes écologiques et de traverser des situations d’instabilité en affinant nos aptitudes collapsonautes (de transformation, de collaboration), autant il nous pousse vers des réactions « survivalistes » qui tendent à rendre nos systèmes sociaux encore plus injustes, insoutenables et raides. En habitant l’effondrement viral, prend-on des bonnes ou des mauvaises habitudes ?
CT: Si l’on laisse de côté la position des élites (« que tout change pour que rien ne change ») et celles des militants, on sent bien le poids de la contradiction entre ces deux tendances, à l’échelle des groupes comme à celle des individus : les prises de position sont souvent contradictoires, elles délivrent le pire (replis « survivaliste ») et le meilleur (mobilisations altruistes, remise en cause des valeurs du monde qui vacille).
Comment faire basculer le centre de gravité, et mobiliser cette « énergie de la peur » au service d’un autre projet de société ? Ce moment, marqué par un sentiment d’urgence et de panique, est-il propice à un tel basculement ?
JR: Je ne suis pas certain, selon une logique plutôt spinoziste, que les affects « négatifs » comme la peur ou la rage puissent constituer le ressort émancipateur et transformateur de la crise actuelle. J’ai plutôt l’impression qu’ils alimentent la perspective d’un Effondrement inéluctable tout autant qu’ils s’alimentent de celle-ci – ce qui signifie au final une désagrégation du corps social, qu’elle soit dans la logique d’une défense à tout prix (suicidaire) du statu quo ou dans la logique d’un anéantissement total du système haï.
Un aspect crucial, à mon avis, concerne plutôt les capacités de recomposer des alliances et des réseaux de relations pour le remembrement d’un corps politique que la pression actuelle est en train de désagréger – ce qui n’est pas forcément un mal, dans la mesure où cela laisse potentiellement la place à des nouvelles recompositions. À ce sujet, il faudra vérifier si le confinement exceptionnel que nous vivons nous laissera en héritage une société plus suturée, raidie et rendue docile par la peur (dont les médias anxiogènes et les dirigeants répressifs sont responsables) ou bien rendue plus ouverte, plastique et courageuse, retissée par des affects joyeux (la solidarité, l’auto-organisation…).
Il faut, en ce sens, que collectivement la majorité soit d’accord qu’elle a plus à gagner (affects positifs) dans une certaine mutation qu’à perdre (affects négatifs) : est-ce que l’effacement de la dette, le renforcement du service public ou la réduction du transport aérien seront perçu comme une conquête féconde ? Est-ce que l’obligation de travailler dans une obéissance hiérarchique, la nécessité d’utiliser un écran pour communiquer avec un autre humain ou encore la nécessité permanente de papiers d’identification et l’obligation à passer par l’oligarchie de la distribution (des supermarchés à Netflix) nous paraîtront particulièrement odieux ? Notre manière de répondre ensemble à ces questions va recomposer des structures sociales à partir de la décomposition qu’on peut observer.
Le problème se situe aussi dans un paradigme rythmique qui se construit, à la fois, sur des tendances comme celle que l’historien François Hartog appelle le « présentisme » et celle que nous appelons dans notre livre « urgentisme ». Si ces horizons temporels constituent l’horizon de notre époque, ils n’épargnent pas les pensées collapsologiques et notre situation de crise actuelle. L’idée d’un basculement soudain vers une société alternative tout comme celle d’un retour le plus rapide possible à la trajectoire d’avant se construisent sur un court terme qui, encore une fois, n’est probablement pas ni celui du changement, ni celui de l’épuisement.
Par la crise virale, entre autres, nous avons l’impression de comprendre que l’effondrement peut être un phénomène qui se propage d’une manière lente et discontinue, un effondrement « cool » – refroidi – qui doit être lu dans une perspective longue, ce qu’on appelle plutôt des « délitements ». Lorsque dans notre livre on parle d’une « remontée » vers un futur qui a été exclu autant par le fatalisme capitaliste que le fatalisme effondriste, c’est un futur qui s’ouvre surtout à moyen et long terme. Une dimension plus lente, moins urgente, que nous avons du mal à nous approprier.
Cette dimension temporelle est autant celle du réchauffement climatique – qui aujourd’hui n’est pas pris en considération, comme il ne sera désastreux que dans 30 ans, en montant petit à petit mais inexorablement – que celle des transformations qui pourront l’accompagner et en désamorcer les effets les plus dangereux. Il faut échapper à le tentation de croire à la possibilité de résoudre ces problèmes magiquement dans l’immédiat, comme le pensent les « solutionnistes » de tout bord (les solutionnistes collapsologues comme les solutionnistes de la géo-ingénierie ou ceux du gouvernement). Il faudrait être en mesure de « croire en » et d’habiter l’échelle de ces temps longs du délitement.
*
Propos recueillis par Pierre Bronstein.