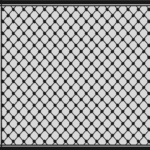Malgré le génocide, mesurer les progrès réalisés
Au moment où une formidable flottille de solidarité avec le peuple palestinien se dirige vers Gaza, comment évaluer l’effet de cette solidarité internationale qui n’a pas cessé depuis octobre 2023 ? Bien que le génocide se poursuive depuis presque deux ans et que l’armée israélienne s’apprête à occuper Gaza City, Emmanuel Dror, militant de la cause palestinienne et auteur de La fierté de Gaza (éditions Terres de Feu, à paraitre en septembre), est revenu lors des dix ans de BDS Saint-Étienne, le 7 juin 2025, sur la portée de ce mouvement, son impact et les raisons d’espérer qu’il peut susciter. Nous publions ici le texte de son intervention.
***
Depuis près de deux ans, les nouvelles quotidiennes des massacres, des crimes les plus abjects de l’armée israélienne, des tortures en prison, de la famine programmée, des destructions, des mort.es, des blessé.es, des orphelin.es, nous enragent et nous affectent profondément.
A cela s’ajoutent notre sentiment d’impuissance et de dégoût face à l’aveuglement, le silence ou la lâcheté d’une partie de la population, et face aux actions complices de nos gouvernements, malgré les injonctions des instances et des cours de justice internationales. Même si nous nous sommes mobilisé.es sans relâche, face à tant d’horreurs, nos actions nous semblent parfois dérisoires, voire totalement vaines.
S’il est compréhensible que ces constats puissent conduire au découragement, ils ne doivent pas nous empêcher de prendre du recul, et de mesurer les progrès réalisés. Ceux-ci peuvent sembler petits à court terme, mais ils sont significatifs, ils seront essentiels sur le temps long, et ils nous donnent des raisons d’espérer. Il est également important de savoir que ces victoires sont en partie les nôtres, nous peuples du monde qui avons tenté de nous élever contre nos gouvernements, pour crier notre soutien au peuple palestinien. Nous devons les analyser, et nous en inspirer pour continuer et amplifier nos mobilisations.
Voici donc sept raisons d’espérer.
1) Nous sommes majoritaires
Tous les sondages le montrent : dans le monde entier, l’écrasante majorité de la population condamne les actes barbares de l’armée israélienne, et reconnaît l’oppression injuste subie par le peuple palestinien[1].
Ces mois de lutte et de sensibilisation ont permis, notamment en France, que l’opinion publique évolue, avec par exemple la diffusion progressive du mot « génocide ». On entend régulièrement parler de telle ou telle star, tel homme politique, ou tel syndicat, qui reconnaît « enfin » que la situation à Gaza est inacceptable. Trop peu, trop tard, trop hypocrite, certes. Mais cette opinion publique aurait-elle changé si l’on ne l’avait pas travaillée au corps depuis près de deux ans ?
Contre toutes les forces réactionnaires, contre les racistes et les négationnistes, c’est nous qui avons progressivement imposé ce changement des discours « mainstream ». Et ce rapport de force finira par atteindre le cœur du pouvoir, qui alors prétendra avoir toujours condamné le génocide[2].
2) Nous sommes de plus en plus nombreux
Alors qu’en Occident, la cause palestinienne était quasiment oubliée, l’ampleur des massacres israéliens a conduit des milliers de nouveaux militant.es en colère et désireux d’agir à se joindre aux mobilisations, outré.es par les images de Gaza, par l’injustice criante, par les mensonges des médias, par l’hypocrisie et la complicité de nos gouvernants. De nouvelles générations ont découvert ou approfondi leur connaissance de la cause palestinienne, massivement portée aujourd’hui dans la jeunesse du monde.
De plus, ce soutien semble traverser les générations, les classes, et les origines. En effet, jamais autant depuis la naissance des mouvements de solidarité avec la Palestine en France, nous avions vu des personnes palestiniennes ou issues de l’immigration post-coloniale à des positions de premier plan dans les organisations et les manifestations[3]. Autre nouveauté : comme en Palestine, les trois composantes de la solidarité palestinienne – nationaliste, marxiste et religieuse – s’expriment et se côtoient en bonne intelligence.
Nous avons vu fleurir des keffiehs dans l’espace public, des drapeaux palestiniens, des affiches et des tags sur les murs de nos villes, des boucles d’oreille pastèque… Nous avons observé avec admiration la détermination décomplexée de ces néo-militant.es, malgré une importante répression, prêts à braver la police et la justice[4].
Alors qu’il y a deux ans à peine, il était difficile d’expliquer le boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions, nous voyons aujourd’hui de nombreux groupes s’emparer spontanément de campagnes de boycott de marques françaises ou américaines complices du génocide[5]. Avec le collectif Stop Arming Israel, des jeunes s’engagent même dans des compagnes plus complexes, telles que l’appel à l’embargo sur les armes[6].
Mais il faudra garder à l’esprit qu’au-delà du génocide, la décolonisation est un long processus, que les fractures sont profondes, et que le combat sera long et ingrat. Il ne faudra pas baisser les bras, même lorsque nous serons fatigués, et que nos luttes seront encore plus réprimées, diabolisées ou silenciées par le pouvoir en place.
3) Nous imposons notre narratif : tout n’a pas commencé le 7 octobre 2023
Cela n’est pas une coïncidence : la « centralité palestinienne » dans le mouvement de solidarité a permis de mieux faire connaître son narratif. Les mobilisations ont ensuite conduit à changer l’opinion publique, en imposant ce nouveau narratif commun sur la Palestine. Nous verrons que la portée de cette victoire sera énorme dans les années à venir.
En effet, depuis les accords d’Oslo en 1993, le monde avait malheureusement intégré l’idée que le « conflit israélo-arabe » était complexe, que deux peuples se disputaient un bout de terre, et qu’il s’agissait d’imposer la seule solution viable pour la paix : celle des deux États sur les frontières de 1967[7].
La séquence historique qui s’est ouverte le 7 octobre 2023 a conduit de nombreuses personnes à remettre ces mythes en question, et à chercher l’origine véritable du problème. Nous avons réussi, et ce n’est pas une mince victoire, à mettre au premier plan la nature coloniale de ce « conflit », et l’histoire du peuple palestinien avec son oppression originelle, celle de la Nakba de 1948, et de ses 800.000 Palestinien.nes expulsé.es de leurs terres. Au passage, ce véritable cours d’Histoire a permis de parler de l’idéologie sioniste, de l’occupation, du vol des terres et des ressources, du nettoyage ethnique, des réfugiés, de l’apartheid, du blocus, et aussi du droit à l’autodétermination…
A Gaza, comme dans le reste de la Palestine, c’est la Nakba qui continue, et qui ne s’est en fait jamais arrêtée depuis 77 ans[8]. Une solution juste aujourd’hui ne peut donc qu’être globale, et ce narratif a pris le pas sur celui de la recherche d’une paix tiède et sans justice.
4) From the river to the sea…
Autre narratif qui s’est imposé, et ce n’est pas un hasard : le slogan « From the river to the sea » repris dans toutes les manifestations à travers le monde, dans des paroles de chansons, et même dans un livre de coloriage pour enfants[9]. Après le cours d’histoire, le cours de géographie : on découvre que ni les frontières de 1948, ni celles de 1967 ne sont justes, et que l’État sioniste a toujours cherché à dominer, conquérir, ou asservir l’ensemble du territoire de la Palestine historique, voire ceux des pays voisins.
On doit donc rebattre les cartes et trouver une solution sur l’ensemble de cette terre, du fleuve Jourdain jusqu’à la mer Méditerranée. La question est donc posée dans des termes inédits, marquant un progrès incontestable du revendicatif palestinien dans le débat public.
5) … Palestine will be free !
L’autre changement fondamental de vocabulaire réside dans l’imposition d’un narratif autour de la « libération » de la Palestine, qui remplace celui d’une hypothétique « paix ». Crier « free, free, Palestine » plutôt que « peace now », rappelle l’enjeu fondamental de ce conflit : la Palestine aujourd’hui n’est pas libre : elle est occupée et colonisée. On parle donc de décolonisation, et d’Israël comme d’une puissance coloniale[10]. Il ne s’agit plus de faire la paix entre deux peuples qui vivent côte à côte, mais d’un peuple colonisé qui doit se libérer du joug colonial. Les imaginaires ouverts par un tel changement de paradigme sont énormes, et les parallèles avec l’Algérie ou le Vietnam, par exemple, commencent à se poser[11].
Après le cours de géographie, le cours de langues : aux côtés de slogans en français et en anglais, la centralité palestinienne dans le mouvement de solidarité a également permis de décoloniser nos pratiques en diffusant des slogans en arabe, et en apprenant à les prononcer : « Tahya Falastin » (Vive la Palestine), « Falastin horra, Israil barra » (Palestine libre, Israël dehors), « Min el mayye lel mayye, Falastin arabiyye » (D’une rive à l’autre, la Palestine est arabe), « Ghazza, Ghazza, ramz el ezza » (Gaza, Gaza, symbole de fierté)…
6) Soutien à la résistance
Si l’on parle de colonisation, on parle de décolonisation, de lutte de libération, et de résistance à l’occupation. Grâce notamment à Boussole Palestine, un collectif composé de Palestinien.nes vivant en diaspora, et d’Urgence Palestine, un mouvement organique très large qui a pris au sérieux la centralité de ces voix palestiniennes, ce mot de « résistance » a réussi à s’imposer en France contre celui de « terrorisme », du moins à gauche.
Malgré la répression massive et les menaces, ces militant.es et leurs allié.es, ont pris le risque d’aborder cette question publiquement, en parlant de soutien à la résistance palestinienne. Il aura fallu pour cela rappeler que la résistance, même armée, est autorisée par le droit international pour un peuple sous occupation[12].
Au-delà des débats autour de la résistance armée ou non-violente, recourir au mot de « résistance » réveille un imaginaire particulier, et résonne avec l’histoire de France. Certains refuseront cette comparaison, mais le débat est ouvert, et il est important de se réapproprier ce terme. Il y a résistance partout où il y a oppression, et il faudra s’en souvenir dans les années qui viennent.
7) En finir avec les mensonges
La propagande israélienne s’est massivement diffusée en France, avec pour objectif de nier les crimes commis par l’armée, ou de les justifier au prix d’une déshumanisation et d’un racisme anti-palestinien de plus en plus systématique[13].
Parmi les débats sémantiques, qui n’ont pas manqué ces derniers mois, celui concernant l’utilisation du mot « génocide » pour qualifier les atrocités commises à Gaza fut le plus médiatisé[14]. Mais les horreurs devenant de plus en plus difficiles à masquer, il n’est maintenant plus possible de continuer à décrire Israël comme la prétendue « seule démocratie du Moyen-Orient », et son armée comme la « plus morale du monde ». Plus jamais ces mensonges ne seront crédibles : voilà une bonne chose de faite.
Il en va de même de notre propre hypocrisie et de notre soutien inconditionnel à Israël. Depuis deux ans, la France et les autres nations occidentales ont activement participé au génocide, après avoir créé, justifié, financé, armé, défendu, protégé et soutenu l’État d’Israël depuis 77 ans[15]. Malgré quelques timides condamnations, rien n’est venu ébranler le soutien à l’allié israélien, et les ventes d’armes, accords économiques, et collaborations de toutes sortes, se sont poursuivis[16].
La perpétuation d’un ordre colonial dont elles profitent, en dépit du droit international et des droits humains les plus élémentaires, demeure leur boussole politique[17]. C’est la fin de l’illusion d’un contre-pouvoir, et la confirmation de la place de ces nations aux côtés d’Israël, quoi qu’il fasse et quoi qu’il en coûte. C’est également la fin pour le mouvement de solidarité de l’illusion d’une marge de manœuvre avec ces gouvernants, et la prise de conscience d’un nécessaire changement de stratégie, de partenaires, d’interlocuteurs, et d’objectifs.
En deux ans, nous avons progressé dans l’utilisation d’un nouveau vocabulaire et de nouveaux concepts dans le débat public. Aujourd’hui, malgré le soutien continu au génocide, de Paris à Tel-Aviv beaucoup commencent à parler de « la fin d’Israël »[18] : peut-être qu’il s’agit du prochain concept qui va s’imposer ? En effet, tôt ou tard, le génocide va s’arrêter, et Israël vivra avec ce crime contre l’Humanité sur la conscience, ainsi que dans la peur du prochain « 7 octobre ».
De nombreux Israéliens ne voudront plus vivre dans de telles conditions, et les États-Unis n’auront pas toujours les moyens de financer de telles guerres. Cette stratégie du « tout militaire » est donc vouée à l’échec. Depuis deux ans, Israël entraîne l’occident dans sa faillite morale et politique, et il lui sera difficile de s’en relever, au point que beaucoup décrivent son attitude actuelle comme suicidaire[19].
La seule solution durable qui pourra émerger sera celle d’une Palestine libre, de la rivière à la mer. Ce sera avant tout la victoire de la résistance palestinienne, celle de la justice, du droit, de l’humanité et de la dignité, mais nous devons y contribuer, à notre échelle, en continuant la lutte, sans relâche, partout où nous sommes, et tout le temps qu’il faudra. Tahya Falastin !
Notes
[1] Laura Silver, Most people across 24 surveyed countries have negative views of Israel and Netanyahu, Pew Research Center, 3 juin 2025.
[2] Omar El Akkad, « One Day, Everyone Will Have Always Been Against This », Canongate Books, 13 février 2025
[3] Emmanuel Riondé La solidarité avec la Palestine sur un point de bascule, Médiapart, 16 décembre 2023.
[4] François Rippe, La solidarité avec le peuple palestinien toujours plus criminalisée, AFPS, juillet 2025.
[5] Comité National du BDS Palestinien, Coca-Cola : étancher la soif des soldats génocidaires d’Israël, 27 novembre 2024.
[6] Verveine Angeli, La lutte contre le colonialisme israélien est aussi un combat syndical, Contretemps, 28 novembre 2023.
[7] Emmanuel Dror, Palestine : retour aux fondamentaux, Agence Média Palestine, mai 2023.
[8] Nada Yafi, « Nakba », le mot de l’année 2023, Orient XXI, 18 décembre 2023.
[9] Rashid Khalidi « De la mer au Jourdain », ou ce qu’Israël a imposé à la Palestine depuis 1967, Contretemps, 6 décembre 2023.
[10] Sbeih Sbeih, Sur la condition coloniale en Palestine, Contretemps, 24 juillet 2024.
[11] Hamza Hamouchene, Entre le Vietnam, l’Algérie et la Palestine : passer le flambeau de la lutte anticoloniale, Transnational Institute, 11 décembre 2024.
[12] Nassim Aissou, Du droit à la résistance des Palestiniens, Yaani, 13 juillet 2025.
[13] Houda Asal, Il est temps de parler de racisme anti-palestinien en France, Contretemps, 16 septembre 2024.
[14] Noura Erakat et John Reynolds, Cour internationale de justice : une mise en accusation dévastatrice de la guerre d’Israël contre Gaza, Contretemps, 13 janvier 2024.
[15] Emmanuel Dror La centralité de la Palestine, Médiapart, 8 août 2025.
[16] Ariane Lavrilleux, La France s’apprête à livrer des équipements pour mitrailleuses vers Israël, Disclose, 4 juin 2025.
[17] Insaf Rezagui, La Palestine, tombeau du droit international ?, Yaani, 13 juillet 2025.
[18] Jean Stern, De Tel-Aviv à Haïfa : « Tu crois que c’est la fin d’Israël ? », Orient XXI, 28 avril 2024.
[19] Jean-Paul Mari Le suicide d’Israël, Grands Reporters, 18 mai 2025.